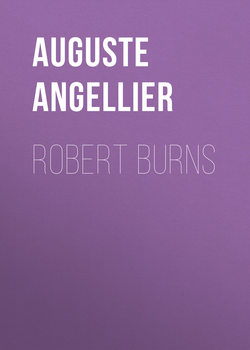Читать книгу Robert Burns - Angellier Auguste - Страница 5
CHAPITRE I
III.
LES PETITS POÈMES POPULAIRES.
LE ROI JACQUES I, LES SEMPLE DE BELTREE, HAMILTON DE GILBERTFIELD, ALLAN RAMSAY, ROBERT FERGUSSON
ОглавлениеOutre des ballades et des chansons, il y a une autre classe de poésies, toutes différentes, et cependant bien indigènes et propres à l'Écosse. Ce sont de courts poèmes comiques, qui se plaisent aux mœurs populaires, et représentent généralement des scènes rustiques, des fêtes de village, les mœurs et les plaisirs des paysans. Ces petits tableaux sont traités avec un sentiment de réalisme très net et très exact, pleins d'humour, de mouvement et de gaîté narquoise151. Leur forme est particulière. Ils sont écrits en une sorte de stance lyrique152, terminée par un refrain qui est le même à travers tout le morceau. L'effort du poète consiste précisément à ramener ce refrain à la fin de chaque strophe, par un tour à la fois ingénieux et naturel. Quand la pièce compte une trentaine de strophes, comme cela est fréquent, on comprend qu'il y ait quelque difficulté et quelque mérite à les boucler toutes de la même boucle, en conservant l'aisance et la marche du récit. C'est un exercice auquel Burns a excellé dès le début, et ses premiers poèmes contiennent des modèles de ce tour de force. Dans cette classe, on peut comprendre des épîtres familières, conçues dans le même esprit, écrites dans une forme analogue, et nourries de la même observation moyenne, nette et railleuse.
Tandis que la poésie orale est, en grande partie, anonyme, ces poèmes portent presque tous le nom de leurs auteurs. Ils sont peu nombreux, et disparaissent, si on n'y regarde pas avec soin, sous la masse des ballades et des chansons. Il importe cependant de les en dégager et de les étudier, car ils contiennent une portion de l'esprit écossais, et ils expliquent la forme d'une partie considérable des œuvres de Burns.
Chose singulière, les deux premiers de ces poèmes populaires sont attribués à Jacques I, le roi poète, peut-être le monarque le plus remarquable qu'ait eu l'Écosse. Sa vie fut romanesque, glorieuse et infortunée. Son père Robert III, pour le soustraire aux attentats du duc d'Albany que cet enfant séparait seul du trône, l'avait envoyé en France, à l'âge de quatorze ans. La nef qui l'emportait avait été interceptée par les Anglais, au mépris d'une trêve qui existait entre les deux nations. Pendant dix-neuf ans le jeune prince fut retenu prisonnier153. Il fut élevé à la cour d'Angleterre, où il apprit à admirer Gower, et Chaucer, son maître en poésie noble et amoureuse. Le donjon de Windsor a conservé son souvenir. C'est là qu'un matin de mai, quand l'herbe était verte, que les haies d'aubépine étaient blanches et toutes sonores d'oiseaux, il aperçut Lady Jane de Beaufort, fille du comte de Somerset et princesse du sang royal d'Angleterre154. Il a raconté en termes brillants et tendres comment, quand il était à songer à son triste sort, il vit passer, dans la fleur de l'année, parmi les fleurs, cette fleur des femmes.
Et alors j'abaissai de nouveau mon regard,
Et je vis se promener au pied de la tour,
Toute solitaire, nouvellement arrivée pour se distraire,
La plus belle ou la plus fraîche jeune fleur
Que j'eusse jamais vue, me sembla-t-il, avant cette heure.
De cette surprise soudaine, tout d'un coup reflua
Le sang de tout mon corps vers mon cœur.
Je décrirai la forme de ses vêtements,
Jusqu'à sa chevelure d'or et sa riche parure;
Ils étaient semés de dessins de perles blanches
Et de topazes brillant comme le feu,
Avec mainte émeraude et maint beau saphir.
Sur sa tête elle portait une coiffure de couleurs fraîches,
De plumes en partie rouges, et blanches et bleues…
Autour de son col blanc comme un émail,
Elle avait une belle chaîne de fine orfévrerie,
À laquelle pendait un rubis sans tache,
Dont la forme était celle d'un cœur,
Qui comme une étincelle de flamme follement
Semblait vouloir brûler sur sa gorge blanche.
Si on pouvait trouver le pareil, Dieu le sait.
Et pour marcher dans ce frais matin de mai,
Elle avait sur sa robe blanche une agrafe
Dont on n'avait jamais vu la plus belle,
Je le suppose; et sa robe pressait lâchement son corps,
Et la marche l'avait entr'ouverte; c'était un tel délice
De voir cette jeunesse dans sa beauté
Que j'ai peur d'en parler trop lourdement155.
Il écrivit, en l'honneur de sa dame, Le Carnet du Roi, un joli poème amoureux, où il raconte comment naquit sa passion, et qui, pour le luxe des descriptions, la révérence envers la femme, un sentiment de fraîcheur printanière, et je ne sais quelle jeunesse et clarté des mots, n'est pas loin de Chaucer156.
Cependant le duc d'Albany, qui avait été nommé régent à la mort de Robert III, était mort lui-même. L'Écosse était sans gouvernement. Henri V consentit à relâcher son prisonnier. Avant son départ, Jacques épousa la jeune fille dont la vision avait consolé son exil. Il rentra dans son royaume en 1423, et fut couronné solennellement dans l'église de l'Abbaye de Scone157. Ce jeune homme, qui avait commencé la vie en artiste, se trouva être un grand roi; ce rêveur avait une énergie rapide et inflexible. Il trouva le pays dans le chaos, les nobles indépendants, le peuple en désarroi, le brigandage et l'anarchie partout. «Si Dieu me prête vie, dit-il en entrant sur son sol, il n'y aura pas un endroit dans mon royaume, où la clef ne gardera pas le château, et la touffe de genêt la vache, quand je devrais mener la vie d'un chien pour l'accomplir158». La répression fut terrible: la famille d'Albany fut détruite; il défendit aux nobles de voyager avec une suite trop nombreuse; confisqua les biens de ceux qui résistaient. Un jour il fit pendre trois cents brigands; tout chef rebelle était exécuté sur le champ. Son activité était infatigable; sa vigilance s'étendait à tout. Il promulgua des lois sur les pêcheries, sur les impôts, contre la simonie, sur les mendiants, des lois somptuaires. Il encouragea le commerce. On a de lui une loi qui ordonnait aux propriétaires d'arbres de détruire les nids de corbeaux, à cause des dégâts que ces oiseaux causent aux blés. Tout arbre, sur lequel un nid de corbeaux était encore trouvé le deux du mois de mai, était abattu et confisqué159. Pendant quinze ans, il travailla sans relâche à rendre à son peuple l'ordre et la paix. Il avait peut-être mené trop rudement les choses, avec des idées trop anglaises, sans tenir assez compte de l'état du pays. Les nobles résolurent de se délivrer de cette main de fer qui les écrasait. Une conspiration s'ourdit. Elle éclata dans une scène qui est une des plus épouvantables que contiennent les annales d'Écosse, riches pourtant en tragédies de ce genre. Pendant que le roi était à Perth, les conjurés pénétrèrent la nuit dans le château. Les verrous de la chambre royale avaient été enlevés par une main traîtresse. Quand on entendit les pas des meurtriers, le roi était seul, sans armes, avec la reine et les dames de la suite. Une d'elles, Catherine Douglas, essaya héroïquement d'arrêter les assassins, en mettant son bras en guise de barre à travers la porte. Le bras fut brisé; la chambre envahie par une bande de furibonds. Jacques I découvert dans une cachette sous le plancher fut massacré160.
C'est de cette vie royale, éclose dans une idylle et close par une tragédie, dépensée aux hautes besognes de la guerre et des lois, que sont sortis, semble-t-il, les deux premiers poèmes populaires, et l'exemple de l'observation grotesque appliquée à la vie vulgaire. On explique cette anomalie en se rappelant que Jacques aimait à se mêler au peuple, afin de se rendre compte de ses besoins161. Ces deux poèmes, dont l'un s'appelle À la Fête de Peebles, et l'autre À Christ's Kirk sur le pré, sont à peu près identiques de sujet. Ce sont des descriptions de journées de fête rustique, avec leurs joyeusetés, leurs lourdes farces, et leurs querelles. Dans les deux, on voit les gens se réunir, le matin, suivre les routes pour aller au lieu désigné; le milieu de la journée est longuement décrit; le départ occupe les dernières strophes. Il y a seulement entre les deux poèmes une différence de tonalité: le premier est de couleurs plus claires et plus gaies, le second d'une teinte un peu plus sombre et d'une touche plus rude.
La pièce À la Fête de Peebles s'ouvre gaîment par l'agitation matinale, dans tous les petits villages, des gens qui se préparent à venir à la fête.
Le premier mai, quand tout le monde s'apprête
Pour la fête de Peebles,
Pour aller entendre les chants et la musique,
Doux confort, à dire vrai,
Par rivière et forêt ils arrivèrent.
Ils s'étaient faits très beaux,
Dieu sait qu'ils n'y auraient pas manqué,
Car c'était leur jour de fête,
Disaient-ils,
À la fête de Peebles.
Toutes les filles de l'ouest
Étaient debout avant le chant du coq;
L'émoi empêchait de dormir
Et les préparatifs et la joie;
L'une dit: «Mes mouchoirs ne sont pas pliés»
Et Meg, toute en colère, répondit:
«Il vaut mieux prendre une capeline».
«Par l'âme de Dieu, c'est vrai»,
Dit l'autre,
À la fête de Peebles162.
De tous les villages des environs, de Hope, de Kailzie, et de Cardronow, ils arrivent par bandes, en chantant des refrains de vieilles chansons, conduits par des cornemusiers. Il y a, sur la route, des rencontres où les gars plaisantent les filles, avec des plaisanteries de paysans. Un groupe arrive à la ville et s'en va à la taverne. La scène est vivante et jolie.
Ils s'en vont à la maison de taverne,
D'un pas gai et dispos.
L'un parla en mots très dégagés:
«En voilà assez de malechance,
Relevez les feuillets de la table, (et il aida à le faire),
Nous sommes tous à attendre;
Veillez à ce que le linge soit blanc,
Car nous allons dîner, puis danser,
Là-dehors,
À la fête de Peebles».
À mesure que l'hôtesse apportait un plat,
L'un d'entre eux faisait une marque sur le mur.
L'un disait de payer, un autre disait: «Non,
Attendez que nous fassions le compte».
Et l'hôtesse disait: «N'ayez crainte,
Vous ne paierez que ce que vous devez».
Un jeune gars se dressa sur ses pieds,
Et commença à rire,
En raillerie,
À la fête de Peebles.
Il prit un plat de bois dans sa main,
Et il se mit à compter:
«C'est deux pence et demi par tête,
C'est ce que nous payons toujours».
Un autre se dressa sur ses pieds
Et dit: «Tu es trop bête,
Pour prendre cet office-là en main;
Par Dieu, tu mérites bien une torgniole
De moi
À la fête de Peebles.163»
«Une torgniole, s'écrie l'autre, tu ne l'oserais pas». Et là-dessus ils font mine de se quereller, de se battre, ils se bousculent, et en profitent pour déguerpir sans rien payer. On dirait une des Repeues Franches de Villon, et racontée d'un style qui n'est pas loin du sien. Après quelques autres péripéties les choses se calment, et l'on est à la danse.
Alors, Will Swain arriva tout suant,
C'était un gros homme, un meunier;
«Si je peux danser, vous allez voir, allons vite,
Donnez-moi un air de cornemuse;
Je vais commencer la danse du Montreur d'ours,
Je suis sûr qu'elle va marcher.»
Lourdement il se démène çà et là.
Seigneur! comme ils accoururent pour le voir,
Cette fois-là,
À la fête de Peebles.
Ils s'assemblèrent tous de la ville,
Et s'approchèrent tous de lui;
L'un demanda qu'on fît place aux danseurs,
Car Will Swain fait des merveilles.
Toutes les filles crièrent: «Ah! ah!»
Et, Seigneur! Will Young se mit à rire.
«Allons, commères, allons-nous en,
Nous avons dansé assez
Pour une fois
À la fête de Peebles164».
On se prépare à s'en retourner. Personne n'a l'air de songer au pauvre souffleur de cornemuse, qui s'est fatigué toute la journée et réclame son dû.
Le cornemusier dit: «Je commence
À être fatigué de jouer pour vous;
Et on ne m'a encore rien donné
Pour tous les airs que j'ai joués;
Trois sous pour un demi jour,
Cela ne vous ruinera pas;
Mais si vous ne me donnez rien du tout,
Que le grand Diable vous accompagne,»
Dit-il,
À la fête de Peebles165.
L'heure du départ arrive. Les gars et les filles se disent adieu, tout tristes de se quitter et se promettent de se revoir. Chacun s'en va de son côté.
Le sujet de À Christ's Kirk sur le pré est également la peinture d'une fête rustique, mais dans un autre ton. Sauf le début où se trouve une riante arrivée de jeunes filles qui viennent danser dans leurs robes neuves, la pièce tout entière est le récit d'une bataille entre paysans. Il n'y a pas de tableau plus exact d'une de ces bagarres qui éclatent souvent à la fin des fêtes villageoises. Cela commence par une querelle à la danse: on se bouscule, on se bourre, on se brutalise, on se menace, on saisit les arcs, quelques flèches volent, et voilà la bagarre lancée. Elle se répand et tourbillonne. Il y a là une suite de strophes pleines de tumulte, de coups, de clameurs, d'un entrain superbe. En un clin d'œil, toute une populace se rue dans la querelle. Ils arrivent de tous côtés, à folles enjambées, accourent se faire casser la tête; ils ont des bâtons, des fourches et des fléaux; ils frappent à tort et à travers, les gourdins s'abattent sur les échines, les coups tintent sur les crânes, les barbes sont pleines de sang, les corps jonchent le sol; deux bergers se battent à coups de tête et se cossent comme des béliers; d'autres vont chercher le brancard d'une charrette et poussent dans le tas, frappant aux figures et défonçant les dents; les femmes sortent, accourent, piaillent, glapissent, se précipitent dans les bousculades; les enfants les y suivent; toute cette cohue se cogne, s'étreint, s'arrache, se buche, trébuche, roule, grouille, s'entasse, s'écrase, dans une trépignée générale. Le tocsin sonne si fort que le clocher en balance. Et tout d'un coup, sans qu'on sache ni comment, ni pourquoi, la fureur tombe, la bataille s'arrête, les gens éreintés se calment, se regardent, ahuris et penauds de s'être entre-tués. C'est une peinture vigoureuse et pourtant comique d'une de ces folies de coups qui s'emparent des foules, à la fin des foires et des marchés. Pendant quelques instants, une frénésie de combat affole cette tourbe; c'est la décharge de nerfs grossiers surexcités par une journée de fête166.
Ce sont deux jolis morceaux, pleins déjà de toutes les qualités qui marquent cette branche de la poésie écossaise. Ils sont lestes, solides, nerveux, solidement appuyés sur la vie, avec le sens d'un grotesque de proportions moyennes qui tient le milieu entre l'observation et la caricature167. Ce sont deux tableaux flamands. Non pas des Téniers, ils n'en ont ni la touche lumineuse et légère, ni les couleurs claires, gaies, se jouant dans une harmonie argentée. Ils sont plus frustes, d'un pinceau moins souple, mais plus vigoureux. On les comparerait volontiers aux tableaux du vieux Pierre Breughel. Il recherchait lui aussi les foires et les kermesses, les scènes de gaîté naïve, semées d'ivrognes trébuchants, et de couples qui dansent. Il les a représentés, du premier coup, avec une bonne humeur primesautière, un entrain et une solidité d'observation, que nul de ses successeurs n'a dépassés. On le surnomma pour cette raison Breughel le Drôle, Breughel le Jovial, et le Breughel des Paysans. Il est le Maître de tout le réalisme flamand. L'auteur de À la fête de Peebles et de À Christ's Kirk sur le pré a droit à la même place dans l'histoire de la poésie écossaise. Allan Ramsay aura un coloris plus léger et plus vif, mais il a moins de force et d'observation. Fergusson aura plus de précision et une notation plus minutieuse des détails, avec moins de mouvement et de gaîté. Burns seul lui sera supérieur.
Outre leurs qualités, ces deux pièces sont intéressantes parce qu'elles ont servi de modèle à beaucoup de ces petits poèmes écossais. Leur cadre a été conservé: l'arrivée le matin sur les routes, les descriptions de la journée, puis le retour des couples le soir, avec quelques plaisanteries appropriées. C'est le plan de la Foire de la Toussaint et des Courses de Leith de Fergusson; c'est exactement celui de la Foire-Sainte de Burns. On a souvent dit que ce poème était imité des Courses de Leith. C'est plus haut qu'il convient de remonter, car la pièce de Fergusson est elle-même calquée sur les deux vieux poèmes.
Ils ont de plus fourni la strophe dans laquelle, avec de légers changements, toute cette suite de tableaux est écrite. C'est une strophe de dix vers: les huit premiers sont des vers de quatre pieds et de trois pieds, alternés; les vers de quatre pieds riment entre eux, et ceux de trois entre eux aussi; le neuvième vers ne compte qu'un pied, il ne rime pas, il sert à détacher le refrain de la strophe et à le faire claquer à part. Ce refrain a trois pieds dans À la Fête de Peebles, et quatre dans À Christ's Kirk sur le pré; il ne rime pas, mais il est le même à travers tout le morceau. Voici à peu près l'effet de cette strophe, d'après une de celles de À Christ's Kirk sur le pré; c'est une imitation qui n'a aucune prétention à l'exactitude.
Le grand Hugh saisit son bâton,
Et va dans la bagarre;
Il tape dans le peloton,
Criant qu'on se sépare;
Fol qui se mêle en hanneton
À pareil tintamarre;
Quand il eut reçu son horion,
Alors il cria: «Gare!
Je meurs!»
À Christ's Kirk sur l'herbe du pré168.
Allan Ramsay, dans la continuation qu'il donna de ce poème, employa la même strophe avec un léger changement. Il fit disparaître le dixième vers et transporta le refrain au neuvième, qu'il allongea d'un pied. Mais il conserva les deux rimes pour les huit premiers. Voici un exemple de cette strophe ainsi modifiée:
À l'est du ciel, l'aube clignote,
Et les coqs de chanter;
Le fermier ouvre l'œil et rote,
Commence à s'étirer;
La fermière se lève et trotte,
Et commence à crier;
Les gars sautent sur leur culotte,
Et les chiens d'aboyer,
Ce matin-là169.
La strophe de Fergusson diffère encore un peu plus de la strophe initiale. Elle n'a elle aussi que neuf vers. Les huit premiers sont également de quatre et de trois pieds alternés. Les vers de quatre pieds riment entre eux, et ceux de trois entre eux également, mais, au lieu des deux rimes uniques qui maintiennent toute la strophe, il y en a quatre, en sorte que la strophe est en réalité coupée en deux. Le petit vers d'un pied est supprimé, et le refrain le remplace, raccourci, car il n'a généralement que deux pieds.
Le rustaud John, en bonnet bleu,
En habits du dimanche,
Court après Meg ainsi qu'au feu,
Et baise sa peau blanche;
Elle, narquoise, dit «Vilain!
Garde pour toi ta bouche.»
Il comprend, quelques sols en main
La rendent moins farouche,
Pour ce jour-là170.
C'est de cette strophe-ci que Burns fit usage. On en trouvera plus loin un exemple tiré de lui. Celle de James I nous semble supérieure; elle est plus savante, plus difficile, mieux ramassée, et elle lance le refrain avec plus de nerf, après le petit arrêt. Mais c'est en somme la même forme et la même allure, courte et rapide. Enfin les deux vieux poèmes ont transmis à ceux qui les ont suivis quelque chose de plus subtil et de plus précieux, leur esprit d'observation exacte, leur gaîté, leur ironie, leur franchise de touche, leur besoin de mouvement et d'action, leur goût de terroir. Ces deux pièces sont donc importantes. Elles sont le point de départ et le modèle de toute une série de poèmes populaires qui aboutissent aux chefs-d'œuvre de Burns, et dont la filiation se suit très bien.
En dépit de l'autorité de M. Veitch, il ne nous semble pas que cette filiation s'établisse d'aucune façon à travers les deux poèmes intitulés: Les Trois contes des Trois prêtres de Peebles, et Les Frères de Berwick171. Ceux-ci ne ressemblent aux pièces que nous avons vues, ni par le choix du sujet rustique et purement écossais, ni par le vers court-vêtu et leste, ni par l'élan lyrique de la strophe, ni par la promptitude et l'allure du récit. Ce sont des histoires étendues et diffuses, se traînant péniblement en vers de dix pieds, sans strophes, de longs fabliaux à la façon du Moyen-Âge, avec digressions morales, satires contre le clergé et allégories172. Le premier raconte un mauvais tour joué par un clerc à un prêtre. Le second se compose de trois histoires morales que trois prêtres de Peebles se racontent, pour se faire mutuellement plaisir. Dans la première de ces histoires, un roi, dans son Parlement assemblé, propose aux trois états trois questions: Pourquoi la famille d'un riche bourgeois ne prospère jamais jusqu'à la troisième génération? Pourquoi les nobles actuels sont-ils tellement dégénérés de leurs ancêtres? Pourquoi le clergé n'est-il plus doué du pouvoir de faire des miracles? On voit toute la distance qu'il y a de ces lentes productions «à tendance morale173» aux joyeux petits poèmes écossais.
C'est par ailleurs qu'il faut aller pour suivre ce filon de poésie nationale. On sent qu'il se prolonge sous le sol. Çà et là des affleurements le trahissent. Si nous avions à indiquer les traces qui en marquent la continuité et la direction, nous choisirions la pièce de Dunbar Aux marchands d'Édimbourg qui fait penser aux pièces citadines de Fergusson; nous prendrions surtout les deux pièces anonymes intitulées Le Mariage de Jok et Jynny, et La Femme d'Auchtermuchty174. Dans la première, la mère de Jynny énumère à Jok ce que sa fille lui apportera en mariage, et Jok déroule devant la mère de Jynny ce qu'il apporte de son côté. C'est un long inventaire burlesque des deux apports qui, mis ensemble, ne montent pas à beaucoup plus que rien. La drôlerie gît dans la longueur de l'interminable énumération, coupée par le refrain où les noms de Jynny et Jok reviennent accouplés, et claquent l'un contre l'autre comme en de rudes baisers rustiques. La femme d'Auchtermuchty raconte la querelle d'un laboureur avec sa femme.
À Auchtermuchty, vivait un homme,
Un mari, à ce qu'on m'a dit,
Qui savait bien boire à un pot,
Et n'aimait ni la faim ni le froid.
Il arriva qu'une fois, un jour,
Il conduisit la charrue dans la plaine,
Si cela est vrai, à ce qu'on m'a dit,
Le jour était mauvais par vent et pluie175.
Quand il rentre chez lui le soir, mouillé et glacé, il trouve sa femme assise au coin du feu. Rien n'est prêt pour lui ni ses bêtes; pas d'avoine pour son cheval, pas de foin ni de paille pour son bœuf. Il entre en colère et dit que les choses iraient bien mieux si elles étaient réglées par lui. La commère le prend au mot.
Dit-il: «où est le grain de mes chevaux?
Mon bœuf n'a ni foin, ni paille,
Femme, tu iras à la charrue, demain,
Je serai ménagère, si cela se peut».
«Époux, dit-elle, je veux bien
Prendre mon jour de charrue,
Pourvu que tu veilles aux veaux et vaches,
Et à toute la maison, dedans et dehors.»
La pièce est le récit de toutes les maladresses qu'il commet. Il trébuche à chaque pas dans quelque mésaventure. Il lâche les oisons qui s'en vont à sept, un milan s'abat qui en mange cinq. Aux cris des oisons, il accourt; pendant ce temps les veaux s'échappent. Il se met à la baratte et bat le beurre jusqu'à en suer; quand il s'est démené une heure, du diable s'il y a une miette de beurre; il a si bien échauffé le lait que celui-ci ne veut plus se cailler. Il met le pot sur le feu, puis il prend deux brocs pour aller chercher l'eau, quand il revient le pot est brûlé. Il court aux enfants; ils sont barbouillés jusqu'aux yeux; il veut aller laver ses draps, le ruisseau les emporte. Si bien que, le soir, il demande pardon à sa femme, confus, humilié, découragé, rompu.
Dit-il: «j'abandonne mon office
Pour le reste de mes jours,
Car je mettrais la maison à la côte,
Si j'étais vingt jours ménagère…»
Dit-elle: «tu peux bien garder la place,
Car bien sûr je ne la reprendrai pas»;
Dit-il: «le démon saisisse ta face menteuse,
Tu seras bien contente de la ravoir.»
Alors elle empoigna un gros bâton,
Et le brave homme fit un pas vers la porte,
Dit-il: «Femme je me tairai,
Car si on se bat j'aurai mon affaire.»
Dit-il: «Quand j'abandonnai ma charrue,
Je m'abandonnai moi-même.
Je vais retourner à ma charrue,
Car cette maison et moi nous ne nous entendrons jamais.176»
La donnée de cette pièce est un peu enfantine sans doute; il est difficile en outre de ne pas y discerner je ne sais quel arrière-goût d'origine étrangère. On dirait plutôt le sujet goguenard d'un fabliau français. Mais les détails sont écossais jusqu'au moindre. Bien que les strophes n'aient pas de refrain, elles conservent cependant l'allure légère et lyrique de ces petits poèmes.
Pendant le XVIIe siècle, cette branche de poésie fleurit et se développa singulièrement dans une même famille de propriétaires, fermiers du Renfrewshire, les Semple de Beltree. Le premier d'entre eux, Sir James Semple, est l'auteur d'un long poème satirique contre la papauté, intitulé Un cure-dent pour le Pape ou le Pater noster du Colporteur; c'est une longue discussion théologique, en forme de dialogue entre un colporteur et un prêtre. Elle ne relève pas du genre qui nous occupe. C'est un pamphlet religieux en vers177. Mais le fils de Sir James, Robert Semple de Beltree, qui naquit vers 1599 et mourut vers 1670, est un personnage important dans la poésie populaire écossaise. Il l'est pour deux motifs.
Le premier, c'est qu'il a donné le modèle de ces fausses élégies qui feignent de déplorer la mort d'une personne encore vivante, ou dont la mort est trop lointaine ou trop indifférente pour causer un vrai chagrin. C'est une parodie de lamentation, où, sur un ton moitié attendri, moitié railleur, les qualités et les défauts du défunt sont rappelés avec bonne humeur. C'est, en plus grand et avec une forme lyrique, ce que sont les épitaphes qui tournent à l'épigramme. Mais tandis que celles-ci, à cause de leur forme brève et brutale d'inscriptions, sont souvent cruelles, ces oraisons funèbres burlesques fournissent à la pensée assez d'espace pour que le rire et l'émotion s'y mêlent, s'y poursuivent et s'y jouent. Il est superflu de dire qu'on ne revendique pas pour Robert Semple l'honneur d'avoir inventé cette forme littéraire, mais le mérite, tout local, de l'avoir introduite dans la littérature de son pays. Il faut y ajouter celui de lui avoir donné d'emblée les qualités qui en ont fait une spécialité écossaise: la bonhomie, la familiarité, l'émotion railleuse, et une forte observation locale dont la saveur pénètre tout. Cela fait penser à ces gâteaux écossais faits de farine d'avoine où, malgré les ingrédients étrangers, domine toujours le goût du sol.
L'élégie de Robert Semple gémit sur le trépas d'un de ces joueurs de cornemuse, alors répandus dans le pays, qui vivait dans le petit hameau de Kilbarchan. Elle est connue, pour cette raison, sous le nom de Le Cornemusier de Kilbarchan. Pour quiconque a vu un cornemusier se promener, un jour de fête, avec sa cornemuse pavoisée de petits drapeaux, le titre seul est un tableau.
Ceci est l'épitaphe de Habbie Simson,
Qui, sur son bourdon, portait de jolis drapeaux.
Ses joues devenaient rouges comme cramoisi,
Et il se démenait quand il soufflait dans sa peau.
C'est, comme on peut le prévoir, l'éloge des qualités et des talents professionnels du défunt, et l'énumération de ce que les Foires, les Mariages, les Fêtes perdent à ne plus l'avoir. C'est l'œuvre d'un esprit facile, élégant, mais dont la verve et la sève sont bien moins riches que celles de l'auteur de À la Fête de Peebles.
Aux représentations, quand il arrivait,
Sa cornemuse accompagnait lestement le tambour,
Comme des essaims d'abeilles, il la faisait bourdonner,
Et il accordait son chalumeau.
Maintenant tous nos cornemusiers peuvent être muets,
Puisque Habbie est mort.
Et aux courses de chevaux maintefois,
Devant le noir, le bai, le gris-pommelé,
Comme sa cornemuse, quand il jouait,
Piaillait et piaulait,
Maintenant ces passe-temps sont bien loin,
Puisque Habbie est mort.
La pièce se termine par un joli trait, à moitié pittoresque et à moitié mélancolique.
Quand il jouait, les enfants s'attroupaient,
Quand il parlait, le vieux, il balbutiait;
Les dimanches, son bonnet avait une plume,
Bel ornement;
Il attachait sa jument dans le cimetière,
Où il repose mort.
Hélas! pour lui mon cœur est navré,
Car j'ai eu ma part de ses airs de danse,
Aux Jeux, aux Courses, aux Fêtes, aux Foires,
Sans malice, ni envie.
N'espérons plus des airs de cornemuse,
Puisque Habbie est mort.178
Cette pièce a donné lieu à un grand nombre d'imitations, et l'élégie comique est, dès lors, devenue un genre favori des poètes écossais. Ramsay a écrit l'Élégie de Maggy Johnstoun, une cabaretière qui vendait une petite bière blanche, claire et grisante, dans une ferme aux abords d'Édimbourg; l'Élégie de John Cowper, le greffier du trésorier de la paroisse; l'Élégie de Lucky Wood, une autre cabaretière, dont la personne et la maison étaient nettes et honnêtes; l'Élégie de Patie Birnie, violoneux, pure transcription du Cornemusier. Fergusson a écrit l'Élégie de David Gregory, professeur de mathématiques à l'Université de Saint-Andrews; l'Élégie de John Hogg, portier de ladite Université; et même l'Élégie de la Musique Écossaise, qui est sa meilleure. C'est en continuant dans cette voie que Burns a écrit son Élégie de Tam Samson, joyeux compagnon, grand pêcheur, grand chasseur et grand joueur de curling. Il a employé exactement le même cadre. Mais, ici comme ailleurs, il y a mis un tableau brossé avec une autre vigueur de main. L'élégie de Robert Semple, gracieuse et distinguée, est un peu mince; celles de Ramsay, naturelles et gaies, manquent de force; celles de Fergusson sont, à nos yeux, froides et ternes. Celle de Burns les laisse toutes en arrière, par le mouvement, la vie, et l'entassement de pensées, de visions, de motifs poétiques, qui font paraître les autres pièces creuses à côté de la sienne.
Le second titre de Robert Semple à la position qu'il occupe dans la poésie de sa contrée, c'est que, pour traiter un sujet nouveau, il a, selon toute apparence, inventé une strophe nouvelle179. Tout au moins, il a employé une strophe qu'on ne retrouve pas au delà de lui. Ce n'est plus la strophe à huit vers de À la Fête de Peebles, la strophe régulière, adaptée aux récits et aux descriptions. C'est une strophe plus courte, plus alerte, avec des mouvements et des flexibilités intérieures. Elle se compose de trois vers de quatre pieds qui riment ensemble, d'un vers de deux pieds de rime différente, d'un vers de quatre pieds qui rime avec les trois premiers, et d'un autre de deux pieds qui rime avec son compagnon. En voici le modèle français calqué sur la première strophe de la Vision de Burns.
Le soleil clôt un jour sauvage,
Les curlers rentrent au village,
Et le lièvre affamé s'engage
Dans les vergers,
Où la neige marque, au passage,
Ses bonds légers180.
On peut la comparer avec l'autre strophe, dont la copie suivante, d'après le début de la Sainte-Foire de Burns, peut donner l'idée.
Un matin d'été calme et pur,
Un dimanche, à ma guise,
Je sortis pour voir le blé mûr
Et respirer la brise.
Le soleil semait de rayons
Les campagnes muettes;
Les lièvres couraient les sillons,
L'air chantait d'alouettes,
En ce jour-là181.
Tandis que l'ancienne strophe, sous le long manteau à plis droits des huit vers uniformes, s'avance tout d'une pièce, sans détails dans la marche, la strophe nouvelle, prise à la taille et retroussée, est plus vive et plus preste. Elle est plus souple, elle saute aisément d'un sentiment à l'autre. Sa fortune a été rapide et grande dans la littérature écossaise. Elle remplit une partie de l'œuvre d'Allan Ramsay et la majeure partie de celle de Fergusson. Elle convenait particulièrement au génie nerveux, agile et rapide de Burns. Il l'a employée dans une quantité de pièces de sa meilleure époque: l'Élégie de la Brebis Mailie, la Mort et le Docteur Hornbook, les Deux Pasteurs ou la Sainte-Querelle, la Prière de Saint Willie, l'Adresse au Diable, la Vision, l'Élégie de Tam Samson, ses pièces à une Marguerite et à une Souris, l'Adresse du Fermier à sa vieille Jument, et dans une foule d'autres morceaux; toutes ses épîtres importantes sont écrites dans cette strophe. On peut dire qu'elle a servi à un grand tiers de son œuvre.
Aussi, en ces récentes années, les Écossais ont proclamé ce que leur littérature doit à l'Élégie de Robert Semple, en plaçant au fronton de l'école paroissiale de Kilbarchan le buste du vieux joueur de cornemuse182. Un autre service que Robert Semple rendit à la poésie écossaise fut d'avoir son fils Francis Semple, le troisième de cette famille de poètes. Il a laissé quelques-uns des modèles les plus humoristiques du genre de poésies que nous retraçons. Ses Joyeuses fiançailles sont une description de mariage rustique à la manière du Mariage de Jok et Jynny, mais avec plus de mouvement et de verve comique. Il retrouva la gaîté robuste qui enlève les strophes de Jacques I.183
Ce tableau des formes que s'est successivement créées la poésie écossaise et dans lesquelles elle s'est développée, ne serait pas complet si l'on omettait celles dont l'a enrichie William Hamilton de Gilbertfield. C'était un ancien lieutenant de l'armée, retiré à la campagne, où il se distrayait par des essais littéraires. Sa réputation est fondée sur deux choses.
Il a appliqué la strophe de Francis Semple à l'épître familière, pour laquelle elle paraît faite spécialement, se prêtant à l'allure libre d'une causerie. Il adressa, sous cette forme, à Allan Ramsay, une lettre d'admiration, quelque chose comme la lettre de Lamartine à Byron, ou de Musset à Lamartine, sauf qu'ici l'admiration vient d'un homme plus âgé, s'en va pédestrement, en gros bas de laine, et parle patois. Il en résulta, entre les deux poètes, un échange d'épîtres plaisantes et cordiales184. La mode s'en est répandue après eux parmi les poètes écossais, et l'épître familière a pris chez eux l'importance d'un genre littéraire. Il s'en trouve dans Fergusson. C'est d'après cette tradition que Burns a écrit sa première Épître à Lapraik qu'il ne connaissait que pour avoir entendu chanter une de ses chansons. C'est ainsi qu'il reçut à son tour une épître de Willie Simpson, poète et maître d'école à Ochiltree, à laquelle il répondit, comme Ramsay avait répondu à Gilbertfield. C'est à cette occasion qu'ont été écrites presque toutes ses épîtres, les plus considérables tout au moins, et celles qui contiennent le plus de renseignements sur sa vie.
Le second titre de Gilbertfield à l'attention est un poème intitulé Les dernières paroles mourantes du brave Heck, un lévrier fameux dans le comté de Fife. Un pauvre chien, qu'on va pendre parce qu'il est vieux, se remémore avec tristesse les jours où il était souple et rapide; il se rappelle les poursuites ardentes après les lièvres pendant des journées entières. Il y a, dans son étonnement d'être maintenant condamné et dans sa résignation, quelque chose de navrant, comme les regards doux et soumis que les chiens adressent à leur maître alors même qu'il les assomme.
Sur le Moor du Roi, sur la plaine de Kelly,
Où de bons forts lièvres détalent roide,
Si habilement je bondissais
Avec fond et vitesse;
Je gagnais la partie, avant eux tous,
Net et clair.
Je courais aussi bien par tous terrains,
Oui, même parmi les rocs d'Ardry,
J'attrapais les lièvres par les fesses
Ou par le cou,
Là où rien ne les atteignait que les fusils
Ou le brave Heck.
J'étais rusé, fin et finaud,
Avec mon vieux malin camarade Pash,
Personne n'aurait pu nous payer avec de l'argent,
À quelques égards;
Ne sont-ils pas damnablement durs
Ceux qui pendent le pauvre Heck?
J'étais un chien dur et hardi,
Bien que je grisonne, je ne suis pas vieux;
Quelqu'un peut-il me dire
Ce que j'ai fait de mal?
Me jeter des pierres avant que je sois refroidi,
Cruelle action!185
Ce poème intéresse Burns parce qu'il a manifestement inspiré une de ses premières productions, La mort et les dernières paroles de la pauvre Mailie, l'unique brebis favorite du poète. Le sujet est traité d'une manière différente, et il est, dans Burns, autrement dramatique, autrement chargé de vie. Mais le seul rapprochement des deux titres indique assez la filiation.
Bien que Le brave Heck soit un curieux petit poème, et que les épîtres à Ramsay soient, pour la vivacité et l'imprévu des drôleries, égales sinon supérieures aux réponses, Gilbertfield n'est pas un grand homme. Il est inférieur aux Semple de Beltree. Toutefois il n'en doit pas moins être tenu en considération dans la poésie écossaise. Il a servi à allumer la lampe d'Allan Ramsay, comme Allan Ramsay a servi à allumer celle de Burns, selon l'expression de Walter Scott. C'est la lecture de ce poème qui a inspiré à Ramsay le désir et l'ambition d'écrire:
Quand je commençai à apprendre des vers,
Et pus réciter vos «Rochers d'Ardry»,
Où le brave Heck courait vite et farouche,
Cela enflamma mon cœur.
Alors l'émulation m'aiguillonna
Qui depuis n'a jamais cessé.
Puissé-je être moulu d'un maillet,
Si je prise peu vos vers;
Vous n'êtes jamais rugueux, creux, ni ombrageux,
Mais jovial et aisé,
Et vous frappez, juste en plein, dans l'esprit
De Habby notre modèle186.
Habby, on le reconnaît, n'est autre chose que Habby Simpson auquel Allan Ramsay rend ainsi hommage par un éloge de côté. Ces strophes auraient suffi pour conserver le nom de Gilbertfield dans une lumière moyenne. Burns l'a frappé d'un rayon plus rapide et plus brillant, rien qu'en le citant.
Mon bon sens serait dans une hotte,
Si j'osais espérer gravir,
Avec Allan ou avec Gilbertfield,
Le talus de la renommée,
Ou avec Fergusson, le pauvre commis,
Un nom immortel187.
Cela suffit pour que le poète de Bonny Heck garde, parmi les hommes de sa race, une petite immortalité. C'est quelque chose de comparable à celle qui est conférée aux hommes obscurs dont les grands peintres représentent les traits et inscrivent le nom dans le coin d'un tableau.
Il ne faut pas cependant hésiter à dire que, si tous ces essais ne servaient à retracer les origines d'une véritable production, digne de figurer parmi les parures d'une nation, ils auraient été oubliés. Ce seraient des bruits évanouis, comme tant de mots heureux, de causeries humoristiques, de paroles brillantes, en qui a palpité, pendant un instant, toute une âme. Les hommes dont nous venons de parler n'ont pas été des écrivains; ils ont été, suivant une juste expression, les poètes d'un seul poème. C'étaient des amateurs qui ont eu, un jour, la main heureuse. Leurs productions ne suffisent pas à constituer une littérature; ils en sont les premiers frémissements. Ils dénotent que, sous le firmament assombri du puritanisme, dans la tourmente des querelles théologiques et des persécutions religieuses, alors que tout était stérile, orageux et dévasté, la sève vivait encore. Elle n'attendait, pour se montrer, jaillir et écumer en fleurs, qu'un peu de calme et de soleil.
En effet, aussitôt que la paix reparut, on vit bien que ces signes n'étaient pas trompeurs. Dès le commencement du XVIIIe siècle, il y eut un fort mouvement littéraire et une renaissance de poésie nationale. Pendant le XVIIe siècle, l'énergie de la nation s'était portée toute entière à défendre son indépendance de conscience; la force nerveuse du pays s'était usée dans un immense effort de résistance et dans une indomptable tension de volonté. Les persécutions endurées, les services clandestins, les prédications sur les montagnes désertes, un enthousiasme où toute la ferveur de la nation se consumait comme en une flamme sombre, avaient absorbé toute la vitalité. Il y avait eu des martyrs jusqu'au bord du XVIIIe siècle. Lorsqu'on visite le pittoresque cimetière de Sterling, d'où la vue est si noble, on remarque, parmi d'autres statues de martyrs, un groupe de deux femmes en marbre blanc. Elles avaient refusé d'abjurer le convenant; l'aînée avait dix-huit ans. On les lia à deux poteaux sur les sables où se précipite le flux rapide de la Solway. On avait placé la plus âgée plus avant, afin que la vue de son agonie terrifiât la plus jeune. Mais l'héroïque fille continua à prier et à chanter des psaumes, jusqu'au moment où les vagues étouffèrent sa voix. Cela se passait en 1685. À la chute de Jacques II, une grande multitude alla ensevelir, avec recueillement, les têtes et les mains des martyrs qui étaient exposées sur les portes d'Édimbourg. Quand un peuple vit dans ces angoisses et ces colères, il n'y a point de place en son âme pour des rêves de littérature. La Révolution de 1688 amena la fin de ces temps douloureux. Peu à peu les esprits se détendirent, dépouillèrent leur obstination farouche, entr'ouvrirent leur dure austérité, laissèrent s'approcher, pénétrer même des idées ailées et gaies, avant-courrières de l'art, et premières abeilles qui entrent bourdonner un instant dans les chambres froides encore de l'hiver.
Un peu plus tard, l'acte d'Union mêla à ce sentiment de sécurité un élan de patriotisme plutôt rétrospectif qu'actif, et où il entrait plus de regret que de révolte. On sentait bien que l'union des deux royaumes était un événement inévitable et utile. Cependant on perdait avec peine l'indépendance nationale. Les discussions et les discours reportèrent l'attention vers le passé du pays, vers ses titres glorieux de bravoure et de poésie. C'est alors que commença cette étude de l'histoire nationale, cette récolte des souvenirs qui se sont continués à travers tout le XVIIIe siècle, et dont on peut dire que Walter Scott a été le dernier et le plus illustre ouvrier. Ses romans ont été la synthèse embellie de ces travaux successifs. Au sortir de la pesante littérature théologique, les premières productions du temps sont des ouvrages d'archéologie ou d'histoire locale: Les Exploits guerriers de la Nation Écossaise, de Patrick Abercombry; les Vies et les Caractères des plus Éminents Écrivains de la Nation Écossaise, du Dr George Mackenzie: le premier en deux volumes in-folio, le second en trois du même format; les dimensions théologiques persistaient encore. En même temps, on commença à recueillir les chansons et les ballades populaires. Le premier des nombreux recueils qui allaient se succéder fut publié par Watson, en 1706188. Le mouvement était lancé.
En sorte que, vers le commencement du XVIIIe siècle, il était devenu possible que l'Écosse eût une littérature, et qu'il y avait des motifs pour que cette littérature, sur le terrain de la poésie tout au moins, fût une littérature nationale.
Ce fut Allan Ramsay qui eut la gloire de l'inaugurer, en grande partie par ses propres œuvres, et aussi en récoltant les gerbes éparses et en les rentrant dans la grange. Sa vie, bien que dépourvue de dramatique, ne laisse pas que d'être bien intéressante189. Comme presque tous les poètes écossais, il s'est formé lui-même. Il était né en 1686, dans un petit village du comté de Lanark, au fond d'un district montagneux, plein d'eaux courantes. C'est là, sans doute, qu'il apprit à aimer la campagne et que le côté pastoral de son talent prit son germe190. De bonne heure, il perdit son père. Peu après, sa mère se remaria; à l'âge de quinze ans, il la perdit et se trouva tout à fait orphelin. Son beau-père l'emmena à Édimbourg, afin qu'il y apprît le métier, alors florissant, de perruquier. Le pauvre apprenti, désormais seul au monde, dut se tirer de la vie du mieux qu'il le put. Il n'avait personne pour l'aider, mais il était déterminé à faire son chemin, et doucement, lentement mais sûrement, il ne cessa de s'élever. Par la persévérance dans l'effort, la prudence et le sens pratique, sa vie fait un contraste avec celle de Burns. Il apprit tranquillement son métier. Son humeur joviale, son esprit, lui donnèrent l'entrée de ces clubs qui étaient alors une des formes de la vie intellectuelle d'Edimburgh. C'est là qu'il composa ses premières pièces: c'était sa contribution aux plaisirs de la soirée. Peu à peu sa réputation se répandit. Il commença à publier des poèmes de circonstances, sur des feuilles volantes. Les braves gens d'Édimbourg envoyaient leurs enfants avec un penny acheter «le dernier morceau de Ramsay191». Son ambition et ses efforts grandirent. En 1716, il publia sa continuation du poème de À Christ's kirk sur le pré. Vers la même époque, continuant, sans jamais reculer d'un pas, sa marche ascendante dans la vie, il abandonna son état de perruquier et s'établit libraire, dans une petite boutique, qui avait pour enseigne une grossière statue de Mercure192. Tout en menant son nouveau métier, il continua à écrire des poésies de toute espèce: chansons, épîtres, élégies, pastorales, et il publia ses recueils de vieilles poésies. En 1725, il donna son chef-d'œuvre, la pastorale du Noble Berger193. Ses affaires prospérant, il alla s'établir dans une autre boutique dont il décora la façade des bustes de Ben Jonson et de Drummond de Hawthornden. Il y ouvrait – car il était homme d'initiative – la première librairie circulante établie en Écosse. Il s'est représenté, lui-même, comme:
Un petit homme qui aime ses aises,
Et n'a jamais pu souffrir longtemps les passions
Qui se proposaient de lui jouer de mauvais tours194.
Sa gaîté, son enjouement, sa facilité de mœurs et l'honnêteté souriante de sa vie firent de lui un des premiers qui luttèrent contre l'esprit morose et sombre du temps. Non seulement il le fit dans sa poésie, mais son activité d'homme d'affaires le poussa dans toutes les entreprises qui pouvaient contribuer à égayer et à éclairer l'esprit de ses concitoyens. Il osa encourager les représentations théâtrales, alors frappées de réprobation. Il alla jusqu'à faire construire, à ses frais, en 1736, une salle de spectacles, qui fut presque aussitôt fermée par les magistrats de la cité. Il y perdit beaucoup d'argent. Ce fut sa seule entreprise malheureuse. Il avait peu à peu conquis la richesse, la réputation, d'honorables amitiés. Il se fit bâtir, à l'ombre du château d'Édimbourg, une petite maison, avec une des plus belles vues qu'il y ait en Europe. Il y passa les dernières années d'une vie paisible, laborieuse, et qui n'avait jamais dévié de la ligne droite vers un but utile. Il y mourut en 1757 dans sa soixante-treizième année.
Le grand service que Ramsay a rendu à la littérature de son pays est d'avoir été véritablement un poète écossais pour les sujets et le langage. «Un écossais de ce temps, dit lord Woodhouselee, parlait écossais et écrivait anglais. Ramsay eut le mérite de transporter le langage oral dans le style écrit195.» Cette remarque n'est qu'à moitié vraie, car tous les poèmes que nous venons de parcourir sont écrits en langue vulgaire. Ce qui est vrai, c'est que, là où il n'y avait eu que des tentatives, Ramsay a laissé un monument. Son mérite est d'avoir fait le même travail, avec une étendue et un talent qui ont assuré à ses œuvres une place dans l'histoire de la poésie, et donné, au dialecte dans lequel elles sont écrites, la dignité d'un langage littéraire. Ses prédécesseurs n'avaient été que des amateurs; il a été un véritable homme de lettres; il en a eu la continuité d'ambition, l'application dans l'effort, la vue claire du but. Il est en cela beaucoup plus littérateur que Fergusson et Burns, qui sont venus après lui. Son œuvre est plus consciente et plus voulue que la leur; elle est aussi moins personnelle et moins éloquente. Il a montré qu'on pouvait être un véritable écrivain en écossais, et que la langue de tout le monde, appliquée jusque-là à des boutades et à des caricatures, pouvait être employée pour des fins plus élevées. Son exemple a éveillé de jeunes ambitions. Et il ne faut pas oublier qu'il a donné à la littérature éparse qui l'avait devancé, de la cohésion et un point d'appui. Comme il arrive qu'un peintre supérieur communique de la valeur à ceux qui l'ont préparé, parce qu'il prête un sens et une direction à leurs tâtonnements, et fournit le point de vue qui les coordonne, en même temps que l'intérêt qu'il y a à les coordonner, Ramsay, en tirant des ébauches de ceux d'avant lui les éléments d'une œuvre, leur a rendu en importance ce qu'ils lui avaient fourni d'aide, et en les rattachant à lui, les a relevés.
Il a complété ce service de vivifier la littérature nationale en attirant l'attention sur les fragments d'anciennes poésies, chansons ou ballades, qui flottaient au hasard des récitations par tout le pays, ou dormaient dans des manuscrits. Il publia en 1724 le premier volume du Tea-Table Miscellany, un recueil de chansons anglaises et écossaises qu'il dédiait:
À toutes les aimables filles de la Grande-Bretagne,
Depuis les ladies Charlotte, Anne et Jeanne,
Jusqu'aux jolies et joyeuses Bess,
Qui dansent, nu pieds, sur l'herbe.
Vers la fin de la même année, il publia un second recueil, plus spécialement national l'Evergreen, collection de Poèmes Écossais écrits par les Ingénieux avant 1600. Ce sont les deux premiers ouvrages marquants dans un genre de recherche qui devait se continuer pendant un siècle, et compter parmi ses ouvriers Burns et Walter Scott. Il ne laisse pas d'être à l'honneur de Ramsay que sa publication précéda de près d'un demi-siècle la fameuse collection de l'évêque Percy. Ce n'est pas que Ramsay ait été le premier, puisque le recueil de Watson avait été publié en 1706, et que l'un de ses plus heureux effets avait été précisément d'éveiller le talent littéraire de Ramsay lui-même. C'est là, en effet, que se trouvait l'Élégie du Brave Heck. Il n'a eu, en rien, le mérite de l'initiative, mais celui d'une volonté et d'une suite plus grandes dans les entreprises. Il est encore vrai qu'il n'a pas accompli sa tâche dans l'esprit de sincérité, d'exactitude et de respect qu'y apporterait un éditeur de nos jours. Il faut l'avouer: il s'est permis des changements, des intercalations, des enjolivements; il a orné, pomponné, attifé, rajeuni ces vieilles chansons, rudes et frustes. Il n'a pas su oublier assez qu'il était perruquier. Il a fait leur toilette, il les a accommodées au goût du jour, mettant çà et là un rien de fard et une vapeur de poudre. Il est probable toutefois qu'il l'a fait avec plus de mesure qu'aucun de ses contemporains, et il est juste de lui en savoir gré. C'était un homme de bon sens et qui tenait à réussir. Il n'a commis que le nécessaire; peut-être n'eût-il pas attiré les regards autrement. En dépit de tout cela, il n'en demeure pas moins certain qu'il a, de ce côté encore, marqué une époque et un point de départ dans l'histoire littéraire de l'Écosse. Les titres ne lui manquent pas à avoir sa statue dans cette rangée d'hommes célèbres qui est la parure d'Édimbourg. De l'endroit où elle est située, dans le bruit de la foule, en face de la maison qu'il s'était construite, on aperçoit la colline solitaire plus hautaine et d'un plus grand caractère où se dresse le monument de Burns. Le rapprochement et la distance sont ainsi marqués.
Les traits caractéristiques du génie de Ramsay sont le naturel, la grâce, et l'aisance. Il a donné de jolis tableaux, d'une observation facile et un peu superficielle, d'un coloris léger et clair. L'ensemble de son œuvre a quelque chose d'aimable, de riant. Ni la passion douloureuse, ni le drame intime n'y apparaissent; on n'y voit jamais les lueurs sombres ni les éclairs tragiques de Burns, ni la teinte mélancolique de Fergusson. Tout y respire l'optimisme d'un homme qui est satisfait de la vie, parce qu'elle lui a donné ce qu'il souhaitait, et aussi parce qu'il n'a point souhaité plus qu'elle ne peut donner. On y rencontre partout le contentement. Aussi Ramsay jette-t-il sur les hommes un regard qui n'eut jamais ni profondeur ni amertume, et quand Hogarth lui dédia ses illustrations de l'Hudibras, il les offrait à un talent bien différent du sien. Son burin âpre, misanthropique, pénétrant, et qui semblait féroce, fait en un mot pour illustrer les pages terribles de Swift, aurait intimidé, effrayé l'œuvre agréable et mince du poète écossais. La représentation de la vie dans Ramsay s'exerce avec une sorte de jovialité bienveillante. «Allan's glee, la gaîté d'Allan» a dit Burns, en le caractérisant d'un mot196. Mais cette gaîté n'atteint jamais à la forte hilarité de Burns lui-même. C'est la bonhomie d'un homme modéré et heureux.
Les deux œuvres principales de Allan Ramsay et celles qui nous intéressent le plus dans cette étude sont sa continuation de à Christ's Kirk sur le pré, et son Noble Berger.
Par le premier de ces poèmes, Ramsay se rattache franchement au véritable créateur du genre de poésie populaire que nous suivons, à l'auteur de à la Fête de Peebles et de à Christ's Kirk sur le pré, Jacques I. Il eût été difficile de mieux reconnaître cette descendance. Il a repris le poème de à Christ's Kirk, à l'endroit où il s'interrompt, et il l'a continué. C'était, on l'a vu, une bagarre de village, un tohu-bohu de coups et bosses, une ripopée d'hommes, d'enfants et de femmes, meurtris, ensanglantés et beuglants. Ramsay trouva cruel de les laisser plus longtemps dans cet état-là. Il ajouta au vieux poème deux chants nouveaux, qui tirent tout le monde de ce mauvais pas et continuent la fête. Vers la fin de la querelle, une commère résolue se jette parmi les combattants avec un grand couteau à choux et les menace de les éventrer s'ils ne cessent pas. On s'arrête, on s'écoute, on s'entend, les uns rarrangent leur tignasse, les autres se bandent le front ou l'œil, la paix est faite. On appelle les musiciens et les danses recommencent; on saute, on boit à plein gosier, on mange à pleines tripes, on s'esclaffe. Vers le soir, on mène la mariée à sa chambre et on jette, selon l'usage, le bas de sa jambe gauche parmi les assistants. Celui où celle qui le reçoit se mariera bientôt. Après quoi tout le monde continue à boire.
Le savetier, le meunier, le forgeron et Dick,
Lawrie et le brave Hutchon,
Gaillards qui n'observaient pas strictement
Les heures, bien qu'ils fussent vieux,
Et n'avaient jamais pu se guérir de ce défaut;
Là où on vendait de la bonne ale,
Ils en buvaient toute la nuit, dût le démon
Conseiller à leurs femmes de les chamailler
Pour les punir le lendemain197.
Et c'est ainsi que finit le premier des deux chants ajoutés par Ramsay. Le troisième s'ouvre par un tableau du réveil du village, qui n'est pas dépourvu de précision. Les voisins, selon la coutume, pénètrent dans la chambre des mariés et jettent sur le lit les cadeaux de noce. Les plaisanteries roulent. Gars et filles reparaissent mal éveillés, les yeux gonflés de sommeil. La ripaille recommence plantureusement. Les tréteaux qui portent les barils de bière sont soulagés. On essaye de griser le nouveau marié. L'ale coule sur les tables et sur le sol. Une buée d'ivresse monte. Le savetier, le meunier, le forgeron, et Dick, et les autres s'en vont, titubant et trébuchant. Le brave Hutchon a la tête qui bourdonne, comme si elle était pleine de guêpes. Tout cela est plein de détails orduriers ou scabreux, qui rappellent certains coins et certains à-parte des toiles de Téniers. Tous ces mauvais sujets finissent par rentrer chez eux, où leurs femmes les accueillent diversement. Le nouveau marié, qu'on a fini par griser jusqu'aux moelles, va, se tenant à peine debout, rejoindre la mariée. Cela réjouit beaucoup Ramsay et lui inspire des plaisanteries qui ne seraient à l'aise que dans du vieux français. Ainsi finissent les choses. Il y a, par tout cela, un excellent brouhaha d'ivrognerie et de gaîté rustiques; c'est vivant, gai, aisé; le langage est observé; la strophe, cette strophe difficile et compliquée, est maniée avec un grand bonheur de main. Mais il n'y a là, ni la vigueur de pinceau du vieux poète, ni la large et vraie humanité de Burns. C'est un joli pastiche.
L'autre poème national de Ramsay, Le Noble Berger, est son plus haut effort et son plus solide titre de gloire. C'est une pastorale romanesque. Le noble berger est le fils d'un seigneur exilé pendant la Révolution de 1648. Il a été élevé, par un vieux berger fidèle, parmi les autres bergers, sur lesquels il l'emporte par une supériorité native. Il aime une jeune bergère et il en est aimé. Le retour de son père, à la Restauration, lui révèle son origine noble et lui déchire le cœur. Comment épousera-t-il maintenant l'humble fillette de village, malgré sa beauté et sa vertu? Heureusement on découvre que la jeune bergère est elle-même une fille noble, et tout se termine par des hymen, hymen, ô hymenæe.
Il était possible de tirer de cela quelque chose de semblable à l'adorable pastorale de Comme il vous plaira. Le sujet n'en est pas très différent. On conçoit, dans le paysage et les mœurs écossais, une intrigue nourrie de passion et d'action, se nouant et se dénouant, à travers la fantaisie de situations romanesques, dans la vérité supérieure et permanente des instincts humains. Le goût de Ramsay, ni celui de son époque n'allaient de ce côté. Il n'a pas tenté une pastorale shakspearienne. La sienne est une pastorale classique, dans la manière italienne, à la façon de L'Amintas, du Tasse, et du Fidèle Berger, de Guarini, sans action, toute en description, en tirades poétiques, en dialogues dont la régularité rappelle les couplets alternés des églogues. Elle se passe dans une vie trop innocente pour ne pas être arcadienne. L'œuvre a quelque chose de faux, qui, du reste, était dans la culture intellectuelle de Ramsay. Il avait gâté sa faculté de voir directement, par un souci d'imitation littéraire; et il avait mal choisi ses modèles. Il avait trop fréquenté Pope. Ce n'est pas que nous n'ayions pour cet habile écrivain une admiration pleine de réserve; mais s'il peut fournir des aphorismes et des épigrammes, si on trouve chez lui des vers faits de main d'ouvrier, achevés, brillants, polis, et si régulièrement rangés que certaines de ses pages font penser à une devanture de coutellerie; ce n'est pas chez lui qu'il faut aller chercher le mouvement et la vie réelle. On peut envoyer la colombe à travers l'œuvre de Pope sans qu'elle en rapporte le moindre rameau vert. Ce fâcheux commerce avait donné à Ramsay une faiblesse pour les vers soutenus, la régularité froide de la forme, et un faux vernis. C'est cet alliage qui a empêché que le Noble Berger ne fût un chef-d'œuvre.
C'est cependant une œuvre très distinguée. Et ce qui la sauve de n'être qu'une pastorale fade dans le goût du XVIIIe siècle, c'est justement ce fond de réalisme écossais, cette saveur de terroir, qui se trouvent dans les poèmes locaux. Ils apparaissent, et dans le langage que Ramsay a eu le bon sens de conserver, et dans certains traits de mœurs villageoises, et dans le paysage qui est exact, encore qu'il soit un peu embelli. C'est cette substance de réalité qui donne, à une conception un peu artificielle, de la fermeté, et qui la soutient. Il résulte parfois de ce mélange de très excellents effets. Ce fond solide, lorsqu'il se mêle en d'heureuses proportions avec l'idéal un peu raréfiant des classiques modernes, produit des passages d'une grâce achevée, et qui semblent vraiment antiques, parce que la pureté de contour que certains modernes ont empruntée aux anciens s'emplit ici d'un sentiment de vie actuelle. On pense à ces poteries agrestes qui, par un hasard heureux, retrouvent parfois la forme divine des vases grecs. Elles ont, sur les pures imitations artistiques, plus achevées peut-être, je ne sais quel avantage que leur vaut un air de solidité et d'emploi. On sent qu'au lieu d'être des galbes vides, elles contiennent le lait, le vin et l'huile, et qu'elles servent à la vie. Ce passage où deux jeunes paysannes vont laver leur linge à l'eau courante, ne fait-il pas penser à un passage d'idylle antique? Cela se termine comme une vision de naïades.
Remontons le ruisseau jusqu'au creux de Habbie,
Où toutes les douceurs du printemps et de l'été croissent:
Là, entre deux bouleaux, par-dessus une petite cascade,
L'eau tombe, en faisant un bruit chantant;
Un bassin, profond jusqu'à la poitrine, et clair comme le cristal,
Baise de ses lents remous l'herbe qui le borde;
Nous finirons de laver notre linge tandis que le matin est frais,
Et, lorsque le jour s'échauffe, nous irons au bassin,
Et nous y baignerons; cela est sain maintenant en mai,
Et d'une délicieuse fraîcheur par une journée si chaude198.
Pour comprendre ce que cette peinture a de particulier dans la poésie anglaise et comment elle s'y distingue par la classique sobriété du dessin, il suffit de la comparer à des peintures analogues prises dans Spenser, dans Shakspeare, ou Shelley. Cette fontaine a l'air d'un coin de tableau du Poussin; elle fait presque penser aux délicats paysages de Fénelon.
On rencontre ailleurs d'autres passages où la réalité est un peu plus marquée, mais encore dégagée, embellie et simplifiée. Celui-ci, avec sa jolie fille qui sort, toute vermeille et riante, de la brume matinale, et marche dans la rosée, est, à la vérité, un des plus parfaits qui se rencontrent dans Ramsay.
Hier matin, j'étais éveillé et dehors de bonne heure;
J'étais appuyé contre un mur bas, regardant au hasard,
Je vis ma Meg arriver, légère, à travers les prés;
Je voyais ma Meg, mais Meg ne me voyait pas,
Car le soleil cheminait encore à travers le brouillard,
Et elle fut tout près de moi avant qu'elle le sût.
Ses jupes étaient relevées, et montraient joliment
Ses jambes droites et nues, plus blanches que la neige.
Ses cheveux, retroussés dans leur filet, étaient lissés;
Les boucles de ses tempes se jouaient sur ses joues,
Ses joues si rouges, et ses yeux si clairs,
Et Ô! sa bouche a plus de miel qu'une poire.
Elle était nette, nette dans son corsage de futaine propre;
Comme elle marchait, glissait, dans l'herbe emperlée,
Joyeux, je m'écriai: «Ma jolie Meg, viens ici;
Je m'émerveille pourquoi tu es dehors si tôt,
Mais je le devine, tu vas cueillir de la rosée.»
Elle s'enfuit et me dit: «Qu'est-ce que cela vous fait?»
«Eh bien, bon voyage, Meg Dorts, comme il vous plaira,»
Lui dis-je insoucieusement, et je sautai le mur pour rentrer.
Je t'assure, quand elle vit cela, en un clin d'œil,
Elle revint avec une commission inutile,
Me malmena d'abord, puis me demanda d'envoyer mon chien
Pour ramener trois brebis égarées, perdues dans le marais.
Je me mis à rire, ainsi fit-elle; alors, rapidement,
Je jetai mes bras autour de son cou et de sa taille,
Autour de sa taille pliante, et je pris une quantité
De baisers très doux sur sa bouche brillante.
Tandis que je la tenais, dur et ferme, dans mes bras,
Mon âme elle-même bondissait à mes lèvres.
Fâchée, très fâchée, elle me grondait entre chaque baiser,
Mais je savais bien qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait199.
N'est-ce pas aussi joli et aussi précis que du Théocrite? Il n'est pas jusqu'à ce petit mur bas qui ne rappelle un autre mur de champs, sur lequel, d'après le goût de l'art grec pour les silhouettes en plein ciel, était, non pas appuyé mais assis, le garçonnet qui gardait si mal les vignes200. Nous ne connaissons rien dans la poésie de l'époque de Ramsay qui approche de cette fraîcheur, de ce naturel, de cette réalité gracieuse. Entre la poésie de la Renaissance et la moderne, on peut dire que le morceau est unique. Je ne sais pourquoi, par la souplesse aisée du vers, il me fait penser à un Cowper qui, au lieu de comprendre de la femme le charme intime, en aurait compris la grâce extérieure. Cependant nous sommes bien en Écosse. Ce soleil qui se dégage péniblement du brouillard, le costume de la jeune fille sont écossais; les traits des paysages et des personnages sont exacts, et le langage est bien local.
Le mérite propre de Ramsay, si l'on considère non plus la fonction historique, mais le résultat artistique de son œuvre, est d'avoir touché d'un peu de grâce la vie des paysans écossais. En cela il est unique. Le trait distinctif de la littérature de son pays est un réalisme rude et vigoureux, qui fut longtemps l'expression des mœurs et des âmes. Rien sans doute n'avait pu empêcher la nature de continuer à produire des créatures belles et saines, douées de l'harmonie des proportions et de la démarche, faites pour être la joie du regard humain. Mais une sombre discipline avait interdit le plaisir et enlevé le sens de l'admiration aux esprits. Ramsay les leur restitua. Il discerna la beauté et la séduction qui existaient autour de lui et que personne ne semblait voir. Il les a quelquefois tournées à une gentillesse maniérée. Mais il a rendu à la poésie écossaise son sourire. Il s'est arrêté aux jolis détails de la vie, avec plus de soin et de complaisance qu'aucun des autres poètes écossais. Il est bon d'ajouter toutefois qu'il n'a pas perçu des beautés plus profondes. Il y avait dans la paysannerie une noblesse morale qui a trouvé son expression dans le Samedi soir du Villageois, de Burns, et même dans Le Foyer du Fermier, de Fergusson. Cette beauté-là, Ramsay ne l'a pas comprise. Il n'a pas pénétré l'âme de sa patrie. Mais il a su admirer la grâce native et l'élégance de la race, avec l'œil d'un véritable et délicat artiste.
Le vrai successeur de Ramsay et le vrai prédécesseur de Burns fut Robert Fergusson. Sa vie, qui est un contraste avec celle du premier, fut plus courte encore et plus malheureuse que celle du second201. C'est une histoire lamentable. Il était né à Édimbourg en 1750. Il avait passé, dans ces hautes maisons sans air et sans lumière, une enfance maladive. À l'âge de treize ans, il avait obtenu une bourse à l'Université de Saint-Andrews. Il en sortit à dix-sept ans, et revint à Édimbourg, sans savoir prendre de parti pour la direction de sa vie. Il fut obligé, pour avoir du pain, de se mettre copiste de papiers légaux. Il passait sa journée à cette besogne et le soir, comme il était recherché pour sa gaîté et son esprit, il prenait part à l'épaisse débauche des clubs. Dans les intervalles, il écrivait ses poèmes qui parurent dans le Weekly Magazine, et furent publiés en volume en 1773, sans qu'ils paraissent lui avoir rapporté un shelling. Sa constitution délicate ne pouvait résister longtemps à la triple fatigue du travail, de la misère, et des excès. Au commencement de 1774, il commença à donner des signes de dérangement d'esprit. Il alarma un de ses amis en lui racontant, avec des regards effarés et des gestes extravagants, que la veille au soir il s'était pris de querelle avec des étudiants, que dans la bagarre l'un d'eux avait tiré un coutelas et lui avait tranché la tête, que sa tête avait roulé assez loin toute tremblante, toute coulante de sang, et que, sans sa présence d'esprit, il serait un homme mort; mais qu'il avait couru après elle, qu'il l'avait replacée si adroitement dans son ancienne position que les parties s'étaient rejointes, et qu'on ne pouvait découvrir aucune trace de sa décapitation. C'était la folie dont tous les affreux symptômes ne tardèrent pas à se montrer: les refus de nourriture pendant des jours entiers, les longues plaintes murmurées à soi-même, les crises de violence, et parfois d'adorables moments de poésie, et ces chansons navrantes, souvent si expressives, des fous. Il chantait alors une délicieuse mélodie: Les Bouleaux d'Invermay, avec un accent très pathétique et très tendre. Sa mère veuve était sans ressources. On fut réduit à le mettre dans un de ces asiles d'aliénés, qui étaient alors d'horribles repaires de douleur. Il fallut le tromper, le faire monter en chaise à porteurs, comme pour aller à une partie de plaisir. Quand il se vit dans ces murailles, il devina tout et poussa un cri désespéré, auquel répondirent, comme un écho, les hurlements des fous. Les deux amis qui l'avaient amené là s'enfuirent horrifiés.
Il resta deux mois dans une de ces cellules, pires que nos cachots. Quand il était tranquille, on permettait qu'il reçût des visites. Quelques jours avant sa mort, sa mère et sa sœur le trouvèrent sur son grabat de paille, calme et raisonnable. Cette dernière scène est douloureuse à lire. Le soir était froid et humide, il pria sa mère de rassembler les couvertures sur lui et de s'asseoir à ses pieds, car, disait-il, ils étaient si froids qu'ils étaient insensibles au toucher. Sa mère fit comme il désirait, et sa sœur s'assit auprès de son lit. Il regarda sa mère mélancoliquement et lui dit: «Oh, mère, comme vous êtes bonne». Puis s'adressant à sa sœur: «Ne pourriez-vous pas venir souvent et vous asseoir près de moi; vous ne sauriez vous imaginer comme je serais bien ainsi; vous pourriez apporter votre ouvrage et coudre près de moi». Elles ne purent lui répondre, et l'intervalle de silence fut rempli de leurs sanglots et de leurs larmes. «Qu'avez-vous? reprit-il? Pourquoi vous chagrinez-vous pour moi, messieurs? Je suis bien soigné ici… je vous assure, je ne manque de rien… seulement il fait froid… il fait très froid. Vous savez bien, je vous l'ai dit que cela finirait ainsi… Oui, je vous l'ai dit. Oh! ne vous en allez pas encore, mère… j'espère être bientôt… Oh! ne vous en allez pas encore… ne me laissez pas!» Le gardien vint dire aux pauvres femmes que l'heure de partir était venue. Encore quelques jours, on le trouva mort; «dans la solitude de sa cellule, dans les horreurs de la nuit, sans une main pour l'aider ou un œil pour le plaindre, le poète expira, son lit de mort fut un paillasson de paille; les derniers sons qui résonnèrent à son oreille furent les hurlements de la démence202». Dans les agonies de poètes, il n'en est pas de plus affligeante; elle l'est plus que celles de Gilbert et d'Hégésippe Moreau. Ainsi se termina, avant la vingt-quatrième année, une vie qui avait été aimable, inoffensive, et, sous ses excès, innocente. Le souvenir de Fergusson resta cher à ses amis.
Ce malheureux garçon était poète, un vrai poète, à sa manière et dans son petit domaine. Il n'avait pas le sens de la grâce physique, ni ces rapides éclairs épars dans Ramsay, ni ces soudains coups de beauté qui éclatent dans Burns. Dans les vieilles rues sombres, la race est souvent moins belle, et surtout ignore ces travaux qui montrent le corps dans des attitudes avantageuses. Il n'avait pas non plus le sentiment de fraîcheur qu'une enfance campagnarde a donné aux deux autres poètes. Sa poésie ne sent jamais l'aubépine, les senteurs des fèves en fleurs n'y arrivent pas. Pauvre Fergusson! Il n'avait jamais respiré à longs loisirs l'atmosphère large et pure des champs; il avait vécu dans l'ombre puante des ruelles, au pied humide des immenses maisons dont le toit seul connaît la lumière. Si le soleil apparaît chez lui, c'est au sommet des édifices quand il touche le coq de Saint-Giles ou le haut des cheminées. Enfermé toute la journée dans son taudis de commis, descendant le soir dans les tavernes, il semble surtout avoir vu le soleil en rentrant chez lui au point du jour. La clarté était pour lui une chose de luxe. Il lui manquait encore la vraie gaîté, le mouvement des vieux poèmes, la large jovialité qu'un tempérament robuste communiquait à Burns, et la claire animation que Ramsay tenait de son contentement de la vie. De complexion maladive, étiolé et affaibli par les privations et le manque d'air, il ne pouvait avoir la même vitalité. Enfin, chose étrange en un homme si jeune, il ne semble pas avoir aimé. Il n'y a guère d'allusion chez lui qu'aux amours nocturnes qu'on rencontre sous un réverbère. Il était misérable, mal vêtu, honteux. Dans des vers qui ne manquent pas de tristesse, il dit lui-même:
Si un gars ardent gémit,
Pour les faveurs des yeux d'une dame,
Qu'il ait soin de ne pas se montrer,
Avant d'avoir mis
Son corps dans un fin fourreau
De beau drap fin.
Car s'il vient en habit râpé,
Elle se souciera de lui comme d'une figue,
Plissera amèrement sa jolie bouche,
Et le renverra en grondant;
L'amoureux peut s'épargner la route
Qui n'a pas de drap fin203.
On dirait qu'il y a là une souffrance personnelle. Mais avec tous ces manques, il avait une observation juste, précise et sincère, un joli sens pittoresque, beaucoup de naturel et d'aisance, une certaine grâce, une langue souple et claire, un filet d'ironie tranquille et légère. Il avait appliqué ces qualités aux scènes qui l'entouraient. Il a été le poète d'Édimbourg, le peintre des rues, des carrefours, des tavernes, des caves à huîtres, des scènes populaires, des fêtes de faubourg, des incidents qui mettent en émoi et en remuement le bas peuple.
Tantôt il montre les réjouissances qui marquent à Édimbourg le jour de naissance du roi. Les cloches sonnent, le château tire une salve de canons; les mendiants du roi arrivent recevoir leur cadeau annuel. Ce sont des mendiants privilégiés; ils reçoivent ce jour-là autant de pence que le roi a d'années, un vêtement bleu neuf, un bon dîner et un sermon d'un des chapelains du roi.
Chante, également, Muse, comment les gars en robe bleue,
Comme des épouvantails détachés des arbres,
Viennent ici quitter leurs habits en haillons,
Et recevoir leur paie.
Où est le magistrat qui est plus fier qu'eux
Le jour de naissance du Roi?204
La garde civique s'est mise en grand uniforme; les pétards partent, sifflant de tous côtés, brûlant de temps en temps une perruque; la populace fait de grosses farces. Ou bien ce sont les amusements et les plaisirs des Jours fous205, c'est-à-dire des quelques jours qui avoisinent le jour de l'an; l'Ouverture et la Clôture de la Session206; l'Élection du Magistrat207. Dans Auld Reekie, il chante la vie d'Édimbourg, depuis le moment où les servantes se frottant les yeux commencent de bonne heure leurs mensonges et leur clabaudage, jusqu'à celui où, le soir, on trouve, dans les flaques et les ruisseaux, «les macaroni» c'est-à-dire les élégants, ivres-morts, souillés et empuantis par l'heure dangereuse de la ville. Les deux plus jolis morceaux de Fergusson sont, dans ce genre, Les Courses de Leith et surtout La Foire de la Toussaint.
Celle-ci commence par une description du matin:
À la Toussaint, quand les nuits se font longues,
Et que les étoiles luisent bien claires,
Quand les gens, pour repousser le froid piquant,
Portent leurs habits d'hiver;
Près d'Édimbourg se tient une foire;
Je crois qu'il n'y en a guère dont le nom soit,
Pour les filles bien droites et les gars solides,
Pour les verres et les pintes, plus fameuse
Que celle de ce jour-là.
Sur le haut des cheminées
Le soleil a commencé à luire,
Et a dit aux filles, en beaux habits, d'aller
Chercher un beau bon-ami,
À la foire de la Toussaint, où les fins brasseurs
Vendent de la bonne ale sur des tréteaux,
Et ne vous refusent pas un morceau
De fromage de leur cuisine,
Très salé ce jour-là208.
Sur le champ de foire, les colporteurs étalent et prônent leurs marchandises; il y a des rétameurs, des chaudronniers, des maquignons, des diseuses de bonne aventure, un marchand de bas d'Aberdeen. Là-bas est l'inévitable sergent de recrutement qui apparaît dans toutes les foules de ce temps.
Un roulement de tambours alarme nos oreilles;
Le sergent piaille à haute voix:
«Vous tous, gentlemen et volontaires,
Qui souhaitez le bien de votre pays,
Venez ici, et je vous donnerai
Deux guinées plus une couronne,
Un bol de punch où, comme sur la mer,
Flotterait un long dragon,
Aisément ce jour-ci209.»
Plus loin, les chevaux piaffent et hennissent. Sous les tentes, les vieillards vident des verres. Il y a un tel tapage de cris, de bavardages de femmes et d'enfants, un tel boucan, qu'on se croirait revenu à la Tour de Babel. Le soleil se couche, et on rentre en ville s'entasser dans les tavernes. Mais il ne fait pas bon y trop rire. Les vieux butors de la garde civique sont là, qui brutalisent et molestent les bons ivrognes. Et il ne faut pas faire d'observations. Jock Bell s'en aperçoit. Il reçoit un coup de hache de Lochaber, et il a la mauvaise idée de protester.
«Aïe! (dit-il) j'aimerais mieux être
Piqué par une épée ou une bayonnette,
Que mon corps ou mon crâne reçoivent
Une entaille d'une si terrible arme».
Là-dessus, il reçut un autre coup
Plus lourd que le premier,
Qui secoua son maigre corps,
Et lui fit cracher le sang,
Tout rouge, ce jour-là.
Il gisait sur la chaussée, reprenant son souffle,
Tout meurtri de coups de pied et de poing;
Le sergent lâcha un juron des Hautes-Terres:
«Mettez l' main sur chet hôme»
Et le brave caporal s'écria:
«Abortez c't imb'cile d'ifrogne».
Ils le traînèrent au poste, et, sur mon âme,
Il eut à payer l'amende d'ivresse,
Pour ça le jour suivant.
Braves gens! en revenant de la foire,
Écartez-vous de cette bande noire;
Il n'y a pas ailleurs de pareils sauvages
Qui aient le droit de porter une cocarde.
Plus que de la mâchoire puissante du lion affamé,
Ou de la défense de l'ours Russe,
De leur patte cruelle et brutale,
Vous avez raison de redouter
Votre mort ce jour-là210.
Fergusson n'aimait pas le bataillon des vieux gaëls. Il avait sans doute eu maille à partir avec eux.
Les Courses de Leith sont un poème du même genre, avec cette différence que, au début, Fergusson introduit une figure imaginaire et abstraite, la Gaîté, qu'il rencontre et avec laquelle il fait route. C'est une idée assez malheureusement ingénieuse, qui n'ajoute rien à la pièce et a le défaut d'introduire dans un tableau réaliste une allégorie fade dans le goût du XVIIIe siècle211. Burns a repris cet artifice au commencement de sa Sainte-Foire, en y mettant plus de vie et en l'adaptant mieux à l'ensemble du morceau.
Toutes ces pièces sont dans la veine ancienne. La Sainte-Foire et Les Courses de Leith sont écrites dans la vieille strophe de neuf vers. Les Jours fous, Le Jour de naissance du Roi sont écrits dans la strophe plus courte de cinq vers. Fergusson, on l'a vu plus haut, s'est rattaché au filon des élégies comiques par son Élégie sur la mort de M. David Gregory, professeur de mathématiques, et par celle Sur John Hogg, ex-portier de l'Université de Saint-Andrews.
Un dernier poème de Fergusson, Le Foyer du Fermier, tient, pour la forme et le ton, une place à part dans son œuvre. Au lieu d'être écrit en vers courts et en strophes légères, il est écrit en vers héroïques de cinq pieds, le vers de Spenser et de Milton, et en strophes de neuf vers, qui se rapprochent de la strophe spenserienne. Celle de Fergusson est seulement moins savante et moins solide. La strophe de Spenser forme réellement un tout, grâce aux rimes du milieu qui entrent dans le premier et le troisième tercets et les accrochent ensemble; on a en effet des rimes disposées ainsi: a b a b b c b c c. Dans la strophe de Fergusson, au lieu de trois rimes, on en a quatre, qui se suivent de la sorte: a b a b c d c d d; en sorte que la strophe se casse, en réalité, après le second b, et que les deux parties ne tiennent ensemble que par juxtaposition typographique et non par interpénétration de sonorités. Voici du reste, un exemple de chacune des deux. Le premier est tiré de l'ouverture du chant XII du livre VI de La Reine des Fées.
Comme un vaisseau qui va sur les flots incertains,
Se dirigeant devers une certaine côte,
S'il rencontre des vents et des courants soudains,
Sa marche est traversée, et lui-même tressaute
Surpris et ballotté sur mainte houle haute;
Mais s'arrêtant souvent, virant souvent de bord,
Il poursuit son chemin, il arrive sans faute:
Ainsi va-t-il de moi dans ce si long effort,
Je m'arrête souvent, mais je gagne le port212.
Voici, en regard de celle-là, la strophe du Foyer du Fermier:
Quand le gris crépuscule avance dans les cieux,
Quand Batie reconduit ses bœufs à leur étable,
Que John ferme la grange, après un jour peineux,
Que les filles nettoient le blé près de la table,
Ce qui tient au dehors les froids soirs engourdis,
Ce qui rend vain l'Hiver sous sa blanche poussière,
Ce qui rend les mortels confiants et hardis,
Oublieux de la plaine où s'étend la misère,
Célèbre-le, ma Muse, en langue familière213.
C'est cependant une strophe d'allure noble et grave. Le ton aussi a perdu toute ironie, et, si la peinture reste humble et réelle, elle est sérieuse. Elle a pour épigraphe deux vers des Georgiques de Virgile. Dans la lignée écossaise, cette pièce, bien qu'elle soit purement descriptive, relèverait plutôt du Noble Berger, par le mélange d'embellissement et de vérité. Mais l'embellissement ici ne porte que sur le côté moral. Elle est écrite en pur dialecte écossais. À cause de l'influence qu'il a eu sur Burns, il est utile de voir d'un peu plus près ce morceau. C'est le tableau d'une soirée, autour de la cheminée d'une petite ferme, et un tableau charmant de justesse et de naturel. Après avoir, dans la strophe citée plus haut, mis la tristesse du dehors comme un cadre sombre à ce coin chaud et heureux, le poète montre les apprêts du repas du soir:
De la grosse meule, bien éventée sur la colline,
Que des plaques de gazon abritent de la pluie et de la neige,
De grosses mottes, des tourbes, du turf de bruyères emplissent la cheminée,
Et envoient leur fumée épaissie saluer le ciel.
Le fermier, qui vient de rentrer, est heureux de voir,
Quand il jette un regard par dessus le bas mur,
Que tout est arrangé à son idée,
Que sa chaumière a l'air net et propre,
Car il aime une maison propre, si humble soit-elle.
La fermière sait bien que la charrue exige
Un repas cordial et un coup rafraîchissant
De bonne ale, auprès d'un feu flambant;
Dur travail et pauvreté ne vont pas bien ensemble.
Des bannocks bien beurrés fument dans la poêle,
Dans un coin obscur le baril de bière écume,
Le kail est tout prêt dans un coin de la cheminée,
Et réchauffe le plafond d'une vapeur bienvenue,
Qui semble plus délicieuse que la plus exquise cuisine…
C'est avec cette nourriture, que maint rude exploit
A été accompli par les ancêtres calédoniens;
Avec elle que maint gars a saigné en combattant
Dans des rencontres, de l'aurore au coucher du soleil;
C'est elle qui tendait leurs bras rudes et robustes,
Qui pliait les redoutables arcs d'if au temps jadis,
Qui étendait sur le sol les hardis fils du Danemarck;
Par elle, les chardons écossais repoussèrent les lauriers romains,
Car ils n'osèrent pas dresser leur tête près de nos côtes214.
Le souper terminé, la causerie se met en train. À côté des préoccupations communes à tous les fermiers, on y retrouve les traces de bien des choses que nous avons vues dans la vie de Burns. La peinture de ce foyer pourrait presque servir à reconstituer celui où notre poète a été élevé. On y trouve corroborés maints détails de sa vie ou de ses souvenirs, l'escabeau du repentir, les contes merveilleux de la vieille commère, la superstition religieuse, l'intervention des esprits diaboliques.
Le bavardage amical commence quand le souper est fini;
Le gobelet qui réjouit les fait parler aisément
Des rayons et des averses d'été, des duretés de l'hiver,
Dont le déluge a gâché autrefois le produit de la ferme.
À propos de l'église, du marché, leurs histoires continuent:
Comment, ici, Jock a courtisé Jenny, comme sa promise,
Et, comment, là, Marion, à cause de son bâtard,
A été forcée de monter sur l'escabeau de pénitence,
Et de subir la dure réprimande de notre Révérend John.
Il n'y a plus un murmure parmi la marmaille,
Car leur mauvaiseté est partie avec leur faim.
Il faut bien que les enfants dont la bouche crie famine
Grognent et pleurent et fassent du tapage.
Les voici en cercle autour de la flamme du foyer;
Là, grand'mère leur raconte des histoires du vieux temps,
De sorciers dansant autour d'un fantôme,
De fantômes qui habitent dans les glens et les cimetières redoutables;
Cela leur brouille toute la tête et les fait frissonner de peur.
Car elle sait bien que les démons et les fées
Sont envoyés par les démons pour nous attirer à notre perte;
Que des vaches ont perdu leur lait par le mauvais œil,
Et que le blé a été brûlé sur le four allumé.
Ne vous moquez pas, mes amis, ayez plutôt pitié,
Vous qui êtes au gai printemps de la vie, où la raison est claire;
Avec la vieillesse nos vaines imaginations reviennent,
Et obscurcissent nos jours décrépits de terreurs enfantines;
L'esprit revient au berceau quand la tombe est proche215.
Vers la fin de la soirée, le fermier va s'asseoir sur le long banc de bois qui, dans les vieilles fermes, était collé au mur. Le chat et le chien viennent près de lui; il leur jette quelques miettes de fromage. Les gars arrivent lui demander les ordres pour le travail du lendemain. Enfin toute la maison, maîtres et serviteurs, s'en vont dormir jusqu'à ce qu'ils soient réveillés par «l'éclat rouge de l'aurore».
Paix au laboureur et à sa race,
Dont le travail vainc nos besoins d'année en année!
Puissent longtemps son soc et son coutre retourner la terre,
Et les rangs de blé se pencher sous de lourds épis!
Puissent les étés de l'Écosse être toujours gais et verts,
Et ses jaunes récoltes être protégées des maigres rafales!
Puissent tous ses tenanciers s'asseoir à l'abri, dans le bien-être,
Délivrés de la dure serre de la maladie et de la pauvreté!
Puissent, en un long et durable cortège, les heures paisibles se succéder!216
C'est assurément la plus belle promesse de Fergusson. Outre ses qualités d'observation, de simplicité et d'élévation, cette pièce témoigne d'un précieux instinct pour trouver dans la vie des sujets de poésie. C'est un grand don d'être capable de découvrir des thèmes nouveaux, ou tout au moins de rajeunir des thèmes éternels. Fergusson l'avait dans les limites où le sort l'avait confiné. «Le poète, dit quelqu'un qui a excellemment écrit sur lui, a ici rencontré un vrai thème de poésie. C'est de beaucoup le plus heureux de ses efforts, et si son goût l'avait toujours conduit à choisir de pareils sujets, il aurait pu disputer à Burns, la première place dans la renommée écossaise. En dehors de toutes considérations relatives, c'est un noble poème, une peinture reposante et fidèle des mœurs simples et vertueuses d'une intéressante classe de la société. Il montre combien Fergusson avait reçu de la nature les qualités pour accomplir l'œuvre nationale si admirablement exécutée par son grand successeur. Il respire la véritable inspiration de la poésie et du patriotisme»217. Il y avait autre chose entre Fergusson et Burns, qu'un choix de sujets. Mais cet éloge n'en est pas moins juste; ce n'est pas un petit honneur, pour un jeune homme de vingt-trois ans, d'avoir laissé un morceau où vit une parcelle de l'âme de son pays, et qui a pris son rang parmi ces tableaux qu'une race conserve, parce qu'elle est fière de s'y reconnaître.
Fergusson a exercé une assez grande influence sur Burns, pour des raisons diverses et qui n'étaient pas toutes littéraires. Burns eut toujours pour lui une sympathie particulière. Dans sa jeunesse, il voyait, dans cette vie malheureuse, une destinée qui n'était pas sans ressemblance avec la sienne. Il put penser plus d'une fois que sa fin, sauf la folie, ne serait pas très différente. Il n'était pas jusqu'au prénom commun qui ne lui semblât les marquer tous deux comme de la même famille; nos esprits ont de ces superstitions. C'est sincèrement qu'il l'appelait son frère.
Ô toi mon frère aîné en infortune,
Et de beaucoup mon frère aîné en poésie218.
Il avait, en outre, envers lui une sorte de reconnaissance. On se souvient que lorsqu'il était revenu d'Irvine, découragé, ayant renoncé à la poésie, c'étaient les poèmes écossais de Fergusson qui l'avaient ranimé. Il avait «tendu de nouveau les cordes de sa lyre rustique aux sons sauvages, avec la vigueur de l'émulation»219. Fergusson lui avait rendu ce service que d'humbles artistes rendent parfois à un plus grand maître: ils lui donnent confiance et l'aident à oser, parce que la distance n'est pas très grande entre ce qu'ils ont fait et ce qu'il croit pouvoir. D'ailleurs il convenait aux générosités et aux rancunes de son caractère de prendre parti pour un génie méconnu, contre les riches qui l'avaient laissé périr misérable.
Maudit soit l'homme ingrat qui peut prendre du plaisir
Et laisser mourir de faim l'auteur de ce plaisir220.
Et ailleurs il disait encore:
Ô Fergusson, tes beaux talents
Allaient mal avec le savoir sec et moisi de la Loi!
Ma malédiction sur vos cœurs de pierre,
Vous bourgeois d'Édimbourg;
La dixième partie de ce que vous gaspillez aux cartes
Aurait garni son garde-manger221.
Cette prédilection pour Fergusson s'est manifestée en maintes circonstances. On n'a pas oublié l'hommage touchant qu'il lui rendit et la tombe du cimetière de Greyfriars. Ce nom revient à plusieurs reprises dans sa correspondance, et dans ses vers chaque fois qu'il a à parler de poésie écossaise. Il semble le préférer à Ramsay:
Ramsay et le fameux Fergusson222.
Et ailleurs:
Ô si j'avais une étincelle de la gaîté d'Allan,
Ou de Fergusson le hardi et le malin223.
Et dans la strophe citée plus haut sur Allan Ramsay et sur Gilbertfield, c'est encore à Fergusson qu'il réserve le vers le plus éclatant. C'est une préférence qui nous semble exagérée. Fergusson est inférieur à Ramsay; disons, pour être juste et tenir compte de sa mort précoce, que son œuvre est inférieure à celle de Ramsay.
Quoi qu'il en soit, l'influence de Fergusson sur Burns est très sensible. De tous les poètes écossais, c'est lui que Burns a le plus imité. Les Doléances Mutuelles du Trottoir et de la Chaussée lui ont fourni l'idée de la conversation des Deux ponts d'Ayr; Les Courses de Leith, le commencement de la Sainte-Foire; L'Eau fraîche lui a inspiré, par opposition, son Breuvage Écossais, c'est-à-dire l'éloge du whiskey; et surtout Le Foyer du Fermier a été, sans conteste, l'inspirateur de sa belle pièce sur Le Samedi soir du Villageois. Mais il faut ramener cette imitation à ses vraies limites. L'influence de Fergusson sur Burns a été tout extérieure, celui-ci n'a pas imité la manière de Fergusson, il lui a emprunté des sujets, moins encore, des idées de sujets. Maniés par les mains vigoureuses de Burns, les mêmes motifs, minces et délicats chez Fergusson, deviennent riches, s'animent, se chargent de vie, et prennent aussitôt, au lieu d'être des sujets locaux, un intérêt général de sujets humains. La distance qui sépare le plus haut effort de Fergusson, de ce qui n'est pas le chef-d'œuvre de Burns, c'est-à-dire Le Foyer du Fermier, du Samedi soir, est, on le verra, incommensurable. Les deux pièces n'appartiennent pas aux mêmes régions. Celle de Fergusson est de petite description exacte. Elle n'a ni la grande poésie, ni le noble enthousiasme, ni la portée sociale de celle de Burns. Elle n'a en rien cette plénitude de vie, cette large sonorité de vase puissant, qui résonne quand on touche du doigt l'œuvre de Burns. C'est l'effort d'un enfant heureusement doué et délicat, à côté de celui d'un homme exceptionnel. Il n'y avait d'ailleurs aucun rapport de nature entre le pauvre écrivain d'Édimbourg et le vigoureux paysan d'Ayrshire. Celui-ci se rapproche bien plus des ancêtres; il en a la sève et le mouvement, mais il a de plus une passion et une force intellectuelle dont les vieux ne se doutaient pas.
Tels sont l'origine et le développement de ce genre indigène auquel se rattache, on peut dire, la moitié la plus significative et la plus probante de la production de Burns: ses petits poèmes des mœurs populaires, presque toutes ses Épîtres, ses Élégies comiques. Dans quelques morceaux, il a employé l'ancienne strophe de neuf vers, telle qu'elle lui a été transmise modifiée par Fergusson. Presque partout ailleurs, il s'est servi de la petite strophe de cinq vers, la strophe de Robert Semple, qu'il manie avec une étonnante dextérité, et à laquelle il donne toutes les allures, de l'espièglerie à la plus haute gravité. Tam de Shanter et les Joyeux Mendiants, quoiqu'ils aient une forme différente, relèvent aussi de la même inspiration. Toute cette partie de son œuvre sort de ce vieux rameau de poésie écossaise; elle en est la fleur ou, pour employer un mot de botanique qui en indique mieux les proportions par rapport à la tige qui la porte, le riche et touffu corymbe terminal.
151
Veitch. History and Poetry of the Scottish Borders, p. 312.
152
Irving. History of Scotish Poetry, p. 145.
153
Hill Burton. History of Scotland, tom. II, p. 384.
154
Voir à ce sujet le joli essai, dans le Sketch Book, de Washington Irving, intitulé a Royal Poet.
155
The King's Quair. Canto II.
156
Voir, sur le King's Quair, Irving, History of Scotish Poetry, p. 134-142.
157
Hill Burton. History of Scotland, tom II, p. 397.
158
Tytler. History of Scotland, tom II, p. 51.
159
Voir, sur les réformes de Jacques I, le chapitre abondant de Tytler, History of Scotland, tom II, chap. II, p. 52-56.
160
Voir le récit de cette scène dans Tytler, History of Scotland, tom II, chap. II, p. 90-93. – Hill Burton. History of Scotland, tom II, p. 408-09.
161
L'attribution de ces deux pièces à Jacques I a soulevé quelque discussion. L'opinion la plus générale est en sa faveur. Voir à ce sujet Irving, History of Scotish Poetry, p. 143 et suiv. – Dans un petit volume publié par Chambers, Miscellany of Popular Scottish Poems, se trouve la note suivante, sur le poème Peebles to the Play: «En ce qui concerne la présomption que le roi Jacques était l'auteur de ce poème, il n'est pas inutile de remarquer que, en 1444, quelques années après sa mort, une fondation fut faite qui avait pour objet (entre autres choses) de prier pour l'âme du monarque défunt, dans l'église paroissiale de Peebles.»
162
Peebles to the Play.
163
Peebles to the Play.
164
Peebles to the Play.
165
Peebles to the Play.
166
Il est probable que la première de ces deux pièces, qui ne fut publiée qu'en 1785, était inconnue à Burns, mais la seconde était couramment populaire. Allan Ramsay l'avait imitée, le Rev John Skinner, l'ami de Burns, en écrivit une traduction en vers latins. Il y avait longtemps d'ailleurs que Pope avait dit:
One likes no language but the Fairy Queen,
A Scot will fight for Christ's Kirk on the Green.
167
Voir Veitch. History and Poetry of the Scottish Borders, p. 313.
168
Heich Hucheon, with ane hissel ryse,
To red can through them rummill;
He muddlet them down, like any mice,
He was no batie-bummil:
Through he was wight, he was not wise,
With such jangleris to jummil;
For frae his thumb they dang a slice,
While he cried barla-fummill,
I'm slain,
At Christ's Kirk on the green, that day.
(Christ's Kirk on the Green, Stanza XVI.)
169
Now frae th' east nook o' Fife the dawn
Speel'd westlines up the lift,
Carles wha heard the cock had crawn
Begoud to rax and rift;
An' greedy wives wi' girning thrawn,
Cry'd lasses up to thrift;
Dogs barked, an' the lads frae hand
Bang'd to their breeks like drift,
Be break o' day.
(A. Ramsay. Christ's Kirk on the Green, Cant. III, Stanza I).
170
Here country John, in bonnet blue,
An' eke his Sunday's claes on,
Rins after Meg wi' rokelay new,
An' sappy kisses lays on;
She'll tauntin' say, «Ye silly coof!
Be o' your gab mair sparin».
He'll take the hint, and creish her loof
Wi' what will buy her fairin',
To chow that day.
R. Fergusson. Hallowfair, Stanza II.
171
Veitch. History and Poetry of the Scottish Borders, chap. X, p. 312 et suivantes.
172
Les deux poèmes se trouvent dans The Book of Scottish Poems de J. Ross.
173
Irving. History of Scotish Poetry, p. 303 et suiv.
174
On trouvera ces deux pièces dans le recueil de J. Ross The Book of Scottish Poems. Dans le petit recueil de Chambers, Popular Scottish Poems, on trouve aussi La Femme d'Auchtermuchty.
175
The Wife of Auchtermuchty, Stanza I.
176
The Wife of Auchtermuchty, la fin.
177
Voir Irving. History of Scotish Poetry, p. 569-72. Il donne des extraits du poème de Sir James Semple.
178
Voir sur Robert Semple: Irving, History of Scotish Poetry, p. 573-77. Irving donne l'élégie en entier. Elle se trouve également dans le petit recueil de Chambers, Miscellany of Popular Scottish Poems.
179
J. Grant Wilson. The Poets and Poetry of Scotland, p. 82. – J. Clark Murray. The Ballads and Songs of Scotland, p. 185.
180
The sun had closed the winter day,
The curlers quat their roaring play,
And hunger'd maukin ta'en her way
To kail-yards green,
While faithless snaws ilk step betray
Whare she has been.
181
Upon a simmer sunday morn,
When nature's face is fair,
I walked forth to view the corn,
And snuff the caller air.
The rising sun owre Galston muirs,
Wi' glorious light was glintin';
The hares were hirplin' down the furs,
The lav'rocks they were chantin'
Fu' sweet that day.
182
Miscellany of Popular Scottish Poems de Chambers, la notice qui précède le poème.
183
Sur Francis Semple, voir Irving, History of Scotish Poetry, p. 578-81. —The Blythsome Bridal se trouve dans the Book of Scottish Poems de J. Ross, – dans the Poets and Poetry of Scotland, J. Grant Wilson le donne également, avec deux autres pièces célèbres du même auteur, She rose and loot me in, et Maggie Lauder; mais ces dernières sont des chansons.
184
Les épîtres d'Hamilton de Gilbertfield à Ramsay se trouvent dans les éditions de Ramsay, avec les réponses de celui-ci. – J. Grant Wilson les reproduit dans the Poets and Poetry of Scotland.
185
On trouvera The Last Dying Words of Bonny Heck dans le recueil de J. Ross, The Book of Scottish Poems.
186
Seven Familiar Epistles which passed between Lieut Hamilton and the Author. Answer I, Edinburgh, July 10th 1719.
187
Epistle to William Simpson.
188
Choice Collection of comic and serious Scots Poems, both ancient and modern, by several hands, Edinburgh 1706-09-11.
189
Voir l'article sur Ramsay dans the Biographical Dictionary of Eminent Scotsmen, et surtout la vie qui se trouve en tête de l'édition de ses œuvres de 1800 et qui est de Chalmers, l'auteur de Caledonia. Cette biographie est, selon l'expression de J. Ross, «la base de toutes celles qui l'ont suivie».
190
Voir, dans l'édition de Ramsay d'Alex. Gardner, Remarks on the Genius and Writings of Allan Ramsay, p. XLIII. – Hill Burton. History of Scotland, tom VIII, p. 546.
191
Notice dans le Biographical Dictionary of Eminent Scotsmen.
192
Voir dans les Reminiscences of old Edinburgh de Daniel Wilson, le chapitre VII du tom I: at the sign of the Mercury.
193
«Il emprunta probablement ce titre au Gentle Shepherd de la XIIe Églogue du Shepherd's Calendar de Spenser» (Ramsay's Life, p. XXVII).
194
The Life of Ramsay, p. XXXIX.
195
Remarks on the Writings of Allan Ramsay, p. XLVI, dans l'édition d'Alex. Gardner.
196
First Epistle to Lapraik.
197
Christ's Kirk on the Green, Canto II.
198
The Gentle Shepherd, Acte I, scène 2.
199
The Gentle Shepherd, Acte I, scène I.
200
Théocrite. Idylle i.
201
Nous avons consulté, pour la vie de Fergusson, la notice très étendue du Biographical Dictionary of Eminent Scotsmen, et la biographie du poète par James Gray, en tête de l'édition de Fairbairn, etc., 1821.
202
Peterkin. Life of Fergusson, prefixed to the London Edition of his poems, 1807.
203
Braid Claith.
204
The King's Birth-Day in Edinburgh.
205
The Daft Days.
206
The Sitting of the Session; the Rising of the Session.
207
The Election.
208
Hallowfair.
209
Hallowfair.
210
Hallowfair.
211
Voir les cinq premières strophes des Leith Races.
212
Like as a ship, that through the Ocean wyde
Directs her course unto one certaine cost,
Is met of many a counter winde and tyde,
With which her winged speed is let and crost,
And she her selfe in stormie surges tost;
Yet, making many a borde and many a bay,
Still winneth way, ne hath her compasse lost:
Right so it fares with me in this long way,
Whose course is often stayed, yet never is astray.
The Faerie Queene, Book VI, Canto XXI, Stanza I.
213
When gloamin' grey out-owre the welkin keeks;
When Batie ca's his owsen to the byre;
When Thrasher John, sair dung, his barn-door steeks,
An' lusty lasses at the dightin tire:
What bangs fu' leal the e'enin's coming cauld,
An' gars snaw-tappit Winter freeze in vain,
Gars dowie mortals look baith blithe an' bauld,
Nor fley'd wi' a' the poortith o' the plain;
Begin, my Muse! and chaunt in hamely strain.
The Farmer's Ingle, Stanza I.
214
The Farmer's Ingle.
215
The Farmer's Ingle.
216
The Farmer's Ingle.
217
Gray. Remarks on the Writings of Fergusson, p. xxii.
218
Lines written under the portrait of Fergusson.
219
Autobiographical Letter to Dr Moore.
220
Lines written under the portrait of Fergusson.
221
Epistle to William Simpson.
222
Epistle to William Simpson.
223
Epistle to John Lapraik.