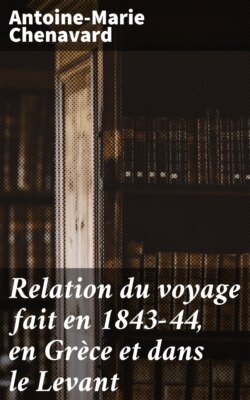Читать книгу Relation du voyage fait en 1843-44, en Grèce et dans le Levant - Antoine-Marie Chenavard - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеTable des matières
Voyage au nord de la Grèce. — Thèbes. — Lebadée. — L’antre de Trophonius. — Chéronée. — Delphes. — Le Parnasse. — Aracova. — Les Thermopyles. — Lamia. — Chalcis. — Le port d’Aulide. — Retour à Athènes.
Peu de jours s’étaient écoulés depuis cette mémorable journée; nous étions irrésolus sur le parti que nous devions prendre, combattus à la fois par la crainte des dangers que nous avions à courir en nous éloignant d’Athènes et par la douloureuse pensée d’emporter dans nos foyers des regrets désormais inutiles, lorsqu’on vint nous annoncer que le nouveau gouverneur des provinces du nord, M. Constantin Douca, partait ce jour même pour se rendre à Lamia, situé sur la frontière de Thessalie. On nous engagea à faire route avec lui, pour que, placés sous sa sauve-garde, nous n’eussions rien à craindre. La demande que nous lui en fîmes fut accueillie; nous nous hatâmes donc de faire nos préparatifs de départ. M. Dalgabio, retenu par plusieurs importants sujets d’étude, et notamment celle du temple de la Victoire sans ailes, se détermina à attendre notre retour à Athènes; M. Rey et moi nous nous en séparâmes, en regrettant son concours dans les explorations que nous allions entreprendre. Munis d’un guide, d’une couverture, meuble indispensable, et de quelques comestibles, nous partîmes d’Athènes dans l’après-midi du 22 septembre.
Le gouverneur était un ancien chef de Palicares, qui avait combattu dans les dernières guerres, il avait une stature peu élevée mais forte, et une voix de stentor. L’énergie de son caractère, sa réputation militaire et l’ascendant de sa parole sur le peuple l’avaient fait choisir pour ce poste difficile; il était accompagné de son secrétaire. Un employé supérieur de l’administration des tabacs, M. Bréban, envoyé par le gouvernement français pour connaître l’état de leur culture dans le Levant, voyageait, ainsi que nous, sous l’égide du gouverneur.
Après avoir passé par Eleusis et traversé la chaîne du Citéron, nous entrâmes dans les champs de Platée, village en ruines, arrosés par l’Asopus; nous traversâmes ce fleuve à l’endroit où le général des Perses, Mardonius, avait établi son camp sur la rive gauche.
Cette vaste plaine est fermée à l’occident par l’Hélicon, au pied duquel Leuctres est situé ; plus loin, au nord, est Thèbes; le Parnasse couvert de neige forme le dernier plan du tableau. Le soleil levant produisait sur ces monts des effets que nulle description ne saurait rendre, et dont nos Alpes, dans leurs plus magiques aspects, n’offrent qu’une image décolorée. Avides de recueillir le souvenir de ces lieux où s’attachent l’intérêt de l’histoire et des temps fabuleux, nous voyagions le carnet à la main; car nous sentions que chaque pas nous en éloignait sans espoir de retour.
En entrant à Thèbes, le voyageur cherche avec empressement quelques traces de monuments qui rappellent les poètes, les héros et les demi-dieux qui l’ont illustrée; mais elles ont disparu, et la patrie d’Hercule, d’Epaminondas et de Pindare, n’est plus qu’un bourg moderne construit sur l’acropole de l’ancienne ville. Parmi quelques débris épars qui s’y voient encore, sont plusieurs chapiteaux ioniques et corinthiens en marbre, et les restes d’une stelle représentant un quadrige de la plus belle époque de l’art. Ces fragments existent dans une salle où se réunissent les enfants de Thèbes, sous un instituteur qui leur donne l’instruction première par le mode de l’enseignement mutuel, tel qu’il se pratique dans nos écoles en France.
Quelques parties des murs qui formaient l’enceinte de l’acropole se remarquent encore, mais il faut les chercher au niveau du sol et parmi les décombres.
Il ne reste plus aucune trace des sept portes qui se voyaient au temps de Pausanias. L’une d’elles, nommée Crénéa, à cause de la fontaine de Dircé qui en était voisine, se trouvait peut-être auprès de la fontaine dont les Turcs ont formé une suite de onze jets qui tombent dans autant de bassins, près de l’église Saint-Isidore, où l’on remarque quelques fragments d’ornements en marbre, de l’époque du bas empire grec.
On conserve, dans une petite église en ruine les tombeau de saint Luc, mutilé par les Turcs. Les Grecs ont pour ce tombeau une dévotion particulière, ils y apportent pour offrande des couronnes, de petits cierges allumés et de l’encens.
Nous partîmes de Thèbes, et passant près du bourg d’Ascra, nous arrivâmes à Lebadée vers la fin du même jour. Cette ville n’offrait plus qu’un monceau de ruines sur lesquelles le peu d’habitants échappés aux fureurs des dernières guerres étaient venus construire de nouvelles demeures.
Le gouverneur se rendit d’abord chez le démarque, M. Lambranoco, à qui il nous présenta; celui-ci nous accueillit avec cette politesse grave qui est dans les habitudes de ce peuple, nous offrit de prendre le repas au milieu de sa famille, et voulut nous donner l’hospitalité.
Les principaux de la province se réunirent chez lui; il s’agissait d’élire des députés qui devaient se rendre à Athènes pour s’occuper de la constitution.
L’assemblée était nombreuse; parfois l’entretien était animé, le gouverneur parlait souvent et longtemps, et, par une transition d’idées inexplicable, pendant que les autres Grecs continuaient à discuter, il prenait une guitarre, en jouait, puis revenait à la discussion. Au nombre des députés des villes à cette assemblée préparatoire, était un habitant du Parnasse; ce n’était pas Apollon, on eut dit plutôt Marsyas; son profil de satyre, ses mouvements brusques attirèrent notre attention, il parlait moins souvent debout qu’accroupi sur ses talons, et, par une force musculaire prodigieuse, il s’abaissait et se relevait verticalement sans nulle apparence d’efforts. L’épouse du démarque prenait part aux discussions politiques; le feu qu’elle y mettait formait un contraste avec le calme et la gravité de son mari.
Empressés de voir l’antre de Trophonius, nous demandâmes à y être conduits. Notre guide nous mena sur le bord du torrent d’Erchina qui coule entre deux rochers à pic. Il nous fit remarquer dans le roc des niches creusées, indice d’un lieu sacré ; auprès est une étroite ouverture que les habitants tiennent pour être celle de l’antre de Trophonius. Muni d’un flambeau, je m’avance avec peine et presque en rampant. A la faible lueur qui éclaire ce souterrain, j’aperçois le chemin dévier et descendre, je lance une pierre au-devant de moi et j’entends le bruit de l’eau dans laquelle elle était tombée; c’était un réservoir naturel des cours d’eau intérieurs de la montagne; je me hâtai de regagner l’ouverture de l’antre.
Mieux renseigné par un ingénieur macédonien, M. Naum, qui résidait à Lébadée, et prenant Pausanias pour guide, nous gravîmes le rocher à une hauteur d’environ cinquante mètres. Nous parvînmes à une plate-forme autour de laquelle on remarque des niches sacrées. Sur le sol se voyait l’orifice d’une ouverture comblée; là était l’antre de Trophonius. C’est donc là qu’on faisait descendre ceux qui voulaient consulter l’oracle, après leur avoir fait subir de longues préparations; c’est là que, dans les ténèbres, les prêtres effrayaient leur imagination par des apparitions soudaines, par des bruits indéfinissables, et d’où ils ne sortaient le plus souvent que sous l’impression de quelque douleur violente qui leur ôtait le sentiment et presque la vie, et qui leur laissait pour toujours un fond de tristesse que rien ne pouvait surmonter.
L’aspect des lieux coïncide parfaitement avec la description qu’en a faite le voyageur grec.
Les niches qui se voient à la base du rocher sur les rives du torrent indiquent la position du bois sacré ; près de là, on voit encore les deux sources du Léthé et de Mnémosine, où devaient boire ceux qui voulaient consulter l’oracle, à l’une pour perdre le souvenir du passé, à l’autre pour conserver la mémoire de ce qu’ils allaient voir et entendre.
Cet oracle devait être un des plus anciens de la Grèce, puisque les Thébains alléguant une vieille inscription, disaient qu’Amphytrion, voulant épouser Alcmène, fit faire une chambre nuptiale par Trophonius et Agamède, les deux célèbres architectes de son temps, auteurs du premier temple d’Apollon à Delphes.
Après avoir remercié nos hôtes de leur bon accueil, nous primes le chemin de Chéronée. Cette ville, située à l’extrémité d’une vaste plaine, est adossée aux montagnes qui en forment l’enceinte.
Avant d’arriver à la ville, nous vîmes les débris épars du lion élevé par les Grecs sur la sépulture des Thébains qui périrent en combattant contre Philippe; il est en marbre, nous nous empressâmes d’en dessiner les fragments. Il est aisé de reconnaître qu’il était assis, et que sa longueur était d’environ 3 mèt. 50 c.
Ainsi, l’on consacrait la mémoire des grands évènements. Ces débris entretiennent encore chez les jeunes Grecs le souvenir de la gloire de leurs ancêtres et même de leurs illustres revers. Un vieux soldat veillait auprès des restes du lion, il se plaisait à nous les expliquer.
Le gouverneur de Lamia, qui avait assisté à nos recherches, nous quitta dans cet endroit pour se rendre à la frontière de Thessalie.
Le premier monument antique qu’on aperçoit en entrant à Chéronée, est le théâtre adossé à lA’cropole. Ce monument est taillé dans le roc ainsi que le théâtre d’Argos. Non loin, dans une église ornée de peintures d’une parfaite conservation, est un siége en marbre que les habitants disent avoir appartenu à Plutarque.
Ce siège, dont quelques parties sont mutilées, est véritablement antique. Il a pu exister au temps de l’historien, mais qui pourrait assurer qu’il lui ail appartenu? C’est chez les habitants une pieuse croyance que nous nous sommes bien gardés de troubler en manifestant quelque doute à son sujet. Nous n’eussions pas été moins curieux d’y voir le sceptre de Jupiter qui avait passé de ce dieu à Mercure, à Pélops, à Atrée, à Thieste, à Agamemnon, que les prêtres conservaient et auquel ils faisaient des sacrifices. On peut pardonner cette prétention à des citoyens qui disaient que c’était au sommet de leur Acropole, que Rhéa trompa Saturne en lui présentant une pierre au lieu du petit Jupiter qu’elle avait mis au monde.
Le lendemain, après avoir suivi de longs défilés au pied du Parnasse, nous arrivâmes à Delphes, situé sur la pente du mont.
Le premier objet qui frappe les regards en entrant dans la ville, est le double sommet tant célébré par les poètes. Ce sont deux pics élevés du milieu desquels s’échappe l’eau de la fontaine Castalie. Le mont Parnasse s’étend de la mer de Corinthe jusqu’à la chaîne de l’Oéta. Il surpasse en hauteur tous les monts de la Grèce. L’imagination poétique des Grecs en avait fait le séjour d’Apollon et des Muses; toutefois on s’attendrait en vain à trouver dans ces lieux de riants bocages; la nature y est grande, mais l’aspect en est sauvage, les rochers y sont nus, et les ruisseaux y sont des torrents. Une partie des eaux de la fontaine Castalie est conduite encore aujourd’hui dans l’antique bain creusé dans le rocher; des marches également taillées dans le roc servent à y descendre, et des niches destinées à recevoir des offrandes témoignent que ce lieu était consacré à une divinité.
Dans le milieu de la ville, on voit les restes du temple d’Apollon, célèbre dans toute la Grèce et jusque chez les peuples de l’Occident.
Il fut construit vers l’an 513 avant J.-C. par l’architecte Spintarus, de Corinthe, 900 ans après l’incendie de celui dont Trophonius avait été l’architecte, ce même Trophonius qui, après le vol du trésor du temple et le meurtre de son frère Agamède, fut englouti dans la terre entr’ouverte sous ses pas.
Dans les fouilles qu’on y a faites, on a découvert des tambours de colonnes doriques revêtues de stuc, des chapiteaux ioniques en marbre d’une grande dimension, des fragments de corniche ornée qui ont dû appartenir au faîte de l’édifice; enfin, une partie du soubassement du temple. Celle-ci est en marbre et de travail cyclopéen.
La partie visible de ce mur a huit mètres de longueur; elle est couverte par une inscription qui fait connaître les noms des archontes sous lesquels des dons ont été faits pour la construction du temple. Cette inscription est divisée en deux parties par un recreusement profond en forme de lyre. Au temps de Spon, aucun vestige de ce monument n’était visible, il fut réduit à en conjecturer l’emplacement.
Il ne reste rien du théâtre dont parle Pausanias, mais le stade qui était placé au dessus se reconnaît en entier. On y voit encore les gradins qui servaient de sièges aux juges des jeux pythiens. Ils sont taillés dans le roc et occupent l’extrémité septentrionale du stade. De ce point élevé, la vue s’étend jusqu’à la mer de Crissa, et au mont Cyllène dans le Péloponèse.
Le stade était dominé par la roche Hiampie, d’où les Delphiens précipitèrent Esope en présence du peuple accouru pour être témoin du meurtre de ce sage, à qui la Grèce aurait dû élever des statues.
Au dessous de la fontaine Castalie est un monastère où l’on trouve parmi quelques fragments antiques, un bas-relief qui représente le torse nu d’une figure de grandeur naturelle, dans l’attitude de tendre un arc. Ce fragment est de la plus belle époque de l’art. Les Religieux prétendent que c’est un Homère; on doit plutôt y voir un Apollon: son attitude, la jeunesse des formes et l’idéal qui règne dans toutes ses parties, autorisent cette conjecture. Là se voient aussi des murs construits en grands blocs, à lits horizontaux: ce sont les restes du Gymnase. C’est dans ce lieu qu’Ulysse fut blessé au dessus du genou par une laie qu’il poursuivait et qui y laissa une cicatrice à laquelle Euriclée le reconnut. Dans ce moment nous fûmes surpris par un orage affreux l’eau ruisselait sur les rochers et coulait en torrent dans la vallée, et cependant nous ne pouvions nous arracher de ces lieux que nous allions quitter pour toujours. Nulle ville de la Grèce ne fut plus célèbre par la pompe des cérémonies religieuses auxquelles accouraient tous les peuples, ni plus riche en monuments des arts, en offrandes du plus grand prix; mais aussi nulle ville n’excita à un plus haut degré l’avidité des peuples qui vinrent tour à tour la dépouiller de ses richesses et détruire ses monuments.
Nous partîmes de Delphes pour nous rendre à Aracova, nous approchions de ce bourg, et déjà nous esquissions la vue de la vallée que nous venions de parcourir, lorsque nous fûmes entourés par un groupe de jeunes grecs aux regards intelligents, à la physionomie heureuse. L’un d’eux, nommé Demitri, jettant les yeux sur un volume de Spon que j’avais auprès de moi, le prit, en lut le titre correctement et le traduisit. Le latin ne lui était point étranger. Plusieurs de ses jeunes émules s’empressèrent à l’envi de me faire voir qu’eux aussi étudiaient notre langue.
Le bourg d’Aracova est situé sur la pente du Parnasse; les hommes y sont, comme dans toute la Grèce, d’une belle stature, et les femmes y sont les plus belles que nous ayons vues nulle part; leur beauté est même passée en proverbe parmi les Grecs. Ce ne sont point cette beauté et ces grâces de la Vénus de Médicis; les femmes d’Aracova semblent être formées plutôt sur le type de la Vénus de Milo ou de la Junon du Capitole.
Nous nous dirigeâmes vers le nord. Il nous fallait traverser le mont Cnémus par des sentiers étroits pratiqués dans les rochers suspendus sur les précipices. De ces sommets, nous voyions l’île montueuse d’Eubée; déjà nous étions parvenus à sa base, dans des forêts de chênes, de pins et de sycomores, lorsque nous aperçûmes une multitude d’hommes munis d’armes, couchés, ayant leurs chevaux auprès d’eux. Nous pensâmes être tombés dans une embuscade de voleurs; notre attention se porta rapidement sur nos guides, et voyant leur calme, nous les crûmes affidés à des bandits à qui ils venaient de nous livrer. Mais nous reconnûmes bientôt notre erreur: c’étaient des muletiers, armés comme ils le sont toujours, qui venaient de transporter leurs denrées dans les villes les plus voisines, et qui étaient venus, comme nous, se désaltérer à une source, lieu de halte ordinaire, et se reposer sous l’ombrage des grands arbres qui l’entourent.
Arrivés sur la plage, nous entrâmes le 30 septembre dans le défilé des Thermopyles, que nous reconnûmes bientôt par sa conformité avec les descriptions qu’en ont faites les historiens. C’est bien là cet étroit passage entre des monts escarpés d’un côté, la mer et des marais impraticables de l’autre. Nous desirions voir la source des eaux thermales qui ruisselaient autour de nous et d’où s’exhalait une forte odeur de soufre, mais nos guides, trompés sur nos intentions, nous conduisirent vers les sommets élevés de l’Oéta, pour nous montrer les restes d’un mur construit par les Phocéens, antérieurement au combat des Grecs et des Perses, afin de se garantir des incursions des Thessaliens.
Après bien des fatigues inutiles, nous redescendîmes les monts de rochers en rochers jusqu’au fond du précipice où roule l’Asopus de Thrachinie. Parvenus au bas de la montagne, nous traversâmes le Sperchius, dont les eaux jaunâtres et profondes se jettent dans le golfe Malliaque, et forme la limite entre la Grèce et la Thessalie.
Après deux heures de marche dans une vaste plaine tranchée de marais, nous arrivâmes enfin à Lamia, ville de la Phtiotie, patrie d’Achille. Déjà le gouverneur était arrivé à sa résidence; nous fûmes assez heureux pour trouver à Lamia un médecin français, M. Dumont, qui avait fait, en 1826, partie de l’expédition française en Morée. Il voulut bien nous accompagner dans une seconde excursion que nous fîmes aux Thermopyles, nous y-servir de guide et nous expliquer ces lieux qu’il avait étudiés souvent et comparés avec-les écrits d’Hérodote. Il nous conduisit à la source des eaux thermales; elles sortent avec abondance du creux des rochers, serpentent d’abord parmi les roseaux, et se répandent ensuite sur le sol qu’elles exhaussent par le dépôt de leur sédiment. Nous reconnûmes la position de l’armée de Xerxès, l’étroit chemin où se replièrent les Grecs emportant le corps de Léonidas, la colline où ils se défendirent encore quelques instants et rendirent les derniers soupirs.
Cette éminence domine le défilé ; on y voyait un temple à Cérès. Les Grecs y élevèrent des tombeaux à Léonidas et à ses compagnons, et des inscriptions parlaient de leur mort glorieuse; inscriptions, temple, tombeaux, tout a disparu; mais le théâtre de cette action mémorable existe encore comme au jour du combat. En effet, que peuvent le temps et les hommes sur une mer, sur les rochers de l’Oéta et sur les sources cachées de ces eaux brûlantes qui ont fait donner à ce passage le nom qui, d’âge, en âge s’est conservé chez le peuple jusqu’à nos jours.
Après avoir offert à la mémoire de ces héros notre tribut d’admiration, et recueilli dans nos cahiers plusieurs souvenirs de ces lieux, nous songeâmes à retourner à Athènes. Ayant donc pris congé du gouverneur, de M. Dumont, dont l’obligeance nous fut si utile, de M. Bréban, ce bon et aimable compagnon de voyage, et munis d’une escorte pour traverser des parages peu sûrs, nous prîmes le chemin de l’Attique.
Ayant traversé des champs de myrthe, de lauriers-roses, des forêts détruites par la flamme, et d’autres brûlant encore, malgré les efforts que fait le gouvernement pour en arrêter les progrès, nous arrivâmes en face de l’extrémité septentrionale de l’Eubée. On y voit l’île ou plutôt le rocher, métamorphose de l’infortuné Lichas, qu’Hercule, dans sa fureur, lança dans la mer après avoir reçu de lui la tunique empoisonnée du Centaure Nessus.
Nous arrivâmes à Chalcis. Dans toute cette pénible route, depuis Lamia, nous n’eûmes pour gîte que les chétives demeures des habitants: quatre murs en terre sans cheminée, le foyer établi au milieu de l’aire, la porte pour toute ouverture, pour meuble un coffre à serrer les vêtements, une table à quelques pouces de terre autour de laquelle la famille s’assied accroupie, pour lit une natte de jonc et une couverture, une planche pour déposer les menus objets, quelques clous fixés dans les murs pour y suspendre les armes. Du reste, dans toutes les habitations grecques, même dans celles des villes, nous avons remarqué cette complète absence des superfluités dont nous remplissons nos demeures.
Chalcis est unie au Continent par un pont de bois de peu d’étendue, jeté sur l’Euripe dont nous avons vu l’eau peu profonde courir avec rapidité du nord au midi et du midi au nord, par intervalles égaux de six heures. Sur les diverses portes de cette capitale de l’Eubée, on voit le lion de saint Marc, indice de la possession des Vénitiens, et quelquefois des fleurs-de-lys. Les rues en sont étroites et tortueuses, et les décombres dont elle est remplie sont les effets des dernières guerres.
Près de Chalcis, sur le rivage de la Grèce, est une anse formée par deux promontoires; là, était le port d’Aulis où la flotte d’Agamemnon fut si longtemps retenue par les vents. Les vaisseaux réunis pour cette expédition fameuse n’auraient pu y être contenus, mais la rade qui s’étend jusqu’à l’Eubée leur donnait tout l’espace nécessaire. Nous vîmes là, comme en tant d’autres lieux, que la nature avait repris tous ses droits; nulle trace d’habitation ni de ces Grecs menaçants dont nous avons vu les tombeaux sur la côte de l’Asie dans ces champs ravagés par eux. Une base de colonne en pierre est le seul fragment qui atteste à Aulis que jadis une ville exista là ; nous l’avons marquée dans nos dessins; plus ces débris sont rares, plus on doit s’empresser de les recueillir.
En suivant la côte, nous arrivâmes à l’embouchure de l’Asopus de Béotie, et limes une station à la fontaine d’Oropos, non loin de Tanagra, patrie de cette Corinne dont on vit plusieurs fois dans les combats de poésie les ouvrages préférés à ceux de Pindare.
Enfin, nous rentrâmes à Athènes, après dix-sept jours d’absence; les Athéniens s’occupaient alors du choix de leurs députés. La jonction des deux rues principales d’Eole et d’Hermès et le café de la Belle-Grèce étaient le forum où ils se réunissaient, mais sans tumulte et sans bruit inquiétant.
Les Grecs, dans des jours si voisins de leur révolution, s’occupaient avec calme des affaires de l’Etat. Une révolution en Grèce n’a pas l’aspect hideux de l’émeute dans nos villes; nul jurement (les Grecs n’en connaissent pas), nul cri ne troublent la régularité de leur physionomie et n’en altèrent la noblesse. On chercherait en vain chez eux ces prévenances, ces soins adulateurs et cet esprit de galanterie qui dominent si fortement dans nos habitudes de société ; les hommes ont entr’eux de la dignité, et les femmes semblent n’avoir avec eux aucun commerce. Nul mélange des sexes, nulle conversation. Est-ce chez les hommes une pudique réserve? Est-ce une insouciance peu naturelle, ou un injuste dédain? C’est, peut-être, un peu de tout cela, et l’exemple de l’esclavage des femmes qui leur a été donné si longtemps par les Turcs, influe peut-être encore sur les mœurs des Grecs devenus libres. Mais l’instruction qui se répand dans toutes les classes, par le bienfait de l’institution d’une bibliothèque publique et d’une école pour renseignement des sciences, des lettres et des arts, le contact avec les autres nations européennes, modifiera insensiblement leurs usages; ils goûteront les charmes d’une civilisation qui ne peut s’accomplir si les femmes n’y sont de moitié.
Un vaisseau partait pour Constantinople, M. Dalgabio ayant terminé les travaux auxquels il s’était livré à Athènes, pendant notre absence, monta à son bord pendant que M. Rey et moi nous entreprîmes le voyage de Corinthe par Epidaure.