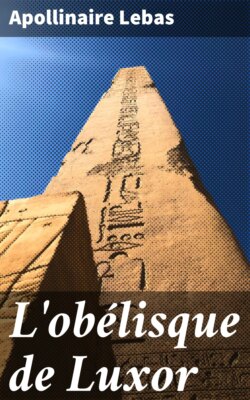Читать книгу L'obélisque de Luxor - Apollinaire Lebas - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II.
ОглавлениеTable des matières
Départ de Toulon et arrivée à Alexandrie. — Entrevue avec Mehemet-Ali. — Départ d’Alexandrie. — Rosette. — Aspect du Nil et de ses rives. — Arrivée au Caire. — Krali-Effendi. — Départ de Boulac pour la Haute-Égypte. — Les pyramides; Memphis. — Scheriff Bey. — Denderah. — La flottille arrive en vue de Thèbes.
LE Luxor, chargé de tous les apparaux dont on se sert habituellement dans les manœuvres de force, appareilla de la rade de Toulon le 15 avril 1831, par une brise favorable de N.-O., et atteignit en cinq jours les côtes de la Sicile.
Depuis notre départ nous naviguions vent largue ou vent arrière; sous ces deux allures, le bâtiment se comporta très-bien et fila jusqu’à huit nœuds. Il n’en fut pas de même lorsque, dans la journée du 21, les vents ayant passé à l’est, on fut obligé de louvoyer. Le Luxor manquait des qualités nécessaires à ce genre de navigation; il dérivait beaucoup, inconvénient prévu, mais inévitable résultat de sa conformation forcée. Nous passâmes la nuit du 24 au 25 en calme au milieu d’une mer houleuse qui fatiguait beaucoup la mâture: le lendemain, la brise ayant repris de la partie N.-O., nous continuâmes notre route sans autres contrariétés ni accidents, et le 3 mai le Luxor mouilla dans le port d’Alexandrie en face du palais du vice-roi.
Quelques minutes après, M. Cardin, chancelier de France, était à bord; il nous apprit que M. Mimaut, consul général, se trouvait au Caire auprès du vice-roi, qui habite cette ville pendant la mauvaise saison. La présence et le concours de M. Mimaut m’étaient indispensables pour mettre à exécution le projet que j’avais formé pendant la traversée: je m’étais proposé de partir immédiatement pour la Haute-Égypte, de devancer le Luxor à Thèbes, afin d’explorer avant l’inondation le terrain sur lequel je devais opérer, de préparer un lit d’échouage pour recevoir le navire, et de commencer en même temps les travaux préparatoires. Tout fut forcément suspendu jusqu’à l’arrivée du consul à Alexandrie; elle n’eut lieu que vingt jours après. Cette contrariété au début de la campagne me parut d’un mauvais augure.
Toutefois je consacrai ce laps de temps à parcourir la ville aux grands souvenirs, dont les monuments servent de signaux de reconnaissance aux marins, et guident l’Arabe dans le désert.
Tout a été dit sur Alexandrie, sur ses ruines confuses, sur son sol remué et bouleversé dans tous les sens; c’est un sujet épuisé pour l’érudition, il ne reste plus au voyageur qu’à voir, admirer et se taire.
Parmi les débris de l’ancienne ville, les aiguilles dites de Cléopâtre attiraient naturellement mon attention; souvent j’allais les visiter pour prendre des inspirations sur les lieux, étudier, méditer les données du problème dont j’avais entrepris la solution, et préparer par la pensée les procédés que je me proposais d’employer plus tard.
A la vue de ces monolithes, je ne me dissimulai pas les difficultés que devait offrir le déplacement d’une masse aussi considérable; mais je puisais dans la nouveauté même de cette opération la confiance, l’énergie et la persévérance nécessaires pour les surmonter.
Le 8 juin, le pacha nous reçut dans son palais, situé sur le Pharos . Prévenu d’avance par le consul général de ma petite stature, il eut l’air de ne pas s’apercevoir de ma présence, et demanda en riant: Où donc est l’ingénieur? Sur ma présentation par M. Mimaut, il ajouta: Il était donc caché derrière vous, dites-lui de s’asseoir à côté de moi pour que je le voie. Cette circonstance fournit du reste au vice-roi l’occasion de faire quelques plaisanteries qui décelaient en lui une imagination vive, un esprit prompt à saisir des rapports.
Son œil, toujours vif et scrutateur, ne laisse rien échapper, sa finesse, sa perspicacité, la profondeur de ses idées, ses réparties heureuses, lui donnent sur tous ceux qui l’approchent un empire auquel il serait assez difficile de se soustraire .
Mehemet-Ali, passionné pour les grandes entreprises et généralement pour tout ce qui sort de la ligne ordinaire, nous témoigna à plusieurs reprises le vif intérêt qu’il prenait au succès de notre hardi projet. «Je m’y intéresse, nous dit-il,
» comme s’il était exécuté en mon nom et pour ma gloire. Les ordres les plus
» formels sont déjà donnés pour que rien de ce qui peut contribuer à l’accomplissement
» de cette œuvre gigantesque ne vous soit refusé.»
Le vice-roi m’adressa ensuite, ainsi qu’au capitaine, diverses questions fort judicieuses, relatives à la flotte que construisait M. de Cerisy, ingénieur de la marine; enfin la généreuse et noble conduite de Mehemet-Ali, son empressement à m’assurer toutes les facilités désirables et le concours des autorités locales m’inspirèrent la plus grande confiance dans la mission qui m’était confiée.
Dès ce moment rien ne me retenait plus à Alexandrie, le matériel avait été transbordé du Luxor sur des barques du pays, appelées djermes , tout était prêt pour mon départ que des circonstances indépendantes de ma volonté avaient retardé jusque-là.
Le 11 juin, au lever du soleil, les bateaux de transport firent voile pour Rosette; je m’étais embarqué avec tous les ouvriers sur la plus grande des djermes qui composaient cette petite flottille. Vers les quatre heures du soir, la couleur jaunâtre des eaux et la figure rembrunie du patron nous annoncèrent l’approche de l’une des bouches du Nil. Cette embouchure est obstruée par des monticules de sable qui se déplacent journellement. Le courant du fleuve, combiné avec la violence de la mer, se crée à travers ces obstacles une ou plusieurs ouvertures souvent sinueuses et de profondeur inégale; la passe qui est reconnue navigable se nomme Boghas (2). Elle est toujours bordée d’écueils sur lesquels les lames viennent déferler, en se déployant avec plus ou moins d’écumes, suivant la force du vent qui les agite. Malheur au navire qui se trouve enveloppé dans ces brisants! il court le risque d’être jeté à la côte et d’y périr. Bientôt nous aperçûmes deux djermes renversées et couvertes en partie d’alluvions, indices certains de naufrages antérieurs; nos barques, toutefois, traversèrent ce passage dangereux en sillonnant le fond sans accident; nous entrâmes ainsi dans ce superbe fleuve, après avoir contourné une île qui n’existait pas il y a quarante ans; c’était au contraire le point de la barre le plus profond où mouillèrent en 1799 les canonnières de l’armée française. Trois heures après nous étions à Rosette, au milieu du plus frais et du plus verdoyant de tous les pays.
Cette ville, autrefois si riche, si florissante, naguère l’un des principaux entrepôts du commerce de l’Orient, languit dans une triste décadence depuis l’ouverture du canal du Mahmoudie ; ce canal dont l’entrée est située à trois lieues en amont joint le Nil au vieux port d’Alexandrie. Toutes les productions de l’Égypte s’écoulent par cette voie, qui exige moins de dépenses et offre plus de sécurité que le transport par mer; aussi la population de Rosette a-t-elle considérablement diminué, à en juger par le grand nombre de maisons qui ne sont pas habitées.
Là il fallut encore transborder le matériel sur des agabas, bateaux à fond plat, destinés spécialement à la navigation du Nil; pendant ce temps le Luxor franchit le Boghas et vint mouiller à Rosette, où il dut séjourner en attendant que la crue du fleuve lui permît de continuer sa route jusqu’à Thèbes. Quelques marins furent répartis sur les agabas; M. Jaurès, élève de première classe, et M. Pons, médecin en second, s’embarquèrent avec moi sur une cange, canot léger, étroit, qui marche avec la plus grande vitesse, soit à la voile, soit à l’aviron. Une maisonnette en bois s’élève à l’arrière de cette embarcation; elle est divisée en deux chambres: la première sert de salon et de salle à manger, la seconde de chambre à coucher. Tous ces préparatifs étant ainsi disposés, nous dîmes adieu à nos compagnons de voyage restés à bord du Luxor, et le 19 juin la flottille, appareillant de Rosette, commença à remonter le Nil.
C’est alors surtout que notre attention fut vivement excitée par les objets qui nous environnaient. Tout était nouveau pour nous, l’aspect des lieux, les arbres, les plantes, les costumes et le langage des Arabes, qui accouraient en foule sur le rivage, et pour lesquels nous étions nous-mêmes un objet de curiosité ; notre vue se reposait agréablement sur le Delta, sur cette terre de nouvelle création, dont les productions nombreuses et variées sont pour la plupart inconnues en Europe. Non loin de Rosette, et sur la rive gauche, se trouve la fameuse mosquée d’Abou-Mandour, lieu de pèlerinage, où les femmes viennent chercher une fécondité qu’elles attribuent aux eaux de la fontaine renfermée dans ce monument religieux; au delà, les deux rives bordées de roseaux déroulent à l’œil étonné du voyageur des forêts de palmiers, de mimosa, de riches moissons; mais auprès de ces fertiles campagnes sont de vastes déserts sans aucune apparence de végétation. Çà et là l’on aperçoit encore les vestiges d’un beau pays tombé dans la plus affreuse misère, de grands villages en ruines, des terrains fertiles perdus pour la culture, de mauvaises cahuttes construites en briques cuites au soleil, et plus souvent en terre. La partie supérieure de ces maisons, si toutefois on peut leur donner ce nom, est réservée aux colombiers, d’où s’échappent parfois des myriades de pigeons. Jamais le fusil meurtrier n’y effraie ces paisibles habitants. Les Arabes ne les mangent pas, ils ne les soignent que pour la fiente, dont ils font un excellent engrais.
L’Obélisque de Luxor.
Paris. Carilian-Gœury et Vr Dalmont éditeurs. Quai des Augustins 39 8c41.
Sous ces cabanes de boue, couvertes par des feuilles de palmier, végète une population malheureuse, qui n’a pour loi, pour institutions sociales, que le caprice et le bâton de quelques Turcs, souvent plus brutes que la brute même. Vous ne voyez partout que des hommes couverts de haillons, exténués par la faim, vieillis par les mauvais traitements et par les privations; des enfants des deux sexes entièrement nus, venant implorer l’assistance du voyageur. Au moindre signal fait par un Turc, tout Arabe est sujet à passer par les courbaches . Sous ce rapport il y a égalité parfaite dans les domaines du vice-roi: tout y est soumis à un despotisme affreux et, je le répète, stupide.
Notre navigation jusqu’au Caire présenta des difficultés auxquelles j’étais loin de m’attendre. Les reïs, ou patrons des agabas, exploitaient une des conditions de leur marché, comme à Paris le cocher de fiacre exploite le voyageur qui le prend à l’heure. Intéressés à rester en route le plus longtemps possible, ils échouaient à dessein leur bateau sur des bancs de sable. Cette manœuvre, qui retardait considérablement notre marche, me causait les plus vives inquiétudes. Déjà la couleur verdâtre des eaux indiquait une crue sensible; il fallait de toute nécessité arriver à Thèbes dans le plus bref délai, pour préparer avant l’inondation une cale d’échouage, d’où dépendait en partie le succès de l’opération. Pressés par cette considération, craignant surtout qu’il ne se perdît quelque partie du matériel dont la moindre parcelle m’était indispensable, nous profitions de la vitesse de la cange pour aller en avant, en arrière, à droite, à gauche, sur tous les points enfin où un agaba était échoué. Nous forcions les équipages à se haler dans les hauts-fonds, tantôt les aidant du mieux que nous pouvions, tantôt ayant recours à l’aide des habitants des villages les plus rapprochés.
Un de ces bateaux, celui qui portait les matériaux les plus importants, lefilinblanc , vint talonner sur un banc de sable et perdit son gouvernail. L’ébranlement causé par le choc détermina une voie d’eau considérable. Le cordage allait être mouillé, avarie qui pouvait avoir les conséquences les plus graves; il n’existait à bord ni pompes ni instruments dont on pût se servir pour épuiser l’eau, et ce ne fut qu’à l’aide de leurs chapeaux de cuir et des débris de quelques vases en poterie, que les marins et les ouvriers parvinrent à l’extraire de la cale. Cette opération terminée, les charpentiers et les calfats mirent le bateau en état de naviguer jusqu’au Caire. Nous arrivâmes dans cette ville le 27 juin 1831.
Je me rendis immédiatement à la citadelle, où réside le gouverneur, tant pour lui faire une visite que pour réclamer l’intervention de son autorité. La première chose qu’il fit, sur le rapport de l’interprète, fut de donner l’ordre de bâtonner les reïs, conformément à la charte du pays. Je m’opposai à cette cruelle punition; toutefois, pour prévenir la fourberie de ces derniers, je priai le gouverneur de faire embarquer sur la flottille quatre cawas , qui seraient chargés de les surveiller pendant la traversée. S. E. me répondit gracieusement qu’il n’avait rien à me refuser, et me remit en même temps une dépêche à l’adresse de Krali-Effendi, directeur de la navigation, par laquelle il autorisait ce fonctionnaire à mettre à ma disposition un nouvel agaba.
En sortant du palais nous descendîmes dans le puits dit de Joseph, qui n’offre rien de bien remarquable; il est creusé dans le rocher et à une assez grande profondeur. On en élève l’eau au moyen de plusieurs roues garnies de godets en terre. Je me reprochais déjà d’avoir accordé quelques minutes à ma curiosité, lorsque notre interprète, Joussouf, ancien mamelouck français, me fit observer, avec son flegme imperturbable, que l’heure avait déjà sonné où tout bon musulman se renferme dans son harem, que le directeur de la navigation ne serait visible que le lendemain dans l’après-midi. Bon gré malgré il fallut se soumettre à ce retard forcé.
L’audience était pour quatre heures; Krali-Effendi, assis sur une espèce de tribune élevée sur la plage, et abritée par des tentes contre l’ardeur du soleil, donnait des ordres aux marins du Nil. Aussitôt qu’il m’aperçut, il me fit signe de m’asseoir à côté de lui. C’était un homme de haute taille, d’une force herculéenne, d’une figure commune, et dont le regard dur et impérieux faisait trembler tous les Arabes.
Après le cérémonial d’usage, je lui exposai le motif qui m’amenait auprès de lui. Au lieu de me répondre, il nous raconta qu’il avait été chargé par le Pacha de transporter à Alexandrie les pierres du roi de France (c’est ainsi qu’il appelait les obélisques de Luxor ). «Arrivé sur les lieux, me dit-il, je fus effrayé de la grandeur
» et de la masse de ces monuments. Ce n’est pas au premier coup d’oeil, mais
» après avoir fait des calculs très-exacts, que je reculai devant les difficultés d’une
» entreprise dont l’exécution me paraît impossible.»
A l’appui de son assertion, il me présenta une règle divisée en parties égales, portant des numéros d’ordre qui indiquaient le cube et le poids de la tranche horizontale du monolithe correspondant à une hauteur proportionnelle à chaque division de l’échelle, ce qui donnait pour poids total environ 500 milliers; «immense
» fardeau, ajouta-t-il, que tu tenteras vainement de déplacer et. de descendre
» de sa base sans accident.»
Étonné de l’instruction et de la justesse des calculs de Krali-Effendi, je lui adressai quelques questions sur la position des obélisques par rapport au fleuve et aux ruines, et sur leur état de conservation. Il me répondit que l’obélisque de droite, en entrant dans le temple, était sillonné par une fissure qui, partant de la base, s’élevait jusqu’au tiers environ de la hauteur. Cela n’est pas possible, m’écriai-je, en me tournant vers le drogman, vous avez mal compris ou mal interprété, le pyramidion seul est ébréché. Mon exclamation, mon étonnement, firent sourire le directeur; il se leva pour me montrer sur un des poteaux de l’estrade une gerçure à peu près semblable à la fente de l’obélisque; en me faisant observer, toutefois, qu’il n’avait pas pu s’assurer si cette fente traversait le granit, parce que la face opposée est cachée par des maisons où sont renfermées des femmes, asile toujours respecté par un Turc . Prenant ensuite le calepin que je tenais à la main, il se mit à dessiner sur un des feuillets le croquis d’un chameau monté par un Arabe du désert. Si les observations du directeur m’avaient étonné, je le fus bien davantage en voyant le dessin qu’il venait de tracer sous mes yeux . Le chameau était bien représenté ; la physionomie de l’Arabe parfaitement caractérisée.
Krali-Effendi avait appris les éléments du dessin et de la géométrie sous la direction de M. Coste, architecte français, et il avait conservé, non sans raison, une haute idée des talents de son maître. Après cet entretien, qui se prolongea plus de deux heures, il donna l’ordre au maître de port de mettre à ma disposition un des meilleurs bateaux du Nil.
Pour revenir à la fissure dont m’avait parlé Krali-Effendi, il est remarquable qu’elle n’a été signalée ni dans le grand ouvrage sur l’Égypte, ni dans la relation plus récente de Champollion jeune. On y trouve, au contraire, que le fut de l’obélisque de droite est dans un état parfait de conservation. Je me fis donc un cas de conscience de croire qu’elle existait réellement; et, me complaisant dans le doute à cet égard, je tâchai de me persuader que Krali-Effendi s’était trompé, qu’il avait peut-être confondu le monolithe de droite avec celui de gauche, dont la partie inférieure est en effet fracturée, ou qu’il avait imaginé ce prétexte pour s’excuser auprès du pacha de l’insuccès de sa mission.
Je croyais bien n’avoir plus d’obstacle à rencontrer: mais il n’en était pas ainsi; le lendemain de mon entrevue avec le directeur de la navigation, le maître du port prétendit que tous les agabas étant chargés, celui qui m’était destiné ne serait disponible que dans trois jours. Informé, par expérience, de l’esprit de rapine qui anime les agents subalternes du pacha, je lui glissai dans la main quelques kiriès (petites pièces d’or); le contact de ce métal, éveillant tout à coup son empressement et sa sollicitude, eut bientôt mis fin à cette difficulté. Une heure après, j’étais en possession de l’agaba tant désiré, et, grâce à un nouvel emploi du même argument, j’obtins les hommes nécessaires pour opérer le transbordement.
Le 3o juillet au soir, la flottille appareilla de Boulac pour la Haute-Égypte. Nous allions enfin atteindre le but désiré ; c’est alors que, rassuré par la présence des cawas qui montaient quatre de nos bateaux, je me décidai à faire une rapide excursion jusqu’aux pyramides de Giseh.
Ces monuments, dont l’aspect est si grandiose, si imposant lorsqu’on les aperçoit des bords du fleuve, perdent de leur grandeur et de leur proportion à mesure qu’on gravit le plateau sur lequel ils sont posés. La raison en est, que leurs formes rentrantes et anguleuses les dissimulent à l’œil, et qu’après avoir traversé la zone cultivable, on ne trouve plus aucun objet qui puisse servir de termes de comparaison. Quoi qu’il en soit, le jugement s’égare en présence de ces masses régulières qui s’élèvent au milieu d’un vaste désert. Mais si l’on énumère le nombre (203) d’assises en grosses pierres qui constituent chacun de ces immenses escaliers pyramidaux, si l’on compare la hauteur de la marche moyenne à la taille d’un homme ordinaire, si l’on réfléchit que vu à une petite distance, le sommet paraît se terminer en pointe, tandis qu’il offre en réalité une surface équivalant à quarante mètres carrés, alors toute l’attention se porte sur des dimensions insolites que l’imagination seule peut embrasser, et qui, appréciées à leur valeur positive, et réduites en chiffre, donneront pour le côté de la base 233 mètres, pour hauteur totale 146 mètres, et pour le volume 2,662,628 mètres cubes.
Nous pénétrâmes dans l’intérieur de la plus grande pyramide par une ouverture pratiquée au tiers environ de la face ouest, et formant un canal incliné. Guidés à la lueur des flambeaux à travers ces antiques retraites, nous parcourûmes, avec une admiration qui commandait parmi nous le silence et une sorte de stupéfaction, de longues galeries et deux salles, dont la plus vaste renferme un beau sarcophage. Jamais rien de si grandiose n’avait frappé mes regards, c’est un travail gigantesque qui semble dépasser les efforts humains. La quantité de matériaux employés à la construction des Pyramides; les difficultés que durent offrir la superposition de ces blocs, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur; la durée, la solidité de ces masses inébranlables, aussi peu susceptibles de dégradation que les chaînes de montagnes qui limitent l’Égypte; les cent mille ouvriers qui y travaillèrent pendant plus d’un siècle, les placent au rang des plus grandes entreprises de l’homme . Quelle patience, quelle pratique suivie n’a-t-il pas fallu pour diriger, coordonner tant d’immenses détails! Les Pyramides, quoi qu’on en ait dit, n’en attestent pas moins aux générations présentes, comme elles le témoigneront aux siècles à venir, l’antique civilisation d’une société sans rivale, qui a pu trouver en elle des ressources suffisantes pour faire élever ces vastes nécropoles et des hommes capables de concevoir et de réaliser un semblable projet.
En sortant des Pyramides, nous nous dirigeâmes vers la plaine où l’on suppose que florissait Memphis. Selon la tradition, cet emplacement était traversé par le fleuve dont Mènes, premier Pharaon, détourna le cours, comme s’il était possible au premier roi d’un pays d’entreprendre et d’exécuter une pareille opération; nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet dans le cours de l’ouvrage. Il ne reste plus de cette antique cité qu’une grande chaîne de décombres, couverte de palmiers, des amas de pierres brisées et accumulées en tout sens. Toutefois on peut juger, par l’inspection des lieux, que cette ville a été parfaitement décrite par Hérodote et Strabon. Memphis était bornée au nord par les pyramides de Gizeh, et au sud par une file d’autres pyramides moins grandes, qui occupent plus de deux lieues de longueur.
Qui pourrait parcourir ce sol arrosé de sang français, et témoin naguère de nos triomphes, sans se rappeler avec admiration le courage et l’énergie de nos soldats? C’est là, disait notre conducteur arabe, que l’armée française s’ébranlant en masse, pulvérisa la meilleure cavalerie de l’univers (les mameloucks), malgré le nar kétir (le feu ardent) qui leur brûlait les pieds; et plus loin, ce nuage de poussière rougeâtre n’est-il pas habité par les âmes errantes des braves d’Héliopolis!
La journée du 30 juin fut consacrée à cette excursion. Douze heures de marche à l’ardeur du soleil nous avaient harassés de fatigue; la chaleur avait été si intense, que notre pauvre chien sautait sur le sable en poussant des cris douloureux, comme s’il eût posé ses pattes sur des charbons ardents; il aurait infailliblement succombé à ses souffrances, si quelqu’un de nous ne l’eût placé en travers sur son âne. A six heures du soir, nous arrivâmes à Sakkàra, bourg situé sur les bords du Nil, où nous attendait la cange.
Pressés de rejoindre la flottille qui devait nous devancer de quinze lieues environ, nous continuâmes à remonter le fleuve, dont les flots fécondants baignent une vallée sinueuse et limitée de droite et de gauche par une chaîne de montagnes blanches, ondulées et dépourvues de toute espèce de terre. Pendant le jour, la chaleur est excessive, insupportable pour un Européen; mais le soir la navigation du Nil devient très-agréable; la brise de N.-O. rafraîchit l’atmosphère; des étoiles, à peine visibles en Europe, brillent de tout leur éclat sous un ciel toujours pur et serein; rangés en cercle autour du grand mât, les matelots chantent des chansons arabes, et la cange, ses antennes apiquées, fait bouillonner par la rapidité de son filage les eaux du fleuve, où viennent se projeter par longues ombres des forêts de palmiers et de sycomores. Tout cet ensemble concourt à exciter dans l’âme un sentiment d’admiration calme et délicieux.
Devant nous passent successivement plusieurs grands bourgs ou villes, tels que Atfyh, Beni-Soueyf, Abou-Girgeh, et parfois des villages tapissés de verdure, mais tristes, pauvres, et dont le silence n’est troublé que par des cris sauvages et des plaintes amères. Ici, comme dans la Basse-Égypte, le despotisme étend sur toute la population un réseau d’airain dont chaque maille est le centre d’action d’une tyrannie subalterne, et, comme dit Montaigne: «Avoir plusieurs maîtres, c’est autant que d’avoir autant de fois à être extrêmement malheureux» ; la civilisation, n’en doutons pas, pénétrera un jour dans ces contrées; elle y naîtra infailliblement du contact de l’Orient et de l’Occident; mais gardons-nous de donner ce nom à l’organisation violente et brutale qui pèse encore sur ce malheureux pays.
Jusque là le Nil n’offre en général aucun des inconvénients de nos grandes rivières, on ne trouve dans son lit ni rochers ni pierres, un caillou même y est une rareté ; la remonte y est toujours possible; le vent de N.-O. ou de N.-E., qui règne pendant toute l’inondation, donne le moyen de vaincre son rapide courant par le simple secours des voiles; seulement, dans les coudes, la brise, qui était favorable dans la direction primitive, devient contraire. Alors les matelots sautent à terre et halent la barque à la cordelle, en réglant leurs pas au son d’un air cadencé ; pendant cette manœuvre, la marche de la cange était si lente, que nous aurions pu, sans perdre beaucoup de temps, faire une excursion vers la montagne où une foule d’objets attiraient nos regards. C’étaient des excavations, des ouvertures en forme de portes creusées dans les flancs de la chaîne arabique qui borde le Nil, des pilastres, des colonnes supportant des portiques brillants encore des plus vives couleurs; mais je savais par expérience que les heures s’écoulent rapidement pour le voyageur qu’arrêtent ces vestiges gigantesques jetés avec tant de profusion et de grandeur sur le sol de l’Égypte. Je m’étais donc imposé l’obligation de ne prendre terre qu’à Siouth, pour remettre à Schérif-bey, gouverneur de la Haute-Égypte, les dépêches dont j’étais porteur. Cette relâche forcée eut lieu plus tôt que je ne m’y attendais, mais ce fut à Mellaouï.
Quelques bateaux étaient mouillés en face de cette ville, située à deux milles environ des bords du fleuve. Nous les prîmes de loin pour nos barques de transport; à une distance plus rapprochée, l’interprète reconnut, aux insignes qui flottaient au sommet des mâts, les canges de Schérif-bey. Son excellence était en tournée dans son gouvernement, et devait séjourner pendant quelques jours à Mellaouï. Arrivé sur les lieux après le coucher du soleil, je me fis annoncer au gouverneur pour le lendemain de très-bonne heure.
A six heures je m’acheminai avec l’interprète vers Mellaouï. Nous parcourûmes une partie de cette ville, qui est plus grande et mieux bâtie que les précédentes. Du N. au S. elle est traversée par un vaste bazar qui semblerait annoncer un peuple commerçant et industriel; mais ce point de réunion, ce foyer de la vie orientale, était presque désert. La plupart des boutiques fermées, les maisons abandonnées, tout enfin accusait une diminution sensible de population et de fortune.
L’interprète de S. E., Ibrahim, dont nous aurons l’occasion de parler plusieurs fois, m’introduisit dans les appartements du gouverneur. On avait dissimulé l’état assez misérable de la salle où il se tenait, au moyen des ornements qui décorent les canges. Le parquet était couvert de nattes et de tapis; une chaise grossièrement travaillée était placée en face de Schérif-bey; l’interprète m’engagea à m’y reposer immédiatement, car tel est l’usage du pays; il est de bon goût de s’asseoir, de respirer pendant quelques minutes avant même de saluer.
S. E., assise à l’orientale, et les bras mollement étendus sur d’élégants coussins de velours, était entourée de quelques officiers, de son médecin, de deux secrétaires et de plusieurs domestiques arabes. Après un grand nombre de salams (salutations), de compliments, qui ne durèrent pas moins de cinq minutes, on servit la pipe et le café. Le moment était venu de remettre à Schérif-bey les ordres du Pacha; il les lut avec beaucoup d’attention; se tournant ensuite vers ses officiers et le médecin, il leur fit remarquer, avec un air de satisfaction et de contentement, la dernière phrase de la dépêche: c’était un compliment de Mehemet-Ali, qui honorait son fidèle serviteur du nom de son fils.
La figure de Schérif-bey annonçait de l’esprit naturel, de la finesse et des dispositions à la gaieté. Le son de sa voix était remarquable par sa douceur; loin d’avoir l’arrogance et la brutalité de son compatriote Krali-Effendi, il se distinguait par un accueil gracieux, par ces manières polies et aisées, qui sont le partage de la bonne compagnie. Nommé, quoique fort jeune, au gouvernement de la Haute-Égypte, par la seule faveur du pacha, il s’y était maintenu par son intelligence, par son zèle et un dévouement sans bornes. Attentif à seconder les vues de son souverain, Schérif-bey ne négligeait aucune occasion de s’informer de ce qui pouvait contribuer à l’accomplissement des vastes projets de Mehemet-Ali; aussi, persuadé que les Français, naturellement très-communicatifs, ne doivent plus avoir de secrets à 1,100 lieues de leur pays, me fit-il subir un long interrogatoire sur la diplomatie européenne et particulièrement sur les projets de la Russie, puissance qu’il paraissait cordialement détester. Apprenant ensuite que j’avais fait partie de l’expédition d’Alger, il voulut connaître jusqu’aux moindres détails de cette mémorable campagne. Après avoir répondu à toutes ses questions et d’une manière qui parut le satisfaire, nous en vînmes à parler de l’obélisque.
Schérif-bey me témoigna à plusieurs reprises le désir de se trouver à Luxor le jour où le monolithe serait descendu de sa base. Il me remit ensuite pour les nazhers de Kéné, de Qous et d’Esné, des dépêches qui, en informant ces fonctionnaires de l’objet de ma mission, leur enjoignaient de m’aider de tout leur pouvoir. L’entrevue se termina du reste comme elle avait commencé, avec une cordialité et une satisfaction réciproques.
Partis de Mellaouï à midi, nous atteignîmes vers les neuf heures du soir le passage périlleux d’Abou-Fedda. Ce mont, qui fait partie de la chaîne arabique, s’élève à pic sur la rive droite, à cent mètres de hauteur; ses flancs offrent des découpures de formes bizarres, dont il serait difficile de se faire une image exacte. Le Nil, forcé de dévier de son cours par ce rempart naturel, roule avec la plus grande rapidité ses eaux bourbeuses le long de cet écueil gigantesque. Réfléchis par cet obstacle dont la crête est couronnée de pitons aigus, les vents réagissent suivant toutes sortes de directions et tourbillonnent avec violence.
La flottille avait doublé le mont Abou-Fedda avant la chute du jour, et se dirigeait en bon ordre vers le prochain mouillage. Le patron de la cange, moins courageux et peut-être plus superstitieux que ses camarades, effrayé d’ailleurs de l’obscurité produite par l’ombre portée de la montagne, refusa de s’engager pendant la nuit dans une passe aussi difficile. Malgré ses observations sur les dangers qui nous menaçaient, nous le forçâmes d’aller en avant; prenant alors son couteau, il le plante dans une gerçure du grand mât, lance une poignée de sel dans le feu, se recommande au prophète, et, rassuré par cette cérémonie bizarre, il oriente ses voiles .
La cange, luttant avec peine, à l’aide de toute sa voilure, contre un courant de quatre à cinq nœuds, avait à peine doublé le tiers d’Abou-Fedda, qu’une raffale, tombée à bord comme un coup de foudre, fit craquer son grand mât. C’était l’avant-coureur d’un véritable ouragan; nous passions instantanément d’un calme plat à une brise violente, qui faisait le tour du compas dans l’espace de cinq minutes. Lancée dans ces mouvements tumultueux, notre frêle embarcation marchait tantôt en avant, tantôt en arrière, à droite, à gauche, courant sous ses deux voiles, plus souvent sous la trinquette, et quelquefois à sec de voiles. Plus nous avancions, plus la tourmente redoublait d’intensité : emportés par la violence du vent jusqu’au pied de la montagne, nous n’étions avertis de notre position critique que par le choc des lames contre les écueils, quand tout à coup nous aperçûmes à fleur d’eau une lumière qui se dérobait par intervalles à nos regards. La scène, pour être éclairée, n’en était que plus effrayante. A la lueur vacillante de ce feu réfléchi par les parois d’une vaste excavation, on distinguait une partie du mont, qui semble menacer de sa chute le navigateur; puis des rocs ardus avançant leur tête luisante dans le lit du fleuve, et contre lesquels le vent et le courant nous poussaient avec la plus grande impétuosité. Le danger était imminent; la cange, enveloppée dans des tourbillons, roulait comme une paille le long de ces rochers, et faillit plusieurs fois à se briser. Ce ne fut qu’après avoir manœuvré pendant deux heures avec beaucoup de prudence et d’habileté que les marins arabes parvinrent à franchir le point le plus dangereux. Alors les vents se calmèrent un peu, les raffales devinrent plus rares, et bientôt nous atteignîmes l’extrémité d’Abou-Fedda. Trois heures après nous étions à Manfalout, où nous attendait la flottille. Notre séjour dans cette ville ne fut pas de longue durée: une brise fraîche de N.-O. nous en fit partir de bon matin, au grand désespoir du reïs, qui, depuis notre passage sous Abou-Fedda, avait pris la navigation en horreur.
Notre marche, toujours favorisée par un vent régulier, fut si rapide, qu’après cinq jours de navigation nous étions en vue de ces superbes forêts de palmiers et de Doums qui précèdent les ruines de Denderah. Ce dernier arbre, dont on m’avait parlé dans la Basse-Égypte, pouvant m’être de quelque utilité dans les travaux de charpentage, j’avais demandé à Schérif-bey l’autorisation de couper ceux dont je présumais avoir besoin. S. E. me remit à cet effet un ordre pour le nazher de Kéné, auprès duquel je me rendis à 7 heures du soir.
Quand la tourmente des premiers compliments et des salutations fut apaisée, je lui communiquai la dépêche du gouverneur. Afin d’éviter toute difficulté, je m’empressai de le prévenir que les bois de Doums seraient payés immédiatement au propriétaire sur l’estimation faite par l’autorité locale. «Avec de l’argent, me dit-il, on t’enverra à Luxor une forêt toute entière.» Après avoir, selon les us et coutumes, bu trois tasses de café et fumé autant de pipes, je pris congé de ce bon vieillard. Ma surprise fut extrême lorsqu’en sortant de sa maison, je fus saisi par des saïs , qui me juchèrent sur un cheval dont l’énorme grosseur contrastait d’une manière singulière avec ma petite taille; mes jambes se trouvaient dans une position presque horizontale. Comme ma situation paraissait fort gênée, le chef des coureurs chercha à me rassurer en me vantant la docilité du cheval que son maître, âgé et infirme, ne craignait pas de monter tout en fumant sa pipe. Cependant par mesure de précaution, il fit placer à mes côtés deux saïs qui serraient de la main l’extrémité de mes bottes, deux autres tenaient la queue et la bride du cheval, et quatre domestiques armés de flambeaux précédaient notre marche. Ils me conduisirent ainsi processionnellement jusqu’à la Cange. On me donnait là, je le sus depuis, un témoignage de grande distinction que l’on paye fort cher, attendu qu’il faut largement rétribuer tous ceux qui y concourent. Bien mal venu serait en Égypte (et il n’en est pas ainsi en Égypte seulement ) celui qui s’y présenterait les mains vides.
Nous voilà parvenus à Kéné. Cette ville de 15,000 âmes environ est le rendez-vous de toutes les caravanes de pèlerins qui vont à la Mecque ou en reviennent. Quoique fort ancienne, elle n’offre aucun vestige d’antiquité. Mais Kéné est renommé par ses excellentes poteries. On y trouve cette terre poreuse qu’on emploie à la confection des alcarazas ( vases en terre, destinés à rafraîchir l’eau), dont on fait un si grand usage en Égypte; c’est delà que partent tous les ans ces radeaux de jarres, goulets, etc., qu’on dirige sur les villes principales où ces mêmes poteries sont vendues à vil prix. En face de Kéné se trouvent les ruines de Denderah, et le premier temple bien conservé que l’on rencontre sur la route que nous venions de parcourir.
Malgré notre extrême impatience, il fallut payer un juste tribut d’admiration à cette œuvre colossale du génie égyptien. Pendant la nuit la flottille traversa le fleuve. Au lever du soleil, officiers, marins et ouvriers agités d’une curiosité électrique, couraient vers Denderah comme s’ils eussent craint que les ruines pussent leur échapper.
Je ne tenterai pas de décrire le spectacle sublime qui s’offrit à nos regards: quelle langue fournirait des termes suffisants pour peindre les effets de ce monument merveilleux! Une pareille tâche est d’ailleurs au-dessus de mes forces. Le temple de Denderah en dit plus à lui seul que des milliers de volumes et de dessins; tout y est grand, inoui, prodigieux.
Je tressaillis en remarquant sur un des murs de refend, des traces de la sauvage ignorance des Turcs. Aux yeux de ces barbares, les antiquités ne sont que des amas de pierres, une carrière propre à fournir des matériaux en partie façonnés pour leurs grossières constructions. Déjà le marteau de la démolition avait retenti sur les dalles antiques, l’édifice allait être mutilé, détruit, anéanti pour toujours, sans l’intervention des consuls européens qui protestèrent contre cet acte de barbarie. Le temple fut conservé, respecté par les Turcs; mais la civilisation garda moins de ménagements. C’est des plafonds de Denderah qu’on a détaché le zodiaque qui, aujourd’hui, se trouve déposé dans les salles du Louvre.
La diversion de cette station curieuse et instructive imprima à toutes nos facultés une nouvelle énergie pour supporter de nouveaux labeurs. Chacun de nous se trouvait amplement dédommagé des fatigues de la traversée, par la vue de ces imposantes ruines.
Le lendemain, dès la pointe du jour, la flottille sous voile avançait lentement vers sa destination; une brise légère, des détours nombreux retardaient notre marche. Enfin le coude Gamouleh est franchi à la cordelle vers les quatre heures du soir; c’est alors que de tous côtés apparurent les vestiges gigantesques de l’antique cité ; éclairées par les derniers rayons du soleil, ces masses séculaires offraient un spectacle admirable, témoignage de la puissance créatrice d’un peuple que nul autre n’a jusqu’ici égalé par le grandiose des conceptions.
A droite, les ruines de Gournah, du Memnonium; derrière, la vallée des tombeaux, et plus loin, au pied de la chaîne lybique, les temples de Medinet-Abou; à gauche, ceux de Karnac, ses immenses pylones, son obélisque géant de trente mètres de haut; un peu plus vers le sud, la colonnade du palais de Luxor, son vaste pylône précédé de deux obélisques en granit. A l’aspect de ces deux monuments, tout s’effaça, tout disparut à mes yeux; pour la première fois, la vue des ruines de Thèbes éveilla dans l’âme d’un voyageur d’autres idées que des souvenirs d’histoire, de grandeur et de décadence. Thèbes! ce n’est plus la ville aux cent portes où il y a des palais, des sphinx, des colosses. Ce n’est plus qu’un point qui renferme un seul objet, l’obélisque de droite, en entrant dans le Rhamséium.
Le bateau de tête se dirige vers la rive de Luxor et vient mouiller en face des obélisques, les autres imitent sa manœuvre. Au même instant, marins et ouvriers s’élancent à terre, traversent la plage en courant, et disparaissent au milieu des ruines. La Cange formant l’arrière-garde pour veiller les traînards arrive la dernière et se place au centre de la flottille.