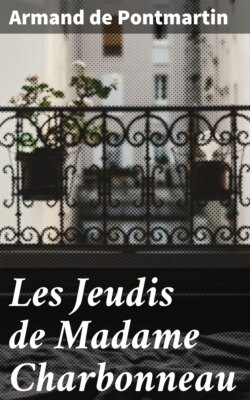Читать книгу Les Jeudis de Madame Charbonneau - Armand de Pontmartin - Страница 5
I
ОглавлениеJeudi 15 décembre 186...
Tiens! c'est singulier; je n'ai pas ri, ou du moins, si je me suis diverti, ce n'est pas du tout de la façon que j'avais espérée. Je ne suis pas même sûr qu'on ne se soit pas un peu amusé à mes dépens.
D'abord madame Charbonneau est une Parisienne, et une Parisienne de l'espèce la plus intelligente; fille d'un artiste sans fortune, mais brillamment élevée, elle m'a rappelé ce type de la belle madame Rabourdin, si minutieusement décrit par Balzac. Son mari, enfant de Paris comme elle, a une physionomie d'ambitieux. D'ici à dix ans, elle en aura fait un receveur général. Son piano est d'Érard; elle est élève de Chopin. Elle s'habille avec cette élégance innée qui ne s'analyse pas. Rien à faire ni à dire de ce côté-là pour les mauvais plaisants. Son thé arrive tout droit de la Porte chinoise. Sa cuisinière fait les brioches comme Félix.
Pourtant, la soirée ne commençait pas mal. Une petite femme brune, la femme de l'adjoint, madame Galimard, est entrée comme une trombe cerclée de crinoline, en s'écriant: «Vous ne savez pas? Madame Burel a renvoyé Catherine!»
Pourquoi madame Burel avait-elle renvoyé Catherine? Un cordon bleu qui avait refusé trois cents francs de gages chez le sous-préfet! On se perdait en conjectures, et cette grande nouvelle menaçait de faire tort aux causeries annoncées, quand la maîtresse de la maison, tournant vers moi son regard pénétrant, me dit avec un spirituel sourire:
—Décidément, nous sommes incorrigibles... Vous nous trouvez bien cancaniers, n'est-ce pas, monsieur le Parisien?
J'allais répondre. M. Dervieux m'a prévenu; c'est le président du tribunal.
—Mon Dieu, madame! ne nous humilions pas trop, et souvenons-nous que les hommes sont partout les mêmes. Au lieu de laisser à monsieur le temps de tourner un compliment ou de déguiser une épigramme, je vais vous raconter ce que j'ai vu de mes yeux et ouï de mes oreilles. La province vous semble avoir le monopole des commérages, des caquets dont parle la Bruyère dans sa fameuse page sur la petite ville. Eh bien, c'était aussi mon avis en 1845, quand je partis pour Paris, où j'allais terminer mon stage. J'avais vingt-cinq ans, et, avant de me décider à être tout à fait magistrat, je désirais essayer de la littérature. Avec quel bonheur je me dis qu'enfin je sortais de notre atmosphère cancanière, que je n'entendrais plus que des gens spirituels, causant sur des sujets élevés et des idées générales, que je n'aurais affaire qu'à des artistes, des savants, des écrivains, des inventeurs, des critiques, trop occupés de leurs pensées, de leurs travaux, de leurs ouvrages, pour s'informer de ce qui se passait chez le voisin! Grâce à un hasard providentiel, je me trouvai, au bout de six mois, dans une société essentiellement artistique et littéraire, composée d'un éditeur célèbre, de deux académiciens, d'un philosophe, d'un poëte, de trois peintres et d'un professeur au Conservatoire. Inutile d'ajouter que, dans ce glorieux cénacle, je me proposais, moins ambitieux que Juvénal, de tout écouter et de ne rien dire. Hélas! hélas! six autres mois ne s'étaient pas écoulés, voici ce qui se passait: médisances et caquets pleuvaient comme grêle. L'éditeur avait rompu avec le philosophe; les deux académiciens ne se saluaient plus; le poëte était brouillé, à hémistiches tirés, avec deux des peintres, et il était question d'une rencontre entre le troisième peintre et le professeur. Tout ce petit monde se criblait réciproquement dans un tamis que Pézenas ou Draguignan eût envié à la rue Jacob. Il est vrai que la plupart de ces messieurs avaient des femmes; mais comment supposer que ces dames eussent leur part dans ces bavardages? Vous ne me croiriez pas si je vous le disais, et je me garderai bien de vous le dire...
J'étais battu sur mon propre terrain, et je m'abstins de répliquer; je savais par expérience à quel point M. Dervieux était dans le vrai. J'essayai de m'en tirer à l'aide d'une phrase sur l'éternelle similitude de l'homme à travers ses variations apparentes, sur le contraste des cadres ne servant qu'à faire ressortir l'uniformité des tableaux, et je me résumai en ces termes:
—La prétention de l'homme est de se différencier constamment, et sa destinée est de se ressembler toujours.
—A qui le dites-vous? interrompit M. Verbelin, le juge d'instruction; et, prenant sur la table le livre de M. Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe, il ajouta:
—N'êtes-vous pas d'avis que toutes les fautes, tous les malheurs de l'illustre auteur des Martyrs ont été causés par son orgueil?
—Oh! oh! pensai-je, voici un Philistin de première force; je tiens ma revanche.
Et je m'inclinai en signe d'assentiment.
—Eh bien, monsieur, reprit-il, je suis d'une génération qui avait fait de M. de Chateaubriand l'idole, le demi-dieu de sa jeunesse. Pourtant, à force d'entendre dire qu'il était plein d'orgueil, j'avais fini par répéter à part moi: «M. de Chateaubriand est orgueilleux; c'est bien extraordinaire. Tant pis pour lui! Je vais chercher un grand écrivain qui soit modeste; je n'aurai que l'embarras du choix.» Là-dessus me voilà portant mon admiration et mon culte à M. de Lamennais. Peu d'années après, l'on m'apprend que M. de Lamennais a été égaré par l'orgueil. Je passe à M. de Lamartine; je le vois découragé, vieilli, accablé, et l'on me crie: «L'orgueil l'a perdu.» Je cours à M. Victor Hugo; il était à Jersey, et tout le monde redisait en chœur que c'était l'orgueil qui l'avait mené là. Je songeai à M. de Balzac; je sus que, non content d'être un immense romancier, il avait écrit, en grosses lettres, sur la porte de son cabinet de travail: «Être par la plume ce que Napoléon a été par l'épée, et n'avoir pas de Waterloo.»—Je me rabattis sur M. de Vigny; je le rencontrai dans un salon où l'on causait littérature, et je le trouvai fermement convaincu que le théâtre français a fini à Chatterton, le roman à Cinq-Mars, et la poésie à Eloa... J'en conclus que la vanité était probablement une maladie littéraire, et je me promis de ne plus fréquenter que des gens illettrés. Je repartis pour le chef-lieu de mon département. Deux amis intimes, Paul et Gustave, venaient de rompre une amitié de quinze ans, parce que Gustave avait supplanté Paul auprès de la première chanteuse du théâtre. «Tu comprends bien, me dit l'amant éconduit, que je tenais très-peu à Léocadie; elle chante faux, elle a de fausses nattes, un œil plus petit que l'autre, et le nez rouge dès qu'elle veut monter au si bémol suraigu; mais l'amour-propre!»—J'arrive à mon chef-lieu de canton, une petite ville de trois mille âmes. Deux proches voisins, un peu parents, et les plus honnêtes gens du monde, avaient cessé de se voir et de se parler, parce que l'un des deux avait été nommé membre du conseil municipal, et que l'autre avait échoué... «Vous entendez bien, me dit le candidat malheureux, qu'au fond cela m'est bien égal; c'est même une corvée que j'évite, mais chacun a son petit amour-propre.»—Enfin, je prends gîte dans mon village; on savait que j'étais avocat. Le lendemain, je vois entrer un pauvre paysan; il me demande en sanglotant s'il n'y a pas moyen de se dédire d'un marché où il va payer cent écus un tas de fagots qui vaut cent francs. «Mais, malheureux! lui demandai-je, comment vous y êtes-vous laissé prendre?—Ah! monsieur, hu! hu!... c'est que Jean Pécoul, le marguillier, voulait les fagots; il a poussé jusqu'à deux cent nonante francs... hu! hu!... et je n'ai pas voulu qu'il les ait... Ah! ma pauvre défunte (explosion de sanglots) me le disait bien: «Jacques, la vanité te ruinera!...» Ce fut là ma première consultation; je la donnai gratis. Je mis quelque argent dans la main de Jacques, en lui disant: «Mon ami, je vous félicite et vous remercie; vous venez de réhabiliter M. de Chateaubriand.»
Le récit de M. Verbelin acheva de m'aplatir. Madame Charbonneau l'écoutait d'un petit air approbatif. L'assistance me regardait, comme pour me dire: «Eh bien, monsieur le poëte comique, avez-vous toujours envie de vous moquer de nous?» Y aurait-il donc des Parisiens en province, comme il y a des provinciaux à Paris? Les chemins de fer, le nivellement démocratique, le va-et-vient perpétuel d'une société que le centre attire sans cesse et renvoie marquée de son empreinte, tout cela a donc effacé les différences, les disparates sur lesquelles je comptais pour rire? Ces idées vagues se pressaient dans mon cerveau, et je commençais à perdre contenance, lorsque l'on annonça M. Toupinel.
Figurez-vous un homme de quarante-cinq à cinquante ans, haut en couleur, un peu gros, drapé plutôt que vêtu dans un de ces amples habits noirs que les hommes politiques ont mis à la mode; possédant une de ces physionomies goguenardes qui dénoncent un amateur de bonne chère, un chanteur de chansonnettes ou un mystificateur de salon. Il portait sous son bras un énorme rouleau de papiers. Son entrée fit sensation.
—La parole est à M. Toupinel! s'écria l'assemblée.
—La parole est à M. Toupinel! dit madame Charbonneau.
—Oh! pour le coup, fis-je dans un nouvel aparté, voici le provincial de lettres dans toute l'expansion naïve de son type primitif; voici la proie que j'attendais. Je suis sûr que ce rouleau de papiers recèle dans ses flancs un poëme sur les vers à soie ou une tragédie de Ménélas. Il va m'indemniser, à lui tout seul, de toutes mes railleries rentrées. Attention!
On a fait silence; mais, au même moment, la pendule de madame Charbonneau a sonné onze heures; c'est l'heure classique de la dispersion générale et du couvre-feu, dans l'honnête ville de C... Madame Charbonneau a servi une tasse de thé à M. Toupinel en le grondant d'être venu si tard. Il a rengainé son rouleau de papiers. Chacun a repris son paletot, son parapluie et ses socques en répétant: «A jeudi prochain!»
Jeudi, je saurai peut-être ce que renfermait le rouleau de papiers de M. Toupinel.