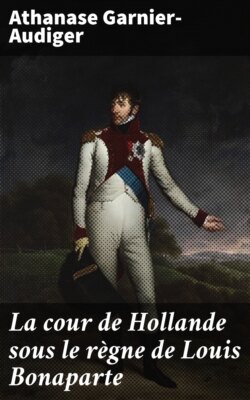Читать книгу La cour de Hollande sous le règne de Louis Bonaparte - Athanase Garnier-Audiger - Страница 13
ANNÉE 1806.
ОглавлениеUN gouvernement républicain, dirigé par Schimmelpenninck (Rudger Jean), qui était décoré du titre de Grand Pensionnaire, régissait la Hollande, et semblait, par sa situation autant que par sa nullité apparente en politique, devoir rester étranger aux commotions qui depuis quinze années bouleversaient la face de l’Europe. Mais ce pays devait fournir un épisode saillant à l’histoire politique de l’Europe, par l’influence de celui qui tour à tour a établi et renversé des républiques, ébranlé tant de trônes et créé tant de monarchies. La Hollande subit tout à coup une nouvelle métamorphose, et reçut pour souverain Louis Bonaparte, frère de l’empereur Napoléon, connétable de France, et colonel-général des carabiniers. Ce prince avait épousé Hortense de Beauharnais, fille de l’impératrice Joséphine.
Avant de se rendre dans leurs états, le roi et la reine se firent précéder dans leur résidence de La Haye, par des personnes d’un rang distingué, et désignées par LL. MM. entre toutes celles qui leur étaient le plus dévouées en France. Ces personnés devaient, en Hollande, se réunir aux hommes les plus importans du pays pour établir les différens services composant la maison du roi.
L’intérieur du palais, auquel on ne pouvait pas encore donner le titre de cour, présentait un coup d’œil fort curieux par le concours de Français et de Hollandais qui s’y trouvaient réunis. Mais le gouvernement républicain n’ayant laissé aucun élément convenable pour organiser dignement la cour d’un monarque, tout était à faire, tout était à créer, c’était un édifice entier à construire. Les Hollandais présentaient pour modèle la cour de Hollande sous le règne du prince d’Orange; les Français, au contraire, prétendaient qu’une cour ordonnée comme celle de France serait plus agréable à leur souverain. C’est au milieu de ce conflit de prétentions et d’intérêts divers, et, pour ainsi dire, à travers ce choc de toutes les passions mises en mouvement par l’esprit national, que LL. MM. arrivèrent à La Haye, le 18 juin 1806. Alors; par respect pour le roi et la reine, les esprits parurent se calmer. Louis, pour tout concilier, choisit parmi les Hollandais et les Français deux personnages qu’il chargea de former définitivement sa maison; et la division cessa. Bientôt, par les soins de l’amiral Verhuell et ceux du grand-maître de la maison, M. de Sénégra, les intentions de S. M. furent remplies.
Des arcs de triomphe avaient été élevés sur le chemin de La Haye à la maison du Bois, où LL. MM. se rendirent avant que d’aller occuper leur palais de la ville. Ces arcs de triomphe étaient chargés de devises qui annonçaient avec plus d’emphase que de vérité combien le peuple hollandais était heureux de posséder ses nouveaux chefs; et pourtant cette allégresse de commande n’empêcha pas qu’on remarquât que dans plusieurs rues où passèrent LL. MM. il y avait beaucoup d’hahitations dont les croisées étaient fermées, ce qui n’annonçait pas un enthousiasme bien général.
Une nation républicaine et pourtant divisée d’opinions, à qui la force donne un roi, et un roi étranger, pouvait bien, sans qu’on s’en étonnât trop, ne point accueillir avec une exaltation spontanée ce maître absolu. Il était assez naturel de supposer à celui-ci des projets qui ne s’accorderaient pas tout-à-fait avec les idées nationales; et la portion du peuple qui raisonne ses affections semblait vouloir ajourner l’expression de son dévoûment jusqu’à ce que le nouveau prince eut fait ses preuves d’entière adoption.
Les députations arrivèrent bientôt en foule à la maison du Bois, où le roi et la reine les accueillirent avec une grâce parfaite; et tout ce que dirent LL. MM. annonçait avec franchise le désir qu’elles montraient de faire le bonheur des peuples sur lesquels elles étaient appelées à régner. Ces députations prononcèrent des discours où l’opinion publique se manifestait assez hardiment, tout en conservant le respect dû à la majesté du trône. Louis, loin de s’offenser de la liberté de ces sentimens, sut beaucoup de gré aux députés de leur franchise. Le discours de M. de la Saussaye, ministre de l’église wallonne, fut regardé comme un chef-d’œuvre, tant par la sagesse et l’élévation des idées que par sa touchante et pastorale simplicité ; mais à travers celui du président de LL. HH. PP. on remarquait avec quelle complaisance M. le président vantait la nation hollandaise comme extrêmement intéressante sous tous les rapports: nation célèbre, ajoutait-il, par les vertus qui l’ont de tout temps distinguée. Quelle modestie!
Après avoir passé quelques jours à la maison du Bois, où il s’occupait avec les secrétaires d’état à recueillir des connaissances locales, le roi fit son entrée dans sa capitale, à La Haye, le 23 juin; mais cette entrée n’eut point toute la pompe, tout le brillant appareil d’un cortège royal, parce que Louis contremanda la réunion d’un corps de troupes françaises à La Haye, où, d’après l’ordre de l’empereur Napoléon, elles devaient escorter le nouveau roi. Mais cette première détermination de Louis, inspirée par une sorte de modestie, déplut à Napoléon, qui remarqua que déjà son frère n’était pas disposé à suivre aveuglément toutes ses intentions.
La Haye, que les Hollandais nomment toujours s’Gravenhage (ou Bois du Comte), ce qui contrarie un peu la vivacité des Français qui prononcent si difficilement les noms étrangers ; La Haye, après avoir été un simple village, est maintenant une des plus jolies villes de la Hollande, où la cour faisait sa résidence dans un palais composé d’un amas de maisons fort anciennes et construites sans goût, ce qui offre un contraste choquant avec la somptuosité des hôtels dont se forme le Voor-Hout, qui est la principale rue de La Haye. Les modes françaises s’étaient introduites depuis long-temps dans les grandes villes de la Hollande, où la bonne société offrait dans les dames autant d’élégance qu’à Paris, et dans le costume des hommes peu de différence avec celui des Français. S’il existe encore des oppositions sensibles entre les moeurs, les coutumes, les habillemens, les manières françaises et ces mêmes objets en Hollande, ce n’est que dans les classes inférieures du peuple. On y remarque aussi une sorte de ressemblance dans la forme et d’analogie dans l’expression de la physionomie, lesquelles d’ailleurs s’étendent à la généralité des habitans.
Heureusement qu’à La Haye il était du bon ton de parler français; car si les Français ont quelque supériorité sur les peuples qui les entourent et qui parlent tous leur langue, il faut avouer qu’ils ne brillent pas dans la con. naissance des idiomes étrangers. Les Français qui avaient accompagné le roi en Hollande ne pouvaient presque pas s’imaginer qu’ils fussent en pays étranger, car ils vivaient à La Haye comme s’ils eussent été à Paris, et leur pétulance, que les Hollandais ne manquent jamais de leur reprocher, s’accommodait assez bien de la gravité presque constitutionnelle de cette nation flegmatique. Les femmes paraissent avoir moins de tendance que les hommes à cette méthodique tranquillité nationale. Les Hollandaises, pour la plupart, sont jolies; malheureusement leur beauté n’est pas de longue durée, et leurs traits et leur teint ne résistent pas à plusieurs grossesses et aux soins de l’allaitement. Une jolie femme en Hollande ne jouit guère des avantages de sa beauté, de sa fraîcheur, que depuis dix-huit ans jusqu’à vingt-six; après cette époque, celles qui ont la prétention de plaire, ne peuvent plus fixer les regards et attirer les hommages que par le manége de la coquetterie.
Les grands officiers de la couronne, lors de la formation de la maison du roi, étaient tous Français; ils avaient été choisis à Paris par le prince, au moment même de son avénement au trône de Hollande. Parmi ces officiers, Louis semblait affectionner particulièrement le lieutenant-général Noguès, qu’il fit son grand-veneur et gouverneur de La Haye. L’occupation de ces grands emplois par les Français excita, avec quelque raison, la jalousie des Hollandais que Leur rang dans la société aurait pu appeler à ces emplois éminens; et ce sentiment, d’abord dissimulé sous le masque de la politique, amena plus tard les changemens qui eurent successivement lieu dans le personnel des grands dignitaires de la couronne. Les Hollandais de marque avaient cependant obtenu d’autres avantages capables de tempérer ou de satisfaire leur ambition, puisque les ministres et les ambassadeurs étaient tous pris, comme cela devait être, parmi des hommes du pays. Le ministère ainsi que le corps diplomatique furent assez souvent composés d’hommes d’un grand mérite. Cette envie nationale, si on peut s’exprimer ainsi, s’étendit plus loin encore; et les Hollandais, tout en avouant la bonté de la nouvelle administration, étaient fâchés de voir autant de Français à la cour et dans les différens services.
Il y avait infiniment plus d’accord entre les dames qui avaient l’honneur d’approcher de la reine, mais on s’en étonnera moins lorsqu’on saura que ses dames d’honneur étaient toutes Hollandaises. Il faut cependant en excepter une qui, malgré qu’elle fut l’épouse d’un Hollandais, était issue d’une grande famille de France. Le crédit de cette dame prit tout à coup un très-grand essor et s’éleva avec rapidité dans la plus haute région des faveurs, mais ce fut moins à sa naissance qu’à son mérite personnel qu’elle dut la puissante considération dont elle fut entourée pendant quelque temps à la cour.
Les Français jouissaient à La Haye de tous les agrémens de la vie; de tous côtés ils portaient cette aimable gaîté, cette constante vivacité qui sut animer, qui sut franciser, si on peut le dire, tous les pays qu’ils ont habités. La galanterie, qui leur est si familière, trouva à s’exercer auprès des dames hollandaises, qui, peu habituées à la flatterie et aux sémillantes agaceries dont on entoure les dames françaises, accueillirent avec bienveillance les hommages qui leur étaient offerts.
En attendant qu’on eût convenablement arrangé au palais les appartemens destinés à quelques officiers français de la maison du roi, au nombre desquels j’étais, plusieurs d’entre eux prirent des logemens au Maréchal de Turenne, hôtel garni recommandable pour les soins qu’on y prodigue aux étrangers, et remarquable par l’excessive cherté avec laquelle on y est traité. Comme les croisées des appartemens de ces officiers donnaient en face de la maison occupée par la principale actrice du Théâtre - Français, cette dame apprit bientôt que ses voisins étaient des compatriotes, et à ce titre elle les engagea à la visiter; plusieurs s’en défendirent, ne pensant pas qu’il fût dans la dignité des convenances de faire, du moins ostensiblement, leur société d’une dame de théâtre, toute jolie et tout aimable qu’elle pût être. Cependant, en y réfléchissant un peu, je fus du nombre de ceux qui s’affranchirent du scrupule de l’étiquette, et nous nous rendîmes à l’invitation de mademoiselle Lobé.C’était une espèce de Ninon, bien connue dans la résidence royale par son esprit, son atticisme et ses bons mots. Elle recevait avec le ton de la très-bonne compagnie, ce qui n’est pas chose commune parmi des femmes qui, assez ordinairement, semblent se dédommager chez elles de l’obligation où elles ont été de prendre au théâtre l’esprit et les manières d’un rôle souvent en contraste avec leur esprit naturel et leurs habitudes domestiques. Mais il était moins difficile à mademoiselle Lobé qu’à toute autre de déployer cette politesse du grand monde qui atteste si bien le bon ton; car, si l’on en croyait la chronique scandaleuse, plus d’un ambassadeur avait eu avec elle des relations toutes particulières. On donnait même alors comme certaine sa liaison intime avec M. Molerus, l’un des chambellans du roi, et l’homme que l’on disait être le plus galant de toute la cour. Mais ce qui pouvait étonner chez mademoiselle Lobé, c’était d’y voir réunis aux principaux acteurs du jour une grande partie des ambassadeurs des puissances étrangères, dont les plus empressés alors étaient M. de Nesselrode, envoyé de Russie, le baron de Feltz, ministre d’Autriche, le comte de Lowendall, auxquels se joignaient des Hollandais du haut parage. Tous paraissaient enchantés d’être admis à l’honneur de former la cour de la reine du théâtre, et qui tenait à La Haye depuis quelque temps le sceptre de la haute galanterie. Le ministre de France, M. Dupont-Chaumont, était le seul des ambassadeurs qui ne se montrât point au cercle de mademoiselle Lobé, dont tout l’esprit et la coquetterie échouèrent pour l’attirer chez elle.
Si l’on peut un instant mettre de côté la convenance des rangs et la dignité des emplois, il faudra convenir que la haute société qui se rassemblait chez mademoiselle Lobé offrait une réunion fort agréable, parce que tous ces grands personnages, en entrant chez elle, y abjuraient toute espèce de morgue, et que là l’homme le plus aimable y était toujours le plus considéré. LL. EExc. venaient s’y délasser du faste des grandeurs, et leur bonhomie et leur franche gaîté n’aurait jamais permis qu’on soupçonnât en eux les ambassadeurs des différentes puissances de l’Europe.
Dans ce cercle composé d’hommes de tous les pays, je me liai assez particulièrement avec un habitant de La Haye, qui, sans être enthousiaste des Français, recherchait volontiers leur société, n’imitant point en cela ceux qui se préviennent aveuglément contre tous les étrangers, sans réfléchir à ce qu’un semblable éloignement peut avoir d’injuste et de puéril. Mon Hollandais, M. Vandenkeuzendyk, ne remarqua point en moi ce qu’en Hollande on appelle le vent français ( fransche wind ), c’est-à-dire cet air évaporé qu’à tort on prendrait pour de la présomption, cette légèreté de caractère qu’on reproche aux Français, mais qui n’exclut point chez eux leur franchise distinctive. Malgré ce préjugé, je fus assez heureux pour gagner la confiance du brave et honnête M. Vandenkeuzendyk. Il m’engagea trop obligeamment à le visiter pour que je m’y refusasse, et sa maison me fut très-agréable, non seulement par la bonté avec laquelle toute la famille me traitait, mais encore parce qu’on y voyait assez Souvent s’y réunir des jeunes personnes fort aimables, au nombre desquelles il se trouva une jeune veuve, parlant très-bien français et à qui, sans l’offenser, on pouvait dire qu’elle était jolie. En tout pays on croit aisément ce qui flatte. Nulle part fille ou femme ne s’est mise en courroux en écoutant de tendres aveux; ce qui ne touche point le cœur, la vanité s’en accommode, et pourvu qu’on sache adroitement insinuer la louange, on peut réussir, sans jamais s’engager dans une fausse position. A travers cet essaim de jeunes Hollandaises je distinguai l’aimable Caroline Nieuweman, dont le mari, en allant mourir à Batavia, lui laissa à La Haye assez de fortune pour vivre dans une heureuse indépendance. Son père, chez lequel elle demeurait, était connu pour avoir la plus belle collection de fleurs du pays; Caroline, par sa taille élégante et sa fraîcheur éblouissante, attirait tous les regards, et son maintien, peut-être un peu libre, donnait à toute sa personne un air d’abandon qui, à mes yeux, ajoutait encore à tous ses attraits. Son père, dans ses momens d’enthousiasme, la comparait souvent à la rose mousseuse se balançant sur sa tige. Il n’était pas très-difficile de lier connaissance avec M. Nieuweman; il suffisait de montrer le désir de voir ses fleurs, pour obtenir l’entrée de sa maison, et sous ce prétexte je captai assez promptement sa bienveillance.
On donnait au palais des fêtes, des concerts et des bals où se réunissaient la cour, le corps diplomatique et un grand nombre de personnes de distinction. A ces premiers bals de la cour, où étaient accourus des départemens beaucoup de gens qui venaient offrir leurs hommages aux nouveaux souverains, le costume et les manières de certains hommes des provinces les plus éloignées contrastaient singulièrement avec l’aisance de ceux qui étaient habitués au grand monde, et la toilette des dames de la Nord-Hollande et de la Zélande, qu’on avait cherché à franciser un peu, n’était pas moins originale. Enfin tout ce bizarre assemblage de différens costumes et de diverses prétentions offrait un coup d’œil très-piquant, et donnait en quelque sorte à ces premières réunions l’apparence d’une mascarade. La reine, quoique assez souvent indisposée, embellisait ces réunions par les agrémens de son esprit et par le charme de ses talens. Lorsqu’elle ne s’y montrait pas assez vite, on voyait la tristesse empreinte sur tous les visages; paraissait-elle, la plus douce joie succédait à l’inquiétude. Alors on aurait pu lui appliquer ce mot de madame de Lambert à Fontenelle: «Les grâces vives et riantes
» semblaient l’attendre à la porte de son ca-
» binet pour l’introduire dans le monde.»
Le roi organisa ses ministères, confirma d’anciens ministres, en nomma de nouveaux, et il eut le bon esprit de conserver près de lui comme secrétaire du conseil d’état M. Appelius, homme d’un grand mérite, mais dont la figure hétéroclite et l’extérieur un peu trop négligé faisaient dire, à ceux qui ne le connaissaient pas, que S. M. avait souvent près d’elle une espèce de fou qui rappelait le temps où les rois se faisaient accompagner par un bouffon.
Déjà la cour était divisée en deux partis bien distincts. Les Hollandais semblaient trouver auprès du roi une bienveillance que ne leur accordait pas la reine, qui paraissait au contraire protéger plus ouvertement les Français. Cette rivalité entre des courtisans ne pouvait se manifester franchement, on le conçoit; aussi voyait - on tout ce grand monde se combler de politesses affectueuses désavouées par le coeur. On sait que l’affabilité des grands est une partie qui jamais ne se joue à jeu découvert.
Le prince Louis Bonaparte, en acceptant malgré lui, comme il l’a dit, de régner en Hollande, jugeait sans doute combien il lui serait difficile de concilier ce que la France semblait attendre de lui, et ce que sa conscience exigerait qu’il fit pour les intérêts de la nation qu’il venait d’adopter. C’était sans doute pour se livrer entièrement et sans reproche à ce dernier sentiment, qu’en acceptant le trône de Hollande il avait montré le désir de ne plus être connétable de France; mais l’empereur, par un motif tout opposé, voulut au contraire très-formellement qu’il gardât cette charge.
C’est donc de ce point de vue politique qu’il faut toujours observer Louis, pour bien juger ses actions pendant qu’il fut sur le trône de Hollande, et ne point attribuer à l’instabilité de son caractère, qu’avec raison on pourrait aussi lui reprocher, tous ces changemens, toutes ces mutations, toutes ces décisions qui se croisaient, qui se multipliaient sans cesse. Il faut considérer un jeune prince qui ne fut point élevé pour régner, mais dont on peut dire cependant que la raison avait devancé l’âge, et qui prouva en maintes occasions que l’expérience n’est pas toujours l’école nécessaire des rois; il faut le considérer luttant sans cesse avec le puissant empereur des Français auquel il doit tout, et auquel il résista pourtant parce qu’il avait le sentiment des obligations contractées avec sa nouvelle patrie. Il ne voulut point régner d’abord, mais du moment où il eut la couronne sur la tête il se crut dégagé envers l’empereur de tout ce qui pouvait nuire aux intérêts de son peuple. Ensuite, trop faible pour résister davantage à la puissance colossale qui le pressait, il aima mieux abdiquer que de transiger avec ce qu’il croyait ses devoirs. Mais au milieu de toutes ces tribulations, les Français qui avaient accompagné le roi en Hollande, et surtout ceux qui approchaient le plus de sa personne, auraient dû le trouver moins enclin à la méfiance. Des hommes d’honneur dont le caractère de loyauté ne s’est jamais démenti devaient toujours être protégés par lui. Le corps diplomatique, qui toujours s’amuse des dissensions d’autrui, riait sous cape de cette mésintelligence, et il s’en amusait encore au cercle de mademoiselle Lobé, qui brodait fort spirituellement sur toutes les aventures de la cour.
Mais tandis que ces nobles et puissans seigneurs étaient aux pieds de la séduisante Laïs dont ils admiraient les charmes, j’offrais modestement mes hommages à l’aimable Caroline, dont le père m’invita un jour à prendre le thé avec sa famille; c’était un dimanche. Cette famille se composait de M. Nieuweman, qui parlait bien moins français qu’il ne l’entendait, de sa femme qui ne parlait que hollandais, de la jeune veuve qui avait auprès d’elle une de ses amies, de leur aïeul, respectable vieillard, accroupi dans un fauteuil de cuir et enveloppé d’une grande robe de chambre d’étoffe à larges raies, lequel se dédommageait en parlant beaucoup, et en hollandais, de l’impossibilité où il était de marcher; enfin d’un cousin, M. Trotman, inspecteur des postes, bel esprit à ce qu’il croyait, et s’efforçant à vouloir le prouver par une érudition puisée dans quelques livres français assez insignifians. Caroline était à coté de moi, et suivant l’ordre de son père elle devait veiller à ce qu’il ne me manquât rien. Nous voilà donc tous rangés autour d’une table couverte en toile cirée et sur laquelle étaient quelques pipes, du tabac, des gâteaux, du fromage, des tartines, du pain et du beurre, l’indispensable crachoir, et enfin l’inépuisable théyère confiée à l’habileté et à l’expérience de madame Nieuweman. Nous bûmes à qui mieux mieux de cette précieuse eau chaude dont en Hollande on fait une si grande consommation. Le grand-papa, qu’on avait roulé à la place d’honneur, se mit à boire sans cesser de fumer; son fils l’imita, M. Trotman en fit autant, et c’est lorsque nous fûmes enveloppés d’un nuage de fumée qu’on me demanda, fort obligeamment, si la pipe ne m’incommodait pas. Un homme qui cherche à plaire ne se plaint de rien, et, pour être agréable à mes hôtes, je fis même l’éloge de la cigogne, cet oiseau si chéri des Hollandais, d’autant plus difficile à louer que son ramage, qui se rapporte assez à son plumage, n’a rien de bien séduisant, et que ses formes étiques se refusent à toute description flatteuse. Mais ce qui me fit infiniment d’honneur, c’est que j’appris à la famille Nieuweman que les Grecs et les Romains avaient eu aussi beaucoup de vénération pour les cigognes. M. Trotman ne s’attendait pas à mon érudition, et pour briller aux yeux de la société il nous déroula, avec une apparence de fierté, toute l’histoire naturelle de la cigogne, mais tout autrement que ne l’a fait M. de Buffon; ensuite il analysa très-longuement tous les services que cet oiseau scolopax rendait au pays, et il termina son apologie en assurant qu’on regardait comme prédestinées les maisons sur lesquelles cet oiseau de passage allait faire son nid; quoique Caroline, avec un peu d’espiéglerie, fit observer que dernièrement le feu du ciel avait consumé une maison sur laquelle depuis long-temps s’était établie une famille entière de cigognes. Madame Nieuweman, prévoyante à l’excès, s’occupait constamment à remplir les tasses de ses convives et à les presser de manger. J’avais déjà l’estomac submergé d’un déluge d’eau chaude et gonflé de pâtisserie, qu’à peine les personnes qui m’entouraient semblaient être au commencement de la collation. Je demandai grâce, et Caroline m’apprit que pour annoncer que l’on ne voulait plus de thé, il fallait renverser sa tasse sur la sous-coupe; «car sans cette précaution, me dit-elle, on ne cesserait pas de vous en offrir». Je remerciai Caroline très-ostensiblement, mais ce qui était moins visible pouvait encore bien mieux lui prouver toute ma gratitude. En France on sait fort bien tout ce que veut dire le jeu muet d’un pied qui cherche à table à se lier avec son voisin; en Hollande, ce langage avait-il la même acception? Je l’ignorais. Au risque de faire une école, je posai doucement mon pied sur celui de Caroline, qui fut sourde à l’appel, mais qui en me regardant avec une gracieuse timidité semblait me dire: Je vous entends bien. Son regard m’en dit beaucoup plus que je n’osais l’espérer. Ce regard m’apprit tous les secrets de son cœur, et si le mot j’aime ne s’échappa point de sa bouche, ses yeux exprimaient le plus doux attendrissement. Enfin on quitta la table et l’on passa dans une autre salle pour boire du vin et manger des boterham, c’est-à-dire des tartines de pain et de beurre. Ces messieurs fumèrent de nouveau, et sans qu’on le trouvât mauvais, j’entretins Caroline avec une liberté qu’on n’oserait jamais prendre en France. Tout en fumant et buvant d’un côté, et jasant de l’autre, l’heure du souper arriva, et toute la famille Nieuweman continua à manger sans qu’il me fût possible de l’imiter. Oh! que de gens en Hollande ne semblent vivre que pour manger! Après avoir fait acte de comparution au souper, je pris congé de la société, et par hasard je sus que le lendemain Caroline et son amie iraient à la promenade du Bois. Ce Bois est un lieu charmant à la porte de La Haye et où de magnifiques arbres déploient une majestueuse croissance. Mais une chose assez extraordinaire, c’est que cette superbe promenade, qui par sa proximité avec la ville et sa beauté réelle devrait être très-fréquentée, est presque toujours un lieu très-solitaire: tant mieux pour ceux qui en s’y promenant peuvent avoir quelque motif d’éviter la publicité. Malgré qu’il n’y eût point eu de rendez-vous d’assigné entre Caroline et moi, nous nous rencontrâmes au Bois, où je la trouvai avec son amie, et j’eus le plaisir de les rejoindre auprès de la petite maison royale qui est à l’extrémité de cette promenade. Le roi n’y étant pas, je me fis ouvrir les appartemens par le concierge, et auprès de ces dames je m’érigeai en cicerone. Si la jolie veuve eût été sans son amie, peut-être aurais-je tenté de guider ses pas du côté d’un certain cabinet chinois où l’ancien stathouder aimait, dit-on, à faire la sieste; cabinet dont on fit depuis un charmant boudoir, et dans lequel on n’allait plus dormir. Je ne laissai point échapper cette occasion de faire connaître à Caroline combien elle m’intéressait, et elle répondit à mes protestations d’amour avec une naïveté charmante, un abandon tout aimable et auquel l’accent étranger semblait ajouter encore une grâce particulière. Nous quittâmes le Bois et je laissai Caroline et son amie à la porte de la ville. J’étais enchanté ! tout me présageait la plus douce intimité. 1
Le roi, animé du désir de faire le bien de la Hollande, s’abandonna sans réserve à cette honorable pensée, mais il voulut exécuter trop de choses en peu de temps, et tout ce qu’il voulait faire n’entrait pas dans les vues de l’empereur des Français; toute ses promesses aux Hollandais à son avénement au trône étaient autant de protestations contre le grand système continental de Napoléon, qui dès lors parut se méfier de son frère.
Louis appela près de lui des Hollandais d’un mérite distingué et pour lesquels il avait conçu beaucoup d’estime. MM. Molerus, Gogel, Twent et Roëll lui furent d’une très-grande utilité, le premier au ministère de l’intérieur, le second aux finances, le troisième à l’administration des digues, et le dernier comme ministre secrétaire d’état. M. Van der Goes, placé au ministère des affaires étrangères, quoiqu’il se fût d’abord ouvertement déclaré l’ennemi du régime monarchique, et qu’il eût les opinions et le caractère républicains, donna au roi toutes les marques d’un dévoûment absolu.
La nouvelle constitution présentant de l’obscurité sur différens points, le roi voulut en faire une nouvelle rédaction, encore bien qu’il ne regardât cette constitution que comme provisoire, jusqu’à la paix générale . Il appela au ministère de la justice et de la police M. Van Hof, à celui des colonies M. Van der Heim, et le général Bonhomme au ministère de la guerre: c’était alors les hommes qui pouvaient le mieux seconder ses vues. Plus tard il voulut connaître la situation des affaires du pays. Il fut justement effrayé de l’état du trésor. L’administration des digues, si importante pour le pays, était dans un désordre affreux, sans mode régulier, et tous ses travaux abandonnés à l’arbitraire des villes, des villages, et même des seigneuries. Cependant, malgré la pénurie des fonds, le roi trouva le moyen de faire continuer les belles écluses de Catwyk, dont les travaux avaient été commencés sous l’ancien gouvernement. Il examina attentivement toute la jurisprudence du pays, qu’il trouva encombrée de lois incohérentes, et d’autant de juridictions qu’il y avait de provinces, en sorte que le même délit, à des distances très-rapprochées, était différemment puni. Ce qui était juste dans une province était injuste dans une autre province. Le gouvernement actuel n’avait point à lui ce qu’on appelle une police dévouée; il marchait dans les ténèbres, se fiant souvent au premier venu, ou à des hommes qui servaient l’étranger à ses dépens.
L’armée de terre n’avait rien d’imposant. On la disait forte de 20,000 hommes, mais on aurait eu beaucoup de peine à en rassembler 10 à 12,000. Le corps de l’artillerie et du génie, qui ne manquait pas d’officiers instruits, se réduisait à fort peu de chose, parce qu’on ne pouvait pas compter sur le soldat, dont on ne prenait pas assez de soin.
La marine était dans une situation plus agréable; elle avait deux flottilles, l’une à Boulogne-sur-Mer, et l’autre pour la garde des côtes et des ports: il y avait au Helder, à Rotterdam et à Amsterdam, un assez grand nombre de vaisseaux, quelques frégates et plusieurs bâtimens légers. Les chefs de la marine étaient MM. Dewinter, Verhuell. Kikkert, Bloys van Treslong, Hartzinck et Lemmers.
Quoique l’exercice du culte fût libre, les ministres de la religion réformée étaient les seuls qui fussent salariés par l’État. L’église catholique végétait dans la plus profonde misère, et les seuls ministres réformés étaient chargés des écoles. Les juifs, et surtout les juifs allemands, étaient dans un état d’abjection et d’oppression dans lequel ils s’abrutissaient de plus en plus. Les catholiques n’étaient admis à aucun emploi honorable, et les juifs étaient éconduits de toutes parts.
Le commerce se réduisait à fort peu de chose, et il s’appauvrit encore davantage lorsque le roi crut devoir supprimer une contribution que les consuls français avaient établie à leur bénéfice sur tous les bâtimens entrans et sortans. La privation de ce droit arrêta toute espèce de relation avec l’Angleterre, et le pays resta dans l’inaction la plus complète. Les manufactures et les fabriques se trouvaient paralysées par la supériorité des mêmes établissemens dans les autres pays.
Les sciences et les arts, cultivés avec moins de succès qu’ailleurs, n’étaient point appliqués à l’industrie.
L’instruction publique présentait un état assez florissant; mais les universités étaient en trop grand nombre. On y distinguait dans tous les genres des hommes du premier mérite.
Après que le roi se fut très-sérieusement occupé d’acquérir des connaissances exactes sur toutes les branches de l’administration, en travaillant beaucoup avec ses ministres, et après avoir pourvu aux principaux objets, il se rendit avec la reine aux eaux d’Aix-la-Chapelle. Une partie de la cour accompagna LL. MM., et quoique la santé du roi fût assez chancelante, il n’en travailla pas moins à vouloir apprendre le hollandais. Malgré tous ses efforts, il n’a pu triompher des difficultés qu’un Français rencontrera toujours à prononcer les langues du Nord. Cependant, quelques courtisans hollandais ayant osé assurer le roi qu’il parlait parfaite ment l’idiome du pays, il se hasarda un jour à prononcer un discours en hollandais; mais il sentit bien lui-même, dès avant la fin du discours, que si l’auditoire ne donnait aucune marque d’improbation, il le devait uniquement au respect dont personne ne pouvait s’écarter envers S. M.
Le roi passa aux eaux tout le mois d’août et une grande partie de celui de septembre, et de là il entretenait avec la Hollande une correspondance très-suivie.
Afin de réduire les dépenses de l’État, le roi se flatta d’obtenir de la France le renvoi des troupes françaises du territoire de la Hollande et la diminution des armemens maritimes; il avait directement écrit à l’empereur son frère qu’il abdiquerait sur-le-champ si le gouvernement français ne s’acquittait point envers la Hollande, et si les troupes françaises restaient plus long-temps à la solde du pays. L’empereur, qui pourtant ne souffrait pas qu’on lui imposât des conditions, accorda dans cette circonstance à peu près tout ce qu’on lui demandait; mais il y a tout lieu de penser que ce prince n’aurait pas voulu retirer ses troupes de la Hollande, s’il ne s’était pas vu dans la nécessité d’augmenter l’armée française en Allemagne, pour s’opposer aux hostilités de la Prusse.
Dans cette situation, le roi jugea qu’il était très-important pour le pays d’augmenter le nombre de ses troupes de terre, afin de pouvoir par lui-même éloigner de son territoire les troupes étrangères, et de se montrer aussi dans une attitude indépendante; car tout lui présageait qu’il devait peu compter sur l’assistance de la France, qui à chaque instant manifestait à son égard des intentions peu bienveillantes. Tout récemment encore, l’empereur venait de refuser, pour ambassadeur à Paris, le général Dumonceau, et s’était opposé à ce que la Hollande eût un commandant à Flessingue.
En portant ses regards au loin, en rapprochant une foule de circonstances, et en se rappelant le propos échappé à M. de Talleyrand, «que sans le prince Louis on n’aurait
» pu rien conclure avec les Hollandais», tout faisait pressentir au roi l’envie qu’avait l’empereur de faire déclarer la banqueroute, et ensuite de réunir la Hollande à la France.
Dans ces dispositions, quoiqu’elles n’altérassent pas l’affection particulière du roi pour son frère, Louis cependant s’opposa à ce que la fête de l’empereur, le 15 août, fut célébrée avec magnificençe. L’empereur s’en formalisa; mais, dès le 3 août, le roi avait, de Mayence, donné ses ordres à cet égard à son grand-maréchal du palais.
La Prusse faisant faire à ses troupes quelques mouvemens sur les frontières de la Hollande, et la France gardant sur ces dispositions le plus absolu silence avec le gouvernement hollandais, le roi quitta les bains et revint à La Haye, où il dut prendre de promptes mesures pour se mettre sur une défensive imposante, car l’empereur n’annonçait pas qu’il voûlut protéger la Hollande dans la lutte qui allait avoir lieu. Louis pressentait même qu’il pourrait bien entrer dans les vues de son frère de ne point lui laisser commander son armée. Cette armée, Louis la divisa en deux corps; l’un de 12 à 15,000 hommes, commandé par lui et qui devait se rendre à Wesel; l’autre, sous les ordres du général Michaud, devait stationner au camp de Zeist. Le roi était prêt à partir, lorsqu’un officier d’ordonnance de l’empereur, M. de Turenne, lui remit des dépêches qui lui confirmèrent la crainte qu’il avait que ses troupes ne fussent point réunies en corps d’armée. Cette disposition l’affligea beaucoup, et par la suite elle découragea le corps de ses officiers qui, ainsi que lui, perdirent tout à coup leur enthousiasme militaire. Le roi devant bientôt partir pour l’armée, la reine, accompagnée de ses deux fils, fut rejoindre l’impératrice Joséphine à Mayence.
Après avoir laissé au général Dumonceau le commandement des troupes qui étaient au camp de Zeist, le roi partit accompagné du général Michaud; il se rendit à Wesel où il fit d’abord construire un pont de bateaux, pour assurer une facile communication entre les deux rives du Rhin; il fit approvisionner la place, et dans le courant d’octobre il quitta Wesel pour se porter en Westphalie avec son armée. La position difficile dans laquelle se trouvait le maréchal Mortier, commandant le 8e corps de l’armée française, engagea le roi à voler à son secours, et il se rendit lui-même à Cassel, où il eut le chagrin d’apprendre que toutes les dispositions de l’empereur tendaient à ne le considérer à l’armée que comme un prince français, et non comme le roi de Hollande.
Depuis ce moment, le système de l’empereur, à l’égard de la Hollande, se déroula complètement aux yeux du roi. Alors se dissipa toute l’obscurité de la conduite du gouvernement français et toute l’ambiguité de la correspondance de Napoléon. C’est de ce moment que Louis prit la résolution de ne plus agir désormais que comme roi de Hollande. Rien n’égalait l’impatience qu’il avait de revenir dans ses états, et il écrivit à La Haye que dans peu de temps on le reverrait au milieu de son peuple. En ramenant son corps d’armée il bloqua les places fortes de Hameln et Nieubourg, occupées par les Prussiens; le général Daendels occupa Rinteln, place forte sur le Weser. La place était investie, lorsqu’un ordre de l’empereur enjoignit au roi de se rendre dans le Hanovre, pour en prendre possession. Le roi, offensé de cette injonction, fit venir de Hollande le général Dumonceau, auquel il donna le commandement de toutes ses troupes, écrivit à l’empereur qu’il retournait à La Haye sans vouloir aller en Hanovre, et il rentra dans sa capitale avec la triste conviction que l’empereur ne l’avait placé sur le trône de Hollande qu’avec l’intention d’obtenir du peuple qu’il était appelé à gouverner tout ce qui pourrait servir aux projets du grand empire.
Pendant l’absence du roi, la cour avait été languissante, et ceux qui n’avaient point accompagné S. M. cherchèrent quelques distractions dans les sociétés où l’on essayait à former de douces habitudes. On allait au spectacle passer des soirées assez ennuyeuses, lorsqu’on n’y faisait point de ces heureuses rencontres, enfans du hasard, qui parfois conduisent à des aventures fort amusantes, et où d’autre fois aussi le cœur, tout en plaisantant, s’engage très-sérieusement. Messieurs les ambassadeurs, fidèles habitués du salon de mademoiselle Lobé, bornaient assez volontiers leurs plaisirs à faire la partie chez cette belle, où d’autres belles venaient aussi tendre leurs filets. L’une d’elles, madame Rolland, alors, oui alors ( car les actrices en général sont de nature très-inconsante: elles changent de nom, de meubles et d’amans avec la même facilité ) la très - spirituelle et jolie madame Rolland,dont les charmes ont probablement aussi éprouvé quelques altérations, si elle n’eût pas changé d’amours, n’aurait point écouté ni encouragé les entreprises d’un prince russe dont les roubles et la galanterie surent toucher son coeur.
J’avais continué d’aller assez assidument dans la famille de l’aimable Caroline, à laquelle j’avais fait l’aveu dé mes sentimens, aveu quelle avait entendu avec ce timide embarras qui tout en ôtant la force de répondre est lui-même la plus douce des réponses. Ma présence chez son père ne donnant aucune inquiétude, elle me fit aisément engager dans une partie qu’on devait faire à Schevelingen où l’on allait manger du poisson. Schevelingen est un village fort curieux, à une lieue de La Haye, et où l’on arrive par une superbe avenue plantée de chênes, de tilleuls et de hêtres. Nous entrâmes dans une grande auberge, où il y avait une telle affluence que nous fûmes fort heureux d’obtenir un coin dans la chambre particulière de la maison. Dans la salle commune c’était un tapage épouvantable, et je ne concevais pas comment ces Hollandais si paisibles, si calmes, pouvaient ce jour-là être aussi bruyans. En France, il n’y a que le peuple, proprement dit, qui se livre à cette grosse gaîté, à cet oubli, pour ainsi dire, de toute bienséance; tandis qu’en Hollande il n’est pas rare de voir ce qu’on appelle la classe bourgeoise s’abandonner les jours de fêtes, dans les lieux de rassemblemens publics, à une turbulente hilarité qui contraste d’une manière bien frappante avec leur sang-froid et leur habituelle tranquillité. Après avoir observé un instant toute cette nombreuse société, dont la majeure partie avait la pipe à la bouche, je revins auprès de mes commensaux, et à côté de l’aimable Caroline j’oubliai la scène originale qui m’avait occupé un moment. Nous mangeâmes d’excellent poisson frais. Par égard pour moi on servit certain poisson sec, exhalant une odeur insupportable, laquelle pourtant ne révolte pas les houpes olfactoires des dames hollandaises. La nuit nous surprit à l’auberge de Schevelingen. L’affluence des personnes qui revenaient à La Haye était si considérable qu’il fut imposible d’avoir des voitures. Nous revînmes à pied; je pris le bras de Caroline, et sans qu’elle s’y opposât je ralentis notre marche afin de nous perdre dans la foule: ainsi tous deux nous cheminâmes et de très-près, sans nous occuper du reste de la société que nous rejoignîmes à la maison Nieuweman, où l’on ne trouva pas mauvais que nous fussions revenus isolément. Dans l’obscurité qui nous protégeait, je lutinai un peu mon compagnon de voyage, qui sans cesse me recommandait d’être sage; ce n’était pas chose facile; cependant j’en fis la promesse, à condition qu’on reviendrait à la maison du Bois et surtout qu’on y viendrait seule. Caroline hésita, j’insistai, et l’aimable veuve s’engagea, mais toujours en me faisant promettre d’être sage. Oh! les femmes! elles sont partout les mêmes! Le jour convenu, Caroline se rendit seule au Bois et je l’eus bientôt rejointe pour la conduire, par une porte secrète, dans le jardin dont le concierge m’avait donné la clef; du jardin, dont je connaissais assez bien les détours, nous allâmes au charmant boudoir chinois lieu de délices, où jamais l’amour ne réunissait deux amans pour bouder.
Le roi revint enfin à La Haye et la cour reprit toute sa splendeur. S. M., que les Hollandais revirent avec beaucoup de plaisir, donna bientôt des réunions où reparurent les dames hollandaises que l’absence du souverain avait d’autant plus affligées que ces réunions étaient une espèce d’arène où leurs attraits paraissaient dans tout leur éclat. Mais le roi, et tous ceux qui suivaient un peu les affaires du pays, furent jetés dans une grande consternation par le système du blocus des îles britanniques, mesure désastreuse prise par le gouvernement français et qui pouvait ruiner la Hollande. Le roi éluda autant que possible l’exécution du décret de l’empereur, mais il ne put éviter que son frère apprît assez promptement qu’il l’abusait; Napoléon s’en plaignit en maître absolu qui désormais veut être aveuglément obéi. Ce ton impérieux détermina enfin le roi à fermer les ports du royaume à tous les vaisseaux et sans aucune exception.
Malgré le décret du 15 décembre par lequel le roi semblait ne plus s’opposer à la pleine et entière exécution du blocus, l’empereur Napoléon se plaignait toujours, et ses agens secrets, qui paraissaient ne point douter qu’il n’y eût encore des relations importantes entre la Hollande et l’Angleterre, lui firent des rapports qui pensèrent amener des visites domiciliaires dans le pays.
Le roi, voulant imiter les autres alliés de la France, envoya au quartier-général de l’empereur une députation chargée de le féliciter sur ses succès. Les personnages choisis par le roi pour remplir cette mission importante étaient MM. de Bylandt - Halt, van Styrum, Bangeman - Huygens et Goldberg, tous Hollandais, et tous, sans doute, jouissant d’une réputation honorable; mais si cette députa tation avait été composée de Français et de Hollandais, les députes, qui furent très-mal reçus, eussent tous été bien accueillis, et l’empereur aurait donné au roi la satifaction qu’il avait droit d’attendre pour tous les sacrifices que la Hollande avait faits depuis quelque temps. Le roi avait alors auprès de lui des Français d’un mérite distingué, et qui, avec raison, s’offensèrent de ne point faire partie de la députation. En voulant tout concilier avec la France, le roi manquait toujours son but dès qu’il semblait affecter d’éloigner les Français qui l’entouraient des affaires de son gouvernement.
Cette sourde mésintelligence entre les deux frères n’empêcha pas le roi de Hollande de s’occuper des institutions qui pouvaient être utiles à son gouvernement. Il choisit des jurisconsultes renommés pour établir un Code civil et un Code criminel. Mais avant tout, il s’occupa de faire compléter le nouveau système des contributions, et d’établir des réglemens sur les corporations et maîtrises. Les efforts qu’il tenta pour asseoir avec égalité les contributions qui devaient peser sur tous les habitans, faisaient l’éloge de son cœur et de sa rectitude. Lorsqu’il eut complété son grand travail sur ce sujet important, et. d’où dépendait le salut du pays, il assembla le conseil-d’état, et, par le discours qu’il prononça à cette occasion, il appelait franchement la discussion. Les débats furent assez vifs, mais les bases de son plan de contributions furent adoptées avec des modifications; et les réglemens sur les corporations et maîtrises avant encore excité les plus vifs débats, il y eut des commissions de nommées de part et d’autre, et leur travail fut converti en une loi qui s’accordait avec celle déjà portée sur l’établissement des contributions.
Le roi montra aussi le désir que l’on s’occupât de la discussion et del’examen du projet du Code criminel. Les principales bases en furent arrêtées, et les rédacteurs chargés de ce grand travail, MM. Reuvens, Élout et Muschenbroeck, demandèrent un an pour le terminer.
Tandis que le corps-législatif était assemblé, le roi sut lui faire, avec autant de dextérité et de ménagemens que de justesse, des observations sur l’inconvenance de la dénomination qu’il prenait quelquefois de Hautes Puissances. L’orgueuil national s’irrita d’abord; mais la raison l’emporta, et depuis ce jour les Hautes Puissances abandonnèrent cette fastueuse qualification, qui tenait un peu de la souveraineté, pour ne plus prendre que le modeste titre de corps-législatif. L’empereur Napoléon en l’apprenant dit: «Comment
» donc! Louis a osé arracher cette plume du
» paon.»
A l’instar de ce qui avait été fait en France, le roi, au commencement du mois de décembre, institua les grands officiers du royaume, maréchaux et colonels-généraux. Plus tard, il proposa au corps-législatif une loi portant création de l’ordre de l’Union et de l’ordre du Mérite.
A la fin de cette première année de son règne, le roi s’empressa de rendre compte au corps-législatif de tout ce qui avait était fait dans l’année, et prit la résolution d’en faire autant de chaque exercice. C’était le moyen de gagner la confiance de la nation, et de l’amener à faire tout ce qu’il voudrait entreprendre pour lui être utile. C’est aussi ce que Schimmelpenninck, le Grand Pensionnaire de la république, se proposait de faire s’il eût conservé le pouvoir en Hollande .