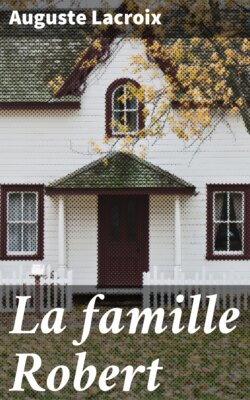Читать книгу La famille Robert - Auguste Lacroix - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PREMIÈRE PARTIE
LA FAMILLE ROBERT PENDANT LA TERREUR
ОглавлениеTable des matières
En1789, il y avait, rue d’Argenteuil, un ancien tailleur nommé Robert, qui pouvait avoir environ cinquante ans; par son aménité et sa réputation d’honnête homme autant que par son savoir-faire, il était parvenu à se faire une excellente clientèle parmi la haute bourgeoisie et la noblesse dans laquelle se trouvaient des personnes de la cour.
Le père Robert, à force d’ordre et d’économie, était arrivé à s’amasser une petite fortune. Alors souvent il parlait de se retirer avec sa femme à la campagne, mais comme il avait une fille de quinze ans qu’il fallait penser à marier, et un fils de dix-sept ans qu’il voulait établir, il ne se pressait pas.
Comme c’était généralement l’usage, Robert avait fait apprendre son état à son fils Ernest, dans l’intention de lui laisser un jour son établissement. Malheureusement le proverbe disant que l’homme propose et Dieu dispose, trouva une trop cruelle justification.
Robert, en effet, fut surpris par la révolution. D’abord il s’en inquiéta peu, se contentant de déplorer les événements sans avoir la pensée d’y prendre la moindre part. Cependant, lorsque le travail vint à baisser, il ne put s’empêcher d’éprouver d’assez vives inquiétudes; le temps arriva où il en manqua tout à fait. Alors Robert dit à son fils: Comme nous n’avons plus d’ouvrage, il faut que j’aille visiter mes clients savoir si c’est qu’ils me quittent et connaître le pourquoi ils ne nous donnent plus rien à faire.
Le lendemain donc, le père Robert prit son chapeau, sa canne, et se mit en route. Déception, même réponse, tous lui disent: nous n’avons rien à vous donner à faire.
Cela n’était pas étonnant, déjà dans ce temps-là, les affaires allaient si mal! La noblesse ne touchait plus de redevances. Les propriétaires ne recevaient plus leurs loyers. Les rentiers ne pouvaient obtenir le payement de leurs rentes. Enfin, les affaires commerciales étaient suspendues. Puis on émigrait de toutes parts.
Robert en rentrant chez lui se demandait ce qu’ils allaient devenir.
–Que veux-tu, père, lui dit Ernest; il nous faut attendre un temps meilleur.
–Attendre, mon garçon, c’est chose facile à dire, mais nos ressources s’épuisent et si d’ici à quelques jours le travail ne revient pas, nous en verrons bientôt la fin.
Un mois plus tard, le brave tailleur renouvela ses visites, personne n’était disposé à lui donner d’ouvrage, tant partout le besoin d’économie se faisait sentir, il était loin d’en avoir assez pour couvrir ses frais; dès lors le capital diminuait d’une manière sensible et l’inquiétude augmentait dans une égale proportion.
Un jour que la famille gémissait sur les événements et sur sa position, Robert prit la parole.
–Mes enfants, leur dit-il; nous ne pouvons continuer ainsi, nos économies seront bientôt épuisées, il est temps que nous prenions un parti. La plupart de nos clients s’expatrient; les autres se cachent ou tombent sous le couteau de la guillotine, en un mot, je ne reçois plus d’argent et nous n’avons plus de travail.
–Eh bien! quel est ton projet, répliqua Mme Robert pleurant ainsi que leur fille Émilie.
–Mon projet, le voici: Vous savez que M. le comte de Villement, notre plus ancienne pratique, nous a toujours voulu beaucoup de bien et que M. Presta, le député, nous a constamment témoigné de l’intérêt. Je sais que le valet de chambre du premier s’est mal conduit avec lui et qu’il a été renvoyé. Il faut que toi, tu lui demandes cette place tandis que j’irai m’offrir à M. Presta qui cherche un concierge. Toi, ma chère femme, tu garderas la porte pendant que je travaillerai un peu de mon état. Quant à Émilie, nous lui chercherons une place de femme de chambre; qu’en penses-tu, ma bonne amie!
–Il est bien dur après avoir été établi, fit Mme Robert, de devenir concierge. Sans doute M. Presta est bon, mais il y a des locataires dans la maison et c’est humiliant. Cependant si nous n’avons plus de quoi vivre, il faut bien s’y résigner.
–Et vous, mes enfants, que répondez-vous?
–Nou n’avons rien autre chose à répondre que ce qu’à répondu notre mère; nous ferons ce que vous voudrez.
–Ce n’est pas d’entrer en condition qui me chagrine, ajouta Émilie, c’est de me séparer de vous.
–Que voulez-vous, mes pauvres enfants, continua Robert, c’est la Révolution qui nous cause tous ces désagréments; elle nous a ruinés et pourtant il faut vivre.
Le lendemain matin, dès neuf heures, le père et le fils s’habillèrent le plus convenablement possible et se dirigèrent, l’un chez le comte de Villement, l’autre chez M. Presta; ils y furent bien accueillis. Après les questions d’usage et que l’on fut convenu des conditions, tous les deux furent acceptés.
Huit jours après, lorsqu’ils eurent réglé leurs affaires personnelles, ils entrèrent en fonctions.
Avant la Révolution, le comte de Villement avait occupé un emploi important dans le gouvernement, mais voyant que les affaires publiques prenaient une mauvaise tournure, il donna sa démission. C’était un homme de soixante-cinq ans, d’une parfaite urbanité, d’une grande politesse et d’une bienveillance exquise pour tout le monde, même pour ses adversaires politiques. Ne possédant qu’une médiocre fortune, il tenait néanmoins un certain rang dans la société. Seulement comme il restait fidèle à Louis XVI, cela avait suffi à le faire remarquer des républicains.
M. Presta était âgé d’environ quarante-huit ans, il possédait une grande fortune acquise dans une entreprise de fournitures pour l’armée, entreprise qu’il avait abandonnée depuis un an ou deux.
D’une nature vive et entreprenante, il ne pouvait s’accoutumer à vivre dans l’oisiveté. D’un caractère passablement autoritaire, il était cependant bon, équitable et avait le jugement très juste.
Quand à ses opinions politiques, il défendait la liberté, mais une liberté sage, prudente et progressive, sans pourtant attaquer les principes monarchiques. Il combattait les privilèges avec ardeur tout en respectant les droits de chacun. De même, il réprouvait les abus du pouvoir, sans jamais attaquer la personne du roi. En un mot, il appartenait à ce grand parti des girondins qui payèrent de leurs têtes la part qu’ils prirent à la Révolution, à ce même parti dont, sous la Restauration, les représentants furent appelés libéraux; constitutionnels sous Louis-Philippe, et enfin, aujourd’hui, républicains modérés.
C’est dans ces dispositions d’esprit qu’avec de persévérants efforts et beaucoup d’argent, M. Presta parvint à se faire nommer député à la Convention; car de tous temps les hommes arrivés à la fortune ambitionnent ce poste d’honneur, le plus souvent, à vrai dire, dans le but d’atteindre des places plus élevées encore ou plus lucratives.
Dans ses démarches, M. Presta avait accepté les services d’un nommé Beaupré qui lui donna un bon coup de main; pour l’en récompenser, il lui avait accordé un appartement dans sa maison et il lui avait promis de s’occuper de lui faire obtenir un emploi dans une administration quelconque; car, depuis longtemps, en raison de ses opinions républicaines, il en sollicitait une qu’il n’avait pu encore obtenir. Cet homme, que M. Presta connaissait à peine, était une véritable charge pour lui. Il aurait bien voulu s’en débarrasser, mais c’était assez difficile, Beaupré ayant contribué, pour une large part, à l’élection de M. Presta.
Dans ce moment-là, on touchait aux plus mauvais jours de la Révolution, Les partis ne cessaient de se disputer. On se querellait à la ville comme à la Convention. De virulents discours étaient journellement prononcés à la tribune, où l’on allait jusqu’à s’injurier et à se menacer mutuellement. Enfin, on n’osait plus parler des affaires publiques ni chez soi, ni dans la rue, tant on se craignait les uns les autres. Car tout le monde se défiait de ses voisins, même de ses amis. Les dénonciations se multipliaient; les prisons regorgeaient; la guillotine fonctionnait sans relâche et elle était devenue insuffisante à la féroce activité de ce sombre tribunal révolutionnaire dont Fouquier-Tinville, si tristement célèbre, était l’accusateur public et qui condamnait ses victimes, sans leur donner le temps ni de s’expliquer ni de se défendre. Ainsi des hommes les plus innocents du monde étaient envoyés à la mort comme d’infâmes criminels.
La terrible crise en étant arrivée à ce point, le comte de Ville ment commençant à craindre pour lui-même, résolut de quitter la France avec sa famille.
Un matin donc il commanda à Ernest de préparer vivement ses malles en lui disant: nous allons faire un long voyage et nous désirons partir sans retard.
–Veux-tu nous suivre? ajouta-t-il. Si tu te décides, dans un temps plus heureux, je ferai en sorte de t’en récompenser; mais hâte-toi, et dès aujourd’hui fais tes adieux à ta famille.
–Je vous suivrai en quelque lieu que vous alliez, monsieur le comte, certain que vous ne m’abandonnerez pas une fois en terre étrangère.
–Compte sur moi, mon ami, mais tu sais, il faut que demain matin avant le jour nous ayons quitté Paris. Fouquier–Tinville ne plaisante pas, vois-tu; et je ne tiens pas à tomber sous sa griffe.
Les préparatifs de voyage terminés, Ernest s’empressa de se rendre chez son père et lui conta ce qui venait de se passer. Robert comprenant le danger auquel était exposé le comte, l’approuva fort du parti qu’il prenait de s’expatrier.
–Allons, mon garçon, ajouta le brave homme, tu fais bien d’accompagner tes maîtres. Si cela me fait de la peine de te voir partir, au moins c’est une preuve que tu as du cœur.
La maman Robert et Émilie pleuraient à chaudes larmes, mais après tout, se dirent-elles, quand on voit ce qui se passe, c’est peut-être un bonheur pour Ernest qu’il s’éloigne. Sait-on ce qui peut arriver? Dans un temps comme celui-ci il faut s’attendre à tout. Au moins, ajouta Mme Robert, si mon fils est exilé, il sera à l’abri de tout danger.
Le lendemain soir, Ernest avait passé la frontière avec ses compagnons de voyage, se rendant en Hollande, le pays que le comte avait choisi, comme étant celui où il pensait pouvoir se mieux convenir.
Revenons à M. Presta; comme tous les hommes arrivés à la fortune, il était assez fier de sa position. En conséquence, il ne se croyait pas inférieur aux gens de noblesse. Aussi, à la Convention, lorsque l’occasion s’en présentait, ne manquait-il pas de se déclarer en faveur de la bourgeoisie et de défendre les intérêts du peuple. Cependant lorsqu’arriva le procès de Louis XVI se refusa-t-il énergiquement à l’accuser d’aucune des soi-disant fautes de son gouvernement. Il ne fut donc pas de ceux qui votèrent la mort du roi.
Dès lors M. Presta fut considéré comme suspect et on le fit surveiller, aussi quelques jours plus tard, une dénonciation ayant été portée contre lui, il fut arrêté et incarcéré sans en comprendre les motifs.
Sa femme connaissant le sort des girondins était dans la désolation. Cette subite arrestation la plongeait dans la plus cruelle inquiétude. Elle et ses filles, dont l’aînée avait à peine douze ans, ne faisaient que pleurer. Le pauvre Robert lui aussi était navré.
Seul, M. Presta ne perdait pas courage. Je n’ai commis aucun acte contre la république. Si ce n’est de n’avoir pas voté la mort du roi, pour ce fait, on ne peut me condamner, en cela j’ai agi selon ma conscience et selon mon droit, en quoi suis-je répréhensible? Néanmoins aujourd’hui les hommes sont si injustes qu’il ne faut pas s’y fier. J’ai de la fortune, avec de l’argent on fait tant de choses; il s’agit donc avant tout de me tirer de là.
Le prisonnier commença à se mettre dans les bonnes grâces du geôlier en chef, lui faisant entendre qu’il n’était nullement hostile à la république et qu’il était fort riche.
Un jour il dit à ce gardien qu’il avait besoin d’argent et lui demanda la permission de s’en faire apporter par son valet de chambre, lui. laissant habilement entrevoir qu’il en aurait une bonne part.
–Cela m’est formellement défendu, grommela le porte-clefs; mais j’aviserai.
–En ce cas, répliqua M. Presta, voulez-vous être assez bon pour faire passer ce billet à ma femme?
–Oh! pour cela, il n’y a pas d’inconvénient, répondit le gardien. Remettez-le-moi.
Le lendemain le geôlier prit M. Presta à part; tenez, lui dit-il à voix basse, voilà votre affaire, et il lui remit deux rouleaux d’or.
–Mais, dites donc, on pourrait me le voler ici, fit M. Presta qui avait tout prévu. Voulez-vous me tenir cet argent en garde?
–Entendu, dit le gardien.
Deux jours après, M. Presta pouvait s’échapper, et tournant les talons il gagnait la frontière.
Dans la lettre adressée à Mme Presta, il y en avait une pour Robert. Cette lettre était ainsi conçue:
«Mon bon Robert,
«Ne t’effraye pas de me savoir en prison et rassure-toi, je serai peut-être un peu longtemps sans te voir. En attendant, comme je connais ta haute probité, demande à ma femme qu’elle te remette les papiers contenus dans un portefeuille qui se trouve dans mon secrétaire, mets-les en lien de sûreté. Je les confie à ta garde jusqu’à ce que je puisse te les réclamer. Continue à toucher pour moi mes loyers, et dépose-les chez le notaire Dubreuil, mais ne sois pas trop exigeant à l’égard des locataires. Surtout ne perds pas courage.»
Pendant ce temps, Mme Presta faisait toutes les démarches possibles pour arriver à délivrer son mari; mais personne n’osait prendre sa défense, tellement chacun avait peur d’être soupçonné de prendre parti pour un royaliste, et de paraître suspect à son tour.
Au moment où Robert venait demander à sa maîtresse les papiers en question, Mme Presta recevait la lettre suivante:
«Ma chère femme,
«Grâce à l’or que tu m’as fait passer par l’entremise de mon geôlier, j’ai pu réussir à m’échapper; je suis en route pour Hambourg où je vais me réfugier; viens avec nos enfants m’y rejoindre le plus tôt possible.»
Cette nouvelle combla de joie tout le monde.
Mme Presta remit à Robert les papiers ainsi que l’avait indiqué M. Presta. Avant de s’éloigner, il lui dit: Hâtez-vous de partir, madame, et soyez sans inquiétude; quant à votre maison; je me charge de la garder, comptez sur moi.
Deux jours après, Mme Presta accompagnée de ses quatre filles sous un faux nom et emportant tout ce qu’elle pouvait emporter, gagnait Hambourg, heureuse de retrouver son époux et de lui ramener ses enfants.
Voilà donc Robert resté seul à Paris, gérant de la maison de M. Presta, et parfaitement tranquille. Mais de nouvelles et terribles épreuves l’attendaient.
Un mois s’était à peine écoulé, lorsque Robert et sa femme virent Ernest rentrer chez eux.
Dans le premier élan de leur joie, heureux de se revoir, ils s’embrassèrent puis vinrent aussitôt les interrogations.
–Comment, Ernest, te voilà à Paris, lui dit Robert, est-ce que tu as été renvoyé de chez M. le comte?
–Non, répondit Ernest, je n’ai point été renvoyé, j’ai été remercié.
–Explique-toi, mon enfant, je ne te comprends pas.
–Apprenez qu’en Hollande, M. le comte a éprouvé tant de chagrin d’avoir quitté son pays et ses amis, qu’il est tombé malade. Non, répétait-il sans cesse à la comtesse, je ne m’habituerai jamais à l’exil loin de ma famille et de mes amis. De jour en jour le mal empira et, malgré tous les soins que nous mettions à le distraire, le pauvre homme succomba en prononçant ces dernières paroles: Pauvre France, les républicains te perdront.
Quelques jours après, Mme la comtesse me dit, continua Ernest, tenez, mon garçon, comme vous le voyez, me voilà seule, désormais je n’ai plus besoin de vos services; ma femme de chambre me suffit, retournez donc chez vos parents. Avant de mourir, mon pauvre mari, en reconnaissance des soins que vous avez eus pour lui, m’a remis pour vous une délégation de dix mille livres, payables chez son notaire, la voici, prenez-la, puisse-t-elle vous rendre heureux et assurer votre avenir. Naturellement, je remerciai la comtesse du mieux que je pus, je pris congé d’elle et me voilà.
Lorsque Ernest eut achevé ces paroles, Mme Robert et Émilie ne cessaient de l’embrasser et de l’interroger sur tout ce qui avait pu lui arriver sur la terre étrangère.
–C’est pas tout cela, dit Robert à son fils, puisque te voilà, mon pauvre garçon, que comptes-tu faire à Paris? Les affaires y vont bien mal.
–Eh bien! mon cher père, répondit Ernest, je tâcherai de me procurer un peu d’ouvrage et je reprendrai mon état de tailleur.
Là-dessus, Émilie invita son frère à la suivre et le conduisit à sa chambre où il put se remettre des fatigues du voyage.
Quelques jours après le retour d’Ernest, un événement nouveau et tout à fait inattendu vint atteindre la famille Robert.
Robert avait un frère qui était entré dans les ordres et qui n’avait pu encore obtenir de cure; il se nommait André. Comme les prêtres étaient alors fort mal vus, sous l’habit bourgeois, il avait sollicité et obtenu un emploi de professeur dans la maison du duc *** qui lui avait confié l’éducation de ses enfants.
Le duc *** avait occupé un poste important dans le gouvernement, et s’y était fait remarquer par ses hautes capacités et sa droiture. Après la mort du roi, il avait été révoqué de ses fonctions; puis un jour il fut dénoncé comme étant accusé d’avoir des rapports avec les royalistes émigrés. En vain, chercha-t-il à démontrer la fausseté de cette accusation, il fut brutalement jeté en prison. Quinze jours après, conduit sur la place de la Révolution, il fut exécuté avec plusieurs autres victimes.
La malheureuse duchesse était en proie à une sorte de folie, et ses gens pouvaient à peine la contenir. André cherchait par tous les moyens, . sinon à la consoler, du moins à calmer sa douleur, mais sans y réussir. Il cherchait aussi à lui faire comprendre qu’elle-même courait des dangers; il ne pouvait la décider à prendre des précautions.
–Non! disait-elle, je veux mourir pour aller rejoindre mon mari; les républicains sont assez, lâches pour tuer une femme, dès qu’elle est noble et vertueuse, cela leur suffit. Qu’ils fassent donc de moi ce qu’ils voudront, ce ne sera jamais qu’une victime de plus; cela les réjouira, les misérables ! En m’ôtant la vie, ils ne feront du moins que me délivrer de mes souffrancs.
–Allons, madame la duchesse, calmez-vous, soyez prudente, ne vous exposez pas à ce qu’il vous arrive malheur, lui répétait André, il y a dans ce monde tant de méchantes gens!
Cependant, lorsque la duchesse eut versé d’abondantes larmes, son état devint un peu meilleur et elle recouvra un peu de calme; alors André put lui faire entendre raison.
–Que croyez-vous que je puisse faire? finit-elle par lui dire.
–Il vous faut prendre un déguisement quelconque, madame la duchesse, et je me charge de vous trouver une retraite sûre.
–Hélas! mon bon André, si j’acceptais votre offre, vous vous compromettriez, et vous courriez autant de dangers que moi. J’apprécie votre dé vouement, mais, à mon âge, à quoi bon fuir la mort? Non, je ne veux pas vous exposer à vous perdre et peut-être d’autres avec vous. Laissez-moi donc près de mes enfants, que j’aime trop pour m’en éloigner, attendre le sort qui m’est réservé. N’oubliez pas que vous êtes prêtre, et si vous ne voulez pas vous exposer aux mêmes dangers que moi, il vous faut quitter sans retard ma maison.
André comprit l’importance de cette observation et, craignant d’être lui-même un sujet de crainte pour la duchesse, il ne crut pas devoir se le laisser dire deux fois, quoique convaincu de ses bonnes intentions à son égard; s’éloigner de la maison de la duchesse était pour lui bien plus une mesure de prudence, qu’un acte d’égoïsme. En conséquence, il rassembla son linge et ses vêtements, en fit un paquet et s’éloigna, non sans rendre ses devoirs à sa bienfaitrice et lui avoir fait toutes sortes de recommandations. Sa douleur était vive et ce qui l’affectait le plus, c’était de se séparer de ses charmants élèves auxquels il était profondément attaché.
De son côté, la duchesse sentait bien qu’en perdant André, elle perdait un serviteur fidèle et dévoué, mais c’était un devoir qu’elle devait accomplir et, bien qu’avec un sincère regret, elle dut s’y résigner.
Sorti de l’hôtel, André ne trouva rien de mieux à faire que d’aller tout droit frapper à la porte de son frère.
Robert parut surpris et lui dit:
–C’est toi, mon frère?
–Oui Robert, c’est moi qui viens te demander un asile.
–Alors entre donc, reprit Robert.
Ce jour-là, toute la famille était réunie dans la loge. André lui conta ce qui venait de se passer à l’hôtel de la malheureuse duchesse, à laquelle tout le monde s’intéressa.
–Voilà pourquoi, mes amis, je viens près de vous en vous priant de vouloir bien me loger.
–Peut-on rien voir de plus affreux, dit Mme Robert? Seigneur de Dieu! si cela continue encore longtemps comme ça, je crois que tous les bourgeois y passeront: quelles méchantes gens, que ces républicains.
–Tais-toi, ma femme, dit Robert, si l’on t’entendait!
–Ah! que veux-tu qu’on nous fasse à nous, pauvres gens, répliqua Mme Robert; tu vois bien qu’on n’en veut qu’aux riches.
–Ne vous y fiez pas, reprit André à son tour, si l’on vous soupçonnait d’être royalistes, vous y passeriez comme les autres.
–Tout cela est bien triste tout de même, continua Mme Robert; mais à propos, dis donc, père, où allons-nous loger ton frère?
–Dame, nous n’avons que deux petites chambres, et encore elles sont au cinquième.
–Je les accepte, dit aussitôt André, qui n’était pas difficile; seulement ne laissez voir à personne que je suis prêtre.
Émilie prit alors les clefs des chambres et y conduisit son oncle.
–Au moins, hasarda Mme Robert, que la peur avait un instant gagnée, il n’y a aucun danger pour nous?
–Je ne le pense pas, mais que veux-tu, c’est mon frère, je dois lui rendre ce service; j’espère bien qu’à lui comme à nous il n’arrivera rien de fâcheux.
Voilà donc André installé; il prenait ses repas dans la famille et y passait toutes ses soirées; il ne sortait qu’habillé en ouvrier.
Un jour, il se hasarda à aller prendre des nouvelles de la duchesse.
Le concierge lui apprit que des hommes, assurément agents de la révolution, étaient venus, avaient fait une perquisition dans l’hôtel, et après y avoir pris plusieurs papiers, avaient arrêté la duchesse, qui était allée rejoindre son mari.
–Lâches, s’écria André, qui ont osé porter la main sur une aussi sainte femme!
–Aujourd’hui, ajouta le portier, qui donc est certain de sauver sa tête?
–Et les pauvres enfants, que sont-ils devenus, continua André.
–Guillaume, le valet de chambre de monsieur le duc, les a conduits chez leur oncle, qui habite, un château dans la Normandie.
–Encore un crime de plus, soupira André en s’éloignant.
Rentré chez son frère, il n’eut rien de plus pressé que de raconter ce qu’il venait d’apprendre. Toute la famille en fut atterrée.
–Prends bien garde à toi, mon oncle, dit Émilie, et ne va plus t’exposer comme tu viens de le faire, il pourrait bien t’arriver malheur.
–Sois tranquille, ma bonne Émilie, je prendrai mes précautions de manière à ce qu’il ne m’arrive rien de fâcheux; je ne me dissimule pas que j’en ai besoin, car si dans le nombre des victimes il y a beaucoup de nobles, je sais aussi qu’il y a des prêtres.
Nons n’avons pas oublié que Beaupré, le protégé de M. Presta, habitait sa maison depuis bientôt. deux ans. Ce Beaupré était un homme d’environ quarante ans. Ni ses allures ni son physique n’avaient rien de bien attrayant, le seul avantage qu’il eût, c’était d’être un grand parleur. Il était de Rouen; établi d’abord fabricant de bonneterie dans cette ville, il avait fait de mauvaises affaires; puis il avait tenu un café, où il n’avait non plus réussi. Il était donc venu à Paris pour y chercher un emploi, que jusque-là il n’avait pas encore obtenu. Voilà pourquoi il s’était attaché à M. Presta, qui le soutenait, ainsi que sa femme et ses trois enfants.
Comme protégé de M. Presta, Robert se croyait tenu d’avoir quelques égards de plus pour lui que pour les autres locataires. Lui qui était la bonté et la simplicité même, il n’avait aucune défiance et ne supposait pas que cet homme eût été capable de quelque méchanceté contre lui, et encore moins contre M. Presta. Il le recevait donc quelquefois dans sa loge avec une certaine urbanité. Quand ils se rencontraient, ils se donnaient une poignée de mains, souvent même il plaisantait avec Mme Robert et sa fille.
Cependant, un jour, Ernest fit remarquer à son père que Beaupré ne faisait plus que de rares visites, et même qu’il rentrait quelquefois chez lui la nuit, et ils en cherchèrent la cause; pour ce qui était des visites, ils ne tardèrent pas à la connaître.
Depuis quelques jours, Mme Robert avait remarqué qu’Émilie était triste et rêveuse, et qu’elle paraissait absorbée par un chagrin qui semblait la dominer. Comme les jeunes filles à dix-huit ans ont souvent de ces moments de tristesse, elle n’y fit d’abord pas trop attention, mais un jour elle la surprit à pleurer.
–Pourquoi pleures-tu, ma fille, dit Mme Robert, quelqu’un t’a-t-il fait de la peine?
–Non, ma mère, répondit Émilie, ce n’est rien.
–Comment, ce n’est rien? repartit Mme Robert, on ne pleure pas comme ça pour rien, mon enfant. Allons, dis-moi la vérité; je suis ta mère, tu dois ne me rien cacher; tu as confiance en moi, n’est-ce pas? dis-moi ce qui te chagrine.
–Puisque tu le veux, maman, je vais te le dire: C’est ce Beaupré qui est la cause de mon chagrin, imagine-toi qu’il me poursuit partout et je ne puis pas monter de fois chez mon frère ou chez mon oncle qu’il ne soit derrière moi. J’ai beau courir, je ne peux me débarrasser de lui.
–Comment, reprit Mme Robert, un père de famille se conduire de la sorte? Mais c’est abominable! Je vais conter ça à ton père et il y mettra bon ordre.
–Ne parle pas de cela à papa, répondit aussitôt Émilie, il traiterait cet homme comme il le mérite, et comme je le crois méchant, il serait capable de se venger.
–Laisse-moi faire, mon enfant, tu le penses bien, une pareille chose ne peut durer. Les hommes sont si entreprenants quand ils ont martel en tête, qu’il est toujours bon de s’en défier et je veux prendre mes précautions.
Cet entretien avait lieu le5janvier de l’année1794, la veille de la fête des Rois que le peuple Français n’osait plus fêter, contrairement à l’habitude qu’il avait depuis des siècles de suivre cet antique usage.
La famille Robert fidèle à ses vieilles traditions toutes patriarcales que les révolutions n’ont pu entièrement déraciner, s’apprêtait à préparer un modeste dîner où, parmi quelques friandises devait figurer le gâteau traditionnel que Mme Robert, pour éviter tout soupçon, avait pétri de ses mains.
L’heure du repas arriva, oubliant pour un instant les sombres préoccupations du moment, la famille se trouva réunie au grand complet, si non très joyeuse, du moins goûtant en apparence un certain bonheur de ce petit extra.
Ce jour-là le père Robert ne manqua pas d’offrir de son meilleur vin dont il avait une petite réserve au fond de sa cave. Tout naturellement le fameux gâteau des rois faisait le plus bel ornement de la salle. Sa belle apparence, sa couleur dorée témoignait des soins dont la ménagère l’avait entouré. Chacun le regardait d’un œil d’envie et en attendait la distribution avec une certaine impatience.
Tout fier de distribuer les parts, où chacun espérait trouver la fève donnant le titre de roi, que précisément le peuple français venait d’abolir, le chef de famille avait le couteau à la main pour trancher le fameux gâteau, lorsqu’on frappa à la porte de la loge. Émilie s’empressa d’ouvrir et paraissant surprise, elle recula de plusieurs pas.
C’était Beaupré qui, en entrant, venait demander s’il n’y avait pas de dépêche pour lui.
–Non, nous n’avons rien pour vous, lui répondit un peu sèchement M. Robert.
–Eh? dit Beaupré, je vois que vous êtes en bonne disposition et que vous fêtez les rois.
–Oh! tout bonnement l’histoire de manger un gâteau répliqua vivement Mme Robert, que cette observation contrariait.
–Si le cœur vous en dit, M. Beaupré, fit Robert.
–Mais ce n’est pas de refus, M. Robert, j’accepte de grand cœur, répondit Beaupré sur cette invitation.
–Alors, prenez une place à notre table, vous serez le bien venu, ajouta Robert.
En entendant ces dernières paroles, Émilie rougit jusqu’au blanc des yeux, et Mme Robert faisait à son mari des signes qu’il ne comprenait pas. Dans tous les cas, il était trop tard, l’invitation était faite et il n’y avait plus possibilité de reculer. On se serra donc un peu, et Ernest fit placer l’invité à côté de lui, ce qu’André ne voyait pas sans un certain déplaisir.
André ne connaissant pas du tout Beaupré, il le regardait de temps à autre, mais sans lui adresser la parole. La physionomie de cet homme ne lui était pas du tout sympathique, et quelque chose lui disait intérieurement qu’il ne devait pas être un honnête homme. Aussi la conversation n’était-elle pas très animée.
Enfin Robert divisa le gâteau en autant de parts qu’il y avait de personnes et les présenta à Beaupré, le premier, qui ne consentit à se servir qu’après Mme Robert et sa fille. Tout à coup Beaupré s’écria: J’ai la fève, et comme Émilie était placée à l’extrémité de la table, il se leva et, tenant la fève à la main, alla la mettre dans son verre. Emilie le laissa faire sans trouver un mot à dire. Il était facile de voir sur son visage que cette courtoisie n’était nullement de son goût.
–D’ordinaire, mademoiselle, fit Beaupré souriant, le roi embrasse sa reine, voulez-vous donc me permettre d’user de ce précieux droit et il se pencha vers la jeune fille.
Oh! non! non! répondit-elle avec une irrésistible brusquerie, et en cachant son visage de ses bras, vous ne m’embrasserez pas!
Ces paroles furent dites avec un tel accent d’âpre répulsion que Beaupré n’osa insister. Se sentant piqué dans son amour-propre, sa colère fut tout près d’éclater, mais il sut se contenir et dissimula son dépit.
Ce petit incident ayant porté le trouble dans l’esprit des assistants, lorsque Beaupré et Émilie portèrent leurs verres à leurs lèvres, personne n’osa prononcer le moindre vivat.
On causa un instant de choses et autres, mais Beaupré mal à l’aise, et sentant qu’il gênait, prit le parti de se retirer, non sans se promettre de se venger de cet affront.
Dès qu’il eut quitté la loge, Robert interpella sa fille:
–Sais-tu bien que tu viens de faire une grande injure à M. Beaupré, Émilie?
–Émilie ne répondit que par des larmes.
–Émilie a bien fait, dit alors Mme Robert; à sa place je n’eusse pas agi autrement. Si vous saviez ce qu’est cet homme, et les propos qu’il s’est permis de lui tenir, vous verriez que la pauvre enfant n’a pas tort. Un homme marié qui a des enfants, se conduire de la sorte! c’est abominable! comment n’a-t-il pas honte?
Emilie continuait à sangloter.
–Est-il possible, dit Robert, que Beaupré ait osé faire des propositions à Émilie.
–Oui, mon ami, reprit Mme Robert; chaque fois qu’il la rencontrait seule, il la poursuivait de ses inconvenantes assiduités.
–Cela n’est pas tolérable, s’écrièrent à la fois André et Ernest, il faut promptement y mettre bon ordre. Puis, tous ensemble, ils se mirent à chercher un moyen de se débarrasser de cet homme, dont on ne connaissait ni les moyens, ni la façon de vivre.
D’abord on pensa à lui faire donner congé, mais Robert objecta que cela n’était pas possible, attendu que Beaupré était le protégé de M. Presta. Ils convinrent alors d’éloigner Émilie de la maison. Par quel moyen? c’est à quoi on aviserait.
Le lendemain matin, Ernest vint trouver ses parents et leur dit:
–J’ai trouvé le moyen d’éloigner ma sœur d’ici: il faut la marier.
–Marier ta sœur! mon pauvre garçon, y penses-tu? et une dot? tu sais bien que je ne possède plus rien!
–Moi, mon père, j’ai de l’argent, reprit Ernest, tu le sais, j’ai reçu dix mille livres du comte de Villement; elles sont déposées chez son notaire, je n’ai qu’à les retirer, voilà la dot toute trouvée; avec cela nous trouverons bien un mari.
–Je reconnais là ton bon cœur, Ernest, répliqua Robert; mais toi, si tu veux te marier, comment feras-tu?
–Moi, père, reprit Ernest, je suis encore jeune, je travaillerai.
Mme Robert embrassa tendrement son fils.
–Allons, lui dit-elle, tu es un brave garçon, le bon Dieu te récompensera.
André appuyant la proposition de son neveu, il fut décidé qu’on s’occuperait immédiatement de trouver un mari à Émilie, qui ne demandait pas mieux; il n’y avait plus qu’à s’occuper de Beaupré.
Une occasion favorable ne tarda pas à se présenter.
Deux jours après, Beaupré étant entré dans la loge pour s’informer s’il y avait des lettres pour lui, Robert lui annonça la nouvelle du projet de mariage de sa fille, et il ajouta bien doucement: J’ai justement, à ce propos, une petite prière à vous faire.
–Laquelle? répondit Beaupré.
–Comme nous recevons tous les soirs le futur d’Émilie, celle de cesser provisoirement vos visites. Vous comprenez qu’un étranger le gênerait.
–Mais, il me semble, vous me chassez de chez vous, répliqua Beaupré, c’est fort bien, je ne vous gênerai plus!
–Je regrette que vous preniez cette observation en mauvaise part, reprit Robert; je n’ai nullement eu l’intention de vous fâcher, c’est simplement une mesure de précaution.
–C’est la deuxième fois qu’on m’insulte chez vous, dit Beaupré d’un air courroucé; on n’agit pas ainsi impunément à mon égard; et il disparut.
Trois semaines après, Émilie épousait un honnête ouvrier ébéniste du faubourg Saint-Antoine, qui, avec la dot qu’il toucha, montait un magasin de meubles.
La famille Robert, heureuse de ce mariage, n’avait donc plus rien à craindre, et il semblait que ce bonheur devait durer longtemps. Malheureusement un bien triste événement vint tout à coup la plonger dans la plus grande affliction.
Un mois après le mariage d’Émilie, Mme Robert tomba malade, et, malgré tous les soins qu’on lui prodigua, elle succomba sans que rien eût pu faire prévoir cette mort prématurée.
A ce moment-là, toutes les églises étaient fermées; force était d’enterrer les morts civilement. La déesse Raison occupait seule les énergumènes révolutionnaires; cependant les bons esprits restés fidèles à la foi catholique étaient loin de se livrer à ces extravagantes et misérables saturnales, qui étaient le comble du ridicule.
Comme André, sans en porter l’habit, n’en était pas moins prêtre, il ne voulut pas laisser partir sa belle-sœur sans dire une messe pour le repos de son âme. Il convertit donc la loge en une sorte de chapelle, revêtit pour la circonstance ses habits ecclésiastiques, et assisté de ses parents et de quelques locataires de la maison, parmi lesquels bien entendu ne figurait pas Beaupré, il rendit les derniers devoirs à la défunte.
Le pauvre veuf et son fils étaient inconsolables et en proie à la plus profonde douleur. Emilie, de son côté, ne pouvait se consoler et versait d’abondantes larmes.
Plusieurs jours se passèrent dans le plus grand abattement, et ces deux hommes avaient bien de la peine à se faire à cet isolement. Mais au moment où ils commençaient à s’y habituer, un plus grand malheur vint tout à coup les surprendre.
Un matin qu’Ernest était allé porter des habits en ville, deux hommes à mine sinistre entrèrent cavalièrement dans la loge.
–Nous venons, dirent-ils brutalement, par ordre de la police pour voir si vous n’avez pas des royalistes dans cette maison. On dit que vous avez des rapports avec les émigrés, et que vous cachez un prêtre chez vous.
–C’est une erreur, messieurs, je n’ai aucun rapport avec les émigrés, et il n’y a ici ni royaliste ni prêtre. Vous pouvez vous en assurer, ajouta Robert.
–C’est justement ce que nous allons faire, dit un des agents, et aussitôt ils se mirent à ouvrir les armoires, fouillant partout.
–Vous avez bien quelques papiers qui appartiennent au conventionnel Presta, qui s’est échappé de prison.
–Non, messieurs, encore une fois vous vous trompez, cherchez, vous ne trouverez rien.
Robert, en prévision de tout événement, avait prudemment déposé le portefeuille de M. Presta chez le notaire Dubreuil. Il était donc bien certain qu’on ne le trouverait pas dans sa loge.
Enfin, après avoir bouleversé linge et vêtements, ils finirent par apercevoir sur une tablette d’armoire un vieux portefeuille où se trouvaient quelques lettres sans importance de M. Presta.
–Pardieu! nous étions bien sûrs que vous correspondiez avec le citoyen Presta. Maintenant que nous en avons des preuves, vous allez nous suivre.
Le pauvre Robert, perdant contenance, devint tout pâle et tout tremblant.
–Mais, messieurs, balbutia-t-il.
–Il n’y a pas de messieurs ici, il n’y a que des citoyens. Nous avons des preuves, c’est tout ce qu’il nous faut. Conduis-nous au cinquième, où nous savons que tu caches un prêtre, un misérable, qui a été professeur des enfants du ci-devant duc ***. Allons, dépêchons, et marche le premier!
L’infortuné Robert pouvait à peine se tenir debout tant il était terrifié; cependant il fallut obéir; mais quand il arriva au cinquième, il était plus mort que vif.
–C’est dans cette chambre qu’habite le citoyen André, dit un des hommes. Robert affolé hocha la tête en signe d’assentiment.
–Au nom de la loi, ouvrez-nous, citoyen André, dit un des deux acolytes en frappant vigoureusement à la porte.
–Qui êtes-vous? demanda André, réveillé en sursaut.
–Des agents du gouvernement, et nous venons faire une perquisition chez vous par ordre du chef de la police.
André comprit de suite qu’il avait été dénoncé et qu’il était perdu, il était donc inutile de résister, il s’habilla à la hâte, ouvrit et se présenta fièrement devant les deux sbires.
–C’est bien vous le citoyen abbé qui avez été professeur chez le ci-devant duc***?
–C’est moi-même, que me voulez-vous?
A peine André avait-il achevé ces paroles qu’il aperçut Robert. Mon pauvre frère! murmura-t-il.
A cet instant apparut Beaupré accompagné de –deux autres hommes, vêtu en officier de police: il portait une large ceinture rouge et avait au cou une cravate de même couleur qui lui cachait tout le bas –du visage.
Il aborda d’abord Robert d’un ton arrogant et narquois, puis il dit: Ah! votre fille m’a insulté et vous m’avez chassé de chez vous! je vais vous en faire sortir à mon tour et la prison vous attend. Voici l’ordre du comité de salut public. C’est moi qui vous ai dénoncés, vous et votre frère.
–Misérable, s’écria André, lâche! vous osez, vous en vanter; un jour viendra où vous rendrez compte à Dieu de tant d’infamie!
–Des injures, des menaces? reprit tranquillement Beaupré; je suis magistrat, je fais mon devoir de bon républicain, je ne vous crains pas. Si vous voulez m’en croire, soyez moins arrogant, citoyen abbé, dans trois jours vous serez moins fier devant le citoyen président du tribunal révolutionnaire. Allons, suivez mes hommes, ils ne vous lâcheront pas, je vous l’affirme. Sur quoi, ses ordres étant donnés à l’avance, Beaupré disparut.
Les deux frères, en proie à l’indignation et au désespoir, convaincus que toute résistance était inutile, durent forcément se soumettre. On leur permit de prendre quelques vêtements et un peu de linge, et, une heure après, ils étaient à la conciergerie, attendant en nombreuse compagnie, avec la plus cruelle anxiété, qu’on statuât sur leur sort.
Pendant tout le temps qu’Ernest était dehors, il était loin de se douter de ce qui se passait dans la maison de Presta.
Il ne rentra donc qu’une heure après le départ de son père et de son oncle. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il ne trouva personne à la loge et qu’il en vit les armoires toutes grandes ouvertes et bonleversées. Mon dieu! se dit-il à lui-même, dans sa stupéfaction; qu’est-il donc arrivé? où est mon père? et il se mit à chercher. Au moment où il montait l’escalier, il aperçut le locataire du premier étage qui l’attendait.
–Vous voilà, mon cher monsieur Ernest, lui dit-il en l’abordant; hélas! un grand malheur vient d’arriver à votre père et à votre oncle, et il lui raconta ce qui venait de se passer.
Ernest était atterré!
–Mais entrez chez moi, continua le locataire, ici on pourrait nous entendre; par le temps qui court, on ne peut trop prendre de précautions.
Ernest suffoquait, était anéanti; il fut à peine entré, qu’il tomba sur une chaise comme foudroyé.
–Remettez-vous, monsieur Ernest; ayez du courage, lui répétait le locataire; vous en avez. besoin pour vous-même.
–Est-ce qu’on voudrait m’arrêter aussi? dit vivement Ernest.
–Ma foi, mon pauvre garçon, il ne faut pas vous y fier, ce Beaupré est si vindicatif que je le crois capable de tout.
–Je voudrais cependant aller prendre des nouvelles de mon père; savez-vous où il a été conduit? demanda Ernest.
–Je pense que c’est à la Conciergerie, mais je ne vous engage pas à vous y présenter, il pourrait vous arriver malheur. Tenez, je suis sûr que Beaupré vous guette. Ce que vous avez de mieux à faire, croyez-moi, c’est de quitter cette maison au plus vite, autrement vous êtes exposé à être arrêté. Allez, suivez mon conseil et n’hésitez pas. Justement j’entends Beaupré qui rentre chez lui.
Après quelques minutes de réflexion, Ernest se décida. La tristesse dans l’âme, et pleurant comme un enfant, il prit la main du locataire, la pressa affectueusement dans la sienne en signe de remerciement et monta sans bruit dans sa chambre, se munit de quelques vêtements et disparut. Cependant il prit le temps de fermer la porte de la loge et d’en prendre la clef, puis se dirigea du côté du faubourg Saint-Antoine. Étourdi, plongé dans d’amères réflexions, il alla demander un asile à sa sœur.
En entrant chez Émilie, il tomba sur une chaise; l’émotion l’empêchait de pouvoir prononcer une parole.
–Remets-toi, Ernest, dit Émilie; que t’est-il arrivé, dis-le moi, mon frère?
–Mon pauvre père, mon oncle! et les sanglots lui interceptèrent de nouveau la parole.
–Eh bien! quoi? insistait Émilie.
Ils sont arrêtés et en prison, finit par dire Ernest.
Émilie poussa un cri déchirant et tomba à demi évanouie.
–Ils sont perdus, répétait-elle, mais pourquoi? qu’ont-ils fait?
–Rien, répondit Ernest, c’est Beaupré qui les a dénoncés.
–Ah! quand je disais que c’était un méchant homme, je ne me trompais pas, dit Emilie.
Lipmann entendant ces lamentations entra précipitamment et interrogea sa femme; Ernest, qui était un peu remis de ses premières émotions, lui raconta le triste événement.
Tous les trois se regardaient comme interdits et un moment de silence se fit entre eux, puis les uns a près les autres ils se répétaient: quel malheur!!!
–Ne pouvons-nous rien faire pour les tirer de là? dit Lipmann.
–Hélas! non, dit aussitôt Ernest; et il raconta la conversation qu’il avait eue avec le locataire. Voilà la justice des révolutionnaires.
–Ah! c’est affreux, ajouta Lipmann.
–Émilie, reprenant ses sens, dit tristement: Eh bien, mon frère, je vais te préparer une chambre, seulement tu ne sortiras pas, promets-le-moi.
–Sois tranquille, ma sœur, je serai prudent.
Dans la journée, Émilie prit des informations pour savoir où passait ordinairement la fatale charrette qui, chaque jour, emmenait les malheureuses victimes à la Place du Trône où fonctionnait une guillotine. L’idée d’Émilie était qu’en allant tous les jours sur son passage, elle pourrait se rendre compte si son père et son oncle échappaient à la mort, pensée cruelle, qui cependant était dictée par une lueur d’espérance.
Le cinquième jour, au milieu de la foule silencieuse, Émilie, hélas! apercevant de loin la maudite charrette, s’écria:
–Mon père, mon oncle! et elle tomba sans connaissance sur le pavé.
Quelques instants après, les têtes des deux malheureux frères Robert tombaient sous le couteau fatal de la guillotine et les deux innocentes victimes rendaient leurs âmes à Dieu.