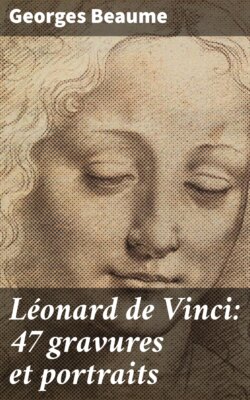Читать книгу Léonard de Vinci: 47 gravures et portraits - Beaume Georges - Страница 5
NUL N’EST PROPHÈTE DANS SON PAYS
ОглавлениеIL va être parlé d’un homme qui brilla dans tous les arts, posséda plusieurs sciences, et se fit dans chacune, en particulier, une réputation enviable. On pourrait, en effet, ranger Léonard de Vinci dans la classe des architectes habiles, des bons sculpteurs, des mathématiciens savants, des mécaniciens célèbres, des grands musiciens, des anatomistes profonds, des vrais philosophes, des poètes ingénieux et des historiens estimables. Il est surtout connu par ses ouvrages en peinture et, dans cet art, il restera l’un des premiers maîtres.
Cet homme, dont la grâce et la beauté ne seront jamais assez vantées, fut un des rares heureux de ce monde, un des plus complets privilégiés de la race humaine. Sa force, son adresse, son courage avaient quelque chose de vraiment royal; sa renommée, éclatante pendant sa vie, s’accrut encore après sa mort.
Le double caractère de la spécialité d’une époque et de l’universalité des vertus de ses plus hauts représentants dans le domaine de l’intelligence, ne fut jamais ni si constant ni si marqué qu’à l’âge de la Renaissance italienne. Cet âge est artiste, avant tout. Ce n’est pas dans Machiavel ou dans Jules II, mais dans ses peintres et ses poètes qu’il s’est incarné. C’est au Politien, à l’Arioste, à Michel-Ange, à Léonard de Vinci, qu’il faut demander la signification de cette période historique. Michel-Ange s’efforce, dans une âpre lutte de chaque jour, d’atteindre aux sommets les plus inaccessibles. Léonard de Vinci, au contraire, spirituel, élégant, ne tente que le possible et touche son but: il est, dirions-nous aujourd’hui, un dilettante de génie.
Au milieu de ce siècle, le XVe, la Toscane présentait un spectacle de labeur cérébral, d’incessante création, que le monde n’avait pas revu depuis le temps de Périclès. Giotto, ayant rompu avec la tradition grecque, avait imprimé à ses compositions un air de réalité plus précis. Paolo Accello, en soumettant la peinture aux règles de la perspective linéaire, en avait décuplé les ressources d’expression. Les Pisani, les Ghiberti, les Donatello avaient en sculpture trouvé des moyens nouveaux de donner dans leurs œuvres plus de relief aux formes et plus d’énergie. Brunelleschi avait déjà élevé le dôme de Santa Maria del Fiore, et bientôt le génial Bramante commençait à construire, avec un goût si délicat et avec tant de force, des palais et des églises.
Léonard eut la bonne fortune de venir au moment où il pouvait le mieux développer toutes ses facultés. Il naquit en 1452, et non en 1445, comme le disent la plupart de ses biographes, au château de Vinci, entre Florence et Pise, près d’Empoli, sur la rive droite de l’Arno. Son père, ser Piero, obscur notaire de la seigneurie de Florence, avait aimé, avec l’innocente ferveur de ses vingt-deux ans, une jeune et belle paysanne du nom de Catarina, dont l’histoire ne sait rien. Mais les parents du tendre tabellion lui refusèrent l’autorisation de consacrer par un mariage cette liaison qui, pour eux, était une mésalliance déshonorante. La paysanne s’éloigna doucement du bourgeois qui lui avait promis son amour éternel, et elle lui laissa leur fils, ce Léonard, que ser Piero, par affection peut-être, sans doute en souvenir de la femme délaissée, éleva chez lui avec beaucoup de soin et que, dans la suite, on le croit, il légitima.
Léonard de Vinci.
(Portrait dessiné par Mlle Bès, d’après la peinture du Vinci.)
Ce ser Piero ne craignait pas les femmes. Tandis que Catarina se consolait de son abandon en épousant un paysan plein d’indulgence, il épousa la même année Albiera di Giovanni Amadori; à la mort de celle-ci, il épousa une fille de quinze ans; devenu veuf encore, il épousa Margharita, qui lui apportait une dot de trois cent soixante-cinq florins et qui lui donna quatre, fils et une fille; à soixante ans, redevenu veuf, et resté viril, beau d’illusions et de désirs, il épousa Lucrezia di Cortegiani, dont il eut six enfants. Dans la souplesse de ce mari si endurant sous les épreuves, ne trouve-t-on pas un peu de la versatilité de Léonard, de ses aptitudes à pénétrer l’intérêt et aussi la volupté des manifestations si variées de l’art et de la vie?...
Ser Piero assura, je le répète, à son fils une éducation nombreuse et achevée. Léonard réussissait en ses études si merveilleusement qu’il ne tardait pas à embarrasser ses maîtres par les doutes et les questions qu’il soulevait à tous propos. Sans l’inconstance de son humeur, il eût fait dans les belles-lettres les plus grands progrès. Il entreprenait beaucoup de choses, pour bientôt les abandonner. Très jeune, il était bon musicien: il s’accompagnait de la lyre, en chantant des chansons qu’il. improvisait sur l’heure. Mais sa passion dominante le portait vers les arts du dessin, «C’était là, dit Vasari, sa fantaisie la plus forte.»
Son père, ser Piero, habitait souvent Florence, sur la place de San Firenze, à l’endroit même où s’élève aujourd’hui le palais Gondi, qui date de la fin du XVe siècle. Frappé des dispositions extraordinaires de Léonard, il prit un jour, en cachette, quelques-uns de ses dessins, et s’en fut frapper à la maison de son ami, André Verrochio, peintre et sculpteur de mérite, élève de Donatello.
— Voici, lui dit-il, certains essais de mon fils. Je te demande de me déclarer franchement ce que tu en penses. Léonard m’étonne et me déconcerte par la diversité de ses dispositions. Il se sent poussé surtout vers la peinture: malheureusement, c’est là une carrière très pénible.
— Je le sais, répliqua Verrochio.
— Je voudrais donc qu’il ne perdît pas son temps ni mon argent.
— Voyons ça. On m’a dit, à la vérité, grand bien de ton fils. Mais, des enfants de génie, il faut se méfier.
Verrochio examinait les essais de Léonard. Plus attentif dans le silence qui s’était fait, il prononçait d’abord entre ses lèvres des mots de surprise, de louange, puis il poussa un cri de ravissement. Et, refermant le carton de ser Piero, il lui déclara:
— Ton fils sera un grand artiste, je l’affirme. Tu dois le laisser libre dans ses études, il a raison.
— Oui. Mais où donc peut-il poursuivre son éducation?
— Chez moi, parbleu!
— C’est bien. Je te l’enverrai...
De tous les artistes qui alors illustraient l’école toscane, aucun n’avait, au même degré qu’André Verrochio, les goûts, la nature de talent susceptibles de mieux convenir à l’esprit du jeune étudiant. Le hasard offrait à Léonard pour premier guide l’homme qu’il aurait choisi, s’il eût été en mesure de le faire. Ses tendances furent donc plutôt encouragées que réprimées par l’exemple du maître.
Celui-ci adorait la musique; il se plaisait à monter à cheval, à être beau de tournure et de manière, à flatter ses amis par les gentillesses de sa conversation. En son esprit curieux fermentait constamment quelque inquiétude d’invention nouvelle. L’un des premiers, il s’enhardit à se servir du plâtre pour le moulage sur nature. Dans sa jeunesse, il s’était beaucoup adonné aux mathématiques et préoccupé de l’application de la géométrie à la perspective linéaire. Artisan d’abord plus qu’artiste, André Verrochio avait débuté par de petits ouvrages d’orfèvrerie, agrafes de chapes, coupes ciselées et vases sacrés, dont ses contemporains vantent l’élégance, et que nous ne pouvons juger, parce qu’ils sont perdus. Cependant, le Festin d’Hérode dans le maître-autel en argent du baptistère de Florence suffit pour donner une idée de la grâce et de la finesse de son talent. Il dessinait à la perfection. Vasari loue, avec enthousiasme, quelques-unes de ses têtes de femmes, «dont les coiffures avaient tant de charme que Léonard de Vinci les imita toujours».
Ce n’est que plus tard que Verrochio s’occupa de peinture. Il dessina les cartons de grands tableaux d’histoire, que sa mobilité d’esprit l’empêcha d’achever. Et il termina sa carrière par l’admirable monument de Bartolommeo Colleoni, à Venise, monument qui le placerait, si l’on prouvait qu’il en est l’auteur unique, au premier rang des artistes de son époque.
Le Vinci entra chez Verrochio en 1469 ou 1470. En 1472, on l’inscrit, comme membre indépendant de la corporation sur le livre des peintres. Dans cet atelier, il eut pour camarades Pérugin et Lorenzo di Credi. Lorenzo, de sept ans plus jeune, suivit bientôt, en élève docile, Léonard dans ses études et dans ses œuvres, s’inspira de ses leçons et de son exemple. Verrochio lui-même, ainsi qu’en fournit la preuve son groupe de Jésus et de saint Thomas qui orne la façade de l’église Or-San-Michele à Florence, subit à son tour l’influence du jeune débutant.
Le premier des ouvrages de Léonard, que mentionne l’histoire, est cette fameuse rondache, dans laquelle, si l’on s’en rapporte à la description de Vasari, se révèlent, à un haut degré, les deux traits caractéristiques de génie du peintre, la préoccupation scientifique, le souci des objets naturels, et la transformation de ces objets en une œuvre ordonnée par l’imagination.
Un paysan, voisin de ser Piero, son compagnon de chasse et de pêche, eut un jour la fantaisie de faire peindre à Florence un gros tronc de figuier, qu’il avait découpé en une sorte de bouclier. Ser Piero, afin de satisfaire au désir de son ami, porta naturellement à son fils ce morceau de bois rudement travaillé. Léonard, après avoir réfléchi quelques instants, se mit à l’œuvre. Ayant redressé au feu le grossier morceau de bois, puis l’ayant couvert d’une couche de blanc, il résolut d’y représenter quelque chose d’épouvantable, une image comparable à la Méduse des Anciens. Il s’enferma dans sa chambre, où il avait patiemment recueilli les animaux les plus horribles, sauterelles, chauves-souris, serpents, lézards, et bravant l’infection que répandaient ces animaux, il ne sortit de sa solitude que le jour où il eut composé un monstre s’échappant d’une obscure caverne. Alors, il pria son père de venir voir son ouvrage.
L’œuvre était placée sur un chevalet, dans le meilleur jour de la chambre. Ser Piero avait, dans son insouciance, oublié de quel ouvrage il avait chargé Léonard. A l’appel de celui-ci, il accourut à Florence, fort intrigué. Du seuil de l’atelier, il aperçut tout à coup le monstre hideux qui, dans la vive clarté du soleil, semblait le menacer. Il tressaillit d’effroi et précipitamment s’élança au dehors pour fuir. Léonard, riant de malice et d’orgueil, le rattrapa par la main et lui dit:
— Félicite-moi, mon père, au lieu de t’en aller ainsi. Car cet ouvrage a produit l’effet que j’en attendais.
Caricature.
— Quel ouvrage?... le monstre?
— Oui. Tu m’avais prié de peindre sur le tronc du figuier, que l’autre jour tu m’as apporté, quelque chose d’effrayant. N’ai-je Pas réussi dans ma tentative?
— Ma foi, oui, tout à fait. Je ne crois pas que la nature ait jamais créé un être d’aspect aussi redoutable. Il est magnifique à force de vie, de laideur et de colère.
— Prends-le donc, et emporte-le où tu voudras.
Ser Piero s’empara de la rondache avec soin et, comme il n’était pas maladroit en affaires, il se garda bien de tenir sa promesse envers son familier compagnon de chasse. Il se rendit tout droit chez un mercier acheter une autre rondache, sur laquelle était peint un cœur percé d’une flèche, et qu’il offrit à son paysan. Puis, il s’en fut aussitôt vendre, pour cent ducats, l’ouvrage de Léonard à des marchands florentins, qui eux-mêmes sans difficulté le revendirent trois cents ducats au duc de Milan.
Léonard était possédé par une intelligence trop curieuse, trop avide, pour s’attacher à une seule branche de l’art. Il rechercha dans le dessin toutes les difficultés, toutes les ressources d’expression. Sans négliger les conseils de Verrechio pour la peinture, il commença de modeler en terre quelques têtes de femmes, plusieurs têtes d’enfants, qu’après de courts tâtonnements, on aurait pu attribuer à la main d’un maître. Il s’attaqua aussi à l’art de l’architecte et de l’ingénieur, dessinant les plans d’un grand nombre d’édifices, de moulins, de fouleries et de machines, que faisait mouvoir un cours d’eau. Il osa, malgré sa grande jeunesse, présenter un projet d’utilisation des eaux de l’Arno, qu’il aurait voulu canaliser de Pise à Florence .
Le destin demandait qu’il fût peintre surtout. Il dessinait beaucoup d’après nature; pour cela, il modelait en terre des figures, qu’il drapait ensuite avec des chiffons mouillés et enduits de terre; sur certaines toiles de linon ou de batiste, il dessinait à la pointe de sa brosse, avec un peu de blanc et de noir, des études admirables. Sur du papier aussi, il dessina des paysages et des figures d’une perfection très pure.
Les progrès de Léonard se marquaient avec une telle rapidité que son maître, lequel ne dédaignait pas de réclamer son aide dans des travaux importants, éprouva bientôt quelque jalousie. Par exemple, André Verrochio, étant chargé de composer pour les frères de Vallombrosa un Baptême du Christ, que l’on voit aujourd’hui à l’Académie des Beaux-Arts de Florence, pria Léonard de peindre dans ce tableau un ange agenouillé. Léonard obéit: son ange apparut d’un lumineux relief, et l’on ne vit que lui. Verrochio, frappé d’admiration, conçut, d’après Vasari, un si violent désespoir de se reconnaître surpassé par son élève, qu’il aurait dès lors renoncé pour toujours à toucher un pinceau.
Vasari était trop l’ami de Michel-Ange pour montrer envers Léonard une bienveillance très généreuse. S’il loue la valeur et les charmes du peintre de la Joconde, c’est qu’il y est contraint: nous ne pouvons alors le croire entièrement sur parole. Pas plus que Tomazzo, il ne nous renseigne guère sur les dix ou douze années que Léonard a passées dans Florence. Il nous est permis de supposer, avec vraisemblance, en observant les séductions de son caractère, qu’il vécut une jeunesse heureuse, gaie, un peu folle. N’avait-il pas, pour l’exciter au plaisir, des camarades bons vivants, le joyeux Atalante Miglioretti, l’excentrique Zoroastre de Piretola?
La fantaisie qui gouvernait ses actions, présidait également à ses études. Je crois que, même si des biographes nous avaient transmis des documents plus nombreux, il nous serait difficile de trouver de l’unité à sa vie, et à son talent un développement logique. Cet homme prodigieux, chez qui le savant l’emporte Peut-être sur l’artiste, préludait, dès ce premier séjour à Florence, à ces études d’hydraulique, d’optique, de géologie, qu’il n’abandonna jamais, et dans lesquelles on peut le considérer comme le précurseur des Pascal, des Helmholtz et des Lyell.
Il composait une grande quantité de dessins et de modèles Pour prouver que l’on pouvait aplanir ou percer une montagne, afin de mettre en communication deux vallées; qu’on pouvait, au moyen de vis, leviers et cabestans, soulever ou traîner des poids énormes; qu’il pouvait, à l’aide de pompes, curer un Port, faire monter les eaux. Il s’amusait à dessiner des nœuds de cordes, disposés de façon à remplir uu cercle. Une fois, il démontra, par le dessin détaillé de l’un de ses projets, à plusieurs citoyens de mérite, qui administraient alors Florence, qu’il soulèverait leur temple de San-Giovanni, et, sans le détruire, l’exhausserait sur des degrés.
Il partageait son temps entre les études les plus sérieuses et les distractions de toute sorte, quelques-unes d’un goût douteux. Il fréquentait le peuple sur les marchés, les ruffians et les portefaix dans les tavernes; il accompagnait les condamnés au supplice; certains soirs de fête, il rassemblait chez lui des paysans, qu’il faisait boire outre mesure. A ces paysans, il racontait les histoires les plus grotesques et, tandis qu’ils riaient de tout cœur, Léonard notait leurs gestes et leurs contorsions. De là proviennent ces caricatures, ces têtes difformes et grimaçantes, dont la plupart ont été conservées par la gravure. Sa belle santé l’autorisait à braver les fatigues du plaisir. D’une force peu commune, et habile à tous les exercices du corps, il était recherché par la société de Florence, si brillante sous les Médicis.
Il plaisait à tous, sans effort. Sans fortune, n’appartenant au travail que par caprice, il s’entourait pourtant de domestiques et de courtisans; il possédait des chevaux, qu’il aimait par-dessus tout, une ménagerie d’animaux de toute espèce, qui faisaient sa distraction, et qu’il soignait avec une patience infinie. Souvent, en passant sur les marchés où l’on vendait des oiseaux, il en payait le prix demandé, les tirait lui-même de leur cage, et glorieusement leur rendait la liberté.
Il y avait, en dehors du Palazzo Vecchio, une boîte qu’on appelait, à cause de sa forme, le tambour. Chacun pouvait à son gré, sans être obligé d’y apposer même sa signature, glisser dans ce tambour une dénonciation quelconque. C’était, en somme, pour les Médicis, un élément d’information, de police, qui ne leur coûtait rien. Des magistrats examinaient la moindre de ces accusations gravement. Or, un jour, une lettre de ce tambour accusa Léonard de mœurs infâmes, et dénonça, comme son complice, Verrochio.
Jeune femme.
(Musée de Venise.)
Léonard avait vingt-quatre ans, Verrochio quarante et un. Ce ne fut pas sans peine que les deux accusés furent absous. Car on procéda tout de suite à une enquête. L’affaire fut appelée devant les magistrats le 9 avril 1476. Les deux artistes furent relaxés temporairement, et sous la condition de se représenter devant le tribunal. En effet, une seconde fois, ils durent comparaître ensemble et, enfin, faute de preuves, on les laissa tranquilles.
Malgré l’agrément de sa personne, malgré la vertu de ses œuvres, Laurent le Magnifique ne songea point à attacher le jeune artiste sa maison. Peut-être Léonard, pour ses caprices et ses fredaines, était-il redouté. En outre, son indifférence dans les questions politiques et religieuses qui passionnaient alors son époque empêchait ses compatriotes d’apprécier impartialement son génie.
Cependant, il trouvait toujours de la joie à produire. Une fois, on lui confia un carton d’après lequel on devait exécuter en Flandre, pour le roi de Portugal, une portière tissue de soie et d’or. Ce carton représentait Adam et Eve au moment de leur désobéissance, dans le paradis terrestre. Léonard dessina en grisaille, et à la brosse, plusieurs animaux dans une prairie émaillée de fleurs. Dans ce carton, qui malheureusement fut abandonné, se manifeste une habileté délicate, une précision frémissante de vie, jusque dans les branches et les feuilles d’un figuier noueux, dont Léonard devait chérir la lumière.
Il peignit ensuite une Vierge, qui a appartenu au pape Clément VII. Il dessina aussi sur une feuille de papier, pour son ami intime, Antonio Segni, un Neptune dont le char est traîné par des chevaux marins. Le dieu respire au bon soleil, la met s’agite harmonieuse, sous son peuple de tritons, de dauphins et d’autans.
Il lui prit la fantaisie de peindre à l’huile une tête de Méduse: des serpents, entrelacés de mille façons bizarres; forment sa chevelure. Il commença encore une figure d’ange, qui tient une main sur sa poitrine, tandis que l’autre main, élevée, dirigée en avant, a permis à Léonard d’exécuter un raccourci de l’épaule au cou. Comme cela lui arrivait souvent, Léonard n’acheva pas ces deux ouvrages. Il craignait trop que son exécution ne pût répondre à son intention trop haute.
Il possédait déjà une méthode très personnelle de création. Afin de donner à sa peinture une puissance de relief et aussi de la souplesse, il employait les oppositions les plus franches de l’ombre et de la lumière. Il s’obstinait à chercher pour ses fonds des tons plus sombres encore que le noir, afin de prêter plus d’éclat aux parties éclairées. Mais alors, par l’outrance de son Procédé, prenant ainsi pour point de départ la teinte la plus vigoureuse, et s’efforçant de parfaire le plus possible ses ouvrages, il les amenait à une tonalité sourde, privée de lumière, qui semblait rendre plutôt les effets de la nuit que ceux du Jour.
Lorsqu’il rencontrait, par hasard, un homme à tête expressive, un type pittoresque, ayant barbe ou cheveux singuliers, Léonard s’émouvait d’une telle satisfaction que, sans honte, il le suivait jusqu’au soir; et puis, lorsqu’il se retrouvait seul, il dessinait cette figure aussi fidèlement que si elle eût posé devant lui.
Pourtant, il était gêné à Florence par la curiosité médisante des gens du peuple, surtout par l’envie impuissante des riches bourgeois qui entouraient Laurent le Magnifique. On ne l’aimait pas, on ne le considérait pas suffisamment à son gré. Il résolut donc de chercher fortune hors de sa patrie, et encouragé Peut-être par des avances de Louis le More, qui projetait d’élever un monument à la mémoire de son père, il partit pour Milan.