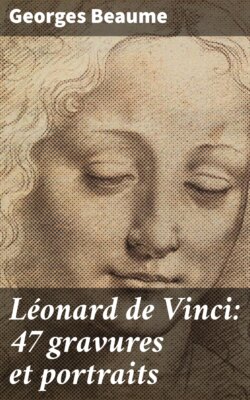Читать книгу Léonard de Vinci: 47 gravures et portraits - Beaume Georges - Страница 7
LA COUR DE MILAN
ОглавлениеC’EST en 1481, ou même en 1480, et non en 1494, ainsi que le pense Vasari, que Léonard quitta Florence. Afin de gagner les bonnes grâces de ce Ludovic Sforza, qui régnait à Milan et qu’il savait d’humeur changeante, Léonard de Vinci lui offrit en quelque sorte ses services, les trésors de son génie, la richesse de ses découvertes, les rêves de ses œuvres d’art.
La famille du Sforza présente une image parfaite de ces dynasties italiennes qui, du moyen âge à la Renaissance, dominèrent par la violence, par la ruse, par la puissance de l’argent. C’est la belle époque du condottiere, plein de talent et de scélératesse, de l’aventurier dont la fortune heureuse excuse tous les crimes. Fils légitimes, bâtards, frères et cousins, se disputent fréquemment le pouvoir, parmi le désordre des cités meurtries. Au milieu des pires dangers, la famille des Sforza s’élève, ayant pour bréviaire, ces trois maximes d’homme fruste et de soldat prudent:
«Ne touche jamais à la femme d’autrui; — ne frappe jamais aucun de tes gens, ou si cela t’arrive, envoie-le bien loin; —ne monte jamais un cheval ayant la bouche dure ou sujet à perdre ses fers.»
Louis le More avait sans scrupule usurpé le pouvoir, aux dépens de son neveu, qu’il sut marier selon les exigences de sa politique, au lieu de le tuer. Le meurtre eût laissé le long souvenir d’une cruauté lâche, et surtout préparé dans l’esprit de ses sujets la pensée des représailles. «Homme très sage, dit Commines, mais fort craintif et bien souple quand il avait peur, Louis Sforza était un homme sans foi, s’il voyait son profit pour la rompre.»
Ludovic du Sforza, par Léonard de Vinci,
(Pinacoteca Ambrosiana, Milan.)
D’ailleurs, doué d’intelligence, ne répugnant pas à l’effort, ce prince aimait la gloire, recherchait l’éclat, la beauté des grandes choses. Latiniste de premier ordre, il recevait avec une cordialité flatteuse des savants et des artistes. Il n’épargna rien pour élever, à la tête des sociétés rivales, l’Université de Pavie. Léonard de Vinci était exactement renseigné dans sa recherche d’un protecteur, capable de le comprendre. Il n’eût jamais rencontré de maître plus accessible à ses tendances et à sa volonté que cet homme, souverain dans ses États, qui ambitionnait de faire de Milan la première ville de l’Italie, que ce prince auquel le poète Bellincione dédiait un sonnet avec cette épigraphe: «Sonnet à la louange du seigneur Ludovic qui veut voir Milan devenir en science une nouvelle Athènes.»
Léonard, cependant, usa de prudence, lui aussi. Il savait qu’avec ces princes, épris de luxe et d’élégance, mais aussi habiles à manier la trique qu’un paysan à user de sa pioche, un humble sujet devait prendre des précautions. Donc, avant de présenter devant lui sa personne, il lui présenta ses idées dans une lettre. Oh! cette lettre n’est certes pas un modèle de modestie. Qu’importe? Les anciens ne tenaient-ils pas cette vertu de la modestie pour un vice?... Et Léonard, pour obtenir du maître une confiance généreuse, devait lui-même faire valoir ses mérites.
Tous les biographes reproduisent intégralement cette lettre si curieuse, qui témoigne d’une si étonnante abondance de savoir et de divination chez un homme de vingt-huit ans. Je me contenterai d’en citer quelques extraits:
«... Je désire soumettre à Votre Excellence les pans et projets de mes inventions, qui demeurent encore secrètes, et l’en faire profiter. En attendant qu’une occasion se présente de les mettre en pratique, je vous eu donne la note suivante:
«1° J’ai un moyen de construire des pontons légers, facilement transportables, incombustibles, avec lesquels on peut poursuivre ou éviter l’ennemi;
«2° J’ai un moyen de tarir l’eau des fossés, pendant le siège d’une place, et de construire une grande quantité de ponts Volants à échelons;
«3° Je sais détruire toute place forte, si elle n’est pas bâtie sur un roc;
«4° Je possède le secret de fabriquer des bombardes facilement transportables, avec lesquelles on peut lancer en détail la tempête, et dont la fumée jettera l’ennemi dans la confusion;
«5° Au moyen de chemins creux, étroits et tracés en zigzags, je saurai faire parvenir les troupes jusqu’à un point, déterminé à l’avance, des fortifications d’une ville;
«6° je sais construire des chariots couverts, avec lesquels on pénètre dans les rangs de l’ennemi, pour détruire son artillerie; et, derrière ces chariots, l’infanterie peut s’avancer sans obstacles;
«7° Si le besoin l’exige, je fabriquerai des bombardes, des Mortiers, des passe-volants, différents de ceux qui sont en usage
«8° Là où les bombardes ne pourraient produire leur effet, je composerai des catapultes, des balistes, ou d’autres engins dont l’effet décisif est tout à fait insoupçonné ;
«9° En mer, je puis employer beaucoup de moyens offensifs ou défensifs, construire, par exemple, des vaisseaux à l’épreuve des bombardes, composer des poudres et des fumées;
«10° En temps de paix, je puis remplir l’office d’architecte, soit pour les édifices publics et privés, soit pour ceux qui servent à la conduite et à la distribution des eaux;
«11° Je puis mener à bonne fin toute espèce de travaux de peinture, et aussi de sculpture en terre, en marbre ou en bronze.
«Si quelqu’une des choses indiquées ci-dessus était estimée d’une exécution impossible, je m’engage à en faire l’expérience dans votre parc ou dans tel lieu qu’il plaira à Votre Excellence, à laquelle je me recommande humblement.»
Les offres de Léonard furent acceptées, mais d’une étrange manière.
— Je connais la grande réputation de Léonard de Vinci comme peintre, déclara Louis le More. Sans contester la valeur de ses prétentions comme ingénieur et comme architecte, nous ne pouvons réaliser tout de suite aucun de ses projets et, par conséquent, les mettre à l’épreuve. Qu’il vienne donc ici en artiste... Puisqu’il se flatte d’être un excellent musicien, je lui demande d’apporter un de ses instruments, et je serais très heureux qu’il pût m’étonner par quelque merveille...
Léonard obéit avec empressement aux ordres du prince. Il arriva au palais du duc de Sforza, à Milan, avec un instrument, une lyre qu’il avait fabriquée lui-même, presque tout entière en argent, et qui affectait la forme d’un crâne de cheval. Cette disposition bizarre donnait aux sons quelque chose de mieux vibrant et de plus agréable.
Dans la salle des fêtes, de nombreux musiciens, préparés depuis longtemps au concours organisé par le prince, se trouvaient déjà réunis. Léonard fut le dernier à pincer de son luth, à chanter les chansons qu’il improvisait sans la moindre fatigue. Il surpassa tous ses concurrents par l’adresse et par la vivacité de son jeu, par l’originalité et l’essor lumineux de ses poésies. Louis le More, sans hésitation, lui décerna la palme du vainqueur; il le combla d’éloges, de caresses; il lui demanda aussitôt un tableau d’autel, la Nativité de Notre-Seigneur, que le prince offrit à l’Empereur, lorsqu’il fut terminé.
A l’issue du concours, Louis le More ne congédia point Léonard, ainsi que les autres musiciens. Il le garda auprès de lui jusqu’au soir, afin de jouir du charme et de l’intelligence de sa conversation. Léonard causait de verve, éloquemment, sur un ton de franchise gaie, n’hésitant pas plus à propos des choses graves que des choses frivoles. Il maniait avec aisance la raillerie, contrefaisait les tics des orgueilleux sans valeur réelle, imitait la voix grotesquement solennelle des courtisans à la loyauté douteuse. Si la conversation languissait un moment, il inventait vite une histoire et la contait avec esprit. Il ne savait pas seulement causer, il savait écouter. Et par son air d’attention sympathique, qui était un hommage aux qualités intellectuelles et morales de ses interlocuteurs, il plaisait tout de Suite. Il s’amusait des autres, et il les amusait: cela lui assurait sur tous la séduction suprême. Patient observateur, pénétrant Psychologue, il voyait sur le visage de ses semblables leur âme. surprenait leurs émotions et leurs pensées. Aussi, pouvait-il aisément les vaincre dans leur ignorance, les flatter pour sa domination jusque dans leurs préjugés de religion ou de caste.
Julien de Médicis,
«Son esprit brillait sans cesse, tout à fait libéral, dit Paul Jove; son visage paraissait le plus beau du monde. Arbitre de toute élégance, il inventait chaque jour des divertissements de salon et de théâtre.» Il était bien l’artiste nécessaire à la cour de Louis le More, la plus polie de l’Europe, à cette date.
«Plus qu’homme du monde, dit le chroniqueur Bernardino Arlano, Louis le More était avide de louange et de gloire. Il attirait par sa bienveillance et par ses dons les philosophes, les sophistes, les médecins remarquables dont un grand nombre fut pensionné par lui. Les Grecs Constantin Lascaris et Démétrius Chalcondylas représentaient à sa cour l’humanisme. Le mathématicien Fra Luca Pacioli écrivait son traité De Divina Proportione, dont il demandait les figures à Léonard de Vinci. Pendant vingt-cinq ans, le célèbre Bramante travailla pour le compte de Louis le More, embellissant Milan de palais et d’églises.»
Mais d’où vient donc que, dans tous les temps, les tyrans de toute envergure éprouvent le besoin de s’entourer d’un luxe d’hommes de science et de pensée, des enchantements de la beauté et de la poésie?... Louis le More n’était pas moins avide de plaisirs que d’opulences. Il appelait en sa ville des joueurs de lyre et de flûte, des danseurs, des mimes, des organisateurs de fêtes. Il aimait les pompes nuptiales et funéraires, les repas splendides, les représentations d’antiques atellanes, les spectacles, les chœurs et les ballets.
Naturellement, les grandes familles suivaient l’ardeur voluptueuse du maître et, dans la corruption des mœurs, les âmes s’avilissaient. Le père livrait, contre de l’argent, ou contre une distinction, sa fille; le mari livrait sa femme, le frère sa sœur. La politique embrouillait encore de ses intrigues les drames ou les comédies de l’amour. Louis l’Usurpateur avait arraché le pouvoir à son neveu: la duchesse Bonne de Savoie, la mère du souverain évincé, n’avait jamais, malgré les apparences, pardonné à son beau-frère son crime d’État. Un soir, elle posta sous le porche de l’église San Ambrogio des assassins, qui attendirent Louis à la sortie des vêpres: il ne dut son salut qu’à un caprice. Sortant par une autre porte que celle où il était attendu, il échappa, sans le soupçonner une seconde, aux spadassins de la duchesse. Plus tard, il prétendit, non sans vraisemblance, que Dieu le protégeait.
Dans cette Italie bouillonnante de jeunesse et de génie, l’assassinat était à l’ordre du jour. On y faisait l’amour avec autant d’entrain et de plaisir qu’on s’y donnait la mort. Les Poètes ne s’émouvaient guère des crimes qui, autour d’eux, dans les villes et dans les campagnes, entravaient parfois le chemin: d’ailleurs, pour ces enfants terribles, à qui la vue du sang ne répugnait pas plus que la vue du vin, les actes de Vengeance, de haine, de provocation, de jalousie meurtrière, n’offraient pas la moindre apparence d’être des crimes; ils n’étaient que les accidents nécessaires, des manifestations décisives, de la grande lutte pour la vie. Pas plus que les bêtes dans les bois ou que les cruels insectes dans l’herbe touffue, ces souverains de la Renaissance ne connaissaient de scrupule ni d’hésitation, ne s’embarrassaient d’idées de justice et d’honneur, lorsqu’ils voyaient leur intérêt à défendre leur peau ou à attaquer le voisin dans sa fortune. Léonard vivait à l’aise, avec son cœur puissant, capable de se passionner au pittoresque de la bataille, au milieu de cette atmosphère d’intrigues et de méfaits. Pendant les heures de paix, il jouissait davantage des rêves de son art et des voluptés de la vie sensuelle.
Ainsi, il se trouvait à Florence en 1478, lors de la conspiration des Pazzi. Dans l’église Santa-Maria del Fiore, Julien de Médicis tomba, au moment de l’élévation; sous le poignard d’un conjuré. Laurent ne put échapper à la fureur de ses ennemis qu’en se réfugiant dans la sacristie. Vous entendez bien que la conjuration fut par les Médicis réprimée sans pitié. On tortura et pendit Quatre cents coupables. L’un de leurs chefs, Bernardo Bandini, avait fui cependant jusqu’à Constantinople: mais il fut livré Par le sultan, et pendu à Florence en 1479. Et Léonard assista si tranquillement à son supplice, qu’il en relata le spectacle détaillé dans un dessin, qui était accompagné de notes sur le costume de l’assassin.
A la cour de Milan, il trouva le milieu le plus favorable à ses goûts de faste, de romanesque et de plaisir. Plus d’une fois, il prêta son pinceau prodigue aux fantaisies licencieuses de Louis le More. C’est lui qui réglait l’ordonnance des fêtes, des processions et des triomphes, des pantomines mythologiques, où il déployait éloquemment sa science toujours neuve des belles formes et des belles couleurs. Aussi, fut-il aimé du duc, des grands seigneurs, autant qu’il les aima.
En 1489, lors du mariage de Jean Galéas, neveu de Louis le More, avec Isabelle d’Aragon, fille du roi de Naples, c’est Léonard de Vinci qui dirigea les réjouissances données en l’honneur d’Isabelle. Il imagina un spectacle intitulé le Paradis, une machine colossale construite avec un grand art. Sous un ciel qui avait la forme d’une sphère, chaque planète décrivait harmonieusement sa révolution, et lorsqu’elle arrivait devant la jeune fiancée, elle chantait des vers composés par le poète courtisan Bellincione.
Louis lui-même épousa, en 1491, Béatrix d’Esté. Cette enfant de seize ans, qui n’avait de la candeur que l’apparence, avait accepté ce mariage par ambition et par désir de divertissement. Léonard fut encore chargé d’organiser en son honneur des bals et des festins, des fêtes dans les rues et au château. C’était alors dans Milan un carnaval folâtre mêlant, tout le long de l’année, toutes les classes de la société, le carnaval dont nous n’entendons plus aujourd’hui que pendant la saison d’hiver, en certaines cités de l’Italie, quelques grelots fatigués. Deux poètes, Baldassare Taccone en italien, Pietro Lazzarone en latin, célébrèrent la magnificence des noces de Béatrix, et parmi les merveilles énumérées dans leurs odes, ils citent la statue colossale de François Sforza, la maquette du Vinci, statue qui fut exposée sous un arc de triomphe, au milieu de la Piazza del Castello.
La duchesse ne jouit que d’un règne très court, puisqu’elle mourut à vingt-deux ans. Elle mourut prématurément, consumée par sa fièvre ardente du plaisir, emportée par une fausse couche, un soir qu’elle avait trop dansé. Elle avait provoqué cependant maintes occasions de mettre à l’épreuve l’esprit inventif de Léonard, qui pour elle recherchait des jeux nouveaux, où elle pût satisfaire ses caprices d’enfant et de femme. C’est pour elle que dans le parc du château il construisit des bains de Marbre.
L’occupation des fêtes bruyantes n’empêchait point l’artiste de se livrer à ses études, ni aux travaux que lui confiait son maître. Il sut autour de lui grouper quelques élèves, organiser cette académie de Milan, dont le but nous est encore imparfaitement connu. Cette académie, je dirai avec plus d’exactitude qu’il la réorganisa, la fit sienne de par sa méthode et ses tendances; elle prit son nom, ainsi que le prouve un sceau sur lequel sont inscrits ces mots: Leonardi Vinci Academia.
Béatrix d’Este, par Léonard de Vinci.
Quelles matières d’enseignement donnait-on dans cette académie? Il est difficile de l’indiquer d’une façon précise. Léonard, à ce qu’il semble, s’y était pleinement consacré. Un grand nombre de ses manuscrits de cette époque, rédigés sous forme de notes, permettent de penser qu’ils étaient plutôt destinés à des leçons publiques qu’à des ouvrages. Léonard, s’il n’était pas l’unique professeur, en était au moins le principal. On peut, en tout cas, affirmer, sans aucun risque d’erreur, d’après ces manuscrits, que les matières enseignées comprenaient l’universalité des sciences qui soutiennent ou éclairent les beaux-arts, c’est-à-dire tout, d’après l’opinion du Vinci lui-même, tout des sciences et des belles-lettres, à l’exception de la théologie, de la philosophie et du droit.
Il recueillit le fond de son enseignement dans le Traité de la Peinture, le plus considérable de ses ouvrages, le seul qui ait été publié en son entier. Ce ne fut que pour commenter ou développer les principaux sujets de ce livre qu’il ébaucha d’autres traités spéciaux, dont certains manuscrits sont perdus, tandis que d’autres sont conservés à Paris, à Milan et à Londres.
A plusieurs reprises, dans le Traité de la Peinture, il mentionne les ouvrages qu’il avait déjà rédigés et ceux qu’il tenait en projet. Par exemple, le Traité de la lumière et des ombres, dont le manuscrit nous reste. Dans un inachevé Traité du mouvement local, il s’occupe du repos, du mouvement et de la pondération du corps humain. Il commence un ouvrage qui devait résumer toutes ses idées d’artiste et dominer sa méthode: De la théorie et de la pratique. Il parle encore d’un Traité des mouvements de l’homme, puis d’un autre, dont nous possédons un fragment, où il donne les mesures de la tête, les Proportions du corps humain.
Cette «divine proportion», selon ses termes, des différentes parties du corps humain l’a toujours et profondément préoccupé. Avec l’humilité touchante du véritable artiste, que dévore à toute heure le désir de l’absolu et du beau, il confesse qu’il a, par ses efforts, par ses œuvres, cherché la perfection de l’art, sans la rencontrer jamais. Sur sa demande sans doute, le Poète Platino Piatto lui composa une épitaphe, qui indique bien la ferveur de son âme dans la religion de l’art et la confusion de son esprit devant l’impuissance de ses moyens matériels. «Admirateur des anciens, leur élève reconnaissant, une seule chose m’a manqué, leur science des proportions. J’ai fait ce que j’ai pu. Que la postérité me pardonne!...»
Benvenuto Cellini assure avoir possédé une copie du Traité de perspective, sorte de préface des ouvrages de Léonard sur la Peinture. On sait enfin que Léonard se livra, pendant des années, à l’étude de l’anatomie, surtout celle du corps humain, et qu’il travailla de concert avec le philosophe Mercantonio della Torre, lequel fut un des premiers à reprendre en médecine la doctrine de Galien. Le livre où il consigna ses observations et ses connaissances, il l’illustra de figures dessinées à la sanguine avec des hachures à la plume. Dans ce livre viennent, après les études de pure ostéologie, celles des nerfs et des muscles, divisées en trois sections: la première pour la couche la plus profonde, la Seconde pour la couche moyenne, la troisième pour la couche superficielle. Chacune de ces figures est entourée de notes explicatives en caractères bizarres, tracés, selon la coutume de l’artiste, à rebours et de la main gauche.
Vasari mentionne enfin un Traité d’anatomie du cheval. Cet ouvrage composé pendant que Léonard travaillait à la statue équestre de François Sforza, fut détruit à la même date que ce grand monument.
J’avoue que la manière, brève, sèche, du Traité de la Peinture, en rend la lecture pénible. Il exige, pour être saisi dans tous les rayons de sa nombreuse intelligence, l’attention la plus soumise; et l’esprit est bientôt récompensé de son effort et de sa sympathie, devant le développement des pensées si variées, de l’expérience si sûre, des conseils si pratiques d’un maître ouvrier soutenu dans l’exposition complète de sa méthode par la flamme de l’idéal. C’est la méthode du réalisme à la fois le plus noble et le plus vrai.
Il exhorte l’élève à regarder la nature vivante, la forme qui, par ses mouvements et ses couleurs, trahit les émotions de l’esprit qui l’anime. Il circonscrit nettement le champ de la peinture. L’intention du peintre doit être, déclare-t-il, de reproduire avant tout le relief des corps. Le couronnement de l’art provient de la dispensation juste et naturelle des ombres et des lumières. Et Léonard ajoute cette parole pénétrante et si juste, qui s’adresse aux amateurs prétentieux de tous les temps, aux mufles et aux snobs de tous les pays:
«Si un peintre épargne les ombres où elles sont nécessaires, il se déshonore, il rend son ouvrage méprisable aux bons esprits, pour acquérir auprès du vulgaire et de l’ignorant une fausse estime. Car ceux-ci ne voient dans un tableau que le brillant et le fard, sans prendre garde au relief.»
Léonard donne encore à ses élèves des conseils, qui pourraient servir aux professionnels de tous les arts, aux littérateurs aussi bien qu’aux peintres:
«Ce n’est pas une chose insignifiante que de repasser en imagination. lorsqu’on est au lit dans l’obscurité, tous les contours des figures qu’on a étudiées; par ce moyen, on fortifie davantage en sa mémoire les idées des choses qu’on y a recueillies.»
Et, plus loin, ces préceptes sévères, combien justes!...
«L’homme le plus sujet à se tromper est celui qui juge son propre ouvrage; le blâme de ses ennemis le sert mille fois plus que l’approbation de ses amis.»
Il supplie ses élèves de travailler lentement, de n’imite! jamais personne, de ne s’attacher qu’à un petit nombre d’œuvres, mais excellentes. Rien dans la nature, pas même ce qui vient du hasard, ne lui paraît inutile au progrès d’un esprit qui sait observer et comparer.
«Si vous prenez garde aux salissures d’un vieux mur, aux bigarrures de certaines pierres jaspées, il pourra s’y rencontrer des représentations de divers paysages, des confusions de batailles, des airs de têtes et de figures étranges, des habillements capricieux...»
Il a trop, avec ses fines qualités de psychologue qui craint le ridicule, mesuré les limites de l’ambition pour ne pas recommander de se Préserver comme d’une maladie de tout ce qui excède les forces humaines;
«Qui ne peut ce qu’il veut, doit vouloir ce qu’il peut... Il n’est pas non plus avantageux de vouloir tout ce qu’on Peut, car souvent ce qui nous paraît doux finit par devenir amer, et j’ai pleuré Parfois ce que j’ai désiré, parce que je l’avais obtenu.»
Insatiable esprit qui souffrait de désirer trop de beauté, et qui dans l’inquiète d’avoir mal dirigé son effort. éprouvait comme un remords d’avoir, par l’exécution d’une œuvre, trahi sa pensée.
Étude de statue équestre.
Les intentions et les croyances de Léonard ne se révèlent pas tout entières dans ses traités ni dans ses vers. Néanmoins, il ne sort de ses livres que des connaissances supérieures, capables de développer la vertu et la souplesse d’une intelligence, d’améliorer les ressources du métier, expérimentées par les maîtres. En lui, tout s’appliquait à être nouveau. Il ne pouvait rien faire comme personne. Ainsi, Luca Pacioli nous apprend que, positivement, il était gaucher. Vasari déclare qu’il écrivait de la main gauche, et l’inspection de ses dessins prouve bien que c’est, en effet, de la main gauche qu’il travaillait. Il commençait par la droite, à rebours par conséquent, selon la manière des Orientaux: il est presque impossible de lire son écriture autrement que dans un miroir.
En ce temps-là, on se plaisait aux secrets, aux mystères; l’alchimie était fort en honneur. Peut-être, Léonard, qui avait des susceptibilités d’amour-propre dans les inspirations de son génie, et pour préserver du contact des esprits impatients, médiocres ou routiniers, la personnalité de ses œuvres, voulait-il ainsi, en employant une méthode obscure, soustraire ses inventions à la curiosité et à la jalousie. La bizarrerie de cette méthode prêtait parfois à l’écriture, aux images qu’elle illustre, une étrange physionomie de choses grimaçantes, comiques, malicieuses, même obscènes.
Ses dessins sont innombrables. Sa main, qui était assez puissante, dit-on, pour tordre le battant d’une cloche, jetait à profusion, allègrement, sur le papier, toutes les lueurs et tous les nuages de sa pensée, l’indication nette des êtres et des paysages qui avaient charmé ses yeux, étonné ou remué son cœur. Ses préoccupations, ses études, se reflètent clairement dans ses esquisses à la plume, à la mine de plomb, à la pointe d’argent: bijoux, pièces d’orfèvrerie, plans d’architecture, pompes d’épuisement, bateaux à nageoires, armes, canons de toutes grandeurs, une planche de son anatomie du cheval, un alphabet illustré, qu’il établit sans doute pour le jeune duc de Milan.
La vie, en ses variations innombrables, l’intéressait; il les notait toutes avec la même dilection: chevaux, ânes, chevreuils, buffles, chameaux, singes, chiens, lézards, tortues, et des oiseaux peints à l’aquarelle, et les fleurs de tous les parterres. Il cherchait toujours la vie, des moyens plus sûrs de la saisir dans son frémissement, des moyens inédits de la traduire plus belle, plus heureuse, et d’en rendre la joie plus accessible aux hommes. S’il tâtonnait parfois, c’était dans une lumière éblouissante qui l’aveuglait lui-même. Et s’il a laissé plus de projets chimériques que d’œuvres achevées, c’est qu’il doutait trop souvent, non de la clairvoyance et de la logique de sa pensée, mais de la puissance de l’instrument de cette pensée. Il était seul à posséder ce doute.
Vers 1490, les constructeurs de la cathédrale de Milan émirent, pour la continuation des travaux, des opinions différentes. Les Italiens, soutenus par Louis le More, prônaient le style de la Renaissance; les Allemands défendaient avec énergie l’art gothique. Tous ces savants têtus, dans un congrès convoqué par Louis, discutaient de leur mieux et, parmi les tempêtes croissantes de leurs disputes, se comprenaient de moins en moins. Le peuple s’impatientait, cependant, de recevoir un résultat de leurs délibérations.
Louis, qui désirait avoir sa cathédrale, chargea Léonard de mettre d’accord les ingénieurs et les architectes, ânes savants de son congrès. Léonard obéit, et par sa bonne grâce, autant que par l’autorité de son savoir en mathématiques appliquées, il les contraignit d’aboutir à une conclusion.
Pour se délasser de son labeur et de ses plaisirs, Léonard confectionnait de petits ouvrages de sculpture, bustes de vieillards, figures de Christ ou de Madone Nous ne pouvons Malheureusement en parler que d’après Lomazzo, qui possédait «une petite tête en terre du Christ enfant, dans laquelle on voit la simplicité et la pureté de l’enfance accompagnées d’un je ne sais quoi de sage, d’intelligent et de majestueux.»
Aujourd’hui, nous considérons en Léonard surtout le peintre; de son temps, c’est comme sculpteur qu’on l’appréciait le plus. Lui-même, pour immortaliser son nom, comptait sur le monument équestre de François Sforza. Il avait entrepris cet ouvrage peu de temps après son arrivée à la cour de Milan; il le maintint pendant seize années sur le chantier. Pour cette statue qu’il rêvait colossale, il demanda cent mille livres de bronze. Dans les esquisses qui nous en ont été léguées, on voit François Sforza à cheval sous un portique. Le cavalier en armure, et dont une toque coiffe la tête, tient en sa main droite, appuyée en arrière sur la selle, le bâton de commandement.
En 1493, après le mariage de Louis avec Béatrix d’Esté, Léonard découvrit enfin sa statue. Ce fut, parmi les seigneurs, dans le peuple, un cri d’admiration. Mais l’artiste, toujours inquiet, hésita, selon la tradition, à la livrer à la fonte. Cependant, Luca Pacioli affirme qu’elle fut parfaitement fondue, qu’elle pesait deux cent mille livres et qu’elle mesurait douze brasses de hauteur, c’est-à-dire un peu plus de sept mètres. Si, en tout cas, la tradition se trompe, lorsqu’elle prétend que les arbalétriers de Louis XII l’ont mise en pièces, il est certain que rien ne reste aujourd’hui de cette statue colossale. D’après une lettre d’Hercule I d’Esté à Jean Valle, son résident à Milan, elle existait encore le 19 septembre 1501. Mais, à présent, nous ne possédons plus que les dessins de la collection de Windsor qui s’y rapportent, les croquis de cavaliers décrits par Vallardi d’après une gravure que l’on attribue à Léonard, le beau manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris (ancien fonds), petit in-folio, n° 9941, qui donne une idée assez complète de l’ouvrage, et une étude d’homme à cheval dessinée à la sanguine et qui rappelle la miniature du manuscrit de Paris.