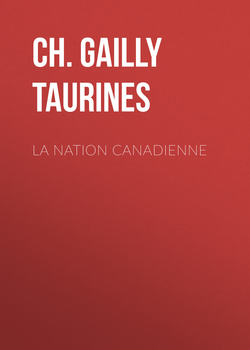Читать книгу La Nation canadienne - Ch. Gailly de Taurines - Страница 3
PREMIÈRE PARTIE
ORIGINES ET ÉVOLUTION HISTORIQUE
DE LA NATION CANADIENNE
CHAPITRE II
LA COLONISATION
ОглавлениеLe pays était parcouru et découvert au loin par les explorateurs; une population déjà assez nombreuse se multipliait autour de Québec, il fallait pourvoir à sa subsistance et à son avenir, défricher la forêt, favoriser la culture, mettre en un mot la colonie en état de se suffire à elle-même, et de continuer seule ses progrès.
Pour faciliter et activer les défrichements, Colbert suggéra un moyen radical et prompt:
«Étant constant, écrivait-il à l'intendant le 1er mai 1669, que la difficulté du défrichement des terres et la facilité que les Iroquois ont de venir attaquer les habitations des Français, proviennent de la quantité de bois qui se trouvent audit pays, il serait bon d'examiner si l'on ne pourrait pas brûler une bonne partie pendant l'hiver en y mettant le feu du côté du vent… et peut-être, si ce moyen est praticable, comme il le paraît, il sera aisé, en découvrant un grand pays, de défricher les terres et d'empêcher les ravages des Iroquois9.»
Mais il ne suffisait pas de faire place nette, il fallait livrer à la culture les terres ainsi découvertes par le feu. Pour cela, non-seulement des bras, mais des capitaux étaient nécessaires. Les convois de colons, l'arrivée des engagés, le licenciement des soldats, avaient bien augmenté la population, mais non les ressources du pays. Tous ces émigrants sortaient des classes les moins fortunées de la population française; Colbert voulut attirer au Canada les classes aisées elles-mêmes. C'est dans ce but qu'il appliqua à la colonie le système des concessions seigneuriales.
Des étendues de terre assez considérables furent, avec le titre de seigneuries, promises à tous ceux qui, nobles ou non, mais disposant de capitaux suffisants pour mettre leurs terres en valeur, voudraient aller s'établir au Canada, et cette promesse y attira en effet un grand nombre de colons appartenant à la petite noblesse et à la bourgeoisie.
C'était là une mesure économique, nullement une institution nobiliaire, et presque tous les noms des premiers seigneurs canadiens sont des noms bourgeois. Un chirurgien du Perche, Pierre Giffard, obtient la seigneurie de Beauport. Nous trouvons encore Louis Hébert, Le Chasseur, Castillon, Simon Lemaître, Cheffaut de la Regnardière, Jean Bourdon, etc.10. Les seigneurs canadiens étaient en somme, comme le fait judicieusement remarquer M. Rameau de Saint-Père, «les entrepreneurs du peuplement d'un territoire». Sur la vaste étendue qui leur avait été concédée, ils appelaient eux-mêmes des colons, et leur intérêt particulier se trouvait ainsi d'accord avec l'intérêt général.
Si la noblesse n'était pas une condition nécessaire pour obtenir une seigneurie, elle pouvait par contre devenir la récompense du zèle déployé dans la culture et dans la mise en valeur des terres, et nous trouvons au Canada plusieurs exemples de ces anoblissements11. Les motifs invoqués dans les lettres de noblesse accordées entre autres au sieur Aubert en 1693 sont: «les avantages qu'il a procurés au commerce du Canada, depuis l'année 1655 qu'il y est établi… qu'il a même employé des sommes très considérables pour le bien et l'augmentation de la colonie, et particulièrement pour le défrichement et la culture d'une grande étendue de terres en divers établissements séparés, et la construction de plusieurs belles maisons et autres édifices12…».
L'intendant Talon avait même proposé de récompenser ces services coloniaux, non seulement par des lettres de noblesse, mais, pour les hommes les plus marquants et les plus dignes, par des titres. Il écrivait à Colbert en 1667: «Afin de concourir par les faits aussi bien que par les conseils à la colonisation du Canada, j'ai donné moi-même l'exemple en achetant une certaine étendue de terrain couverte de bois. Je me propose de l'étendre encore de manière à pouvoir y établir plusieurs hameaux; il est situé dans le voisinage de Québec et pourra être utile à cette ville. On pourrait doter cet établissement d'un titre nobiliaire si Sa Majesté y consentait, et on pourrait même annexer à ce fief, avec les noms qui pourront lui convenir, les trois villages que je désirerais y créer. On arriverait ainsi, en commençant par mon exemple, à faire surgir une certaine émulation parmi les officiers et les plus riches colons à s'employer avec zèle à la colonisation de leurs terres, dans l'espoir d'en être récompensés par un titre.
«Vous savez que M. Berthelot m'a autorisé, jusqu'à la concurrence de 10,000 livres, à faire établir ici une ferme pour son compte. D'autres personnes de France m'ont adressé de pareilles demandes, et la création de titres que je propose serait un moyen facile de faire progresser la colonie13.»
La concession demandée par Talon lui avait été accordée. Elle porta d'abord le nom des Islets, avec le titre de Baronnie, puis celui d'Orsainville, avec celui de Comté, et c'est là qu'il avait établi ces villages modèles de Charlesbourg, Bourg-Royal et la Petite-Auvergne.
Il ne paraît pas qu'il ait été accordé d'autres seigneuries titrées. On continua seulement à concéder de simples seigneuries, soit à des gentilshommes, soit à des bourgeois. Talon, en faisant cette proposition, n'agissait d'ailleurs qu'en vue du bien de la colonie, et croyait donner un exemple utile, sans aucune arrière-pensée de vanité. Vanité d'ailleurs qui eût été bien aveugle, car le nom de Talon, porté par de célèbres magistrats, était aussi respecté, aussi illustre même, que celui d'Orsainville était obscur et nouveau. En quittant en 1672 ses fonctions d'intendant du Canada, Talon abandonna son comté d'Orsainville, qui put être concédé de nouveau aux religieuses de l'hôpital de Québec.
Outre qu'il favorisait l'émigration de la classe riche, le système seigneurial avait encore, dans la colonie même, cet avantage d'intéresser d'une façon puissante le seigneur au peuplement et à la mise en culture de ses terres.
Tous les avantages que le seigneur pouvait retirer de sa seigneurie étaient subordonnés à l'établissement et même à la réussite de ses censitaires. C'est gratuitement, en effet, qu'il devait leur concéder les lots qu'il taillait dans son domaine; son principal revenu consistait seulement en droits de mouture dans le moulin banal qu'il était obligé de construire. Ainsi, pas de récolte chez le censitaire, point de revenus chez le seigneur; la richesse de l'un dépend de la prospérité de l'autre. Mais pour que de son côté le censitaire n'ait pas la tentation de laisser ses terres incultes, il doit, tant qu'il les occupe, payer au seigneur une légère redevance annuelle.
Les obligations imposées par la loi au seigneur étaient rigoureusement observées. S'il refusait ou négligeait de concéder ses terres, l'intendant était autorisé à le faire d'office, par un arrêt dont l'expédition devenait un titre de propriété pour le censitaire. Un arrêt de 1711 va même plus loin: il ordonne la confiscation des seigneuries dont les terres ne seraient pas concédées dans l'espace de deux années14.
La construction du moulin banal était un devoir tout aussi strictement exigé; et si le seigneur oubliait de s'y conformer, il s'exposait, d'après un édit de 1686, à voir son droit de banalité éteint au bout d'une année15.
Le seigneur canadien était loin de jouir de privilèges exorbitants. La somme de ses devoirs était au moins équivalente à celle de ses droits. Pour tirer parti de son domaine, il était nécessaire qu'il y résidât lui-même et en cultivât pour son compte une portion; il n'était pas assuré d'arriver à la richesse, et les rapports des gouverneurs nous montrent plusieurs familles de seigneurs canadiens, – même parmi celles qui appartenaient à la noblesse, – obligées de prendre part elles-mêmes au travail des champs: «Je dois rendre compte à Monseigneur, écrivait au ministre le gouverneur M. de Denonville, en 1686, de l'extrême pauvreté de plusieurs familles… toutes nobles ou vivant comme telles. La famille de M. de Saint-Ours est à la tête. Il est bon gentilhomme du Dauphiné (parent du maréchal d'Estrade) chargé d'une femme et de dix enfants. Le père et la mère me paroissent dans un véritable désespoir de leur pauvreté. Cependant les enfants ne s'épargnent pas car j'ai vu deux grandes filles couper les blés et tenir la charrue.»
M. de Denonville nommait encore les Linctot, les d'Ailleboust16, les Dugué, les Boucher, les Chambly, les d'Arpentigny, les Tilly.
Au début de la colonisation, la propriété seigneuriale garda au Canada les formes et la procédure un peu archaïque qu'elle n'avait même plus en France. Qu'on en juge par ce procès-verbal rédigé le 30 juillet 1646 à propos d'une contestation entre le sieur Giffard, seigneur de Beauport, et l'un de ses censitaires, Jean Guyon: «Ledit Guyon s'est transporté en la maison seigneuriale de Beauport et à la principale porte et entrée de ladite maison; où étant ledit Guyon aurait frappé et seroit survenu François Boullé, fermier dudit seigneur de Beauport, auquel ledit Guyon auroit demandé si le seigneur de Beauport étoit en sa dite maison seigneuriale de Beauport, ou personne pour lui ayant charge de recevoir les vassaux à foi et hommage… Après sa réponse et à la principale porte, ledit Guyon, s'est mis à genouil en terre nud teste, sans espée ni esperons, et a dit trois fois en ces mots: «Monsieur de Beauport, monsieur de Beauport, monsieur de Beauport, je vous fais et porte la foy et hommage que je suis tenu de vous faire et porter, à cause de mon fief du Buisson duquel je suis homme de foy, relevant de votre seigneurie de Beauport, laquelle m'appartient au moyen du contrat que nous avons passé ensemble par devant Roussel à Mortagne le 14e jour de mars mil six cent trente-quatre, vous déclarant que je vous offre payer les droits seigneuraux et féodaux quand dus seront, vous requérant me recevoir à la dite foy et hommage17.» Le résultat pratique de cette pompeuse procédure est la promesse, faite par le censitaire à la fin du procès-verbal, d'acquitter les droits qu'il avait sans doute omis de payer jusqu'alors. Détour bien long et bien curieux pour en arriver là; curieux surtout lorsque, sous la pompe des qualifications, l'on reconnaît les personnages: le seigneur de Beauport un chirurgien de province, son manoir une ferme, son vassal, Jean Guyon, un maçon du Perche, qui eût été bien embarrassé sans doute de se présenter autrement que sans espée ni esperons devant la porte de son seigneur.
Ces formes vieillies ne furent guère appliquées au Canada et cet exemple curieux est peut-être le seul que l'on cite. Il en est de même pour un droit qui, en Europe, avait été attaché à la propriété féodale: le droit de justice. Il avait déjà à peu près disparu en France au dix-septième siècle. Au Canada il demeura en fait lettre morte. Ce n'est qu'en 1714, il est vrai, qu'un édit défendit d'accorder des seigneuries «en justice», mais jusque-là, comme pour entretenir des tribunaux, les seigneurs auraient été obligés d'en supporter tous les frais, ils se gardèrent d'user du droit onéreux qui leur était laissé, et l'administration judiciaire tout entière demeura aux magistrats du Roi.
«La vérité historique, affirme l'historien canadien Garneau, nous oblige à dire que cette juridiction, dans le très petit nombre de lieux où elle a été exercée, ne paraît avoir fait naître aucun abus sérieux, car elle n'a laissé, ni dans l'esprit des habitants, ni dans la tradition, aucun de ces souvenirs haineux qui rappellent une ancienne tyrannie18.»
Ainsi les concessions seigneuriales, loin d'être un abus, une entrave à la colonisation, comme l'ont prétendu certains historiens américains, furent au contraire très favorables au peuplement et à la mise en valeur des colonies; elles favorisaient l'émigration parmi la classe aisée et encourageaient la culture des terres.
Le système colonial de Colbert fut en somme judicieux et habile. Il eut cependant un défaut, et ce défaut devait faire la faiblesse de l'œuvre tout entière et devenir une des causes de sa ruine: l'excès de centralisation!
Tandis que les colonies anglaises jouissaient d'une liberté locale qui laissait toute latitude à leur initiative et facilita leur merveilleux développement, les colonies françaises demeurèrent toujours soumise à une étroite sujétion envers leur métropole. Règlements, ordonnances, tout arrivait de France, et c'est du ministère que la colonie était gouvernée. Jamais il ne fut permis aux colons de prendre la moindre part à l'administration de leur propre pays, même dans les affaires qui ne touchaient qu'aux intérêts locaux.
Non seulement les habitants étaient tenus en tutelle, mais le gouverneur général lui-même n'était pas libre de gouverner à sa guise; c'est à Paris qu'il devait prendre le mot d'ordre, et lorsqu'en 1672 le comte de Frontenac voulut essayer de consulter les Canadiens sur leurs intérêts, et réunit une assemblée qu'il nomma avec un peu d'emphase les États généraux de la colonie, il s'attira, de la part du ministre, une assez sévère réprimande: «Il est bon d'observer, lui mandait celui-ci, que comme vous devez toujours suivre dans le gouvernement de ce pays-là les formes qui se pratiquent ici, et que nos rois ont estimé du bien de leur service, depuis longtemps, de ne pas assembler les États généraux de leur royaume, pour, peut-être, anéantir cette forme ancienne, vous ne devez aussi donner que très rarement, pour mieux dire jamais, cette forme au corps des habitants du dit pays19.»
Ainsi, pas d'assemblées générales; celles-là, à la rigueur, les Canadiens pouvaient s'en passer, mais ce qui est plus grave, c'est que les assemblées locales elles-mêmes furent interdites, et les intérêts municipaux confiés à l'administration, sans que les habitants eussent aucune part au règlement de questions qui les touchaient de si près. La nomination même d'un syndic, choisi pour transmettre au gouvernement leurs vœux et leurs réclamations, est rigoureusement prohibée. Dans la dépêche citée plus haut Colbert ajoute: «Il faudra même, avec un peu de temps, et lorsque la colonie sera devenue plus forte qu'elle n'est, supprimer insensiblement le syndic qui présente des requêtes au nom de tous les habitants, il est bon que chacun parle pour soi et que personne ne parle pour tous20.»
Quand, en 1721, pour les besoins de l'organisation religieuse, les habitations répandues sur les deux rives du Saint-Laurent, entre Montréal et Québec, furent réparties en paroisses par le gouverneur, marquis de Vaudreuil, et l'intendant Bégon, l'administration de ces paroisses fut confiée non aux paroissiens, mais au conseil supérieur de la colonie. Les officiers qui, dans chacune d'elles, étaient chargés d'exécuter les décisions de ce conseil, dépendaient eux-mêmes d'une façon plus ou moins directe de l'administration; c'étaient le curé, le seigneur et le capitaine de la milice.
Aussi dans quel état d'inexpérience la conquête anglaise trouva les colons français! Ils étaient incapables de conduire eux-mêmes leurs propres affaires et les conquérants ne pouvaient revenir de leur étonnement! «L'erreur de ceux qui gouvernèrent la Nouvelle-France, dit l'historien américain Parkmann, ne fut pas d'exercer leur autorité, mais de l'exercer trop, et au lieu d'apprendre à l'enfant à marcher seul, de le tenir perpétuellement en lisières, le rendant de plus en plus dépendant, de moins en moins apte à la liberté21.»
Cet état d'enfance dans lequel le régime français avait tenu les Canadiens au point de vue politique, devint plus tard un grief contre eux. Dans le rapport qu'il rédigea à la suite de l'insurrection de 1837, lord Durham les déclara inhabiles au gouvernement représentatif, et indignes d'en profiter. Le leur avoir accordé, disait-il, était une faute, et la seule cause de l'insurrection était que «ces hommes, qui n'étaient pas même initiés au gouvernement d'une paroisse, avaient tout d'un coup été mis en mesure d'agir par leurs votes sur les destinées d'un État22».
9
Instructions pour le sieur Gaudais, 1er mai 1667. (Correspondance de Colbert, 2e part., t. III, p. 443.)
10
Ces seigneuries avaient été concédées avant Colbert. Il n'inventa pas le système, mais le perfectionna et l'étendit.
11
: On peut citer les Boucher de Boucherville, les Le Moyne, les Aubert de Gaspé, familles encore honorablement représentées au Canada.
12
Lettres d'anoblissement du sieur Aubert de la Chesnaie, citées par Casgrain, Biographies canadiennes.
13
Lettre de Talon à Colbert, 10 novembre 1667, citée par Rameau, Acadiens et Canadiens, 2e part., p. 286.
Voici la réponse de Colbert: «Sur le compte que j'ai eu l'honneur de rendre au Roi du défrichement considérable que vous avez fait d'une terre au Canada, Sa Majesté a estimé à propos de l'ériger en baronnie, et j'en ai expédié suivant ses ordres les lettres patentes… Je ne doute pas que cette marque d'honneur ne convie non seulement tous les officiers et habitants du pays qui sont riches et accommodés, mais même les sujets du Roi de l'ancienne France, à entreprendre de pareils défrichements et à pousser ceux qui sont commencés, dans la vue de recevoir de pareilles grâces de Sa Majesté. C'est à quoi il est bien important que vous les excitiez fortement en poussant encore plus avant celui que vous avez fait.» Dépêche de Colbert à Talon, 11 février 1671. (P. Clément, Correspondance administrative de Colbert.)
14
Voy. Turcotte, le Canada sous l'Union, t. II, p. 245. Québec, 1871, 2 vol. in-18.
15
Arrêt du 4 juin 1686: «Le Roi étant en son conseil, ayant été informé que la plupart des seigneurs qui possèdent des fiefs dans son pays de la Nouvelle-France négligent de bâtir des moulins banaux nécessaires pour la subsistance des habitants dudit pays, et voulant pourvoir à un défaut si préjudiciable à l'entretien de la colonie, Sa Majesté étant en son conseil, a ordonné et ordonne que tous les seigneurs qui possèdent des fiefs dans l'étendue dudit pays de la Nouvelle-France seront tenus d'y faire construire des moulins banaux dans le temps d'une année après la publication du présent arrêt; et ledit temps passé faute par eux d'y avoir satisfait, permet Sa Majesté à tous particuliers de quelque qualité et condition qu'ils soient, de bâtir lesdits moulins leur en attribuant à cette fin le droit de banalité, faisant défense à toute personne de les y troubler.» (Cité par Lareau, Histoire du droit canadien, t. I, p. 191. Montréal, 1889, 2 vol. in-8º.)
16
Les d'Ailleboust, dont il est question, étaient les enfants de Louis d'Ailleboust, qui avait été gouverneur du Canada de 1628 à 1651. Sa famille était originaire d'Allemagne. Venu en France, son grand-père avait été anobli comme premier médecin du Roi.
17
De La Sicotière, l'Émigration percheronne au Canada. Alençon, 1887, broch. in-8º.
18
Garneau, Histoire du Canada, t. I, p. 182.
19
Lettres et instructions de Colbert (30 juin 1673) au comte de Frontenac. (Correspondance de Colbert, 2e part., t. III, p. 558.)
20
Mignault, Manuel de droit parlementaire, p. 35. Montréal, 1889, in-12.
L'élection des syndics demeura-tant qu'elle eut lieu-si subordonnée au pouvoir, qu'elle ne devait pas pourtant être considérée comme bien dangereuse. En 1664, lors de l'élection d'un syndic de Québec, le gouverneur, M. de Mézy, choisit lui-même les électeurs, et ne convoqua par billet que les personnes «non suspectes». (Garneau, t. I, p. 179.)
21
Cité par Bourinot, Local government in Canada.
22
Ibid.