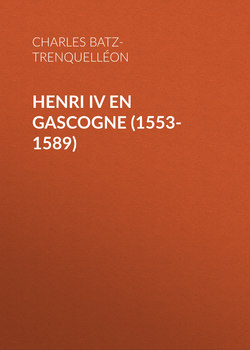Читать книгу Henri IV en Gascogne (1553-1589) - Charles de Batz-Trenquelléon - Страница 3
LIVRE PREMIER
(1553-1575)
CHAPITRE II
ОглавлениеLa gouvernante du prince de Navarre. – Le château de Coarraze. – L'éducation à la «béarnaise». – Les premières leçons. – Mort de Henri d'Albret. – Résumé de son règne. – L'aïeul et le petit-fils. – Avènement de Jeanne et d'Antoine. – Les desseins de Henri II sur la Navarre et le Béarn. – Antoine protège la Réforme. – Menaces du roi de France. – Le prince de Navarre à la cour de Henri II. – Naissance de Catherine de Bourbon. – La paix de Cateau-Cambrésis. – Mort de Henri II et avènement de François II. – La politique de Catherine de Médicis. – Les Bourbons évincés par les Guises. – La revanche du roi et de la reine de Navarre. – La conjuration d'Amboise. – Mort de François II et avènement de Charles IX. – Catherine de Médicis régente. – Le triumvirat. – Le chancelier Michel de l'Hospital et l'édit de Janvier. – Les troubles. – La prise d'armes de Condé et de Coligny.
A la mort du comte de Marle, son second petit-fils, Henri d'Albret s'était fort courroucé contre la duchesse de Vendôme, «l'appelant marâtre», dit Favyn, «et indigne d'avoir des enfants, puisqu'elle en avait si peu de soin». Tout injuste qu'était ce reproche, il toucha au cœur la mère, qui, prenant pour guide l'affectueuse sévérité de l'aïeul, se voua, avec un redoublement de sollicitude, à l'éducation du jeune prince. Le roi de Navarre avait fait le plan de cette éducation; il fut exécuté de point en point. L'allaitement dans une chaumière, en plein air, pour ainsi dire, fit de Henri un nourrisson robuste; même avant le sevrage, il ravissait son grand-père par un agréable mélange de force et de gentillesse. Au sortir des bras de Jeanne Lafourcade, il eut pour gouvernante Susanne de Bourbon-Busset, baronne de Miossens, à qui fut donné l'ordre de l'élever, non dans le palais natal, mais dans un site agreste, aux environs de Pau. Elle s'établit avec Henri au château de Coarraze, chef-lieu d'une des treize baronnies du Béarn, et là commença, pour l'héritier des Maisons d'Albret et de Bourbon, cette éducation à la «béarnaise» qui devait préparer, comme dit d'Aubigné, «un ferme coin d'acier aux nœuds endurcis de nos calamités».
Trois siècles de vicissitudes sociales et politiques n'ont laissé de l'antique manoir qu'une tour et quelques pans de muraille, mais trois siècles de civilisation n'ont eu que peu de prise sur la nature. C'est toujours la même riante vallée du Gave, le même ciel radieux, le même air salubre; ce sont encore les collines boisées, les rocs stériles, les profonds ravins, tout ce cadre magnifiquement sauvage que la volonté de Henri d'Albret imposait à l'enfance de son petit-fils. Et ce ne fut pas en prince, mais en paysan, qu'il y passa ses premières années. Nourri de pain bis et de laitage, de bœuf et d'ail, vêtu sans élégance, souvent pieds nus et nu-tête, bravant le soleil et la pluie, courant les buissons, les bois et les rochers, ignorant toutes les superfluités et tous les luxes de la vie, s'ignorant lui-même, il fraternisait avec les fils de pâtres, parlait leur langue, se mêlait à leurs jeux et s'intéressait à leurs travaux. Il apprit à Coarraze trois choses qui résument presque toute sa vie: l'activité, la hardiesse et la cordialité. Il vit de près le peuple, le vrai peuple, celui qui travaille, et il l'aima, sûr moyen d'être aimé de lui. C'est le rustique châtelain de Coarraze qu'on retrouvera toujours en lui, lorsque, à la tête des armées, il prendra constamment la défense des «pauvres gens», même contre ses plus fidèles serviteurs, entraînés parfois à faire trop bon marché de la faiblesse et de la misère. C'est le coureur de bois et de montagnes, à la fois intrépide et insoucieux, qui, plus tard, saura railler la fortune inconstante, rire au danger, relever, par un mot d'héroïque gaîté, le courage chancelant de ses compagnons d'armes.
Tel était l'homme qui s'ébauchait dans la solitude de Coarraze. Malheureusement, Henri d'Albret ne vit pas grandir à son gré ce «lion généreux, capable de faire trembler les Espagnols». Le 25 mai 1555, le roi de Navarre, âgé de cinquante-trois ans, mourut à Hagetmau, pendant une absence de Jeanne, qui était allée rejoindre Antoine de Bourbon en Picardie, et au moment où les complications de la politique ravivaient, dans le cœur de cet irréconciliable ennemi de l'Espagne, l'espoir si souvent déçu de recouvrer ses Etats. Henri d'Albret est un des plus dignes ancêtres de Henri IV: rien qu'à ce titre, l'histoire lui devrait un pieux souvenir.
Il était né en 1503. Dans son enfance, attristée par le démembrement du royaume de Navarre, que ne sut pas défendre son père, Jean d'Albret, il se lia d'une étroite amitié avec le futur vainqueur de Marignan: les archives du château de Pau contiennent de nombreux témoignages de l'affection qui unissait les deux princes avant le désastre de Pavie. On sait de quelle vaillance fit preuve Henri d'Albret dans cette bataille, et tous les historiens ont raconté son évasion hardie, lorsque Charles-Quint voulut abuser de sa captivité pour lui imposer des conditions déshonorantes. L'héroïsme et le malheur communs firent des deux amis deux frères. Marguerite de Valois-Angoulême, veuve du duc d'Alençon, émue et charmée de la magnanimité du chevalier béarnais, lui donna sa main, qu'il avait ardemment désirée quelques années auparavant. Ce fut un grand bonheur pour le Béarn et les autres Etats de la couronne de Navarre, que cette illustre union. Henri et Marguerite se partagèrent la mission d'enrichir et d'embellir ces contrées. La reine, dit l'auteur du Château de Pau, appela des artistes italiens pour décorer les vastes appartements qu'elle fit construire au midi, le grand escalier que l'on admire encore, la cour intérieure et tout le dehors de l'édifice, remanié dans le style de la Renaissance. Le palais des rois de Navarre dut paraître magnifique: le vieux Louvre des rois de France, les Tuileries et le Luxembourg ne devaient resplendir que plus tard. Ce fut alors, sans doute, que les Béarnais ravis répandirent le fameux distique:
Qui n'a vist lo casteig de Paü,
Jamais n'a vist arey de taü.
Henri d'Albret s'associa aux nobles goûts de sa femme; mais, de son côté, il accomplissait une œuvre encore plus méritoire. En Béarn, de vastes étendues de terrain étaient incultes, les populations de ce pays s'adonnant surtout à la vie pastorale. Rien ne coûta au roi pour développer, on peut dire pour créer l'agriculture dans ses Etats: en quelques années, le territoire béarnais avait changé de face. En même temps, Henri, précurseur des progrès industriels, fondait à Nay une fabrique de draps et établissait à Pau une imprimerie. Partout, enfin, il favorisait la naissance ou le développement des entreprises qui avaient pour but l'amélioration de la fortune publique. Il ne s'en tint pas à ces actes de sollicitude éclairée. Les antiques Fors de Béarn morcelaient, en quelque sorte, la constitution du pays: il les fit reviser avec un soin minutieux, et les transforma en un For général qui répondait aux nécessités de l'époque. Rien n'échappait à son activité de gouvernant: il réorganisa la plupart des services publics, divisa son conseil en deux chambres, l'une civile, l'autre criminelle; créa des chambres des comptes, de nouvelles administrations, de nouveaux emplois d'une haute utilité; et législateur aussi ferme que fécond, il fit en sorte que ses lois fussent fidèlement appliquées.
L'enthousiasme d'un écrivain béarnais prête à Charles-Quint ce mot invraisemblable: «Je n'ai trouvé qu'un homme en France: c'est le roi de Navarre». L'exagération castillane n'est pas nécessaire pour peindre Henri d'Albret et honorer sa mémoire: le grand-père maternel de Henri IV fut un prince vaillant, sage, ami de son peuple, qui le pleura comme un bienfaiteur. Toutes ses royales vertus devaient revivre avec éclat dans son petit-fils. Il fut inhumé, comme Marguerite, dans le cathédrale de Lescar, en attendant, disaient ses dernières volontés, qu'il pût reposer à Pampelune, à côté des anciens rois de Navarre, ses prédécesseurs.
En vertu des lois fondamentales du royaume de Navarre, Jeanne d'Albret succédait à son père et partageait la couronne avec son mari. Ils furent bien près de ne la porter ni l'un ni l'autre. Au moment où ils se préparaient à partir pour le Béarn, Henri II eut la pensée de réunir leurs Etats à la couronne de France, en échange de quelques domaines du centre et du nord. Il faut citer ici une page du vieil historien de la Navarre.
«Antoine de Bourbon se prépare, avec la reine Jeanne d'Albret, sa femme, pour aller prendre possession de leurs nouveaux Etats, où ils étaient attendus avec un grand désir de leurs sujets. Le roi Henri II, conseillé de quelques grands seigneurs de sa cour qui avaient son oreille, le persuadèrent de retenir ce prince auprès de lui, et que tout ainsi qu'il n'y avait qu'un soleil au monde, sans qu'aucune autre planète eût la lumière à part, de même la France ne pouvait souffrir qu'un roi; qu'il fallait récompenser le duc Antoine en France selon la valeur des terres et souverainetés qu'il avait en la Basse-Navarre, Béarn et Gascogne. Cette proposition trouvée bonne, il en avertit le roi de Navarre, lequel remet cette affaire si importante au consentement de la reine sa femme, à laquelle, disait-il, il appartenait d'agréer cet échange, d'autant que les dits royaumes et seigneuries étaient de son propre. Cette avisée princesse, résolue de conserver les biens que ses pères et aïeux lui avaient délaissés, pour apaiser le roi, lui promit de s'y résoudre, avec ses sujets, et lui donner en ceci et en toutes autres choses tout le contentement qu'il pouvait désirer. Sur ces promesses, le roi de Navarre ayant remis son gouvernement de Picardie entre les mains du roi, il lui fit le serment de celui de Guienne, arrêté pour lors être tenu à l'avenir par celui qui serait jugé et déclaré premier prince du sang, comme le fut le roi Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, reçu en cette qualité au parlement de Paris, au mois de juin dudit an mil cinq cent cinquante-cinq, et depuis confirmé aux Etats d'Orléans. Et se dispose avec sa femme à faire son voyage.
«Le roi de Navarre et sa femme furent magnifiquement reçus par toutes les terres de leur obéissance, et nommément en Foix et en Béarn, où ayant été parlé de l'échange que le roi de France voulait faire à leurs princes, ce ne fut qu'assemblées pour en empêcher l'effet… Incontinent, la noblesse et le peuple en alarme pour la défense de leurs princes naturels, voilà tout aussitôt Navarrenx fortifié, et le même à Pau, où est établi le parlement, et la chambre des comptes du pays; et ensuite le même se fait par toutes les autres villes, pour résister au roi de France, s'il en venait à la force, ce qu'il ne fit, ayant entendu la réponse des Etats du pays. Ainsi cette affaire rompue, le roi en fut fâché, et en montra les effets, en ce que il retrancha le gouvernement de Guienne de la moitié, en ayant éclipsé et tiré le Languedoc, fit un gouvernement à part, dont la ville de Toulouse était le chef. Messire Anne de Montmorency en fut le premier gouverneur, auquel en cette charge, et à la dignité de connétable, la première de France, a succédé son fils Messire Henri de Montmorency. L'autre trait de l'indignation du roi parut, en ce que le roi de Navarre ayant remis entre ses mains le gouvernement de Picardie, et supplié Sa Majesté d'en investir Louis de Bourbon, prince de Condé, son frère, il le donna à l'amiral de France Gaspard de Coligny, seigneur de Châtillon, neveu dudit connétable. Ainsi furent assurés le roi de Navarre et sa femme en la jouissance de leurs souverainetés, sans plus parler d'échange.»
Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret furent couronnés, en cette même année, au château de Pau. Selon les traditions du pays, ils prêtèrent serment entre les mains des évêques, en présence du clergé et de la noblesse. Ils passèrent dans leurs Etats deux années de paix, durant lesquelles la grande affaire de la reine fut l'éducation de son fils, si bien commencée du vivant de Henri d'Albret. Mais Antoine et Jeanne avaient été blessés au cœur par la conduite de Henri II à leur égard et par la disgrâce où il tenait les Maisons d'Albret et de Bourbon, tout en favorisant la Maison de Lorraine, depuis le refus des Etats de Navarre et de Béarn de passer sous la domination française. De là, des ressentiments qui s'aigrissaient chaque jour et dont l'expression, par suite des circonstances, prit des formes provoquantes et scandaleuses.
Les imprudences de la reine Marguerite avaient donné pied, en Béarn, à la Réforme. Elle subsistait sans bruit et gagnait peu à peu du terrain. Antoine se mit en tête de la protéger ouvertement, ce qu'il fit bien plutôt pour mortifier Henri II que pour obéir à de nouvelles convictions religieuses. On le vit accueillir les ministres et les orateurs calvinistes; il donna même à David, l'un d'entre eux, le titre de prédicateur du roi et de la reine de Navarre, et ce moine apostat eut, un jour, licence de prêcher sa doctrine à Nérac, dans la grande salle du château. Il ne paraît pas que Jeanne ait personnellement donné les mains à ces premiers essais de propagande: loin de là, tous les historiens constatent qu'à cette époque, soit par politique, soit par respect des croyances traditionnelles, elle était et prétendait rester catholique. Brantôme dit à ce sujet: «La reine de Navarre, qui était jeune, belle et très honnête princesse, ne se plaisait point à cette nouveauté de religion, si tant qu'on eût bien dit… Je tiens de bon lieu qu'elle le remontra, un jour, au roi son mari, et lui dit, tout-à-trac, que s'il voulait se ruiner et faire confisquer son bien, elle ne voulait perdre le sien…» Il n'en est pas moins vrai que les progrès sérieux du calvinisme en Béarn et en Gascogne datent du patronage manifeste d'Antoine de Bourbon et de la tolérance de sa femme. Jeanne aurait pu, en effet, sans avoir recours à la persécution ni même à l'hostilité, paralyser et peut-être détruire des velléités d'hérésie dont l'esprit public ne s'émouvait que parce qu'il les voyait s'affirmer autour du roi et de la reine.
Les manifestations calvinistes organisées ou encouragées par Antoine de Bourbon prirent de tels développements, qu'à la fin elles offusquèrent Henri II. Des avis, des remontrances, des reproches furent d'abord adressés au roi et à la reine de Navarre, et, en 1557, Henri II en vint d'autant plus résolûment aux menaces d'intervention armée, qu'en ce moment, il sévissait contre les réformés, dans ses propres Etats. Il fallut courber la tête sous l'orage qu'on avait déchaîné de gaîté de cœur: Antoine et Jeanne imposèrent silence aux plus fougueux apôtres de la nouvelle religion, et résolurent d'aller faire leur paix avec le roi de France. Dans ce but, ils confièrent la lieutenance-générale de leurs Etats au cardinal d'Armagnac, et, accompagnés du prince de Navarre, âgé de cinq ans à peine, ils se rendirent à Amiens, où Henri II tenait sa cour. Froidement accueillis dès l'arrivée, ils auraient eu peut-être à regretter ce voyage, si les grâces naissantes et l'heureuse figure de leur fils n'eussent touché le cœur du roi de France. Rare mélange de noblesse et de rusticité, le petit prince ne pouvait passer nulle part inaperçu. Henri II fut frappé de ses allures primesautières, de cet œil d'aiglon qui reflétait quelque chose du ciel méridional et des âpres beautés d'un site pyrénéen. Il le prit dans ses bras et lui dit: – «Veux-tu être mon fils? —Aquet es lou seignou pay.– Celui-ci est mon seigneur et père», répondit l'enfant, qui ne parlait pas encore français, en désignant Antoine de Bourbon. «Le roi, dit Favyn, prenant plaisir à ce jargon, lui demanda: «Puisque vous ne voulez être mon fils, voulez-vous être mon gendre?» Il répondit promptement, sans songer: «Obé!– Oui bien!» On a voulu voir, dans cette riante scène d'intimité, l'origine du mariage, trop fameux dans l'histoire, qui fut une des péripéties les plus sinistres de la Saint-Barthélémy. Lorsque Catherine de Médicis et Charles IX donnèrent Marguerite de Valois à Henri de Bourbon, ce n'étaient plus les affections de famille qui inspiraient leurs actes!
Henri II voulait retenir le jeune prince à la cour et le faire élever parmi ses enfants; Jeanne et Antoine, trouvant leur fils trop jeune pour vivre loin d'eux, déclinèrent cette offre, et le ramenèrent en Béarn, au milieu de ses chères montagnes. Mais l'année suivante, ayant fait un nouveau voyage à la cour, à l'occasion du mariage du Dauphin avec Marie Stuart, ils durent céder aux sollicitations de Henri II: il fut décidé que le prince de Navarre resterait auprès du roi, sous la sauvegarde de sa gouvernante, la baronne de Miossens. Ce fut pendant son séjour à Paris que Jeanne d'Albret mit au monde, le 27 février 1559, Catherine, son dernier enfant, qui fut tenue sur les fonts par la reine de France.
Le règne de Henri II, si brillant dans la plus grande partie de son cours, allait finir par un désastre politique et une catastrophe personnelle. Le désastre fut la paix de Cateau-Cambrésis, suite des défaites de Saint-Quentin et de Gravelines. Les principaux négociateurs de cette paix, le connétable de Montmorency et le maréchal de Saint-André, humiliaient et dépouillaient la France au profit de l'Angleterre, de l'Espagne et de la Savoie. Il était stipulé, en outre, que Philippe II épouserait Elisabeth, fille de Henri II, dont la main avait été promise à don Carlos, fils du roi d'Espagne, et que le duc de Savoie aurait la main de Marguerite, sœur du roi de France. Les intérêts et les droits de la couronne de Navarre étaient absolument sacrifiés. Cette triste paix fut l'instrument diplomatique des divisions qui allaient de nouveau ensanglanter l'Europe.
A l'occasion du mariage des deux princesses françaises, Henri II ordonna des fêtes splendides, et surtout un tournoi, jeu guerrier qu'il aimait avec passion. Après y avoir fait ses prouesses habituelles, il voulut jouter une dernière fois contre le comte de Montgomery, capitaine de ses gardes, dont la lance rompue atteignit le roi à la tête. Henri II mourut le 10 juillet 1559.
Il laissait à son successeur une situation amoindrie au dehors et périlleuse à l'intérieur. Les progrès du calvinisme ne pouvaient plus se nier. Si Henri II eût vécu, peut-être la crise que sa fin précipita eût-elle avorté sous les coups de force auxquels il avait eu déjà recours; mais sa mort inopinée, livrant le pouvoir à un enfant débile, ou plutôt à Catherine de Médicis, fut, au contraire, l'origine des brigues et des dissensions les plus redoutables. A peine François II était-il sacré à Reims, que les partis se dessinèrent. Catherine se jette d'abord tout entière du côté des Guises; les Maisons de Bourbon, de Châtillon et de Montmorency sont laissées à l'écart, où elles n'entendent pas se morfondre, et elles vont s'efforcer de ressaisir, coûte que coûte, leurs avantages. Elles trouveront des armées dans la foule des mécontents et des sectaires. La veille, le trône était assiégé d'ambitions et d'intrigues; aujourd'hui, le voilà au milieu des factions. Catherine aura beau ruser avec elles, essayer de battre l'une par l'autre, s'appuyer sur les catholiques pour arrêter les «huguenots», dont le nom vient de surgir, flatter les protestants pour se dégager de l'étreinte des catholiques, favoriser ce que l'on appellerait, de nos jours, le «tiers-parti»: la France est sur le seuil de l'enfer des guerres civiles, des guerres de religion, où tomberont tant de générations fanatisées, criminelles ou innocentes, jusqu'à ce que le bras et le génie d'un roi aient rendu la patrie à elle-même et la paix à la patrie.
Les maisons princières évincées par les Guises s'efforcèrent de contrebalancer la toute-puissante influence des princes lorrains, en prenant la tête du parti protestant. Elles luttèrent mal, surtout Antoine, facile à duper. Catherine l'envoya rejoindre en Béarn sa femme et son fils, et, pour colorer ce congé d'un semblant de raison avouable, elle lui confia la mission de conduire en Espagne Elisabeth de France, mariée par procuration à Philippe II, après la paix de Cateau-Cambrésis. Le roi, la reine et le prince de Navarre prirent, dans cette occasion, une revanche qui ne fut pas sans noblesse. C'est ce que rapporte l'historien de la Navarre, dans son récit à la fois naïf et fier. «A Bordeaux, le roi Antoine vint recevoir Madame Elisabeth, et peu de temps après la reine Jeanne et le prince de Navarre son fils. De Bordeaux ils traversèrent le reste de la Guienne et les terres du roi de Navarre, où elle fut reçue et traitée avec tout honneur et magnificence. En Guienne, le premier logis était marqué par le maréchal pour la reine d'Espagne; dès l'entrée de Béarn, celui du roi Antoine le fut le premier, et celui de la reine Elisabeth après; à celui d'Antoine était crayé: pour le roi, sans autre addition; à l'autre: pour la reine d'Espagne. Arrivés en la Haute-Navarre, le même fut pratiqué nonobstant toutes les rodomontades espagnoles, épouvantails de chenevière à l'endroit des Français. Car le Béarn étant principauté souveraine, les rois de France n'y avaient aucune supériorité en ce temps-là. En Navarre, quoiqu'injustement usurpée par les rois d'Espagne, Antoine en étant roi par droit légitime et successif, il emporta de haute lutte que les étiquettes des logis marqués fussent de même façon qu'en Béarn, même dans Roncevaux, où le premier logis fut marqué: pour le roi, sans addition, et le second: pour la reine d'Espagne.
«Par le traité de mariage il avait nommément été stipulé que Madame Elisabeth serait délivrée aux Espagnols sur les frontières de France et d'Espagne, ce qui se pouvait faire, si elle eût pris le chemin du Languedoc, de Narbonne à Perpignan; mais par l'autre clef de France, qui est Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, où la rivière d'Andaye fait la séparation de la France et de la Navarre, dont Fontarabie est la première ville, et de même par le Béarn, qui marchise à la France, d'un côté, et à la Navarre, de l'autre, cela ne se pouvait accomplir. De sorte que cette délivrance se faisait infailliblement, non sur les frontières de France ni d'Espagne, mais sur celles de la Haute et de la Basse-Navarre. C'est pourquoi le roi Antoine demanda acte de cette délivrance sur ses terres, à ce qu'on ne voulût inférer à l'avenir que le Béarn et la Basse-Navarre fussent retenus pour confins de la France, et la Haute-Navarre pour finages de l'Espagne, d'autant que laissant parachever cet acte solennel sans protestation, c'était n'être plus roi de Navarre en prétention, mais volontairement avouer n'y avoir aucun droit; de sorte que le cardinal D. François de Mendoça, évêque de Burgos, et le duc de l'Infantasgo D. Lopez de Mendoça, députés du roi d'Espagne pour recevoir la princesse, furent contraints de lui délivrer cet acte, et par celui-ci le reconnaître roi de Navarre, nonobstant toutes leurs exceptions dilatoires.
«Cet acte délivré ainsi que le roi Antoine l'avait fait dresser, le lieu où la reine Elisabeth devait être délivrée fut débattu durant cinq jours par les Espagnols. Car le roi de Navarre et la dite Elisabeth étaient logés à l'abbaye de Roncevaux, les Espagnols étaient à l'Espinal, deux heures au-dessus de Roncevaux. Ils voulaient que cette délivrance fût faite au Pignon, justement au milieu du chemin de l'Espinal à l'Abbaye, afin que chacun fît la moitié du chemin: néanmoins force leur fut de venir à Roncevaux.»
Tandis que les princes navarrais tenaient en échec l'arrogance castillane, la conspiration d'Amboise s'ourdissait dans l'ombre avec une ampleur et une activité qui forcent presque l'admiration en faveur de La Renaudie, son audacieux organisateur. Nous n'avons pas à raconter cette sanglante aventure. Il est probable que la plupart des conjurés croyaient marcher seulement à l'assaut du pouvoir excessif des Guises, mais que les chefs visaient plus haut. Le prince de Condé, frère puîné d'Antoine de Bourbon, fut soupçonné d'être le «capitaine muet» de cette prise d'armes. A demi justifié par sa fière attitude, puis soupçonné une seconde fois, après les revendications de l'assemblée des notables tenue à Fontainebleau, il finit par être emprisonné à Orléans, jugé et condamné à mort. Le roi de Navarre avait eu la générosité ou la faiblesse, peut-être l'une et l'autre, de se livrer aux accusateurs de son frère. Il pouvait d'autant mieux s'en dispenser qu'après la découverte de la conspiration, il avait, sur l'ordre du roi, réprimé avec vigueur, dans son gouvernement de Guienne, quelques mouvements tentés par les factieux. Il n'en fut pas moins traité en ennemi; mais, comme on ne pouvait relever contre lui les charges qui pesaient sur le prince de Condé, on se contentait de le garder à vue, et on hésitait, pour le faire disparaître, entre une exécution sommaire5 et une détention perpétuelle, lorsque la mort du roi de France modifia brusquement la situation. Condé recouvra la liberté, et Antoine fut revêtu du titre à peu près illusoire de lieutenant-général du royaume, tandis que les Guises, en gens avisés, affectaient un simulacre de retraite. Alors commença le gouvernement direct de Catherine de Médicis, déclarée régente, au détriment d'Antoine, pendant la minorité de Charles IX.
La reine-mère arrivait au pouvoir sous les plus défavorables auspices. La conjuration d'Amboise, les troubles qui l'avaient précédée ou suivie dans diverses provinces, la rigueur de la répression, les ressentiments des calvinistes, le procès du prince de Condé et, plus encore peut-être, la déclaration qui le déchargea, le 13 mars 1561, des accusations portées contre lui, enfin, les tergiversations qui caractérisèrent, dès le début, la politique de Catherine, tout faisait pressentir de longs et funestes déchirements. Les actes du triumvirat formé par le connétable de Montmorency, François de Guise et le maréchal de Saint-André, la naissance du «tiers-parti» que personnifia le chancelier Michel de l'Hospital, les assemblées ou colloques de Pontoise et de Poissy, où les discours déguisèrent mal les passions, semblèrent pourtant devoir aboutir à une sorte de paix. Ce fut l'édit de tolérance du 17 janvier 1562, qui proclamait, non l'entière liberté du culte, mais une liberté de conscience relative. Il ne sortit de cet essai, dicté par l'Hospital, qu'une surexcitation générale et un antagonisme plus manifeste entre les croyants, surtout entre les partisans des deux religions. De là, de nouveaux troubles en Bourgogne, en Provence, en Guienne et en Bretagne; les excès de Montluc dans le sud-ouest, égalés tout au moins par les violences du baron des Adrets dans le midi; puis la sanglante querelle de Vassy, les émeutes de Sens, de Cahors, de Toulouse, la surprise de Rouen par les huguenots; et, pour dernier coup aux espérances de paix, l'éclatante prise d'armes de Condé et de Coligny, au moment où le roi de Navarre achevait de se rapprocher des catholiques, dans les rangs desquels nous le retrouverons bientôt. Le récit de tous ces désordres, de ces révolutions successives ou simultanées, n'entre pas dans le cadre de notre sujet. Revenons au héros de cette histoire, qui ne tardera pas à nous ramener lui-même au milieu des discordes civiles et des combats.
5
Appendice: III.