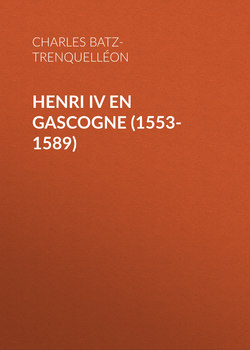Читать книгу Henri IV en Gascogne (1553-1589) - Charles de Batz-Trenquelléon - Страница 5
LIVRE PREMIER
(1553-1575)
CHAPITRE IV
ОглавлениеCatherine de Médicis entre les catholiques et les protestants. – Antoine de Bourbon retourne au catholicisme. – Ses querelles avec Jeanne d'Albret, résolûment calviniste. – Henri entre la messe et le prêche. – Réponse de la reine de Navarre à Catherine de Médicis. – Jeanne quitte la cour de France. – Lettre de Henri. – La guerre civile. – Le siège de Rouen. – Mort d'Antoine de Bourbon. – Jeanne d'Albret zélatrice de la Réforme. – Le monitoire de Pie IV contre la reine de Navarre, dont Charles IX prend la défense. – Jeanne ramène son fils en Béarn. – Le complot franco-espagnol contre Jeanne et ses enfants. – Catherine de Médicis ressaisit son «otage». – Voyage de la cour en France. – Charles IX dans le midi. – La prédiction de Nostradamus. – L'entrevue de Bayonne. – Le prince de Navarre devant l'ennemi héréditaire. – La cour à Nérac. – L'assemblée de Moulins. – Retour de Jeanne et de Henri en Béarn.
Antoine de Bourbon ayant accepté la lieutenance-générale du royaume, en échange de la régence, à laquelle il avait droit, fit venir à la cour sa femme et ses enfants. Le roi de Navarre et le prince de Condé passaient alors pour être les chefs du parti huguenot, et il pouvait sembler étrange que la reine mère, naguère inféodée aux Guises, chefs incontestés du parti catholique, se tournât ostensiblement du côté opposé. Elle révélait de la sorte son système de gouvernement, qui consista toujours, non seulement à diviser pour régner, comme on l'a dit si souvent, mais encore à réagir contre l'influence de ceux sur qui elle s'était appuyée, aussitôt que cette influence lui donnait de l'ombrage. Durant le règne de dix-huit mois de François II, elle avait senti et subi le joug mal dissimulé des Guises, et s'il n'entrait pas dans ses desseins de les frapper de disgrâce, elle jugea, du moins, que son intérêt lui commandait de relever quelque peu la fortune de leurs adversaires naturels, sans toutefois se livrer à ceux-ci. C'est ce qui explique l'espèce de faveur dont les réformés parurent jouir dès les premiers mois de sa régence. Elle avait, du reste, une arrière-pensée, qui se manifesta par la suite: c'était, au cas où les réformés ne s'amenderaient pas, de les priver de leurs chefs par la séduction ou par quelque mesure de rigueur arbitraire. La reine-mère ne manqua jamais de vues ni de finesses; seulement, ses vues étaient courtes, ses finesses trop multipliées, et, quoique travaillant toujours à concilier les partis qui assiégèrent si longtemps le pouvoir, elle ne réussit qu'à les précipiter tour à tour et tous ensemble sur le trône.
En appelant Jeanne d'Albret et ses enfants à la cour de France, Catherine comptait qu'il lui serait aisé, par quelques flatteries ou, au besoin, par quelques menaces, d'arrêter l'élan de la reine de Navarre vers la Réforme. Antoine, esprit flottant et circonvenu par des galanteries diplomatiques, semblait déjà prêt à combattre ses coreligionnaires de la veille; mais la reine de Navarre n'était pas une âme facile à pétrir: lentement gagnée aux doctrines de la Réforme, rien ne put l'en détacher. Dans son voyage de Pau à Paris, elle se montra ouvertement favorable aux calvinistes, partout où ils invoquèrent sa protection; en passant à Nérac, elle leur donna le couvent des Cordeliers; à Périgueux et en plusieurs autres villes, ils reçurent des marques de sa munificence et de sa sympathie. Quand elle arriva à la cour, elle était huguenote sans réserve et sans esprit de retour.
Une lutte pénible, qui eut ses jours de scandale et de funestes contre-coups dans l'esprit public, commença bientôt entre la reine de Navarre et son mari, manié par Catherine de Médicis et par les princes lorrains. On fut sur le point de décider Antoine à répudier sa femme pour épouser Marie Stuart, veuve de François II. Ce projet abandonné, on lui fit proposer, par les Espagnols, la cession de la Sardaigne, en échange de ses prétentions sur la Haute-Navarre, proposition qu'il finit par décliner aussi. On cherchait moins à le gagner qu'à le paralyser. On lui dicta tout un système de persécutions contre sa femme, qu'il s'efforça de ramener au catholicisme avec ses enfants, déjà calvinistes, sinon de cœur, du moins d'éducation. Le prince de Navarre, mêlé à ces querelles de famille, dont le sens politique lui échappait, reçut de son père l'ordre d'aller à la messe, et de sa mère, celui de s'en abstenir. A mesure que de nouveaux troubles éclataient dans les provinces au nom de la religion, cette lutte, qui était, au fond, celle de deux factions, arrivait à des éclats dont retentissait l'Europe entière. Assiégée de toutes parts, la reine de Navarre eut à défendre sa nouvelle foi contre Catherine de Médicis en personne. Un jour que la reine-mère s'évertuait à la convertir par des raisons tirées de l'intérêt politique: « – Madame, répondit Jeanne, si j'avais mon fils et tous les royaumes du monde dans la main, je les jetterais au fond de la mer plutôt que d'aller à la messe6!» Enfin, fatiguée des combats de toute sorte qu'on lui livrait, ne pouvant plus douter du parti pris d'Antoine de devenir l'épée des catholiques, après avoir été le champion des protestants, blessée, d'ailleurs, dans sa double dignité d'épouse et de mère, par le spectacle des dérèglements de son mari, la reine de Navarre reprit le chemin de ses Etats, laissant auprès de son fils le précepteur dont nous avons raconté la tâche heureusement accomplie. De cette séparation, qui devait être éternelle pour les deux époux, il existe un touchant souvenir: c'est la lettre suivante, écrite par le prince de Navarre, quelques jours après le départ de sa mère, et adressée à Nicolas de Grémonville, seigneur de Larchant, qui accompagnait la reine dans son voyage: «Larchant, écrivez-moi pour me mettre hors de peine de la reine ma mère; car j'ai si grande peur qu'il lui advienne mal de ce voyage où vous êtes, que le plus grand plaisir que l'on me puisse faire, c'est m'en mander souvent des nouvelles. Dieu vous veuille bien conduire en toute sûreté. Priant Dieu vous conserver. – De Paris, le vingt-deuxième jour de septembre (1562).»
Le départ de Jeanne ressembla fort à une fuite: la reine crut, non sans raison, qu'il y allait, pour elle, de la perte de sa couronne et de la ruine de ses enfants. «Je fermai mon cœur à la tendresse que je portais à mon mari, dit-elle dans une de ses lettres, pour l'ouvrir tout entier à mon devoir.» Sa résolution prise, elle se mit en route dans l'été de 1562, avec une suite nombreuse de gentilshommes protestants ou catholiques, à laquelle se joignit, en Guienne, une escorte béarnaise. On a prétendu, sans preuves, que ce déploiement de forces fut nécessité par les desseins hostiles d'Antoine de Bourbon: c'est une accusation que ne justifie pas la correspondance récemment publiée du roi et de la reine de Navarre. Il suffisait, d'ailleurs, pour motiver les précautions dont s'entoura cette princesse, des difficultés habituelles d'un long voyage, à cette époque de troubles et de violences. Arrivée en Guienne, elle trouva cette province en pleine guerre civile. Montluc, lieutenant d'Antoine de Bourbon, était aux prises avec les réformés. Jeanne séjourna quelque temps au château de Duras, puis au château de Caumont, où elle tomba malade. De là, elle se rendit en Béarn, après avoir vainement tenté de pacifier la Guienne et la Gascogne, à travers lesquelles Montluc promenait son impitoyable épée. Vers la fin du mois de novembre, Jeanne, devenue l'ennemie de la religion catholique, s'était déjà mise à l'œuvre pour la détruire au moins dans ses pays souverains, lorsqu'elle reçut la nouvelle de la mort d'Antoine de Bourbon.
Pendant que la reine de Navarre s'éloignait de la cour de France, les événements avaient suivi un cours rapide, l'ère des guerres civiles s'était rouverte au nord et au midi: l'armée royale dut reprendre Poitiers et Bourges aux protestants, vainqueurs à Saint-Gilles, dans le Bas-Languedoc, au moment où se concluait l'alliance de Condé et de Coligny avec l'Angleterre. Maîtres de Rouen depuis le 15 avril, les réformés s'y étaient fortifiés de deux mille mercenaires anglais. Assiégés par l'armée royale sous le commandement d'Antoine de Bourbon, de François de Guise et du connétable de Montmorency, ils ne furent forcés qu'après une vive résistance. Le roi de Navarre, blessé dans la tranchée, rendit sa blessure mortelle par toutes sortes d'imprudences, dont l'une, du moins, fut héroïque: il voulut entrer dans Rouen par la brèche, porté dans sa litière. Un mois après, il rendait le dernier soupir. C'était le 17 novembre 1562, deux jours avant la bataille de Dreux, et trois mois avant la mort de François de Guise, assassiné au siège d'Orléans. Brave et affable, mais d'un faible caractère, Antoine n'avait presque aucune des qualités nécessaires à un prince dans le temps où il vivait; il fut loin, toutefois, de mériter les injures dont le parti calviniste poursuivit sa mémoire7.
Après la mort de son mari, Jeanne d'Albret laissa encore quelque temps le prince de Navarre à la cour de France. Henri assista, le 17 août 1563, à la déclaration de majorité de Charles IX, faite à Rouen, en lit de justice. La reine de Navarre avait apparemment de graves motifs pour ajourner le retour de son fils: l'histoire ne les a pas pénétrés. Peut-être fut-elle obligée de s'incliner devant quelque refus de Charles IX ou de Catherine de Médicis; peut-être aussi ne voulut-elle pas que Henri assistât à la révolution qu'elle méditait: Jeanne s'était mise en tête de protestantiser son petit royaume. L'auteur du Château de Pau a résumé avec une parfaite mesure le rôle de réformatrice assumé par la reine de Navarre8.
Aussitôt après la mort de son mari, elle fit connaître son inflexible volonté de répandre partout les nouvelles doctrines. Son hostilité contre le catholicisme se manifestait jusque dans les actes de sa vie privée, jusque dans ses plaisirs: on la vit accueillir des œuvres de théâtre qui tournaient en dérision les prêtres et les sacrements. Elle assistait régulièrement au prêche, où, par une étrange tolérance des ministres, rapporte Pierre Mathieu, elle travaillait à des ouvrages de tapisserie, sans perdre, pour cela, un mot du sermon. Le jour de Pâques de l'année 1563, elle fit son abjuration à Pau, dans une cérémonie publique, et communia selon le rite calviniste. Enflammée de zèle, comme la plupart des néophytes, elle commença par interdire la procession de la Fête-Dieu. Cette atteinte portée à de pieux usages causa une irritation profonde parmi les catholiques béarnais; malgré la défense royale, ils firent leur procession traditionnelle dans les rues de Pau, et les huguenots s'étant ameutés, il s'ensuivit une sanglante mêlée. De réformatrice qu'elle s'était montrée dans l'origine, elle devint bientôt persécutrice, soit gratuitement, soit par représailles. En 1566, en 1569 et en 1571, elle rendit des ordonnances qui dépassaient de beaucoup l'intolérance reprochée par les calvinistes aux édits royaux. Dans le préambule de l'ordonnance de 1571, par exemple, Jeanne d'Albret déclare «que les rois sont tenus, non seulement d'établir parmi leurs sujets le fondement et la perfection de la doctrine du salut», mais «qu'ils doivent encore bannir du milieu d'eux le mensonge, l'erreur, la superstition et les autres abus…» Elle ajoute: «En quoi la reine désirant se prêter, satisfaisant, en même temps, aux vœux de son cœur et à ceux de ses sujets exprimés dans la supplication que viennent de lui présenter les Etats de son pays légitimement assemblés, voulant, en conséquence, procéder à l'extirpation des idolâtries et semblables abus qui ont régné dans son présent pays, pour y planter et rétablir la véritable religion chrétienne et réformée, déclare, veut, ordonne que tous ses sujets, de quelque qualité qu'ils soient, fassent profession publique de la confession solennelle de foi qu'elle présente». Les pénalités qu'édictait l'ordonnance étaient excessives: l'amende, la prison, le bannissement.
La reine de Navarre n'en était pas encore arrivée, en 1563, à ces violentes manifestations de l'esprit de secte, mais elle s'y acheminait, quand la cour de Rome, inquiète des bouleversements religieux qui s'accomplissaient en Béarn, la cita, au mois de septembre, devant le tribunal de l'inquisition. Jeanne devait comparaître dans un délai de six mois, sous peine, disait le monitoire, d'être déclarée «convaincue du crime d'hérésie, privée de la dignité royale, et son royaume et ses Etats adjugés au premier qui s'en saisirait». La cour de France ne pouvait arguer contre l'accusation d'hérésie formulée par le monitoire; «mais le roi très chrétien, dit Mézeray, jugeant de la conséquence, comme il le devait, en montra un très grand ressentiment…» Les ambassadeurs français à Rome reçurent l'ordre de faire au Pape des remontrances dont le texte offre de l'interêt, sous plusieurs rapports9. Ce document se terminait par une protestation formelle et une supplication au Saint-Père de vouloir bien, par acte public, révoquer la sentence fulminée contre la reine de Navarre. Pie IV, qui, au moment de son élévation, avait dit: «Il me faut la paix!» usa de prudence et de modération: la sentence fut annulée. Ce résultat produisit quelque attiédissement dans l'esprit de l'ardente Navarraise. Elle se rendit à la cour de France pour remercier Charles IX de l'avoir défendue, elle et ses Etats, contre les décrets pontificaux et les arrêts de déchéance des parlements de Toulouse et de Bordeaux. Elle retrouva son fils entre les mains dévouées de La Gaucherie, et, avec l'agrément du roi, le ramena avec elle en Béarn.
Lorsque Jeanne rentra dans ses Etats, le comte de Gramont, son lieutenant-général, était aux prises avec les mécontents catholiques, dont il eut raison. Elle réprima ce soulèvement, provoqué par ses hostilités contre la religion traditionnelle, mais sans la passion qu'elle devait apporter plus tard à la défense de ses droits ou de ses prétentions abusives. Cet orage passé, Jeanne paraît avoir gouverné avec sagesse. Ses actes sont inspirés par une vive sollicitude pour les intérêts du pays. Elle diminue les impôts, publie de bons règlements, établit une police bien entendue, reprend la tâche paternelle de Henri d'Albret. Quoique vouée, corps et âme, à la Réforme, qu'elle favorise publiquement, elle impose des bornes aux empiétements des ministres du nouveau culte: ses lettres-patentes du 28 mai 1564 refrènent leur zèle oppressif et interdisent toute espèce de contrainte pour le choix d'une religion. En même temps, elle s'occupait sans relâche de l'éducation de Henri et de sa sœur Catherine, noble devoir qui domina toujours ses préoccupations. Il y eut là, enfin, pour les membres de la famille royale et pour les Etats de Jeanne, une courte période de paix et de prospérité. Et, cependant, une étrange conspiration s'ourdissait, au loin, contre elle, sa Maison et son pays.
On a voulu faire remonter l'idée première de cette conspiration, niée par plusieurs historiens, aux jours qui suivirent la mort d'Antoine de Bourbon. A ce moment, a-t-on prétendu, les ennemis des Maisons de Bourbon et d'Albret, d'accord avec Philippe II et inspirés par François de Guise, auraient préparé un projet d'enlèvement de Jeanne d'Albret et de ses enfants, jugeant que, ce coup fait, il serait plus aisé de venir à bout des partisans français de la Réforme. On va même jusqu'à parler d'une armée rassemblée par Philippe II à Barcelone, et dont un corps léger, transporté secrètement à Tarragone, devait arriver à Pau par les montagnes. Là, aidés, au besoin, de Montluc et de quelques hauts affidés, les Espagnols eussent enlevé la famille royale pour la mettre au pouvoir de Philippe II. Un capitaine béarnais, nommé Dimanche, servait d'entremetteur aux conjurés. Tout était prêt, et il ne restait plus qu'à échanger les dernières instructions, lorsque François de Guise fut assassiné. Il y eut un temps d'arrêt. Reprise en 1563, la ténébreuse affaire échoua par un remarquable concours de circonstances: le capitaine Dimanche, tombé malade en Espagne, confia son secret à un valet de chambre de la reine Elisabeth, qui fit agir l'ambassadeur de France et prévenir la reine de Navarre10.
A la suite des explications que provoqua cette tentative, Catherine de Médicis, émue ou feignant de s'émouvoir des dangers qu'avaient courus Jeanne et ses enfants, insista auprès de la reine pour qu'elle lui confiât de nouveau le jeune prince, qui, placé directement sous la protection du roi de France, serait désormais à l'abri de semblables accidents. Le refus était difficile: Jeanne accéda au désir de la reine-mère, d'autant mieux qu'elle connaissait le projet de la cour de faire prochainement un voyage en France, et jusque dans les provinces méridionales. Henri retourna donc auprès du roi, et ce fut avec la cour qu'il partit de Fontainebleau pour ce voyage, dont l'histoire a noté l'influence considérable sur les événements politiques du règne de Charles IX. En l'ordonnant, Catherine obéissait à une double pensée: elle comptait assurer, dans une certaine mesure, l'exécution de l'édit d'Amboise, expédient inspiré par la mort du duc de Guise, en même temps qu'attirer les sympathies populaires sur la personne du jeune roi. L'édit d'Amboise, daté du 19 mars 1563, avait fait remettre l'épée au fourreau, mais non rétabli la paix dans les esprits. Il autorisait l'exercice du nouveau culte dans une ville par bailliage, dans quelques seigneuries et dans l'intérieur de chaque maison noble. A ce prix, les réformés rendaient les villes et les églises dont il s'étaient emparés. Exclus des charges publiques, comme précédemment, ils étaient amnistiés pour tous leurs actes antérieurs. Cet édit, œuvre ingénieuse du chancelier de l'Hospital, était considéré par les deux partis comme la préface d'une nouvelle politique, et Catherine eût bien voulu qu'il devînt la loi fondamentale de la paix définitive dont elle sentait le besoin.
Charles IX, en quittant Fontainebleau après un séjour de deux mois, se rendit à Sens, puis à Troyes, où il signa, le 11 avril 1564, avec l'Angleterre, un traité avantageux, par lequel furent atténuées quelques-unes des conséquences onéreuses de la paix de Cateau-Cambrésis. La cour fut retenue à Troyes par une chute du prince de Navarre. Catherine de Médicis écrivit à Jeanne d'Albret pour la rassurer sur les suites de cet accident et lui transmettre une invitation du roi. «Vous le trouverez (Henri) à votre contentement, disait-elle, car tous ceux qui le voient en sont bien contents, et le trouvent, comme il est, le plus joli enfant que l'on vît jamais. Je m'assure que vous ne le trouverez pas empiré en mes mains.» Jeanne joignit la cour à Lyon, et voyagea quelque temps avec elle; mais, arrivée dans le midi, la reine de Navarre, peu satisfaite de ce qu'elle voyait ou entendait, et d'ailleurs assez gravement atteinte dans sa santé, repartit pour ses Etats, en recommandant au jeune prince de visiter, sur son passage, tous les domaines de la couronne de Navarre. Suivant cet avis, il parcourut le comté de Foix, et séjourna à Pamiers et à Mazères, accompagné de ses gouverneurs et d'un nombreux cortège de gentilshommes.
Avant le séjour à Lyon, qui fut d'un mois, la cour avait visité Bar-le-Duc et la Lorraine, et Catherine, profitant du voisinage, avait entamé avec les princes allemands des négociations destinées, dans sa pensée, à les tenir à l'écart des mouvements calvinistes en France. Chassé de Lyon par la peste, Charles IX s'établit au château de Roussillon, en Dauphiné, d'où furent datés plusieurs actes de gouvernement et d'administration, tels que la destruction d'un grand nombre de citadelles élevées pendant la guerre civile, la fortification de diverses places, et la restriction, sur quelques points, des immunités accordées aux calvinistes par l'édit d'Amboise. Il reçut dans ce château la visite des ducs de Savoie et de Ferrare.
Après avoir visité le Dauphiné, surtout les contrées de cette province où la guerre civile avait laissé le plus de traces, le roi se rendit à Orange et à Avignon. Il donna audience, dans la ville pontificale, à un envoyé du Pape: le Saint-Siège et l'Italie sollicitaient, d'un commun accord, la cour de France de prendre contre l'hérésie des mesures sévères et décisives. Charles IX entrait et séjournait dans presque toutes les villes importantes. Il fut reçu à Aix, à Marseille, à Nîmes, à Montpellier, et il passa l'hiver à Carcassonne. Là, lui parvinrent les plaintes des calvinistes du Languedoc contre Damville-Montmorency, gouverneur de cette province, le même qui devait plus tard protéger et embrasser leur cause. En traversant la Provence, le prince de Navarre fut l'objet d'une curieuse prédiction du fameux Nostradamus. «Henri n'avait que dix à onze ans, rapporte P. de L'Estoile, et il était nommé prince de Navarre ou de Béarn, lorsqu'au retour du voyage de Bayonne, que le roi Charles IX fit en 1564, étant arrivé avec Sa Majesté à Salon du Crau, en Provence, où Nostradamus faisait sa demeure, celui-ci pria son gouverneur qu'il pût voir ce jeune prince. Le lendemain, le prince étant nu à son lever, dans le temps que l'on lui donnait sa chemise, Nostradamus fut introduit dans sa chambre; et, l'ayant contemplé assez longtemps, il dit au gouverneur qu'il aurait tout l'héritage. «Et si Dieu, ajouta-t-il, vous fait grâce de vivre jusque-là, vous aurez pour maître un roi de France et de Navarre.» Ce qui semblait lors incroyable est arrivé en nos jours: laquelle histoire prophétique le roi a depuis racontée fort souvent, même à la reine; y ajoutant par gausserie qu'à cause qu'on tardait trop à lui bailler la chemise, afin que Nostradamus pût le contempler à l'aise, il eut peur qu'on voulût lui donner le fouet.»
Le roi tint un lit de justice à Toulouse, le 1er février 1565, et séjourna longtemps dans cette ville. Il fit son entrée à Bordeaux le 9 avril, y tint un autre lit de justice et accorda aux Bordelais l'institution d'un tribunal consulaire semblable à celui de Paris. Les protestants de la Guienne profitèrent du passage de la cour pour se plaindre d'une ligue formée par le comte de Candale et favorisée par le maréchal de Bourdillon. Toute décision sur cette affaire fut ajournée: elle devait se lier, dans la pensée de la cour, aux entreprises de même nature que faisaient, en divers lieux, les catholiques, à l'imitation de l'association protestante. En passant à Mont-de-Marsan, Charles IX, dévoilant cette pensée, décida, en conseil, que toute prise d'armes non soumise à la volonté royale serait considérée comme un crime de lèse-majesté.
La cour, arrivée à Bayonne le 3 juin, s'y rencontra avec la reine Elisabeth, sœur de Charles IX, accompagnée du duc d'Albe. Philippe II avait accrédité ce personnage dominant pour influer sur les décisions qui pourraient être prises ou préparées dans l'entrevue des deux cours.
Les historiens se sont partagés en deux camps, au sujet de cette entrevue. Les calvinistes ont voulu y voir des négociations formelles tendant à l'extirpation violente de l'hérésie dans les Etats de France et d'Espagne, et qui auraient abouti à un traité secret, préliminaire de la Saint-Barthélemy. La plupart des écrivains catholiques des siècles précédents se sont élevés avec énergie contre cette interprétation; selon eux, les deux cours se rencontrèrent à Bayonne sans aucun but politique. Les mêmes divergences subsistent de nos jours, mais seulement chez les esprits voués aux thèses absolues. L'histoire digne de sa mission ne peut adopter ni l'ancienne version calviniste, ni la version contraire: des faits authentiques ont démenti celle-ci, et de celle-là les preuves manquent. Ajoutons que la vraisemblance témoigne contre l'une et l'autre.
La vérité, comme il arrive souvent, paraît être à égale distance des deux opinions extrêmes. L'entrevue de Bayonne ne pouvait être qu'essentiellement politique: il y fut question des vœux communs que faisaient les cours de France et d'Espagne pour la ruine ou l'abaissement d'un parti religieux et politique dont l'existence seule menaçait, à chaque instant, la paix dans les deux royaumes. Nul n'a vu le «traité secret», le «pacte de sang»; nul ne saurait mettre au jour un seul protocole, à plus forte raison, le texte d'un «projet arrêté»; mais il y eut certainement des velléités d'accord et de ligue, un échange de vues générales, de doléances et de paroles courroucées contre la Réforme: on n'a pas inventé les témoignages qui abondent sur ces divers points; François de la Noue, Pierre Mathieu, le duc de Nevers et de Thou sont dignes de foi quand ils les reproduisent, et tombent dans l'erreur seulement lorsqu'ils concluent. Le propos du duc d'Albe, entendu par le prince de Navarre, «qu'une tête de saumon vaut mieux que mille têtes de grenouilles», n'est qu'un propos, mais des plus caractéristiques. Il s'en tint bien d'autres de ce genre, on peut l'affirmer, et si, tous ensemble, ils ne suffisent pas pour inscrire une conjuration de plus dans l'histoire, pareillement ils démontrent l'inanité de la thèse qui refuse à l'entrevue de Bayonne tout caractère d'hostilité contre les protestants.
Le prince de Navarre, malgré son extrême jeunesse, ne passa pas inaperçu dans cette réunion des cours de France et d'Espagne. Jeanne était venue à Bordeaux visiter Charles IX et la reine-mère, et les prier de s'arrêter à Nérac, au retour de Bayonne. Elle avait pris des mesures pour que le prince de Navarre parût sur la frontière d'Espagne avec l'appareil qui convenait à son rang: il importait, selon elle, que l'héritier des débris du royaume de Navarre se montrât avec éclat, à côté du roi de France, devant les représentants de la nation ennemie. Une lettre de Henri, datée de Bazas, 8 mai 1565, porte les traces de cette maternelle et royale préoccupation: «Monsieur d'Espalungue, ayant délibéré de m'accompagner, au voyage de Bayonne, des plus notables et apparents gentilshommes que je pourrai aviser, je vous ai bien voulu avertir que, pour la bonne confiance que j'ai eue toute ma vie en vous, je vous ai choisi et élu pour me faire compagnie audit voyage».
Pendant les fêtes de Bayonne, qui durèrent dix-sept jours, le prince de Navarre, dit Favyn, «tint toujours son rang de premier prince du sang, magnifique en son train, splendide en son service, doux et agréable à tous, mais avec une telle majesté, qu'il était admiré des Français et redouté par les Espagnols, qui, en un âge si tendre de ce prince, jugeaient bien que cet aigle presserait, quelque jour, de ses serres leur lion, pour lui faire démordre son royaume de Navarre. C'est pourquoi le duc de Rio-Secco, ambassadeur de Philippe II, ayant considéré les actions de ce prince de plus près que les autres, dit ces paroles, qui furent depuis bien remarquées: «Ce prince est empereur ou le doit être. —Mi parece este principe o es imperador, o lo ha de ser.» Ce succès un peu théâtral répondit aux sollicitudes de Jeanne d'Albret et des gentilshommes béarnais dont elle avait formé le cortège de son fils; malheureusement, leur joie ne fut pas sans mélange: Charles IX, pour plaire à la reine sa sœur, consentit, en faveur de l'Espagne, au démembrement du diocèse de Bayonne, qui fut amoindri de tout le Guipuscoa.
La cour de France revint de Bayonne par Condom et Nérac. Jeanne d'Albret lui avait préparé une réception royale: il y eut quatre jours de gala11, pendant lesquels la reine de Navarre fut vivement sollicitée, mais en vain, de rentrer au giron de l'Eglise. Quelques historiens placent à cette époque sa hautaine réponse à Catherine de Médicis sur l'inflexibilité de ses nouvelles convictions religieuses. Elle dut, cependant, faire une importante concession. La liberté du culte catholique n'existait plus dans la capitale de l'Albret, et comme ce duché n'était pas un pays souverain, mais un fief, Jeanne, se rendant au vœu de Charles IX, leva son interdiction. Il fut convenu, en outre, que les magistrats municipaux seraient mi-partis, et Montluc, lieutenant-général en Guienne, reçut l'ordre de tenir la main à cet arrangement.
Après avoir quitté la Gascogne et la Guienne, Charles IX traversa Angoulême, Niort, Thouars, Angers, Tours, et il arriva à Blois à l'entrée de l'hiver. Il rapportait de ce long voyage beaucoup d'impressions pénibles et de souvenirs irritants. Frappé, de tous côtés, du spectacle des églises, des châteaux, des hameaux dévastés par les réformés, il en conçut contre eux, au rapport de Davila, une sorte d'aversion et de dégoût. Au mois de janvier 1566, la cour se rendit à Moulins, où le chancelier de l'Hospital avait convoqué, avec les personnages les plus considérables du royaume, les présidents de tous les parlements de France. Il s'agissait de réconcilier solennellement les Maisons de Guise et de Châtillon, de reviser l'édit d'Amboise, déjà modifié, et de discuter quelques projets de réforme judiciaire ou administrative préparés par le chancelier. La réconciliation eut lieu, et personne ne la tint pour sincère; les projets de réforme furent approuvés, en attendant que la guerre les rendît illusoires; quant à la révision de l'édit d'Amboise, elle occupa les esprits sans les apaiser.
Vers ce temps-là, Jeanne fut rappelée à la cour par diverses affaires, entre autres un procès qu'elle soutenait contre son beau-frère le cardinal de Bourbon, au sujet de ses domaines du Vendômois. Elle comprit bientôt, au premier aspect des choses, que la guerre allait sortir de tous les instruments de paix forgés sur le pupitre du chancelier. Elle avait laissé elle-même, dans ses Etats, des ferments de discorde qui lui inspiraient peu de confiance en l'avenir. D'un autre côté, le prince de Navarre touchait à un âge critique, et la cour des Valois n'était guère le lieu où se pût achever son éducation. Jeanne prit le parti de le ramener en Béarn. Ce fut presque un enlèvement, nécessité, il faut le dire, par la persistance de Catherine de Médicis à conserver son otage. Epiant le moment favorable, Jeanne, avec l'agrément de Charles IX, partit, accompagnée de son fils, pour ses domaines de Picardie, d'où elle passa dans le Vendômois, et de là en Anjou. De La Flèche, elle écrit au roi pour excuser son départ précipité, alléguant les troubles qui venaient d'éclater dans la Navarre; elle gagne le Poitou, traverse la Guienne et la Gascogne, et arrive à Pau. Son allégation au roi n'était que trop exacte: elle trouva une partie du Béarn soulevée, et il fallut, peu de temps après, recourir aux armes pour avoir raison de ces nouveaux désordres, provoqués, comme les précédents, par les dissensions religieuses.
6
Appendice: II.
7
Appendice: III.
8
Appendice: II.
9
Appendice: II.
10
Appendice: V.
11
Appendice: VI.