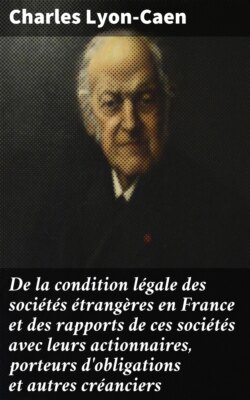Читать книгу De la condition légale des sociétés étrangères en France et des rapports de ces sociétés avec leurs actionnaires, porteurs d'obligations et autres créanciers - Charles Lyon-Caen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CONDITION LÉGALE DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES EN FRANCE AVANT LA LOI DU 30 MAI 1857.
Оглавление6. Droit reconnu aux sociétés étrangères en nom collectif et en commandite d’opérer en France.
7. Rejet d’une opinion récente, d’après laquelle les personnes morales n’auraient jamais d’existence en dehors du pays où elles se sont établies.
8. Décisions judiciaires et administratives consacrant le droit de ces deux classes de sociétés étrangères.
8 bis, 9, 10, 11, 12 Examen de la question de savoir si, dans les principes du droit international privé, une société anonyme étrangère autorisée dans son pays peut opérer et agir en France sans une autorisation du gouvernement français.
13, 14. Historique des décisions administratives et judiciaires rendues sur la question.
15. Arrêt de la cour de cassation de Belgique de 1849, refusant aux sociétés anonymes françaises non autorisées par le gouvernement belge d’agir dans ce pays. Origine de la loi du 30 mai 1857.
6. Avant la loi du 30 mai 1857, il ne paraît pas qu’on ait jamais tenté d’empêcher les sociétés en nom collectif ou en commandite étrangères d’opérer en France en leur qualité de personnes morales Elles étaient donc certainement investies du droit d’exercer en France leur commerce et d’y plaider, comme tout étranger, contre des Français, soit en demandant (art. 15 C. N.), soit en défendant (art. 14 C. N.), et elles étaient légitimement représentées dans leurs procès par leurs gérants.
Cette reconnaissance en France de l’existence des sociétés étrangères en commandite ou en nom collectif se déduit logiquement du principe de droit international selon lequel les lois relatives à l’état et à la capacité des personnes suivent les nationaux même à l’étranger (art. 3 C. N.). La loi qui reconnaît l’existence et la personnalité des sociétés est une loi personnelle par excellence, puisqu’elle crée en quelque sorte la personne morale elle-même. C’est l’idée que développe M. Félix (Traité de Droit international privé ; n° 31, édition Demangeat), quand il dit: «Par suite des principes
«que nous venons d’énoncer, les établissements
«publics ou personnes morales (moralische personen
«d’après la dénomination allemande) jouissent
«en pays étrangers des mêmes droits qui leur
«appartiennent dans le pays où ils ont leur siège
«ou domicile.»
7. On a cependant soutenu, dans ces derniers temps, une doctrine qui tendrait à faire refuser l’existence à toutes les personnes morales (et par conséquent à toutes les sociétés même en nom collectif ou en commandite) en dehors du pays dans lequel elles ont été créées.
Cette théorie a été défendue par M. Laurens, dans ses Principes de Droit civil, t. Ier. Il part de l’idée que les personnes morales ne sont pas des personnes véritables, qu’elles n’ont qu’une existence fictive et que, par suite, le nombre et l’étendue de leurs droits se déterminent par le but que le législateur a dû se proposer en les créant. Du moment où un droit ne leur serait pas absolument nécessaire pour atteindre ce but, il devrait leur être refusé. Ainsi, selon M. Laurens, les sociétés étrangères qui ont reçu du législateur de leur pays la qualité de personnes morales, ne l’ont obtenue que pour faire le commerce dans ce pays même. Elles doivent donc être privées de toute espèce de droits à l’étranger.
Ce système nouveau nous semble à la fois être inexact en lui-même et conduire à un arbitraire inévitable. Lorsque le législateur confère la personnalité à un établissement ou à une société, le sens le plus naturel de la concession nous paraît être que cette personne de création nouvelle aura tous les droits qui auraient pu appartenir à chacun des associés pris individuellement, en un mot qu’elle jouira de tous les droits dont jouit une personne ordinaire, lorsque le législateur ne lui en aura pas enlevé quelques-uns. (C’est ainsi que, par exemple, chez nous, les établissements d’utilité publique ne peuvent acquérir à titre gratuit qu’avec une autorisation de l’administration. Art. 910 C. N.).
L’opinion contraire conduit à l’arbitraire. On conçoit combien il est difficile parfois de déterminer d’une façon précise et certaine quel est le but dans lequel le législateur a créé une personne morale et surtout quels sont les droits dont la jouissance lui est indispensable pour atteindre ce but.
D’ailleurs, spécialement en ce qui touche les sociétés en nom collectif et en commandite, elles sont créées pour faire le commerce, et nous ne voyons aucun signe qui implique qu’il ne faut entendre par là que le commerce intérieur. Comme nous le dirons bientôt et comme on l’a fait déjà souvent observer, il y a des sociétés qui, sans les opérations qu’elles font avec des étrangers, ne pourraient pas vivre. Il serait bien singulier qu’en leur permettant d’exister, le législateur ait, par les restrictions apportées à leur liberté d’action, déposé en elles, pour ainsi dire, un germe de mort.
8. On ne rencontre cependant aucune décision judiciaire qui ait expressément consacré cette existence légale en France des sociétés étrangères en nom collectif et en commandite. Leur absence provient précisément de ce que leur droit d’agir en France n’a jamais été mis en doute.
Mais l’administration a eu plusieurs fois l’occasion de reconnaître cette doctrine. En 1820, notamment, le Ministre de l’Intérieur déclarait qu’une société anglaise (le Phénix) ne pouvait pas opérer en France sous une dénomination tirée de son objet (ce qui est l’un des caractères de la société anonyme), mais bien sous une raison de commerce contenant des noms d’associés (ce qui est l’un des caractères des sociétés en nom collectif et en commandite). Art. 20 et 23 C. de Com.
8 bis. Il en fut bien différemment des sociétés anonymes. Dès les premières années qui suivirent la promulgation du code de commerce, on contesta aux sociétés anonymes étrangères le droit d’exercer en France leur commerce ou d’y plaider, en soutenant qu’elles cessaient pour ainsi dire d’exister à la frontière française, si elles n’avaient pas reçu de notre gouvernement une autorisation spéciale, tout comme les sociétés anonymes constituées en France (art. 37 C. de Com.).
L’administration et la jurisprudence tranchèrent cette délicate question en sens opposés. La première refusa, dans toutes les occasions où elle eut à se prononcer, de reconnaître en France l’existence des sociétés anonymes étrangères. La seconde, au contraire, paraît avoir toujours admis qu’elles conservaient en France leur existence et leur personnalité, en leur permettant de plaider par l’intermédiaire de leurs administrateurs.
Avant de faire l’historique des principales décisions rendues sur la question jusqu’en 1857, recherchons quelle était, en l’absence de textes formels, la doctrine conforme aux principes du droit international privé. Cette question offre encore, comme nous l’avons déjà indiqué plus haut (n° 4), un véritable intérêt pratique. Car, il y a des sociétés anonymes étrangères qui restent régies en France par les mêmes règles qu’avant 1857 (voy. n° 60 et suiv.).
9. Quelques jurisconsultes prétendent que, d’après les principes purs du droit international (et par conséquent avant 1857, dans le silence de nos lois), les sociétés anonymes étrangères constituées légalement dans leur pays devaient être capables d’opérer et de plaider en France sans aucune autorisation du gouvernement français. Pour eux, la difficulté se résout par une règle élémentaire. La loi étrangère, disent-ils, qui donne en quelque sorte la vie aux sociétés anonymes est une loi personnelle. Ces sociétés ont une existence légale dans leur pays, puisqu’elles ont été autorisées par leur gouvernement; elles doivent, par cela même, pouvoir agir en France. Si on les assujétissait en outre à l’autorisation du gouvernement français, on violerait le principe du droit international qui fait suivre les nationaux par leurs lois personnelles même en dehors de leur pays. C’est assurément là un principe qu’on n’a jamais refusé d’appliquer aux personnes morales comme aux personnes physiques. Ce qui le prouve, c’est qu’on a toujours été unanime pour reconnaître le droit d’agir en France aux sociétés en commandite et en nom collectif. Bien plus, le conseil d’Etat, dans un avis du 12 janvier 1854, a déclaré que tout établissement d’utilité publique étranger constitue en France une personne civile et peut, comme telle, recevoir des dons et legs de biens meubles ou immeubles situés en France. Or, quel motif y a-t-il de faire une distinction entre les établissements d’utilité publique étrangers et les sociétés anonymes étrangères?
L’intérêt du commerce français lui-même serait compromis par la doctrine opposée. La chambre de commerce de Valenciennes l’indiquait clairement dans une lettre écrite au Ministre du Commerce le 20 décembre 1850. Elle observait que, si l’on refusait aux sociétés anonymes étrangères le droit d’opérer en France sans autorisation du gouvernement français, par représailles, dans les pays étrangers, on soumettrait nos sociétés anonymes aux mêmes restrictions. «Et alors», ajoutait cette Chambre de commerce, «si les marchés étrangers
«leur sont fermés, si elles sont condamnées à circonscrire
«le cercle de leurs affaires à l’intérieur,
«mieux vaudrait déchirer la loi qui les institue.»
D’ailleurs, on a fait remarquer que l’art. 37 du code de commerce, qui établit le principe de l’autorisation préalable, ne pouvait pas avoir songé aux sociétés anonymes étrangères. S’il y avait pensé pour faire dépendre leur existence en France de cette autorisation, il en aurait fait en réalité des sociétés anonymes françaises. Car qui aurait créé l’être moral? La loi française. Et que resterait-il d’étranger dans la société ? Des individus qui ne sont rien sans l’être moral.
Enfin, on ajoutait qu’on pourrait reprocher au système opposé de se mettre en contradiction complète avec l’esprit général de nos lois sur les étrangers. Elles se montrent si libérales à leur égard qu’elles leur concèdent presque tous les droits privés qui appartiennent aux Français, et elles auraient refusé aux sociétés anonymes étrangères l’existence elle-même!
10. Nous ne croyons point que telle fut la règle à suivre. Selon nous, avant 1857, l’autorisation du gouvernement français était indispensable aux sociétés anonymes étrangères pour qu’elles pussent agir et opérer en France en leur qualité de personnes morales. En le décidant ainsi, loin de méconnaître le principe de droit international selon lequel les lois personnelles suivent les étrangers en France, nous pensons en faire une saine application. Ce principe régit sans doute les personnes morales comme les individus. Et, comme nous l’avons reconnu, il en résulte que les sociétés étrangères ont en règle générale en France la personnalité que leur a conférée la loi de leur pays. (Voy. nos 6 et 7.)
Mais ce principe ne saurait avoir à l’égard des personnes morales une étendue qu’il n’a certainement pas à l’égard des personnes ordinaires.
En ce qui concerne les personnes étrangères proprement dites, les lois de leur pays cessent de pouvoir les régir en France, dès l’instant qu’elles se trouvent en conflit avec des lois d’ordre public françaises. Car les lois d’ordre public obligent même les étrangers (art. 3 C. N.) . Rien ne s’oppose donc, comme nous l’avons dit plus haut, à ce que les sociétés en nom collectif étrangères puissent agir en France. Mais on ne doit pas reconnaître de plein droit en France l’existence d’une personne morale créée à l’étranger toutes les fois que cette reconnaissance empêcherait l’application d’une loi d’ordre public. Or, c’est précisément là qu’on en serait arrivé si l’on avait admis sans autre condition que l’autorisation du gouvernement étranger l’existence et la capacité des sociétés anonymes en France. Il suffit, pour s’en convaincre, de se référer aux motifs qui avaient déterminé les rédacteurs du code de commerce à soumettre les sociétés anonymes à l’autorisation du gouvernement.
Cambacérès les résumait très-bien quand il disait : «L’ordre public est intéressé dans toute société
«qui se forme par actions, parce que, trop
«souvent, ces entreprises ne sont qu’un piège
«tendu à la crédulité des citoyens. Point de doute
«qu’une société qui travaille sur ses propres fonds
«n’ait pas besoin d’autorisation; mais si elle
«forme ses fonds par des actions émises sur la
«place, il faut bien que l’autorité supérieure examine
«la valeur de ses effets, et n’en permette le
«cours que lorsqu’elle est bien convaincue qu’ils
«ne cachent pas de surprise.» La loi qui soumettait les sociétés anonymes à l’autorisation du gouvernement était donc bien une de ces lois de sûreté ou d’ordre public qui obligent en France les étrangers comme les nationaux, alors même qu’elles ne sont pas conformes à leurs lois personnelles (art. 3 C. N.).
Mais on pourrait être tenté d’objecter que les sociétés anonymes étant dans la plupart des pays assujéties à l’autorisation, celle du gouvernement du pays où la société a son siège devait être pour nos nationaux une garantie suffisante. Cette objection n’est nullement décisive.
Les gouvernements étrangers peuvent se montrer trop faciles dans la concussion des autorisations, et on aurait pu redouter que, ces autorisations étant accordées à la légère, des sociétés étrangères n’ayant pas d’existence sérieuse vinssent, en opérant en France, engloutir une grande quantité de capitaux français.
Ce n’est pas seulement aux individus se mettant en rapport avec les sociétés étrangères que le système opposé aurait pu causer le préjudice le plus grave, c’est encore aux sociétés anonymes françaises. Il leur aurait fait une position moins avantageuse qu’aux sociétés étrangères, à raison de la facilité que parfois celles-ci auraient eue pour s’établir dans leurs pays.
Quant à l’avis du conseil d’Etat du 12 janvier 1854, qui reconnaît l’existence en France des établissements d’utilité publique étrangers, il ne nous semble pas complètement inconciliable avec notre doctrine. Nous avons dit que, selon nous, les personnes morales étrangères conservaient leur existence en France, à moins que cela pût être contraire aux principes de notre ordre public. Or, ces établissements n’offrent certes pas, pour les épargnes de nos nationaux, les mêmes dangers que les sociétés anonymes. En définitive, la seule crainte sérieuse qu’on puisse avoir à leur égard, c’est qu’ils fassent en France des acquisitions importantes et qu’ainsi une grande quantité de biens soient frappés d’immobilité. L’avis du conseil d’Etat indique très-justement lui-même la raison décisive qui doit faire écarter toute crainte de ce genre. Car, il déclare que l’application des dispositions de l’art. 910 C. Nap. ne saurait dépendre de la nationalité de l’établissement auquel une libéralité est faite, et qu’en conséquence les dons et legs faits au profit d’établissements publics étrangers ne peuvent avoir d’effet qu’autant qu’ils ont été autorisés par le gouvernement français.
11. Le refus qu’on devait faire avant 1857 à toutes les sociétés anonymes étrangères du droit d’agir et d’opérer en France ne pouvait pas toutefois conduire à des conséquences extrêmes. En définitive, ces sociétés se trouvaient dans une situation tout à fait analogue à celle des sociétés anonymes françaises non autorisées. Or, si ces sociétés n’existaient pas comme sociétés de droit, on reconnaissait, du moins en général, qu’on ne devait pas faire abstraction complète de leur existence et qu’elles devaient être traitées comme des sociétés de fait. Il n’y avait pas de raison pour ne pas traiter de la même manière les sociétés anonymes étrangères non autorisées en France.
12. Par quelles règles sont régies ces sociétés de fait? Sous quels rapports diffèrent-elles des véritables sociétés? Ce sont là des questions très-délicates que nous examinerons en détail à propos de la loi du 30 mai 1857 (voy. nos 63 et suiv.). Bornons-nous à dire pour le moment que, selon nous, les sociétés anonymes étrangères non autorisées ne pouvaient pas introduire de demandes en justice, mais rien ne les empêchait de plaider comme défenderesses devant nos tribunaux. Il serait en effet de la dernière iniquité qu’une société pût arguer de son irrégularité pour se soustraire à l’exécution de ses obligations.
13. L’administration, comme nous l’avons indiqué plus haut (n° 8), a toujours maintenu, depuis la promulgation du code de commerce jusqu’à la loi de 1857, la nécessité de son autorisation pour les sociétés anonymes étrangères. Les Ministres de l’Intérieur et du Commerce ont eu des occasions fréquentes de manifester et d’appliquer leur doctrine sur ce point.
Dès 1815, une société anglaise d’assurances contre l’incendie (le Phénix) se présentait. au Ministre de l’Intérieur pour faire des opérations en France. Celui-ci lui déclara que si elle voulait les faire comme société anonyme, il y avait lieu d’y mettre obstacle. En 1820, cette même compagnie ayant fait une concurrence préjudiciable à la compagnie française du même nom, le Ministre de l’Intérieur ordonna de s’opposer à toute apposition de plaques portant le nom de la compagnie anglaise.
Des décisions analogues furent rendues en 1833 et 1836. En 1837, la ville de Lyon avait conclu un projet de traité pour l’éclairage au gaz avec la Société impériale continentale établie à Londres. Le maire de cette ville demanda au Ministre de l’Intérieur si cette compagnie était autorisée en France, et, dans le cas où elle ne le serait pas, si le projet de traité serait néanmoins approuvé. Il fut répondu que, cette société n’étant pas autorisée, la ville de Lyon ne pouvait pas faire avec elle un traité, dont l’approbation ne serait pas possible.
14. Alors que l’administration maintenait rigoureusement le principe de l’autorisation préalable, les tribunaux français reconnaissaient l’existence légale des sociétés anonymes étrangères en les laissant plaider devant eux. La jurisprudence n’a pas varié sur ce point.
Les défendeurs français ne paraissent jamais avoir contesté le droit des sociétés anonymes étrangères d’agir en justice. Mais, d’un autre côté, jamais nos tribunaux ne se sont déclarés incompétents. Leur abstention à cet égard prouve manifestement qu’ils reconnaissaient l’existence légale des sociétés anonymes étrangères. Car, s’ils ne l’avaient point admise, leur incompétence eût été d’ordre public (voy. n° 10), et ils auraient dû la déclarer même d’office (art. 170 C. de Pr. civ. analog. ).
15. Si aucune difficulté ne s’est, jusqu’en 1857, présentée devant nos tribunaux relativement à l’existence légale des sociétés anonymes étrangères, il n’en a pas été de même en Belgique, bien que ce pays soit régi par notre code de commerce. Les tribunaux inférieurs y avaient rendu des décisions en sens divers. La cour de cassation de Belgique, après quelques variations, refusa définitivement, dans un arrêt rendu en 1847 toutes chambres réunies, aux sociétés anonymes françaises non pourvues d’autorisation en Belgique, le droit d’agir devant les tribunaux belges, parce qu’elles n’y avaient pas d’existence légale.
Cette jurisprudence émut vivement l’opinion publique en France. Les Chambres de commerce, effrayées des conséquences qu’elle pouvait avoir pour le commerce français, en relation continuelle avec la Belgique, prièrent le gouvernement d’intervenir pour régler d’une manière générale avec le gouvernement belge la situation légale des sociétés anonymes dans les deux pays. Les Belges, de leur côté craignant des représailles, firent la même demande à leur gouvernement.
Ces réclamations amenèrent entre la France et la Belgique une convention annexée au traité de commerce du 27 février 1854. D’après cette convention, le gouvernement belge s’engageait à présenter aux Chambres une loi ayant pour but d’habiliter les sociétés anonymes légalement constituées en France à exercer en Belgique tous leurs droits, à la charge seulement de réciprocité de la part de la France. C’est en exécution de cette convention que fut promulguée la loi belge du 14 mars 1855. Elle contient relativement aux sociétés anonymes françaises les dispositions suivantes:
Loi relative à la réciprocité internationale en matière de sociétés anonymes.
«ART. 1er. Les sociétés anonymes et autres associations, «commerciales, industrielles ou finan- «cières, qui sont soumises à l’autorisation du gouvernement «français, et qui l’auront obtenue, «pourront exercer leurs droits et ester en justice «en Belgique en se conformant aux lois du «royaume toutes les fois que les sociétés ou associations «légalement établies en Belgique jouiront «des mêmes droits en France.
. .............................
«ART. 3. Cette réciprocité sera constatée soit
«par les traités, soit par la production des lois ou
«actes propres à en établir l’existence.»
En présence de cette loi, nos sociétés anonymes crurent pouvoir agir en Belgique en toute sécurité. Elles pensaient n’avoir à fournir d’autre preuve de la réciprocité à laquelle leur droit était soumis, que la jurisprudence française invariablement favorable aux sociétés anonymes belges. Mais les tribunaux de Belgique ne l’entendirent point ainsi. Ils observèrent que la jurisprudence française pouvait changer et que la loi n’avait pas entendu fonder sur une réciprocité aussi mobile la situation légale des sociétés anonymes dans les deux pays.
Cette déclaration fit apercevoir au gouvernement français la nécessité de présenter au Corps législatif un projet de loi destiné à fixer la situation en France des sociétés belges et des sociétés étrangères en général. Ce projet est devenu la loi du 30 mai 1857, qui nous régit actuellement.