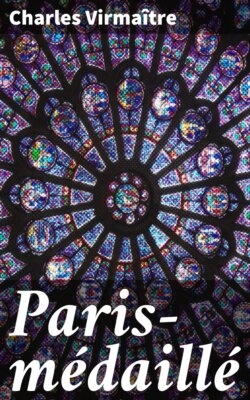Читать книгу Paris-médaillé - Charles Virmaître - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
Les corportions, jurandes et maîtrises. — La confrérie de Saint-Luc. — La première exposition libre. — La première Académie. — L’origine des expositions. — De 1663 à 1767. — Le premier jury, 1748. — Les premiers livrets, 1673. — La Révolution de 1793. — La Commune générale des arts. — Les divers Salons sous le Consulat, l’Empire, la Restauration et Louis-Philippe. — Le Salon de 1848. — Les premières médailles. — En 1871. — Beaucoup de bruit pour rien. — Une lettre de Gustave Courbet. — La fédération artistique. — Le Suffrage universel. — Décret de 1881. — Le Salon aux mains des artistes. — Le premier comité des 90. — Discours de M. Turquet.
L’IDÉE d’association remonte au moyen âge. De là naquirent les corporations, les jurandes, les maîtrises, qui, sous différents titres, étaient des sociétés de secours et d’encouragement; le compagnonnage, malheureusement disparu, a laissé des traces profondes dans les souvenirs des anciens.
Il était naturel que les artistes d’alors imitassent l’exemple des ouvriers des différents corps d’états; ils se groupèrent sous la protection de différentes sociétés. Malheureusement, toutes les choses excellentes en elles-mêmes deviennent mauvaises par l’abus d’autorité qu’en font les dirigeants; c’est pourquoi, plus tard, l’Académie de France se constitua pour lutter contre les abus et les prétentions excessives des confréries et des maîtrises.
Les conditions à remplir pour faire partie des confréries, corporations et maîtrises, étaient celles-ci:
Il fallait deux degrés pour arriver à la maîtrise:
1° Cinq années d’apprentissage;
2° Cinq années de compagnonnage.
La maîtrise s’obtenait au bout de dix ans, sur la présentation du chef-d’œuvre.
Les avantages retirés par les membres de ces associations étaient considérables.
Au point de vue individuel, les dix années d’apprentissage et de compagnonnage développaient toutes les facultés natives par un travail ininterrompu et une direction généralement intelligente.
Les chefs-d’œuvre conservés jusqu’à nos jours, principalement ceux de la corporation des orfèvres, témoignent de l’adresse, du goût et du génie des artisans formés par les corporations.
Chacun des membres de ces sociétés recueillait de l’association des avantages matériels, et, comme ces sociétés, les maîtrises avaient seules le droit d’exploiter le genre d’industrie qui leur était particulier; elles formaient une personne civile, avaient des biens mobiliers et immobiliers, contractaient, acquéraient et plaidaient.
De nos jours, certaines rues ont conservé le nom qui était affecté à ces corporations: la rue des Orfèvres, la rue des Marchands, la rue de la Lingerie, la rue de la Ferronnerie, etc.
Une de ces maîtrises, dont les membres étaient en grande partie des artistes, s’était formée en confrérie et avait pris pour patron Saint Luc.
Ce nom est spécialement, en Italie et dans les Flandres, le patron des corporations artistiques.
Cette confrérie se trouve, depuis 1748. mêlée intimement à l’histoire de l’ancienne Académie royale de peinture et de sculpture, et aussi à l’histoire des expositions.
La Confrérie de Saint-Luc, rivale naturelle de l’Académie royale en voie de formation, et qui, par conséquent, allait lui ôter une partie de ses privilèges, fit tous ses efforts pour empêcher la fondation de cette Académie, et, pour lutter contre elle, elle organisa des expositions.
En 1751. elle parvint à en ouvrir une; dans l’intervalle de vingt-trois ans, jusqu’en 1774, elle en eut sept,
Les Compagnons de Saint-Luc étaient seuls admis à faire figurer leurs ouvrages dans ces expositions, qui eurent un grand succès.
La Confrérie de Saint-Luc, quoique soutenue par de hautes protections, avait à sa charge tous les frais des dites expositions, frais qui étaient très lourds.
En 1776. les maîtrises, confréries et jurandes furent supprimées.
En 1648, plusieurs hommes de valeur, à la tête desquels était Lebrun, séduits par les résultats obtenus par les académies italiennes, conçurent l’idée de se grouper afin de résister aux prétentions sans cesse envahissantes des confréries et des maîtrises.
Ils obtinrent la protection du roi Louis XIV, qui leur donna l’autorisation de fonder une académie.
Cette forme particulière d’association devenait, par sa concentration, une réunion d’artistes plus choisie. Elle prospéra si bien, qu’on lui doit la plupart des grandes institutions en faveur des beaux-arts qui subsistent aujourd’hui: l’Ecole des Beaux-Arts et l’Ecole de France, à Rouen.
L’ancienne Académie royale a servi de modèle à toutes les académies d’art que l’Angleterre, l’Autriche, l’Espagne, la Russie, le Danube, en un mot, l’Europe entière, organisèrent au dix-huitième siècle, et dont la plupart sont encore prospères aujourd’hui.
Cette Académie était très libérale; elle était ouverte et accessible à tous les talents: elle acceptait même les étrangers.
Les expositions, leur origine, leur développement, sont intimement liés à l’existence des confréries et académies.
Pour étudier l’histoire des expositions, il faut remonter à l’Académie royale de peinture et de sculpture, fondée en 1648.
L’Académie royale avait, entre autres prérogatives, celle de faire les Salons.
L’idée de ces solennités remonte à 1663. Ce ne fut qu’en 1767 qu’elle se réalisa pour la première fois.
En 1748 apparaît, pour la première fois, un jury dont la mission était d’éliminer, après un examen attentif, les ouvrages qui lui semblaient inconvenants ou par trop faibles.
Ce jury était composé :
Du directeur de l’Académie,
De deux recteurs,
De deux adjoints,
De douze membres élus par les académiciens et pris parmi les professeurs et les conseillers de la Compagnie.
Ce jury ainsi constitué fonctionnait encore à la veille de la Révolution.
La durée des expositions était d’un mois; la date d’ouverture était variable; mais elle fut définitivement fixée par une flatterie délicate au 25 août, jour de la Saint-Louis, fête du roi, car c’était le roi qui faisait, sur sa cassette particulière, les frais des expositions, l’Académie, qui les supportait primitivement, n’ayant pu continuer à le faire.
Les livrets, dont l’origine remonte à 1673, se vendaient douze sols au profit de la Compagnie. Ces livrets n’avaient que quatre pages. (Voir à l’Appendice.)
Il n’était pas distribué de récompenses.
Les premiers Salons furent tenus tantôt au Louvre, dans le local affecté à l’Académie, tantôt au Palais-Royal.
A partir de 1737, ils occupèrent le salon carré du Louvre, où ils s’ouvrirent tous les deux ans; et même tous les ans, pendant plus d’un siècle.
Ce Salon était loin de présenter l’aspect opulent qu’il a de nos jours: il faut croire que son apparence était des plus misérables, si l’on s’en rapporte aux vers suivants qui circulaient alors dans Paris:
Il est au Louvre un galetas
Où, dans un calme solitaire,
Les chauves-souris et les rats,
Viennent tenir leur cour plénière;
C’est là qu’Apollon sur leurs pas,
Des Beaux-Arts ouvrant la barrière,
Tous les deux ans, tient ses Etats
Et vient placer son sanctuaire.
En 1776 eut lieu la première tentative d’exposition libre connue sous le nom d’Exposition du Colysée; c’était une manifestation posthume de l’Académie de Saint-Luc, qui venait d’être supprimée; elle eut un succès considérable, mais elle ne put être renouvelée, à cause de l’opposition qui se produisit de la part de l’Académie royale.
La Révolution ne se borna pas à bouleverser l’ordre politique, elle s’occupa aussi des artistes.
En 1791, l’Assemblée nationale admit tous les artistes, Français ou Etrangers, membres ou non de l’Académie, à exposer leurs ouvrages au Louvre.
Les quatre sections, Peinture, Sculpture, Gravure et Architecture, furent appelées à figurer pour la première fois dans les expositions.
Le ministre compétent fit les frais de ce Salon, comme de ceux qui suivirent.
Une très curieuse remarque: le Salon de 1793 fut formé des ouvrages exposés par les artistes qui composaient la Commune générale des Arts, c’est-à-dire par tous les artistes; nous verrons plus loin que les fils de 1871 ne firent qu’imiter leurs pères de 1793.
Le Salon de 1795 présentait cette nouveauté, c’est que, divisé par sections, dans chacune d’elles les ouvrages étaient classés par ordre alphabétique.
Les dessins exécutés d’après les grands maîtres furent réunis dans la section de la Gravure; il en fut de même qour les expositions qui suivirent jusqu’en 1798.
C’est au Salon de 1799 que les récompenses firent leur apparition, non point sous forme de médailles, mais les artistes dont les toiles avaient été appréciées furent honorés, comme distinction, de travaux d’encouragement.
Au Salon de 1800, il n’est pas question de récompenses officielles.
Pendant la période décennale de 1791 à 1800, les Salons dépendirent tantôt du ministère de l’Intérieur, tantôt du ministère de l’Instruction publique.
Tout s’y faisait administrativement; ils constituèrent les premières Expositions d’Etat et inaugurèrent le régime qui, avec différentes modifications, a prévalu-pendant de longues années.
Le Premier Consul, en 1803, donna à l’Institut le droit de diriger les expositions.
Sons l’Empire, de 1803 jusqu’en 1815, les récompenses commencèrent à être décernées à la fin de chaque Salon; c’est à cette époque que remonte le Prix décennal.
De 1815 à 1830, la Restauration, voulant équilibrer plus justement les influences dans le jury, à qui on reprochait de n’être pas suffisamment impartial, adjoignit à l’Institut un certain nombre d’administrateurs et d’amateurs choisis.
A cette époque, c’était l’administration qui décernait les récompenses.
Les médailles étaient divisées en trois classes.
Sous le règne de Louis-Philippe, de 1830 à 1847, les Salons devinrent annuels. Le jury était composé des quatre sections de l’Académie des Beaux-Arts: Peinture, Sculpture, Architecture et Gravure.
Sous la République de 1848, les premières bases des associations d’artistes furent jetées; mais devant des difficultés sans nombre, on dut y renoncer presque aussitôt.
Ledru-Rollin décida alors une exposition libre. 5181 ouvrages furent exposés; la commission de placement fut élue par les artistes; l’essai réussit mal; il y eut un mécontentement général; et l’opinion demanda le retour à un jury; c’est, du reste, à partir de 1848 que les médailles furent décernées par le jury.
. En 1850, nouvel essai. L’administration composa deux jurys: l’un pour l’admission et l’autre pour juger les œuvres dignes d’être récompensées. Ce système ne produisit pas grand’chose de bon, car en 1852 et 1858, elle dut équilibrer les deux influences en réservant moitié des voix aux artistes et moitié à l’administration.
En 1853, le Salon qui, jusque-là, s’était tenu au Louvre et aux Tuileries, eut lieu aux Menus-Plaisirs.
En 1855, le Salon eut lieu dans un bâtiment provisoire, avenue Montaigne.
En 1857, on rendit le Salon à l’Institut.
C’est depuis 1858 que l’exposition de Peinture, qui prit le nom de Salon, a lieu chaque année au Palais de l’Industrie, du 1er mai au 30 juin.
En 1864, l’Institut fut remplacé par un jury élu, pour les trois quarts, par les artistes; l’autre quart choisi par l’administration.
L’unité des médailles fut décidée.
C’est en 1870 que le ministère des Beaux-Arts fut créé.
Le jury fut alors exclusivement composé d’artistes élus par tous les exposants.
En 1871, sous la Commune, la Fédération des artistes voulait jouer un rôle politique; Courbet avait organisé des réunions à l’Ecole de Médecine pour préparer les élections; les élus voulurent siéger au Louvre, mais ils en furent empêchés par M. Barbet de Jouy, conservateur des Musées. Ils se réunissaient souvent et passaient leur temps à critiquer l’administration, tout en essayant de l’imiter. Ils discutaient des programmes, des règlements, nommaient des commissions, des sous-commissions, des quarts de commissions, des délégués, des sous-délégués; tout le monde voulait être quelque chose; Courbet voulait fonder un journal, l’Officiel des Arts.
Ce n’étaient pas des fonctions à l’œil; ils s’attribuaient des indemnités sous toutes les formes: tant par séance, tant par rapport, tant par délégation, tant pour frais de bureau et même pour des pains à cacheter. Courbet leur avait apporté 6,000 francs, mais cette somme avait été vivement engloutie; à l’entrée des troupes françaises dans Paris, il leur était dû une assez forte somme, que le gouvernement s’empressa de ne pas leur payer; il est juste de dire qu’ils ne songèrent pas à réclamer leurs jetons de présence.
En matière d’art, ils ne firent absolument rien que d’accoucher de cette théorie: que la Commune était, en matière d’art, le pouvoir exécutif, et la Fédération le pouvoir législatif.
On lit dans le Journal officiel de la Commune, du jeudi 6 avril 1871, l’appel suivant, adressé par Gustave Courbet, président des artistes, autorisé par la Commune; il les invitait à se réunir, le vendredi suivant, dans le bâtiment de l’Ecole de Médecine:
La revanche est prise, Paris a sauvé la France du déshonneur et de l’abaissement. Ah! Paris. Paris a compris, dans son génie, qu on ne pouvait combattre un ennemi attardé avec ses propres armes. Paris s’est mis sur son terrain, et l’ennemi sera vaincu comme il n’a pu nous vaincre. Aujourd’hui, Paris est libre et s’appartient, et la province est en servage. Quand la France fédérée pourra comprendre Paris, l’Europe sera sauvée.
Aujourd’hui, j’en appelle aux artistes, j’en appelle à leur intelligence, à leur sentiment, à leur reconnaissance. Paris les a nourris comme une mère, et leur a donné leur génie. Les artistes, à cette heure, doivent, par tous leurs efforts (c’est une dette d’honneur) concourir à la reconstitution de son état normal et au rétablissement des arts, qui sont sa fortune. Par conséquent, il est de toute urgence de rouvrir les Musées et de songer sérieusement à une exposition prochaine; que chacun, dès à présent, se mette à l’œuvre, et les artistes des nations amies répondront à notre appel.
La revanche est prise, le génie aura son essor; car les vrais Prussiens n’étaient pas ceux qui nous attaquaient d’abord. Ceux-là nous ont servi, en nous faisant mourir de faim physiquement, à reconquérir notre vie morale et à élever tout individu à la dignité humaine.
Ah! Paris, Paris, la grande ville, vient de secouer la poussière de toute féodalité. Les Prussiens les plus cruels, les exploiteurs du pauvre étaient à Versailles. La révolution est d’autant plus équitable qu’elle part du peuple. Ses apôtres sont ouvriers, son Christ a été Proudhon. Depuis dix-huit cents ans, les hommes de cœur mouraient en soupirant; mais le peuple héroïque de Paris vaincra les mistagogues et les tourmenteurs de Versailles; l’homme se gouvernera lui-même, la fédération sera comprise, et Paris aura la plus grande part de gloire que jamais l’Histoire ait enregistrée.
Aujourd’hui, je le répète, que chacun se mette à l’œuvre avec acharnement: c’est le devoir que nous avons tous vis-à-vis de nos frères soldats, ces héros qui meurent pour nous. Le bon droit est avec eux. Les criminels ont réservé leur courage pour la sainte cause.
Oui, chacun se livrant à son génie, sans entrave, Paris oubliera son importance, et la ville internationale européenne pourra offrir aux arts, à l’industrie, au commerce, aux transactions de toutes sortes, aux visiteurs. de tous pays, un ordre impérissable, l’ordre par les citoyens, qui ne pourra pas être interrompu par les ambitions monstrueuses de prétendants monstrueux.
Notre ère va commencer; coïncidence curieuse! c’est dimanche prochain le jour de Pâques: est-ce ce jour-là que notre résurrection aura lieu?
Adieu le vieux monde et sa diplomatie!
GUSTAVE COURBET
Voici les noms de la Fédération des artistes, élus au Louvre, le 17 avril 1871, tels qu’ils furent publiés dans le Journal officiel de la Commune, le 12 avril 1871:
FÉDÉRATION DES ARTISTES DE PARIS
PEINTRES
Bonvin.
Corot.
Courbet.
Daumier.
Durbec (Armand).
Dubois (Hippolyte).
Feyen-Perrin.
Gautier (Amand).
Glück.
Héreau (Jules).
Lançon.
Leroux (Eugène).
Manet (Edouard).
Millet (François).
Oulevay.
Picchio.
SCULPTEURS
Becquet.
Chapuy (Agénor).
Dalou.
Lagrange.
Lindeneher (Edouard).
Moreau-Vauthier.
Moulin (Hippolyte).
Ottin.
Poitevin.
Deblézer.
ARCHITECTES
Boileau fils.
Delbrouck.
Nicolle.
Oudinot (Achille).
Raulin.
GRAVEURS-LITHOGRAPHES
Bellenger (Georges).
Bracquemond.
Flameng.
Gill (André).
Huot.
Pothey.
ARTISTES INDUSTRIELS
Aubin (Emile).
Boudier.
Chabert.
Chesneau.
Fuzier.
Meyer.
Ottin fils.
Pottier (Eugène).
Reiber.
Riester.
Cette commission entra immédiatement en fonctions.
Le Salon qui devait régénérer l’art français n’eut pas lieu.
En 1872 et 1873, l’élection du jury fut confiée aux artistes récompensés; en 1879, on donna le droit d’élection à ceux qui avaient exposé trois fois.
En 1880, une mesure plus libérale fut appliquée aux artistes, car il suffit d’avoir exposé une fois au Salon, pour que l’artiste eùt le droit de voter.
Sur un vœu émis par le Conseil supérieur des Beaux-Arts, dans sa séance du 13 décembre 1.880, sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat du ministère des Beaux-Arts, le président du Conseil, Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, prit l’arrêté suivant:
ARTICLE 1er. — Les artistes Français, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, ayant été admis une fois à l’exposition annuelle des artistes vivants, sont convoqués pour le mercredi 12 janvier, à l’effet d’élire un Comité de 90 membres, qui réglera, D’ACCORD AVEC L’ADMINISTRATION DES BEAUX-ARTS, les conditions suivant lesquelles se fera l’exposition de 1881.
ART. 2. — Le Comité sera élu par section, au scrutin de liste, à la majorité relative des votants.
La première section, dite de peinture comprendra la peinture, le dessin, les pastels, aquarelles, émaux, cartons de vitraux et vitraux, et élira 50 membres.
La deuxième section, dite de sculpture, comprendra la sculpture, la gravures en médailles et sur pierres fines et élira 20 membres.
La troisième section, dite d’architecture, élira 10 membres.
La quatrième section, dite de gravure, comprendra la gravure et la lithographie, et élira 10 membres.
ART. 3. — Le scrutin ouvrira au Palais des Champs-Elysées, le mercredi 12 janvier, à 8 heures du matin et sera clos à 4 heures du soir.
Les artistes électeurs seront admis à voter sur la présentation de leur carte électorale et apposeront leur signature sur un registre spécial. Chacun déposera dans l’urne de sa section un bulletin portant le nom des membres choisis par lui.
Les électeurs qui, domiciliés hors de Paris, ou absents momentanément de cette ville, ne pourraient venir en personne voter au jour indiqué plus haut, pourront adresser par la poste, et jusqu’au 11 janvier, à M. le sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts, au Palais des Champs-Elysées, un pli cacheté signé d’eux, contenant leur carte électorale et leur bulletin de vote également cacheté.
Ces votes seront mentionnés sur le registre des électeurs.
ART. 4. — Le dépouillement du scrutin aura lieu le jour même du vote, à 4 heures du soir, après la clôture des urnes; il sera fait par des fonctionnaires de l’Administration des Beaux-Arts et en présence des artistes qui voudraient assister à cette opération.
En cas de non acceptation d’un ou de plusieurs des membres élus, ils seront remplacés par les membres qui viendront après dans l’ordre des suffrages.
ART. 5. — Le sous-secrétaire d’Etat au Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 27 décembre 1880.
JULES FERRY.
A la suite de ce décret, il fut procédé, le mercredi 12 janvier, à l’élection des membres du Comité des 90.
Il nous a paru intéressant de reproduire ces noms, qui empruntent une importance en raison des faits qui se passent aujourd’hui.
SECTION DE PEINTURE
50 membres à élire
MM. Bonnat. — Henner. — Puvis de Chavannes. — Jules Lefebvre. — J.-P. Laurens. — Harpignies. — Vollon. — J. Breton. — Carolus-Duran. — BASTIEN-LE-PAGE. — Busson. — Bouguereau. — Delaunay. — Barrias. — DE NEUVILLE. — CABANEL. — FEYEN-PERRIN. — BAUDRY. — Duez. — De Vuillefroy. — G. BOULANGER. — Ribot. — Roll. — Hannoteau. — Cormon. — Moreau. — Gervex. — Humbert. — Mazerolle. — LALANNE. — Guillemet. — Français. — Fantin-Latour. — Benjamin Constant. — PROTAIS. — Detaille. — Luminais. — Bin. — Emile Lévy. — Rapin. — Lansyer. — BONVIN. — BUTIN. — Cazin. — Van Marcke. — Lerolle. — GUILLAUMET. — Lavieille. — J. Dupré. — Henri Lévy.
MM. J. Breton, Delaunay, Baudry, Ribot, Guillaumet, n’ayant pas accepté , ont été remplacés par MM. Pelouse. — L.-O. Merson. — Bernier. — Pille. — T.-Robert Fleury.
M. L.-O. Merson, ayant refusé, a été remplacé par M. COT.
SCULPTURE
20 membres à élire
MM. P. Dubois. — Chapu. — Mercié. — Frémiet. — Falguière. — SCHŒNEWERK. — Math. Moreau. — Thomas. — HIOLLE. — Cavellier. — Guillaume. — Barrias. — Delaplanche, — Millet. — Degeorge. — Captier. — Dumont. — Galbrürmer. — Tony Noel. — Allar.
MM. Dumont, n’ayant pas accepté, fut remplacé par M. Iselin.
ARCHITECTURE
10 membres à élire
MM. Vaudremer. — Lisch. — BALLU. — Boeswilwald. — RUPRICH-ROBERT. — Baudot. — Ch. Garnier. — Bailly. — Coquart. — BRUNE.
GRAVURE ET LITHOGRAPHIE
10 membres à élire
MM. Jules Laurens. — Bracquemond. — Didier. — GAILLARD, — Laguillermie. — Gilbert. — Boilvin. — Rousseau. — Henriquel Dupont. — J. Robert .
M. Gaillard, n’ayant pas accepté, fut remplacé par M. Leveillé.
Le 17 janvier 1881, le Comité de 90 membres nommé par les artistes, se réunit pour la première fois au Palais de l’Industrie.
A l’ouverture de la séance, M. Edmond Turquet, sous-secrétaire d’Etat, lut la déclaration suivante; en remettant le Salon aux mains des artistes:
Le Conseil supérieur des Beaux-Arts, vous le savez déjà, reconnaissant la nécessité de rendre aux expositions officielles l’éclat et l’intérêt qu’on est en droit de leur demander, a émis le vœu que, dorénavant, ces expositions, comprenant la production choisie de plusieurs années, n’eussent lieu qu’à des dates éloignées.
Tout en s’efforçant d’assigner ses véritables limites à la haute protection que l’Etat peut exercer vis-à-vis de l’art, le Conseil ne pouvait oublier les intérêts des artistes, dont l’activité, chaque jour croissante, honore et enrichit notre pays. Ces intérêts, respectables et multiples, ne peuvent, on l’a reconnu, trouver leur satisfaction entière que dans les expositions annuelles, d’un accès plus facile. Le Conseil a donc pensé qu’il fallait maintenir le principe de ces expositions: mais il a en même temps reconnu que l’Etat n’avait pas à y intervenir directement, et que nul ne pouvait, aussi bien que les intéressés, les organiser au mieux de leurs intérêts. Il a proposé à M. le Ministre d’en offrir la gestion libre et complète, la gestion matérielle et pratique à tous les artistes français.
C’est pour donner suite à ce vœu que j’ai invité tous les artistes français, dont le nom est inscrit sur les livrets du Salon, à nommer un Comité de quatre-vingt-dix membres, et que je viens aujourd’hui vous confirmer, au nom de M. le Ministre, les pouvoirs qui vous sont donnés par l’élection de vos confrères.
La mission que vous avez à remplir est simple et précise. Vous avez à prendre en main la gestion libre et entière, matérielle et artistique des expositions annuelles, aux lieu et place de l’Administration. L’État n’interviendra plus dans vos affaires qu’à titre gracieux, si vous le désirez, par la cession temporaire d’un local, dans les conditions déjà faites à d’autres sociétés.
Vous aurez tous les bénéfices de l’entreprise; vous en aurez, comme il est juste aussi, toutes les charges. Les recettes seront encaissées par vous, les dépenses seront réglées par vous; vous serez seuls les maîtres de fixer le nombre et la valeur des récompenses que vous jugerez à propos de décerner au nom de votre association. S’il y a quelques difficultés dans une première organisation, elles sont moindres qu’on ne se l’imagine; en tous cas, ce ne sont point des difficultés de nature à effrayer une association qui compte dans son sein tant d’hommes supérieurs accoutumés à diriger des entreprises autrement longues et compliquées, ni à vous faire renoncer aux avantages considérables d’une liberté qui permettra à votre corporation de conquérir, en peu de temps, une situation aussi indépendante que celle dont jouissent déjà, grâce à des efforts pareils, la Société des Gens de lettres et la Société des Auteurs dramatiques.
Vous avez encore tout le temps nécessaire pour vous organiser, c’est-à-dire pour établir votre acte de société, choisir votre Conseil d’administration, former votre capital social, élaborer votre Règlement, nommer votre personnel. Il suffit que vous soyez prêts à agir le 1er février. Dès que vous m’aurez présenté vos propositions, je m’empresserai de les soumettre à M. le Ministre de l’Intruction publique et des Beaux-Arts, à M. le Ministre des Travaux publics et à M. le Ministre des Finances, qui auront, chacun en ce qui le concerne, à prendre les mesures nécessaires, et qui seront heureux, j’en suis assuré, de prêter leur concours le plus bienveillant à votre initiative. Je vous prie de me faire connaître les décisions que vous aurez prises le 31 janvier au plus tard.
Ai-je besoin d’ajouter que le concours de l’Administration, dans les questions d’un ordre général et élevé, vous fera d’ autant moins défaut, que son intervention n’aura plus à s’exercer dans des questions inférieures de détail? La franchise avec laquelle je vous parle doit vous être un sûr garant de l’intérêt que je vous porte.
Si l’État reprend sa liberté, en vous rendant la vôtre, ce n’est point pour se séparer de vous. Notre conviction profonde est que nous marcherons d’autant mieux d’accord que nous marcherons plus librement côte à côte, et que la dignité des artistes, aussi bien que celle de l’État, sera mieux sauvegardée par l’exacte définition de leurs rôles respectifs. Le soin de faire des acquisitions et des commandes utiles à nos musées et édifices publics, celui de désigner au Président de la République les artistes éminents qui méritent des récompenses honorifiques, nous parait une tâche assez honorable à remplir pour que nous n’en désirions pas d’autre.
Je suis d’ailleurs tout a fait rassuré sur l’issue ds vos délibérations par la composition de votre Comité. Le suffrage intelligent des artistes ne pouvait confier le soin de diriger leurs affaires à des maîtres plus respectés, ni à des plus dignes Confrères. Vos résolutions auront une gravité et une autorité qui s’imposeront à tous. L’expérience a suffisamment démontré qu’il n’y avait point de transaction possible entre la gestion complète par l’Etat ou la gestion libre par les artistes.