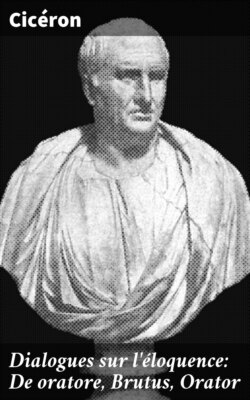Читать книгу Dialogues sur l'éloquence: De oratore, Brutus, Orator - Cicéron - Страница 5
LIVRE PREMIER.
ОглавлениеI.–Souvent dans mes réflexions, lorsque ma pensée se reporte aux temps anciens, combien, mon frère, je trouve heureux ces hommes .qui, dans un État bien constitué, illustrés par l’éclat d’un nom glorieux et celui que donnent les dignités, ont su également se ménager la sécurité dans les affaires et l’honneur dans le repos! Et moi aussi, j’espérais qu’un jour, délivré des fatigues infinies du barreau, de la poursuite des honneurs, arrivé au terme de mon ambition et commençant à vieillir, il n’y aurait alors personne qui n’approuvât ma retraite, et aussi de me voir reprendre ces nobles études que nous avons toujours aimées. Mais cet avenir où je dirigeais toutes mes pensées, les malheurs publics et les miens particuliers l’ont détruit; le temps qui m’annonait le plus de calme et de repos a été précisément celui où j’ai rencontré le plus d’orages et de tourments, et, trompé dans mes vœux les plus chers, je n’ai trouvé aucun loisir pour exhorter mes concitoyens à des études commencées par nous dès notre enfance, et que j’aurais été heureux de poursuivre avec vous. C’est qu’en effet mes premières années ont vu s’écrouler notre ancienne constitution, et, arrivé au consulat à une époque de luttes et de bouleversements, je n’ai pas tardé, en le quittant, d’être englouti par ces mêmes flots que j’avais repoussés loin de mon pays. Toutefois, en ces temps difficiles, et soumis à des épreuves pénibles, je n’en serai pas moins fidèle à nos études, réservant pour écrire les instants que je pourrai dérober aux attaques de mes ennemis, à la défense de mes amis et aux intérêts de la république. Quant à vous, mon frère, aucun de vos désirs ou de vos conseils ne sera par moi négligé ou repoussé; car il n’est personne qui ait su m’inspirer plus de confiance et d’affection.
II.–Or, je veux ici me rappeler un entretien dont le souvenir s’est un peu effacé de mon esprit, mais qui sera néanmoins suffisant à vous faire connaître l’opinion que nos orateurs les plus éloquents s’étaient formée de l’art oratoire. En effet, comme les premiers essais de notre jeunesse, (ces recueils imparfaits, inachevés), vous paraissent maintenant peu dignes de l’âge où nous sommes parvenus et de l’expérience que nous ont donnée des causes si variées, si importantes, vous désirez, (vous me l’avez dit souvent), que reprenant ces questions, je les soumette à une discussion moins aride et plus accomplie. Nos conversations m’ont également appris que vous différiez avec moi d’opinion sur ce sujet; car je soutiens que l’éloquence n’appartient qu’aux hommes les plus éclairés, et vous, au contraire, regardant le savoir comme lui étant superflu, vous la faites consister dans l’exercice d’une faculté naturelle.
Souvent aussi, lorsque je passe en revue les grands hommes, ceux dont le génie a excité en nous le plus d’admiration, il me semble curieux d’examiner pourquoi on en trouve un plus grand nombre d’éminents dans les autres arts que dans l’éloquence. En effet, quel que soit le genre que vous parcouriez, le plus simple comme le plus noble, ils offrent tous de nombreux modèles, et si le mérite des hommes supérieurs a pour mesure l’éclat ou les avantages qu’ont produits leurs actions, peut-on s’empêcher de convenir que le général l’emporte sur l’orateur. Cependant qui ne voit combien Rome seule a fourni de grands capitaines, lorsqu’à peine on y trouve quelques orateurs accomplis. D’un autre côté, notre époque, et encore plus celle de nos pères et de nos ancêtres, s’est montrée riche en citoyens capables de gouverner et d’administrer sagement et habilement la république, alors qu’il faut remonter des siècles pour trouver de bons orateurs, et qu’à peine il s’en présente un de tolérable par génération. Et si quelqu’un oppose que le talent de la parole a peu de rapport avec le mérite d’un général ou la prudence d’un sénateur, et qu’il vaudrait mieux le comparer à ces arts que l’on cultive dans la retraite et qui forment le domaine des lettres, qu’il çonsidère ces mêmes arts et remarque tous ceux qui s’y sont illustrés, il lui sera aisé de reconnaître combien ils ont toujours été en petit nombre.
III.–Vous n’ignorez pas, en effet, qu’au jugement des hommes les plus instruits, la philosophie, comme disent les Grecs, renferme en elle-même le germe et le développement des plus nobles études.–, Or, qui pourrait compter tous ceux qu’elle a rendus célèbres par leur savoir, l’étendue et la variété de leurs connaissances? car ce n’est pas seulement une partie de la science qui a borné leurs recherches; ils l’ont considérée dans son ensemble, et rien autant que possible n’est demeuré étranger à leurs discussions. Qui ne sait combien les matières que traitent les mathématiciens sont obscures; combien sont abstraites, infinies et subtiles leurs démonstrations? Or, tel est le nombre de ceux qui y ont excellé, que, pour réussir dans cet art, on dirait qu’il suffit d’y apporter une ardeur persévérante. Quel homme s’est jamais consacré entièrement à la musique et au genre d’érudition qui constitue la critique, sans être parvenu à posséder cette foule de connaissances, cette multitude presque infinie d’objets dont ces études se composent? Je ne crains pas de le soutenir: parmi tous ceux qui se sont appliqués aux lettres et à ces nobles exercices de l’esprit, la classe la moins nombreuse est celle des grands poètes, comme aussi dans cette même classe, où il est si rare de se montrer supérieur, comparez-vous avec soin ceux qu’ont produits Rome et la Grèce, vous trouverez encore plus de bons poètes que d’excellents orateurs; ce qui doit d’autant plus nous surprendre, que les inspirations des autres arts découlent d’une source plus mystérieuse, plus cachée, au lieu que l’éloquence, pour ainsi dire à découvert, à la portée de chacun, se rapproche des mœurs et de la langue commune: de sorte que si dans les autres genres on s’élève d’autant plus qu’on s’éloigne des sentiments et des idées du vulgaire, en fait de discours, le plus grand de tous les défauts serait de ne pas se conformer à la manière de parler ou de sentir du plus grand nombre.
IV.–Et qu’on ne dise pas que les autres arts ont été plus généralement cultivés; qu’ils présentent une étude plus agréable, des espérances plus brillantes, des récompenses plus encourageantes; car, sans parler d’Athènes, ce berceau de toutes les sciences, et où l’art de la parole a montré ses premiers essais et est arrivé à la perfection, à Rome même, il faut le reconnaître, quelle étude a jamais excité plus de passion que celle de l’éloquence? En effet, lorsque la conquête du monde fut achevée, et qu’une longue paix eut assuré du loisir aux esprits, tous les jeunes gens ambitieux de gloire n’eurent rien plus à cœur que d’apprendre à bien dire. D’abord étrangers à toute méthode, ne soupçonnant pas qu’il y eût un art de s’exercer à la parole, que cet art fût soumis à des lois, chacun alla aussi loin que le portait son génie ou la réflexion. Mais plus tard, lorsqu’ils eurent entendu les orateurs de la Grèce, étudié sa littérature, assisté aux leçons des rhéteurs, on ne peut se faire une idée de l’ardeur avec laquelle ils se livrèrent à l’étude de l’éloquence. Sans cesse animés par l’importance, la variété, la multitude des causes, ils voulaient joindre aux lumières qu’ils puisaient dans leurs études des leçons plus précieuses que tous les préceptes, celles que donne une pratique journalière; d’un autre côté, comme aujourd’hui, le zèle de l’orateur était soutenu par les encouragements les plus flatteurs, la considération, la fortune, les dignités; et à l’égard du génie, mille preuves font foi que nos Romains l’emportent sur toutes les autres nations. Cela étant, qui pourrait ne pas s’étonner qu’à parcourir les générations et les époques de chaque peuple on y rencontre si peu d’orateurs; mais peut-être que l’éloquence est quelque chose de plus difficile qu’on ne pense, et suppose la réunion d’un grand nombre de talents et d’études.
V.–Le moyen, en effet, au milieu de cette foule innombrable de disciples doués de facultés supérieures, de ces maîtres si recommandables par leur savoir, de ces causes si multipliées, de ces triomphes réservés à l’éloquence, le moyen, dis-je, de trouver à ce petit nombre d’orateurs une autre raison que la difficulté et la grandeur presque infinie de l’art lui-même. C’est que l’éloquence a besoin d’acquérir l’intelligence d’une multitude de choses, sans quoi elle n’est qu’un vain flux de paroles digne de moquerie; il lui faut dans la composition du discours choisir les termes, et en étudier l’arrangement; il lui faut connaître à fond les différentes passions que la nature a mises dans le cœur de l’homme: car tous les efforts, toute la puissance de celui qui parle doit s’appliquer à calmer ou à émouvoir l’âme de celui qui écoute; outre cela, il lui faut posséder la grâce, l’enjouement, l’élégance d’un homme bien né, la promptitude et la précision dans la réplique ou dans l’attaque, jointes à la délicatesse et à l’urbanité. L’orateur doit s’armer encore de la connaissance de l’antiquité et de l’autorité des exemples; il ne doit pas non plus négliger l’étude des lois et du droit civil. Parlerai-je de tout ce qui se rapporte à l’action, laquelle comprend les mouvements du corps, le geste, le regard, l’émission et les inflexions de la voix, toutes choses dont l’art frivole du comédien peut nous faire comprendre la difficulté. En effet, les acteurs passent leur vie à former leur voix, à composer leurs traits et leurs gestes; et cependant combien il en est peu dont nous soyons satisfaits. Que dirai-je de la mémoire, ce trésor de toutes nos connaissances? et ne voyez-vous pas que si elle ne tient en réserve les pensées et les expressions de l’orateur, ses plus belles inspirations doivent périr. Cessons donc de nous étonner qu’il y ait si peu d’hommes éloquents, lorsque l’éloquence résulte d’un ensemble de qualités dont chacune en particulier ne s’acquiert qu’à grand peine, et exhortons plutôt nos enfants et ceux dont la gloire et l’avenir nous intéressent à bien se pénétrer de la grandeur de cetart, comme aussi à se persuader qu’aux méthodes, aux maîtres et aux exercices, dont ils se contentent maintenant, il faut ajouter encore quelque chose s’ils veulent parvenir au but qu’ils se proposent.
VI.–Suivant moi, personne ne pourra devenir un orateur parfait s’il ne possède les connaissances les plus étendues; car c’est l’intelligence des choses qui développe et nourrit le discours; et l’orateur n’a-t-il de son sujet qu’une idée vague et superficielle, sa parole n’est plus qu’un vain et puéril étalage de mots. Je n’irai pas toutefois jusqu’à prétendre que les orateurs, les nôtres surtout, au milieu des occupations qu’entraîne la vie publique ou privée, ne doivent rien ignorer, bien que le nom qu’ils portent, et l’art de la parole dont ils font profession, semblent annoncer la prétention de parler avec agrément et abondance sur tous les sujets qui leur seront proposés. Je ne doute pas qu’une pareille obligation ne parût au plus grand nombre d’une étendue excessive. D’un autre côté, voyant que les Grecs, malgré leur génie, leur savoir et leur passion pour cette étude, ont établi des divisions et reconnu des genres, (un seul homme chez eux ne les embrassait pas tous, et, dans le partage qu’ils ont fait du domaine de l’éloquence, ils ont réservé à l’orateur les causes judiciaires et les harangues délibératives), je n’irai pas dans ce livre au-delà des limites que les meilleurs esprits, après y avoir longtemps réfléchi, se sont presque tous accordés à reconnaître à mon sujet; et, sans remonter à ces préceptes élémentaires dont on occupait notre enfance, j’exposerai ceux qu’on m’a dit avoir été un jour discutés en conversation par les plus illustres de nos Romains en éloquence et en dignités. Je ne méprise point les enseignements que nous ont laissés les rhéteurs grecs; mais leurs ouvrages sont à la disposition et à la connaissance de tout le monde, et un commentaire de ma part ne pourrait leur donner plus d’élégance ou de clarté; souffrez donc, mon frère, que je préfère à l’autorité des Grecs celle d’orateurs que les suffrages de nos concitoyens ont placés au premier rang dans l’art de bien dire. "’–
VII.–Or, dans le temps que le consul Philippe attaquait le plus violemment les patriciens, et que le tribun Drusus, institué en faveur du sénat, semblait mollir et reculer, (je me rappelle l’avoir entendu dire à Cotta, ) Crassus, pendant les jours consacrés aux jeunes romains était venu prendre quelque repos à Tusculum en compagnie de Scévola, son beau-père, et de M. Antoine, lié avec lui par les doubles liens de la politique et de l’amitié. Crassus avait encore engagé à le suivre deux jeunes gens sur qui les anciens du sénat comptaient beaucoup pour la défense de leur autorité: l’un était Cotta, briguant alors la charge de tribun du peuple, et l’autre P. Sulpicius, que l’on supposait la demander après lui. Le premier jour ils ne s’entretinrent que du sujet de leur réunion, des événements actuels de la république, en général; et leur conversation se prolongea jusqu’à la nuit. Cotta ajoutait que, pendant leur entretien, ces trois illustres consulaires avaient échangé les réflexions les plus tristes et les plus vraies; si bien que depuis aucun malheur n’était survenu dans l’État qu’ils ne l’eussent prévu; mais qu’une fois l’entretien terminé, ayant pris le bain, et s’étant mis à table, Crassus s’y montra si poli, d’un esprit si enjoué, d’une plaisanterie si aimable, qu’ils eurent bien vite oublié ce que leur conversation précédente avait de trop sévère, et que, si le jour qu’ils venaient de passer avait été digne du sénat, le repas l’avait été de Tusculum.
Le lendemain, lorsque les plus âgés eurent pris assez de repos, et qu’on fut descendu au jardin, après un ou deux tours d’allée, Scévola, selon Cotta, aurait dit:–«Pourquoi ne faisons-nous, Crassus, comme Socrate dans le Phèdre de Platon; votre platane m’y fait songer, et ses branches touffues me paraissent aussi propres à ombrager ce réduit que celles qui couvrirent Socrate, et dont l’imagination de Platon a, ce me semble, étendu les feuilles autant que le ruisseau qu’il décrit. Or, si Socrate, qui ne craignait pas la fatigue, s’est couché sur l’herbe pour faire entendre des discours que les philosophes prétendent lui avoir été inspirés par lès dieux, je puis bien réclamer le même privilége.–Sans doute, dit Crassus, et même vous serez plus commodément.» Puis, ayant fait apporter des coussins, chacun s’assit sur les bancs qui entouraient le platane.
VIII.–Ce fut là, Cotta me l’a souvent raconté, que, pour chasser entièrement de leur esprit les préoccupations de la veille, Crassus fit tomber la conversation sur l’éloquence. Or, ayant commencé par dire que Sulpicius et Cotta n’avaient plus besoin d’être encouragés, mais qu’on leur devait plutôt des éloges, puisqu’ils étaient parvenus-non seulement à dépasser les jeunes gens de leur âge, mais à se faire comparer aux anciens: «Pour moi, ajouta-t-il, rien ne me semble plus beau que de pouvoir par la parole retenir les hommes assemblés, charmer les esprits, soulever ou apaiser à son gré les passions. Chez tous les peuples libres, et principalement dans les États calmes et prospères, cet art surtout a toujours été honoré et puissant. Qu’y a-t-il, en effet, de plus digne d’admiration que de voir un mortel privilégié s’élever au-dessus de la foule des hommes, et user seul ou avec quelques autres d’une faculté que la nature a donnée à tous! Quoi de plus agréable que de lire ou d’entendre un discours riche et brillant de pensées solides, d’expressions choisies! Quelle puissance, quelle autorité plus manifeste que de commander par son éloquence aux entraînements du peuple, à la conscience du juge, à la majesté du sénat! Est il rien aussi de plus grand, de plus généreux, de plus royal, que de secourir les malheureux, de protéger les opprimés, d’arracher ses concitoyens à la mort, à l’exil? Et encore est-il rien de plus nécessaire que d’être toujours armé pour se défendre soi-même, attaquer les méchants ou se venger de leurs outrages? D’un autre côté, pour ne pas toujours nous occuper du barreau, de la tribune et du sénat, quel délassement plus doux, plus digne de l’homme, qu’une conversation aimable et polie! Car, si notre seul ou principal avantage sur les animaux est de pouvoir converser avec nos semblables et leur communiquer nos pensées, ne devons-nous pas cultiver cette admirable faculté, et nous efforcer de nous montrer supérieurs à l’égard des autres hommes dans cela même qui fait notre supériorité sur les animaux? Enfin, pour mettre un terme à ces réflexions, quelle autre force a pu réunir dans un même lieu les hommes dispersés, les faire passer de leur vie libre et sauvage à l’état social et civilisé, et, la société une fois établie, proclamer les conventions, les lois, les jugements?
«Je ne veux pas entrer dans des détails qui seraient infinis. Je dirai donc, en peu de mots, que du talent et des lumières d’un grand orateur dépendent non-seulement sa propre gloire, mais le salut d’une foule de citoyens et de l’Etat tout entier. C’est pourquoi, jeunes gens, persévérez dans vos efforts, et redoublez d’ardeur pour un art qui peut vous rendre illustres, précieux à vos amis et nécessaire même à la république.»
IX.–Scévola reprit alors avec sa politesse accoutumée: «Je suis tout disposé à confirmer l’opinion de Crassus; car je ne veux déprécier ni la gloire de mon beau-père ni le talent de mon gendre. Mais il est deux points, Crassus, sur lesquels, je le crains, nous ne pourrons nous accorder: l’un, que les orateurs ont fondé et conservé les Etats; l’autre, que même loin du barreau, de la tribune et du sénat, ils doivent posséder tout ce qui peut être un sujet de discours et se rapporter à la société.
» Comment, en effet, croire avec vous qu’autrefois les hommes dispersés dans les bois et dans les montagnes sont venus se renfermer dans l’enceinte des villes, moins entraînés par la force de la raison que séduits par le charme d’un beau discours, ou bien que ce sont les paroles d’un orateur disert, plutôt que le génie des sages et des héros, qui ont servi à fonder et à conserver les empires. Lorsque Romulus rassembla des pâtres et des aventuriers, qu’il conclut les mariages avec les Sabins, qu’il repoussa les attaques des peuplades voisines, pensez-vous que lout cela fut l’œuvre de son éloquence, ou de sa raison et de vues supérieures? Et Numa, et Tullius, et les autres rois à qui Rome est redevable de tant de précieuses institutions, est-ce que vous trouvez en eux la moindre trace d’éloquence? On sait que ce fut par la force de son âme, et non par celle de la parole, que Brutus parvint à chasser les rois. Depuis cette révolution, je vois partout présider la sagesse, et l’éloquence nulle part. Si je voulais puiser des exemples dans nos annales et celles des autres peuples, il me serait facile de prouver que les plus grands orateurs ont été plus funestes qu’utiles à leur patrie; mais, laissant de côté tous les outres, je ne parlerai que des Gracques, les deux hommes,– vous Crassus et Antoine exceptés,–les plus éloquents que j’aie entendus. Leur père, homme de rien et éclairé, mais sans aucun talent de parole, rendit en maintes circonstances, et surtout comme consul, les plus grands services à l’Etat. D’un mot et d’un geste, dédaignant les apprêts d’un discours étudié, il fil incorporer les affranchis dans les tribus; et sans cette mesure la république, que nous avons aujourd’hui tant de peine à soutenir, aurait depuis long-temps cessé d’exister. Mais ses fils, hommes liserts, riches de toutes les qualités dont l’art et la nature peuvent douer l’orateur, avec celle éloquence lui selon vous gouverne si bien les Etats, précipirèrent dans le désordre cette république que la sagesse de leur père et les armes de leur aïeul avaient rendue si florissante.
X.–» Eh quoi! nos anciennes lois, les coutumes de nos ancêtres, les auspices auxquels vous et moi, Crassus, nous présidons pour le salut de Rome, les cérémonies de la religion, le droit civil, que notre famille a toujours cultivé sans aucune prétention à l’éloquence, tout cela a-t il été inventé par les orateurs? l’ont-ils connu, l’ont-ils même étudié? Je me souviens d’avoir vu S. Galba, dont on admirait l’éloquence, M. Émilius Porcina, et C. Carbon, que jeune encore vous avez combattu avec succès, tous trois ignoraient les lois, connaissaient imparfaitement les coutumes de nos ancêtres, et n’avaient aucune idée du droit civil. Enfin, le dirai-je, excepté vous, Crassus, qui pour obéir à un goût particulier, et non pour remplir une des conditions de l’éloquence, avez appris de moi le droit civil, tout le monde est sur cette matière d’une ignorance dont je rougis pour notre époque.
«Quant à votre dernière prétention, que l’orateur peut s’exprimer avec abondance n’importe sur quel sujet, si nous n’étions pas ici dans votre domaine, je la combattrais; je me mettrais à la tête de nombreux opposants, qui solliciteraient contre vous l’interdict du préteur pour avoir usurpé si témérairement la propriété d’autrui. Tous les disciples de Pythagore et de Démocrite, tous les philosophes qui étudient la nature, et dont le langage est aussi orné que substantiel, vous prendraient à partie, et vous n’auriez pas avec eux gain de cause. Pressé ensuite par toutes les sectes ’de philosophes qui reconnaissent Socrate pour leur maître et leur guide, vous seriez obligé de convenir que vous n’avez rien étudié, que vous n’avez rien appris, que vous ne savez rien de ce qui concerne les vrais biens et les vrais maux, les passions, les mœurs, la conduite de la vie. Ainsi les académiciens, en vous pressant, vous amèneraient à nier ce que d’abord vous auriez affirmé. Nos stoïciens vous prendraient au piége de leurs questions et de leurs raisonnements. Les péripatéticiens vous feraient avouer que vous êtes obligé de leur emprunter ce que vous pensiez n’appartenir qu’à l’orateur, l’agrément et la force du discours, et vous prouveraient qu’Aristote et Théophraste ont beaucoup mieux et beaucoup plus écrit sur la rhétorique que tous les rhéteurs de profession. Je laisse de côté les mathématiciens, les grammairiens, les musiciens; ils n’ont rien de commun avec vous. Cessez donc, Crassus, de vous montrer si exigeant envers l’orateur; car c’est un assez beau privilége que de pouvoir au barreau faire paraître votre cause la meilleure et la plus juste, au sénat et dans les assemblées votre opinion la plus salutaire, de faire en un mot, aux habiles admirer les ressources de votre esprit, aux ignorants la solidité de vos raisons; que si vous allez au-delà, Crassus, une telle puissance ne sera plus celle de l’orateur, mais la vôtre, et l’effet d’un talent qui n’appartient qu’à vous.
–. XI.–«Je n’ignore pas, Scévola, reprit Crassus, que ces questions sont un sujet fréquent de controverse parmi les Grecs. En effet, à mon retour de Macédoine, où j’avais été questeur, passant à Athènes, j’y entendis les plus habiles philosophes; c’était, disait-on, une des belles époquesde l’Académie: Charmadas y dominait avec Eschine et Clitomaque; Métrodore s’y faisait aussi remarquer, comme eux, disciple zélé de cet illustre Carnéadcs, l’homme qu’ils admiraient le plus pour l’abondance et l’énergie; Mnéséarque, qui avait eu pour maître votre Panétius, et Diodore, disciple du péripatéticien Critolaüs, y jouissaient d’une grande renommée. On y voyait encore plusieurs célèbres philosophes. Tous d’un commun accord excluaient l’orateur du gouvernement des Etats, lui interdisaient toute science, toute connaissance un peu élevée, et, le renvoyant aux assemblées et au barreau, semblaient l’y confiner comme en une étroite prison; mais j’étais loin de partager leur sentiment, non plus que celui de Platon, qui le premier a soulevé cette polémique et l’a soutenue avec le plus de force et d’éloquence. Pendant mon séjour à Athènes, Charmadas et moi nous lûmes attentivement son Gorgias, et ce qui me frappait le plus dans ce livre, était de voir que tout en se moquant des orateurs, Platon se montre lui-même très-grand orateur. Il y a long-temps, en effet, que ces querelles de mots servent d’aliments aux disputes des Grecs, plus amoureux de la controverse que de la vérité.
«Car, même en réduisant les fonctions de l’orateur à parler avec abondance au barreau, devant le peuple ou au sénat, on est encore obligé de lui accorder une infinité de connaissances. Que si, en effet, il n’a long-temps étudié les affaires publiques; s’il ne connaît ni les lois, ni la morale, ni le droit civil; s’il ne comprend la nature et les passions de l’homme, comment voulez-vous qu’il se montre habile à traiter ces matières? Et s’il possède ces connaissances, sans lesquelles, même dans les affaires les plus simples, il est impossible de parler raisonnablement, quel sujet essentiel pouvez vous lui reprocher d’ignorer? Si au contraire, tout le talent de l’orateur consiste pour vous à s’exprimer avec ordre, élégance et fécondité, comment pourra-t-il, je vous le demande, y parvenir sans les lumières que vous lui refusez? L’art de bien dire suppose, en effet, dans celui qui parle une connaissance approfondie de la matière qu’il traite, de sorte que si Démocrite a su répandre les grâces du style sur des questions de physique, comme on le dit et comme je le reconnais, son sujet appartenait au physicien, el les ornements de sa diction à l’orateur; et si Platon, j’en conviens encore, a parlé avec un charme divin sur les matières les plus étrangères aux discussions civiles; si Aristote, Théophraste, Carnéades, ont appliqué une élocution douce et brillante aux sujets qu’ils ont traités, reconnaissez que le fond de leurs pensées est compris dans tel ou tel genre d’étude, mais que leur diction rentre dans celui qui nous occupe en ce moment. Nous voyons, en effet, que d’autres ont écrit sur le même sujet d’un style sec et décharné; comme Chrysippe, dont on vante la subtilité, et qui, pour n’avoir pas réuni à son art un mérite qui lui est étranger, n’en a pas moins rempli l’objet que se propose la philosophie.
XII.–» Quelle est donc la différence qui les sépare, et comment discerner la richesse et l’abondance des premiers, de la sécheresse de ceux qui ne possèdent ni le même charme ni la même variété? Évidemment, ce ne peut être que par un avantage particulier à ceux qui parlent bien, une élocution mesurée, élégante, soumise aux lois du goût et de la méthode. Or, cette élocution elle-même, si elle ne s’appuie sur des idées claires et bien arrêtées, n’est rien, ou ne sera pour tout le monde qu’un sujet de moquerie. Qu’y a-t-il, en effet, de moins raisonnable qu’un vain bruit de paroles, belles, il est vrai, et des plus choisies, mais qui ne laissent dans l’esprit ni pensées ni instruction? Ainsi, quel que soit le sujet dont s’occupe l’orateur, il commencera par l’étudier comme il ferait pour la cause d’un client, et alors il en parlera plus sciemment et plus facilement que ceux mêmes qui en ont fait l’objet de leurs recherches,
» Maintenant, si l’on prétend qu’il est un ordre d’idées et de matières qui appartiennent de préférence à l’orateur, et que sa science est circonscrite dans les limites étroites du barreau, je conviendrai qu’en effet c’est là que son talent a le plus d’occasion de s’exercer. Cependant, là même il est un grand nombre de connaissances, que les maîtres que l’on nomme rhéteurs ne peuvent enseigner et ne possèdent pas. Qui ne sait, en effet, que l’orateur emploie toute sa puissance à porter les âmes à l’indignation, à la haine ou à la douleur, ou à les ramener de ces mêmes passions à la bienveillance et à la pitié. Or, s’il n’est entré profondément dans la nature de l’homme et la connaissance des ressorts qui le font agir, qui soulèvent et apaisent les âmes, jamais sa parole ne produira les effets qu’il poursuit. Il est vrai que ce sujet semble être du domaine des philosophes, et jamais l’orateur ne dira le contraire; mais en leur accordant la science des choses, unique objet de leurs recherches, il se réservera le mérite de l’élocution, qui est nul sans cette science; car, je le répète, ce qui distingue l’orateur est un langage noble, élégant et conforme aux sentiments et aux idées des autres hommes.
XIII.–» Aristote et Théophraste ont écrit, je l’avoue, sur ces matières. Mais prenez garde, Scévola, que cette observation ne soit tout à mon avantage; car pour ce qu’il y a de commun entre eux et l’orateur, ils ne me sont d’aucun secours; mais ont-ils entrepris de traiter ce sujet, ils reconnaissent qu’il appartient à l’orateur. C’est ainsi que leurs autres livres portent le nom de la science à laquelle ils s’appliquent, au lieu que ces derniers sont compris sous le nom de rhétorique. Que l’orateur se trouve obligé, ce qui arrive souvent, de parler des dieux immortels, de la piété, de la concorde, de l’amitié, du droit civil, du droit naturel et du droit des gens, de l’équité, de la tempérance, de la grandeur d’âme, enfin de toutes les autres vertus, à l’instant tous les gymnases, toutes les sectes de philosophes vont s’écrier qu’on empiète sur leurs attributions, et que rien de tout cela n’appartient à l’orateur. Or, je consens que, pour amuser leurs loisirs, ils s’occupent de ces grands objets dans la poussière de leur école; mais lorsqu’ils les auront froidement et sèchement discutés, je veux qu’il soit permis à l’orateur de consacrer à leur développement l’animation et le mouvement de sa parole. Voilà ce que j’osais soutenir à Athènes en présence même des philosophes, pressé que j’étais par notre ami Marcellus, qui dès lors, presqu’au sortir de l’enfance, montrait pour ces nobles études une ardeur merveilleuse, et qui assisterait sans doute à notre entretien, si les fonctions d’édile ne le retenaient à Rome pour célébrer les jeux.
» En ce qui regarde l’institution des lois, la paix ou la guerre, les alliances, les impôts, les droits des citoyens considérés en masse ou suivant l’âge et le rang, que les Grecs, s’ils veulent, donnent dans ces matières à Solon et à Lycurgue,–que je ne crains pas de ranger parmi les hommes éloquents,–la supériorité sur Démosthène et Ilypéride, ces orateurs accomplis; qu’on préfère encore pour celle science nos décemvirs auteurs des Douze Tables, et dont la sagesse est reconnue, à Serv. Galba et à votre beau-père Lélius, malgré leur réputation d’éloquence, j’y consens: jamais je ne contesterai que certaines sciences ne soient le partage exclusif de ceux qui ont consacré à leur étude leur vie entière; mais je ne reconnaîtrai pour véritable et parfait orateur que l’homme en état de parler sur toutes choses avec abondance et variété.
XIV–» C’est que même dans ces causes, que tout le monde s’accorde à réserver aux seuls orateurs, il se rencontre. souvent des difficultés supérieures à la pratique du barreau où vous les renfermez, et dont la solution appartient à une science beaucoup moins connue. Je demande, en effet, comment un orateur peut parler en faveur d’un général ou contre lui sans connaître l’art militaire, peut être aussi la géographie terrestre et maritime; proposer au peuple d’approuver ou de rejeter une loi, discuter dans le sénat les intérêts de la République, sans une haute raison et une parfaite intelligence des besoins de l’ État; comment ses discours sauraient-ils pénétrer dans les cœurs, exciter ou calmer les passions, ce qui est le triomphe de son art, s’il n’a fait une étude approfondie de tout ce que la philosophie enseigne sur le caractère et les mœurs des hommes? Peut-être n’approuverez-vous pas ce que je vais ajouter, j’oserai néanmoins dire ma pensée: la physique, les mathématiques et les autres sciences dont vous faisiez tout.à-l’heure une classe particulière, appartiennent, il est vrai, à ceux qui les cultivent; mais veut-on y ajouter le charme du style, c’est à l’art de l’orateur qu’il faut avoir recours. Car s’il est vrai que l’architecte Philon, après avoir construit l’arsenal d’Athènes, rendit compte au peuple de ses travaux avec un grand talent de parole, il dut ce talent à l’art de l’orateur, et non à celui de l’architecte. Si Antoine, qui m’écoute, avait eu à parler pour Hermodore sur la construction des ports, instruit par lui sur le fond du sujet, c’est dans ses connaissances personnelles qu’il aurait cherché le moyen de l’orner. Asclépiade, qui a été notre médecin et notre ami, s’exprimait plus éloquemment que tous ses confrères; mais ce mérite appartenait à l’orateur, et non au médecin. Enfin, Socrate a dit avec plus de vraisemblance que de vérité qu’on parle toujours bien de ce qu’on sait; mais il serait plus vrai de dire qu’on parle toujours mal de ce qu’on ignore, et qu’on ne parlera jamais bien de ce qu’on connaît le mieux, si on ne possède l’art d’exposer et d’orner ses pensées.
XV.–» Voulez-vous donc comprendre dans une définition générale tout ce qui est essentiel à l’orateur, croyez-moi, jamais il ne parviendra à mériter ce beau nom, s’il n’est capable de parler sur quelque sujet que ce soit, avec justesse, ordre, agrément; s’il est dépourvu de mémoire ou de noblesse dans l’action. Trouvez-vous cette définition trop étendue, en ce qu’elle porte sur quelque sujet que ce soit, vous êtes libre de la resserrer, de la restreindre; mais je n’en persisterai pas moins à soutenir que l’orateur, fût-il demeuré étranger à la plupart des sciences et des arts, qu’on lui interdit, pour s’adonner entièrement aux discussions de la tribune et à la pratique du barreau, s’il est obligé d’aborder ces matières qu’il ignore, après avoir consulté ceux qui les possèdent, il en parlera beaucoup mieux qu’ils ne feraient eux-mêmes. Ainsi, que Sulpicius ait à s’expliquer sur l’art militaire, il s’adressera à notre allié Marius, et, après l’avoir entendu, il s’exprimera de telle sorte que, Marius lui-même sera tenté de croire que Sulpicius sait mieux la guerre que lui. Qu’il ait à traiter une qestion de droit, il viendra vous consulter, Scévola, et, tout profond jurisconsulte que vous êtes, il s’énoncera mieux que vous sur les choses que vous lui aurez apprises. Et s’il se présente une affaire où il ait à parler de la nature ou des vices des hommes, de leurs passions, de la modération, de la continence, de la douleur et de la mort, bien que ces divers sujets doivent être familiers à l’orateur, peut-être qu’il se croira tenu d’en conférer avec Sextus Pompée, cet homme si profondément versé dans la philosophie. Mais n’importe le sujet qui l’oblige à recourir aux lumières d’autrui, il saura mieux l’expliquer que tel ou tel qui l’aura éclairé. Toutefois, comme la philosophie se partage en trois parties, la physique, la dialectique et la moraie, nous laisserons de côté les deux premières, par ménagement pour notre paresse; et si l’orateur m’en croit, il s’appliquera surtout à la troisième, qui lui a toujours appartenu et où se trouve en réalité sa puissance. La morale est donc l’étude qui lui convient principalement; quant aux autres, qu’il pourrait avoir négligées, rien n’empêche qu’il n’emprunte au besoin les lumières qui lui manquent, en y ajoutant le coloris de sa parole.
XVI.–» En effet, si l’on convient qu’Aratus, sans connaître l’astronomie, a composé un beau poëme sur le ciel et les étoiles; si Nicandre de Colophon, tout étranger qu’il était aux travaux rustiques, mais inspiré par la poésie, a chanté l’agriculture avec succès, pourquoi l’orateur ne pourrait-il également orner de sa diction les matières que la nécessité du moment lui aura fait étudier? Le poète, en effet, se rapproche beaucoup de l’orateur; plus enchaîné par la mesure, il a plus de liberté dans l’expression; et si tous les deux sont associés pour le choix des ornements, on peut dire qu’ils se confondent dans un mépris commun pour tout ce qui tendrait à comprimer l’essor de leur éloquence ou de leur génie.
«A l’égard de cette opposition que, si vous n’aviez pas été sur mon terrain, vous m’auriez, dites-vous, suscitée pour avoir prétendu que l’orateur doit posséder en toutes choses une instruction accomplie, croyez bien, Scévola, que jamais je n’eusse émis cette opinion, si j’avais pensé être le modèle dont j’essaye de donner une idée. Je n’ai fait que rapporter ce que disait souvent Lucilius, qui gardait contre vous un peu de ressentiment, et me voyait pour cela moins souvent qu’il n’aurait voulu, mais qui, d’ailleurs, était un homme rempli de science et d’urbanité. «Il ne faut, disait il, mettre au nombre des orateurs que celui qui réunit toutes les connaissances dignes d’un homme bien né; car dans nos discours nous n’en faisons pas constamment usage, mais on a bien vite reconnu si elles nous manquent ou si nous les avons cultivées. Celui qui joue à la paume n’a pas besoin d’employer les mouvements qu’enseigne la gymnastique; cependant l’attitude de son corps indique s’il a suivi les exercices du gymnase. Le sculpteur ne se sert pas du pinceau lorsqu’il façonne l’argile; mais on distingue facilement s’il ignore ou connaît le dessin. Ainsi pour l’orateur: qu’il parle au barreau, à la tribune ou au sénat, il aura beau tenir en réserve le savoir dont il est pourvu, on ne tardera pas à sentir s’il n’a préparé pour la circonstance qu’une vaine déclamation, ou s’il se présente nourri depuis longtemps de tout ce qui fait la force de l’éloquence.»
XVII.–Scévola reprit en souriant: «Je renonce, Crassus, à prolonger avec vous cette discussion, vous y avez l’avantage; car si d’abord vous avez paru convenir avec moi de ce qui n’est pas essentiel à l’orateur, bientôt, je ne sais par quel détour, vous êtes parvenu à le revendiquer et en faire sa propriété. Or, ceci me rappelle que lorsque j’étais rhéteur à Rhodes, ayant voulu répéter au célèbre Apollonius les leçons que j’avais reçues de Panétius, il se moqua de la philosophie, selon sa coutume, en parla avec dédain et la combattit, je lois le dire, avec plus d’esprit que de vérité. Vous, au contraire, loin de mépriser aucun art, aucune science, vous les présentez comme une arme toujours à la disposition de l’orateur; et je conviens lue si à des connaissances aussi étendues on joignait encore le mérite d’une élocution brillante, on serait en effet un homme supérieur et digne d’admiration. Mais cet homme, Crassus, s’il existait, s’il avait existé, s’il pouvait jamais exister, ne serait-ce pas vous qui, selon moi et au jugement de tous, (je ne crains pas d’être démenti par un orateur), n’avez laissé aucune palme à cueillir après vous? Or, si vous, qui réunissez tout ce qui a rapport à l’éloquence judiciaire et politique, convenez cependant ne pas avoir embrassé toutes les connaissances que vous imposez à l’orateur, ne craignez-vous pas d’avoir étendu vos exigences au delà des limites du besoin et de la vérité?
–» Rappelez-vous, dit Crassus, que je n’ai pas entendu parler de ma puissance, mais de celle de l’orateur. Qu’ai-je pu apprendre en effet, et que puis-je savoir moi qui ai commencé à pratiquer un art avant de l’avoir étudié, moi que le barreau, l’ambition, la république et l’amitié ont absorbé avant que j’aie réfléchi à de si grandes choses? Et quand j’ avouerais posséder ce talent que vous m’attribuez, vous seriez obligé de convenir que j’ai manqué au moins de savoir, de loisir et surtout d’ardeur pour apprendre. Or, que penseriez-vous de celui qui à plus de génie saurait encore unir tous les avantages qui m’ont manqué? Quel orateur et quel homme ce serait!»
XVIII.–Antoine prit alors la parole: «Je suis de votre avis, Crassus, et je ne doute pas que des connaissances générales et l’art d’en user ne doivent seconder puissamment l’éloquence de l’orateur; mais, outre qu’il me paraît difficile d’acquérir un tel savoir avec notre manière de vivre et nos occupations, je craindrais que cette recherche ne s’éloignât du ton qui convient à la tribune et au barreau: rien n’en diffère plus que celui des philosophes dont vous venez de parler, bien qu’ils aient écrit sur la physique et la morale avec noblesse et agrément; mais leur style brillant et fleuri est plus fait pour le calme du cabinet, ou la promenade, que pour l’agitation du Forum et de la place publique. Pour moi, je n’ai prêté aux auteurs grecs qu’une attention tardive et superficielle; cependant, me rendant en Cilicie en qualité de proconsul, et le mauvais temps m’ayant retenu plusieurs jours à Athènes, je fus constamment entouré des plus célèbres philosophes. C’étaient à peu près les mêmes que vous citiez tout-à-l’heure; et comme le bruit s’était, je ne sais comment, répandu parmi eux qu’à Rome j’étais avec vous mêlé aux affaires les plus importantes, chacun d’eux discourait à sa manière sur l’art et les fonctions de l’orateur. Quelques-uns, et Mnéséarque était du nombre, prétendaient que ceux à qui nous donnons le titre d’orateurs ne sont pour ainsi dire que des ouvriers en paroles, à la langue agile et bien exercée; qu’il n’y a d’orateur que le sage; que l’éloquence qui consiste dans l’art de bien dire est une vertu; que toutes les vertus sont égales et liées entre elles; que celui qui en possède une les possède toutes; qu’ainsi l’homme éloquent a toutes les vertus, et n’est autre que le sage. Or ces raisonnements secs et décharnés étaient loin de me convenir. Pour Charmadas, il s’exprimait sur le même sujet avec plus d’abondance; non qu’il découvrît toute sa pensée: il restait fidèle aux traditions de l’Académie, qui dans la discussion se borne à contredire. Mais il tenait surtout à nous faire comprendre que les rhéteurs, et ceux qui ont la prétention d’enseigner l’éloquence, n’ont qu’un demi-savoir, et que jamais l’orateur ne deviendra éloquent il ne s’instruit à l’école des philosophes.
XIX.–» Quelques Athéniens, doués d’une certaine facilité de parole et habitués aux controverses de la tribune et du barreau, soutenaient le contraire; parmi eux se trouvait Ménédème, que dernièrement j’ai eu pour hôte à Rome. Il disait qu’on trouve chez les rhéteurs des notions sur tout ce qui peut servir à fonder et à régir les États; mais à la vivacité de son esprit Charmadas opposait l’étendue de son savoir et une prodigieuse variété de connaissances. Il assurait que toutes ces notions ne se rencontrent que dans les écrits des philosophes, et qu’en ce qui regarde le culte des dieux, l’éducation de la jeunesse, la justice, la force, la tempérance, la modération en toutes choses, enfin pour tous ces principes nécessaires à l’existence ou au bon ordre des sociétés, on ne trouve rien dans ceux des rhéteurs. Que si l’art de ces maîtres, ajoutait-il, comprend de si hautes connaissances, pourquoi leurs traités sont-ils remplis de règles sur l’exorde, la péroraison et d’autres niaiseries pareilles,–c’est le nom qu’il leur donnait,–pendant qu’ils ne disent mot sur la constitution des empires, l’établissement des lois, l’équité, la justice, la bonne foi, les moyens de régler nos mœurs et de réprimer nos passions; il aimait encore à se moquer de leurs préceptes en prouvant que, loin de posséder les lumières qu’ils s’attribuent, ils n’ont pas même compris cette théorie de l’éloquence qu’ils ont prétendu expliquer. En effet, disait-il, ce qui importe surtout à l’orateur est de se montrer à ceux qu’il cherche à persuader tel qui veut leur paraître. Or, cela n’est possible que par la dignité du caractère, sur quoi les maîtres de rhétorique n’ont laissé aucune instruction. Comme aussi est-il question d’inspirer à ceux qui l’écoutent telle ou telle passion, le moyen pour lui d’y parvenir, s’il ignore comment on maîtrise les âmes, par quels ressorts on les dirige, par quels discours on les pénètre des impressions les plus opposées; et tout cela est comme caché, enseveli dans les profondeurs de la philosophie, dont ces rhéteurs n’ont pas même effleuré la surface.–Ménédème s’efforçait de le réfuter plutôt par des exemples que par des raisonnements. C’est ainsi que, récitant de mémoire les plus beaux fragments des discours de Démosthène, il soutenait qu’habile à manier l’âme du peuple ou des juges il avait possédé ce secret que la philosophie, disait-on, pouvait seule enseigner.
XX.–» Charmadas lui répondait qu’il ne refusait à Démosthène ni l’étendue de la science ni la force du talent. Mais, soit qu’il en fût redevable à son génie ou aux leçons de Platon, dont on reconnaissait qu’il avait été le disciple, la question, disait-il, n’était pas de savoir combien ce grand homme s’était montré supérieur, mais ce que les rhéteurs peuvent nous enseigner. Souvent même, entraîné par la dispute, il allait jusqu’à soutenir qu’il n’existe aucun art de parler. Ainsi, après avoir prouvé par le raisonnement que la nature elle-même nous apprend à flatter ceux de qui notre sort dépend, à leur insinuer en notre faveur des sentiments de bienveillance, à effrayer nos ennemis par la menace, à exposer les faits, à confirmer nos prétentions, à réfuter celles de notre adversaire, à employer en terminant le langage de la prière et celui de la commisération, il ajoutait qu’en cela seulement consistait la mission de l’orateur, et qu’ensuite l’habitude et l’exercice développent l’intelligence et donnent la facilité de l’élocution. Il s’étayait encore d’une foule d’exemple; car, remontant jusqu’à un certain Corax et un certain Tisias, qui les premiers ont écrit sur la rhétorique et en ont fait un art, il prétendait que depuis eux pas un seul rhéteur n’avait montré la moindre éloquence; il nommait au contraire une multitude d’orateurs illustres qui jamais n’avaient étudié ces préceptes non plus que d’autres sciences; et même, soit qu’il voulût railler, ou qu’il parlât sérieusement, il me citait comme un exemple de ceux qui étrangers à l’art oratoire n’en avaient pas été pour cela moins éloquents. Sur le premier point, à savoir que je n’avais pas étudié la rhétorique, je prenais aisément condamnation; mais pour l’autre, je lui répondais, ou qu’il voulait se moquer ou qu’il était dans l’erreur. Il soutenait au surplus que tout art doit avoir des principes fermes et bien arrêtés, tendant constamment aux mêmes fins el d’une application invariable; que pour l’éloquence, au contraire, tout est vague et incertain, les orateurs ne possédant eux-mêmes qu’imparfaitement les choses dont ils parlent, et ne pouvant en donuer à la hâte qu’une idée fausse ou du moins obscure. Enfin, il réussit presque à me convaincre que l’éloquence n’est point un art, et qu’il est impossible de parler avec ampleur et habileté sans avoir étudié les plus grands philosophes. Dans tous ces entretiens, Charmadas témoignait l’admiration la plus vive pour votre talent, et disait qu’il avait trouvé en moi un disciple docile, en vous, Crassus, un antagoniste infatigable..
XXI.–» Ce fut à cette époque que, imbu de la même opinion, j’écrivis dans un petit traité qui m’échappa, je ne sais comment, et devint public, que j’avais connu quelques hommes diserts, mais que je n’en avais pas vu encore un seul éloquent. Je donnais en effet le nom de disert à celui qui peut s’exprimer avec assez d’art et de clarté pour satisfaire au commun des hommes; et j’appelais éloquent celui qui, toujours prêt à développer et embellir, par le charme et la magnificence de son langage, le sujet qu’il aura choisi, semble tenir en réserve dans son âme ou dans sa mémoire tout ce que la parole peut exprimer. Que si, absorbés par la poursuite des magistratures et le travail du barreau, avant même que nous ayons pu étudier, il nous est difficile d’acquérir une telle faculté, nous devons cependant l’admettre comme possible et inhérente à l’orateur. Pour moi, autant qu’il m’est permis de le présager en voyant les heureuses dispositions de nos concitoyens, je ne dçsespère pas qu’un jour il ne se rencontre un homme qui, avec plus de zèle que nous pour l’étude, plus de loisir pour le travail, un génie plus formé, une application plus constante, après avoir beaucoup lu, beaucoup entendu, beaucoup écrit, atteigne enfin à cette perfection que nous recherchons et mérite d’être appelé non seulement disert, mais éloquent. Or cet orateur, je le crois, ce sera Crassus lui-même ou tout autre qui, doué d’un génie égal au sien, mais ayant plus écrit, lu et entendu, pourra lui être de quelques degrés supérieur.
«Nous sommes heureux, Cotta et moi, dit alors Sulpicius, de vous voir engagé dans cette discussion; car nous ne l’espérions pas. En effet, Crassus, en nous rendant auprès de vous, c’était déjà beaucoup pour nous de vous entendre causer sur d’autres sujets, et de pouvoir recueillir quelques-unes de vos sages pensées; mais que vous en vinssiez à un examen approfondi de cette étude, de cet art ou de ce don de la nature, c’est ce que nous aurions à peine osé désirer. Pour moi, dès ma plus tendre jeunesse je vous ai recherchés l’un et l’autre avec empressement, et mon amitié pour Crassus m’en a rendu presque inséparable. Cependant, malgré mes instances et les tentatives de Drusus, je n’ai pu jamais obtenir un mot de lui sur la nature et les règles de l’éloquence. Quant à vous, Antoine, je vous dois cette justice: vous n’avez jamais refusé de répondre à mes questions, d’éclaircir mes doutes, et souvent j’ai appris de vous en quoi consistait votre méthode. Mais aujourd’hui, puisque vous avez tous deux commencé à nous mettre sur la voie de nos recherches, et que Crassus a été le premier à en faire le sujet de cet entretien, accordez-nous la faveur de vous entendre discourir sur les divers genres d’éloquence. Si nous avons le bonheur de l’obtenir, j’en aurai, Crassus, une éternelle obligation à votre jardin de Tusculum, et je préfèrerai désormais ce gymnase, voisin de Rome, à l’Académie et au Lycée.
XXII.–«Adressons-nous de préférence à Antoine, répondit Crassus. Ce genre d’entretien lui convient mieux qu’à personne, et vous venez de nous dire qu’il lui était familier. Pour moi, j’avoue que je m’y suis toujours refusé; et comme vous venez de m’en faire le reproche, je n’ai jamais voulu me rendre à vos instances et à vos prières, non qu’il y eût de ma part orgueil ou mauvaise volonté, et que je n’eusse été heureux de seconder une ardeur si juste et si louable, alors surtout que je ne voyais personne offrir plus que vous de dispositions naturelles pour l’éloquence; mais c’est que, je vous le répète, étranger à ce genre de discussion, j’ignore toutes ces règles dont on a fait un art.»
Cotta reprit alors: «Puisque nous avons obtenu, Crassus, ce qui était le plus difficile, de vous amener à parler sur ces matières, il y aurait maintenant de notre faute si vous nous quittiez avant d’avoir répondu à toutes nos questions.–A celles du moins, dit Crassus, qui n’excèderont ni mes facultés ni mes connaissances, selon la clause usitée dans les actes. –Qui de nous, répondit Cotta, aurait la prétention de savoir ce que vous ignorez ou de pouvoir ce qui vous serait impossible?–S’il en est ainsi, faites celles qu’il vous plaira, pourvu qu’il me soit permis d’avouer ne pouvoir ce qui est au-dessus de mes forces et ignorer ce que je ne sais pas.
–«Je commencerai, dit Sulpicius, par vous demander votre opinion sur un sujet qu’Antoine vient de proposer. Pensez-vous qu’il y ait un art de bien dire?
–«Eh quoi! reprit Crassus, ne serais-je pour vous qu’un de ces Grecs, éternels parleurs et désœuvrés, parfois aussi érudits et savants, et venez-vous me proposer un vain texte d’argumentation pour me le faire développer à mon gré? Où avez-vous pris, en effet, que je me sois jamais occupé ou inquiété de ces futilités? Et ne savez-vous pas, au contraire, que je me suis toujours moqué de ces charlatants qui, du haut de la chaire, élèvent impudemment la voix au milieu d’une assemblée nombreuse pour demander qu’on leur adresse quelque question. Ce fut, dit-on, Gorgias le Léontin qui le premier en donna l’exemple; et il croyait faire preuve d’un grand talent en disant qu’il était prêt à parler sur quelque sujet qu’on voudrait lui proposer. Après lui cette présomption est devenue commune, elle l’est encore de nos jours; et il n’est pas de question, quelque sérieuse, quelque inattendue, quelque neuve qu’elle soit, qui ne trouve ces parleurs intrépides disposés à lui donner tous les développements qu’elle comporte. Si j’avais pensé, Cotta, et vous, Sulpicius, que vous eussiez le désir d’entendre une dissertation de cette espèce, j’aurais amené ici quelqu’un de ces Grecs, qui aurait pu vous satisfaire; car rien ne m’était plus facile. Mon ami Pison, jeune homme du plus rare talent, et qui a beaucoup de goût pour ces sortes d’exercices, a chez lui le péripatéticien Staséas. Je connais beaucoup ce rhéteur; et, au jugement des hommes instruits, il tient le premier rang parmiceux de sa profession.
XXIII–Q, ue nous parlez-vous, dit Scévola, de Staséas et des péripatéticiens? Vous devez condescendre aux sollicitations de ces jeunes gens. Or, ce n’est point le futile bavardage d’un Grec sans expérience, ou l’éternel refrain de l’Ecole qu’ils demandent; ils s’adressent au plus sage et au plus éloquent des hommes, à un orateur que des causes importantes plutôt que de frivoles traités ont rendu célèbre, et que son talent et ses lumières ont placé au premier rang dans cette patrie du commandement et de la gloire. Voulant marcher sur ses traces, ils lui demandent conseil. Or, si je vous ai toujours regardé comme le prince des orateurs, je n’en ai pas moins reconnu en vous, Crassus, autant de bonté que d’éloquence. Croyez donc qu’il vous importe aujourd’hui de nous en donner une preuve; et ne vous refusez pas davantage à une conversation, que deux jeunes gens aussi distingués brûlent de vous voir commencer.
–«Je me rends à leurs vœux, reprit Crassus, et je m’empresse, selon ma coutume, de dire en peu de mots ce que je pense sur chacune de leurs questions. Et d’abord, puisqu’il m’est impossible, Scévola, de résister à vos instances, je réponds que, selon moi, ou il n’y a point d’art de parler, ou il se réduit à peu de choses, tout ce débat qui partage les savants n’étant au fond qu’une dispute de mots. Que si en effet, d’après la définition d’Antoine, tout art doit avoir des principes fixes, bien connus, indépendants de tout arbitraire et réunis en un corps de doctrine, je ne crois pas qu’il existe un art de parler; car le langage de l’orateur varie suivant les causes, et doit se conformer aux sentiments du peuple qui l’écoute. Mais si l’on a observé les moyens oratoires employés avec le plus de succès; si ces observations, recueillies avec soin par des esprits judicieux, ont pu être consignées dans des écrits, classées par genres et réduites à des divisions bien distinctes, ce que l’expérience démontre, je ne vois pas pourquoi elle ne constituraient pas un art, sinon dans toute la rigueur de la définition, du moins selon l’acception ordinaire de ce mot. Au surplus, que ce soit un art ou seulement quelque chose qui ressemble à un art, il ne faut pas certainement le négliger, mais se persuader qu’il est des moyens plus puissants pour atteindre à l’éloquence.»
XXIV.–Antoine dit alors: «Je suis parfaitement de votre avis, Crassus, lorsque, sans donner à l’art l’importance que lui attribuent ceux qui placent en lui toute la force de l’éloquence, vous êtes loin aussi de le méconnaître, comme la plupart des philosophes; vous ferez donc, je crois, plaisir à ces jeunes gens si vous leur expliquez ces moyens, qui, selon vous, sont plus plus puissants que l’art lui même.
–«Sans doute, reprit Crassus, je continuerai, puisque j’ai commencé, tout en vous priant de ne pas divulguer mes sottises, et je lâcherai de prendre le ton qui convient, non point au rhéteur, mais à un membre du sénat, à un homme qui a quelque usage du barreau et du monde, et qui, sans avoir rien promis, s’est trouvé engagé fortuitement dans votre conversation. Autrefois, lorsque je sollicitais une magistrature, je commençais par m’éloigner de Scévola. «Retirez-vous, lui disais-je, «je vais faire des bassesses; il faut plaire au peuple, et c’en est le seul moyen.» Scévola, en effet, était l’homme du monde devant qui il m’en coûtait le plus de m’abaisser. Aujourd’hui le hasard a voulu qu’il fût encore témoin de mes sottises; car y a-t-il une plus grande sottise que de parler, et n’est-ce pas remplir le rôle d’un sot que de parler sans y être obligé?
–«Continuez, Crassus, dit Scévola, si vous craignez de commettre une faute, j’en prends sur moi la responsabilité.
XXV.–«Je crois donc, poursuivit Crassus, que la nature, le génie est la source où l’orateur puise ses plus belles inspirations; et quant à ces rhéteurs, à ces maîtres de l’art, dont nous parlait tout-à-l’heure Antoine, ce sont moins les règles ou la méthode que le talent qui leur a manqué. Il suppose dans le cœur et dans l’intelligence des mouvements rapides, qui donnent à la pensée plus de pénétration, à l’élocution plus de richesse et d’abondance, à la mémoire des impressions plus fermes et plus durables; et si quelqu’un s’imagine que l’art peut nous procurer ces avantages, ce qui n’est pas, (nous serions, en effet, trop heureux si l’art pouvait nous transmettre ou produire en nous l’inspiration, l’art n’ayant qu’une influence bornée, et ne pouvant remplacer les dispositions naturelles), que pense-t il de ces qualités que l’homme apporte certainement avec lui en naissant: une langue souple et déliée, une voix sonore, des poumons vigoureux, une organisation forte, enfin une certaine régularité ou proportion dans les traits du visage et les membres du corps; et en disant cela, je ne prétends pas que l’art ne puisse ajouter à la nature. Je sais que le travail peut perfectionner ce qui est bien, améliorer en quelque sorte et corriger ce qui est défectueux. Mais il est des hommes dont la langue est si embarrassée, la voix si ingrate, la physionomie si dure, les mouvements du corps si disgracieux, que, malgré toutes les ressources de leur esprit et de leur savoir, on ne peut les compter au nombre des orateurs; comme aussi il en est d’autres sur tous ces points tellement favorisés, tellement comblés par la nature, qu’on dirait qu’ils ne sont pas nés comme les autres hommes, mais qu’un dieu lui-même a pris soin de les former. C’est, il faut en convenir, un rôle difficile et périlleux à remplir, que de s’offrir et s’engager à parler seul sur les grands intérêts, au milieu d’une assemblée nombreuse qui se tait pour vous écouter. Il n’est personne, en effet, qui ne se montre alors plus empressé à remarquer les défauts que les qualités de l’orateur; et la moindre imperfection qui nous blesse suffit pour détruire ce que le discours peut avoir de louable. Or, en faisant cette remarque, je suis loin de vouloir détourner de l’étude de l’éloquence les jeunes gens à qui la nature aurait refusé quelques-uns de ses dons. Qui ne voit, en effet, la réputation que C. Célius, homme nouveau, et mon contemporain, s’est acquise par son talent de la parole, tout médiocre qu’il peut être; et ne sait-on pas que Q. Varius, homme inculte et grossier, n’en doit pas moins à sa prétendue éloquence l’autorité et le crédit dont il jouit à Home.
XXVI.–» Mais puisque nous voulons connaître le véritable orateur, il nous faut ici le représenter exempt de tout défaut, réunissant toutes les qualités; car si la multitude des procès, la variété infinie des causes, le tumulte et la rudesse du Forum autorisent les plus détestables parleurs, ce n’est pas une raison pour nous d’abandonner l’objet de nos recherches. Voyez dans les arts qui n’ont rien de vraiment utile, et ne se proposent que de ménager à l’esprit une honnête distraction, combien nos jugements sont sévères et dédaigneux; c’est qu’il n’est point de procès ou de discussions d’intérêt qui nous obligent à supporter au théâtre un mauvais acteur, comme au barreau un mauvais avocat. Aussi l’orateur doit-il s’étudier, non pas seulement à mériter l’approbation de celui qui l’emploie, mais à se faire admirer de ceux dont le jugement est désintéressé; et si vous tenez à connaître le fond de ma pensée, je vous dirai, à vous qui êtes mes amis, ce que jusqu’à présent j’avais cru ne devoir déclarer à personne: L’orateur le plus habile, celui qui s’exprime avec le plus d’élégance et de facilité, n’est à mes yeux qu’un effronté, s’il ne s’approche avec crainte de la tribune et ne commence son discours en proie à l’émotion. Or, cela même ne peut manquer d’arriver, car plus un orateur est habile, plus aussi H connaît les difficultés de l’art, plus il redoute l’incertitude du succès, plus il craint de ne pas répondre à l’attente des auditeurs. Mais celui qui n’est capable de produire rien qui soit digne de la profession, digne du nom d’orateur, rien qui puisse flatter l’oreille de ceux qui l’écoutent, éprouvât-il en parlant quelque émotion, il n’en serait pas moins à mes yeux un impudent: car le moyen d’éviter le reproche d’impudence est non point de rougir, mais de ne faire que ce qui convient. Quant à ceux qu’aucun trouble n’agite, et il en est beaucoup, non-seulement je blâme leur assurance, mais je voudrais qu’on la punît. Quoi qu’il en soit, j’ai remarqué en vous une impression à laquelle je suis très sujet; souvent en prononçant mon exorde je pâlis, mes idées se confondent, et je tremble de tous mes membres. Un jour même. que je m’étais porté pour accusateur, dans ma première jeunesse, je fus si troublé en commençant mon discours, que Q. Maximus, s’apercevant de mon désordre, renvoya la cause, et c’est un service que je n’oublierai de ma vie.»
Tout le monde à ces mots fit un mouvement de tête en signe d’approbation, et se mit à causer à voix basse; la timidité de Crassus, en effet, était extrême. Mais loin de nuire à sa parole, elle lui donnait, au contraire, un lustre de probité.
XXVII.–«Votre observation, Crassus, est fondée, dit alors Antoine. Je me suis souvent aperçu, que vous et les plus grands orateurs,–quoiqu’à mon avis personne ne vous ait encore égalé,–ne commenciez jamais à parler sans une certaine émotion, et lorsque étonné de voir que les plus habiles étaient aussi les plus émus, j’ai cherché à m’expliquer ce fait; j’en ai trouvé deux raisons: la première est que ceux qui joignent aux dons de la nature les leçons de l’expérience savent que, même pour les plus grands orateurs, le talent ne fait pas toujours le succès; de telle sorte, qu’obligés de parler, il est tout naturel qu’ils redoutent un mécompte qui n’a rien d’impossible; la seconde, une injustice contre laquelle je me suis souvent élevé. Qu’un tel, qui excelle dans un autre art, n’ait pas réussi comme à son ordinaire, on juge ou qu’il ne l’a pas voulu ou qu’il était mal disposé. Roscius, dit-on, s’est négligé aujourd’hui, ou bien il avait l’estomac chargé. Mais si un orateur s’est montré faible, on déclare aussitôt que c’est faute d’esprit; et il paraît sans excuse, car on ne manque pas d’esprit parce qu’on l’a voulu ou parce qu’on est malade. On nous juge donc bien plus sévèrement, et chaque fois que nous parlons en public, nous avons à subir un nouvel arrêt. Enfin, un acteur ne perdra point sa réputation pour avoir mal rempli un rôle, mais qu’un mauvais succès indispose contre un orateur, cette impression ne s’effacera plus ou subsistera long temps.
XXVIII.–» A l’égard de ces autres qualités que, selon vous l’orateur ne peut tenir que de la nature, et pour lesquelles un maître ne saurait lui être d’un grand secours, je suis entièrement de votre avis, et j’ai toujours approuvé le célèbre rhéteur Apollonius d’Alabanda, qui se faisant payer ses leçons, ne souffrait pas, cependant, que ceux de ses élèves qu’il jugeait incapables de devenir orateurs perdissent leur temps à son école: il les renvoyait, et leur conseillait de prendre la profession pour laquelle il leur reconnaissait quelque aptitude. En effet, pour réussir dans les autres arts, il suffit en quelque sorte d’avoir l’organisation humaine, et de pouvoir comprendre et retenir quelques principes qu’on vous démontre, ou qu’on introduit par force dans les esprits rebelles. On n’exige de vous ni la souplesse de la langue, ni la rapidité de l’expression, ni ces autres qualités que nous ne pouvons acquérir de nous-même, la beauté, la physionomie, la voix; mais pour l’orateur il faut qu’il réunisse la subtilité des dialecticiens, la raison des philosophes, l’élocution des poètes, la mémoire des juriconsultes, l’organe des acteurs tragiques, et le geste des comédiens les plus habiles. Aussi, rien n’est il plus difficile à trouver au monde qu’un orateur parfait: car dans les autres arts, pour être approuvé, il suffit de posséder à un degré médiocre la qualité particulière que chacun d’eux réclame; dans l’éloquence, il n’y a de succès qu’à la condition de les réunir toutes au degré le plus éminent.
–«Voyez, cependant, reprit Crassus, combien on apporte plus de soin et d’étude à un art léger et futile qu’à celui de l’éloquence, que vous prétendez être le plus difficile de tous. En effet, j’entends dire souvent à Roscius qu’il n’a jamais trouvé un seul élève dont il fût content, non que dans le nombre il n’en ait rencontré qui eussent du talent, mais parce qu’il ne peut souffrir en eux le moindre défaut, car ce qui blesse est ce qui frappe le plus vite, et qu’on a le plus de peine à oublier. Ainsi, pour revenir à notre comparaison de la perfection oratoire avec cet acteur, admirez la justesse, la grâce qu’il montre dans ses moindres gestes; comme tout en lui est conforme aux bienséances, comme tout émeut, enchante les spectateurs! Aussi en est il arrivé à ce point, qu’un artiste s’est-il rendu supérieur dans son art, aussitôt on dit de lui qu’il en est le Roscius; mais, je le sens, exiger de l’orateur une perfection dont je me trouve moi-même si éloigné, n’est-ce pas vouloir être taxé de déraison? car, demandant grâce pour moi, je ne l’accorde à personne, et pourtant je suis de l’avis d’Apollonius. Tout homme qui ne peut atteindre à l’éloquence, qui s’exprime mal, qui ne dit pas ce qui convient, doit embrasser une profession plus conforme à son talent.
XXIX.–«Vous nous conseillez donc à Cotta et à moi, dit Sulpicius, d’abandonner l’éloquence pour le droit civil ou l’art militaire. Qui pourrait, en effet, se flatter de parvenir à cette perfection en tout genre que vous exigez de l’orateur?
–«Au contraire, répondit Crassus, c’est parce que j’ai reconnu en vous les plus heureuses dispositions pour l’éloquence, que je me suis permis tous ces développements. Comme aussi mon intention était moins de retenir ceux qui ne pourraient y atteindre, que de vous encourager, vous qui devez y exceller. Car si j’ai admiré en vous deux le talent et la passion, je conviens encore qu’à l’égard des qualités extérieures, sur lesquelles j’ai insisté plus peut-être que les Grecs n’ont coutume de le faire, la nature, Sulpicius, s’est montrée envers vous prodigue de ses dons. Je ne crois pas, en effet, avoir jamais entendu personne dont le maintien, les gestes, l’extérieur fussent plus convenables, dont l’organe fût à la fois plus doux et plus sonore, avantages précieux, même lorsqu’on les possède à un moindre degré de perfection; car on peut toujours s’en servir avec justesse et ne blesser aucune convenance. C’est là, en effet, le point essentiel et sur quoi il est le plus difficile de prescrire des règles, non-seulement pour moi, qui m’entretiens ici avec vous comme un père avec ses enfants, mais pour Roscius lui-même, à qui j’ai souvent entendu dire que la convenance était l’objet suprême de l’art, et le seul pourtant que l’art ne puisse enseigner. Mais trouvez bon que je passe à un autre sujet et qu’abandonnant le ton des rhéteurs, j’en prenne un qui me soit naturel.
–«Non vraiment, reprit Cotta, puisqu’au lieu de nous renvoyer à quelque autre profession, vous nous engagez à persister dans l’étude de l’éloquence, c’est pour nous une nécessité de réclamer de vous l’explication de votre méthode. Notre ambition n’est pas excessive. Satisfaits de ce que vous appelez votre médiocrité, nous vous prions de nous aider à y parvenir; et si, comme vous le dites, nous ne sommes pas entièrement dépourvus des avantages que la nature seule peut donner, apprenez-nous, de grâce, ce qu’il faut y ajouter.
XXX.–«Rien, Cotta, dit Crassus en souriant, que ce zèle, cette passion sans laquelle on ne fait rien de grand dans la vie, et qui seule peut nous donner la gloire où vous aspirez. Je ne crois pas, au reste, que vous ayez besoin d’être stimulés, vos instances auprès de moi témoignent assez de votre impatience. Toutefois, le désir d’arriver ne sert de rien si l’on ne connaît le chemin qui mène au but. Aussi, dès là que, vous montrant à mon égard moins exigeants, vous ne demandez pas que je vous expose la théorie de l’art oratoire, mais seulement la méthode que j’ai suivie, laissant de côté tout système qui aurait la prétention d’être profond et mystérieux, je vous dirai simplement ce que j’ai fait dans ma jeunesse, lorsque j’avais le loisir de me livrer à cette étude.
–«0jour tant de fois désiré! s’écria alors Sulpicius, nous allons enfin connaître de Crassus ce que toutes mes prières, mes ruses, mes détours, mes questions à Diphile, n’avaient pu m’apprendre ou me faire entrevoir au sujet de sa composition, de son élocution; et c’est Crassus lui-même qui va nous découvrir le secret que nous cherchons depuis si longtemps.
XXXI.–«Je crains bien, reprit Crassus, qu’après m’avoir entendu vous ne soyez moins surpris de mes paroles que de votre empressement à les entendre; car, je vous le répète, je ne prétends vous dire rien d’extraordinaire, rien qui réponde à votre attente, rien qui ne soit connu de vous, de tout le monde. Et d’abord, en homme franc et sincère, je commencerai par avouer que j’ai rempli ma mémoire de tous ces préceptes vulgaires qu’on apprend à l’école:–que le premier devoir de l’orateur est de parler de manière à produire la persuasion;– qu’ensuite le discours s’applique à une question indéfinie sans désignation de temps ni de personnes, ou à une question déterminée par les considérations de temps et de personnes: que dans ces deux cas, quel que soit le sujet de la contestation, on examine si le fait est arrivé, puis quelle en est la nature ou quel nom il faut lui donner, ou encore, suivant quelques-uns, s’il est juste ou injuste;–que la discussion a souvent pour objet l’interprétation d’un acte lorsqu’il s’y trouve quelque équivoque, quelque opposition entre le sens et la lettre; que chacun de ces différents cas a ses moyens qui lui sont propres; que dans les causes qui n’appartiennent pas à la question générale on distingue deux genres: le judiciaire et le délibéraiif; qu’il en existe encore un troisième, qui a pour objet l’éloge et le blâme;–que chacun de ces trois genres a ses lieux communs: que dans le premier, par exemple, on cherche de quel côté est la justice; dans le second, on examine ce qui est utile à ceux que l’on conseille, et dans le troisième, enfin, on développe tout ce qui est à l’avantage de ceux dont on fait l’éloge;–que toute la puissance, la tactique de l’orateur se divise en cinq parties: trouver les pensées qui doivent faire le fond du discours; les ranger non seulement dans un ordre convenable, mais les distribuer, les grouper avec discernement, avec habileté, de manière à leur donner plus de force; les parer des ornements de la diction, les imprimer fortement dans sa mémoire, les débiter avec grâce, avec noblesse. J’appris encore qu’avant d’aborder la discussion il faut commencer par nous concilier les auditeurs, ensuite raconter le fait, préciser la question, fortifier nos moyens, réfuter ceux de nos adversaires, et enfin en terminant le discours amplifier et rehausser ce qui nous est favorable, atténuer et détruire ce qui nous est contraire.
XXXII.–» J’étudiai également les préceptes qu’on donne sur l’élocution, lesquels sont: d’abord la pureté et la correction du langage, la clarté. la netteté, l’élégance, enfin la bienséance et la convenance du style avec le sujet. J’appris tout ce qu’on enseigne sur chacune de ces qualités; je vis même que l’art cherchait à régler ce qui dépend le plus de la nature; je retins quelques principes sur la prononciation et la mémoire, et je m’exerçai à les mettre en pratique.–
» Tels sont à peu près les points essentiels sur lesquels porte la doctrine des rhéteurs; j’aurais tort de prétendre qu’elle est inutile. Elle éclaire l’orateur, elle guide sa marche, elle lui montre le but où il doit tendre et l’empêche de s’en écarter, mais je n’en reconnais pas moins la limite où doit s’arrêter la puissance des préceptes; ils n’ont pas formé les grands orateurs. Seulement on a observé la marche du génie guidé par la nature, et on a cherché à suivre ses traces. Ainsi ce n’est pas l’éloquence qui est un produit de l’art, mais c’est l’art qui est venu à la suite de l’éloquence. Cependant, je le répète, je suis loin de vouloir le rejeter. S’il n’est pas pour l’orateur d’une absolue nécessité, c’est du moins une connaissance digne d’orner son esprit. Il est encore un exercice auquel je vous conseille de vous livrer: vous y gagnerez, bien que déjà avancés dans la carrière; mais il sera plus utile à ceux qui se disposent à la parcourir, car ce qu’un jour ils seront obligés de faire au Forum, comme dans un combat, ils peuvent aujourd’hui, en se jouant, le prévoir et s’y préparer.
–«Nous sommes tout disposés à vous écouter sur ce point, dit Sulpicius, malgré notre envie de vous entendre développer les principes de l’art oratoire. Nous en avons bien quelque idée, mais vous n’avez fait que les indiquer; quoi qu’il en soit, remettons les à un autre moment, et dites-nous ce que vous pensez sur cet exercice dont vous nous parliez tout-à l’heure.
XXXIII.–J’approuve entièrement, reprit Crassus, l’usage où vous êtes de supposer une cause analogue à celles qui se plaident au barreau, et de la traiter comme si elle était véritable; mais la plupart en cela songent moins à régler les intonations de leur voix qu’à lui donner plus de force et d’étendue; ils s’habituent à la volubilité, et se complaisent dans un flux de paroles. Or, ce qui les trompe est qu’ils ont entendu dire qu’en parlant on apprend à parler; mais on peut dire aussi avec vérité qu’en parlant mal on apprend très-vite à mal parler; de sorte que s’il est utile dans ces exercices de parler souvent sans préparation, il l’est plus encore de prendre du temps pour réfléchir, méditer son sujet et le traiter avec soin. Or, la méthode, il faut le reconnaître, la plus efficace, et celle aussi que nous suivons le moins, à cause du travail qu’elle exige et que nous cherchons tous à éviter, c’est d’écrire beaucoup. La plume est le meilleur et le plus habile maître d’éloquence, et cela doit être; car si un discours préparé d’avance par la méditation l’emporte sur une improvisation soudaine et rapide, celui-ci même le cèdera à une composition écrite avec soin et épurée par un travail assidu. En effet, nous sommes nous étudiés à rechercher tous les développements que comporte notre sujet, qu’ils soient du domaine de l’art ou n’appartiennent qu’au talent, si notre esprit s’y est appliqué de toutes ses forces, ils apparaissent et se présentent comme d’eux-mêmes; alors les pensées tes plus brillantes, les expressions les plus heureuses, selon la nature de la composition, viennent nécessairement se placer sous la plume; les mots se rangent dans un ordre régulier; et les périodes se forment, sinon à la mesure des poètes, du moins au nombre qui convient à la parole de l’orateur. Telles sont les qualités qui dans l’homme éloquent le font admirer et applaudir, et qu’il demanderait en vain à ces déclamations improvisées, et mille fois répétées, si depuis longtemps il ne s’est appliqué à écrire; car celui qui avant de monter à la tribune a su se former à cette précieuse habitude obtient cet avantage que lors même qu’il parle sans préparation, il semble encore avoir écrit tout ce qu’il dit; et si après n’avoir confié au papier qu’une partie de son discours, il s’abandonne pour le reste aux inspirations de sa pensée, l’auditeur ne s’apercevra d’aucun changement dans la diction. Comme un navire lancé sur les flots, lorsque les rameurs s’inclinent en avant, s’avance et continue à voguer en attendant un autre coup de rame et une nouvelle impulsion, ainsi pour le discours, le manuscrit de l’orateur vient-il à s’arrêter, sa parole n’en témoigne aucune interruption, animée qu’elle est par ce qui précède et qu’elle continue.
XXXIV.–» Dans les études de ma première jeunesse, j’essayai d’un exercice que je savais avoir été pratiqué souvent par C. Carbon, aujourd’hui notre ennemi. Je faisais choix d’un beau fragment de prose ou de poésie, je le lisais; et lorsque je m’en étais bien pénétré, je m’appliquais à le rendre sous une autre forme, la meilleure que je pouvais trouver; mais je ne tardai pas à m’apercevoir du vice de cette méthode, Ennius, si j’avais cherché à refaire quelques-uns de ses vers, Gracchus, si j’avais pris pour modèle un de ses discours, s’étant toujours arrêté à l’expression la plus juste et la plus élégante: ainsi ce travail m’était inutile si je me servais des mêmes termes, et préjudiciable si j’en employais d’autres, parce qu’il m’habituait à ne pas choisir ceux qui étaient les meilleurs. Plus tard je me livrai à une autre pratique, et je la continuai pendant toute ma jeunesse: c’était de traduire les discours des plus grands orateurs de la Grèce; et ce travail me fut utile, car, m’étudiant à rendre en latin ce que j’avais lu en grec, non-seulement je devais me servir des meilleures expressions en usage parmi nous, mais l’imitation pouvait encore m’en faire trouver d’autres, qui, pour être nouvelles dans notre langue, n’en seraient pas moins convenables. Pour ce qui regarde la voix, la respiration, le geste, les mouvements de la langue, on a moins besoin d’art que d’exercice; en tout cela l’essentiel est de bien choisir les modèles sur lesquels on veut se former. Or, nous devons étudier non-seulement la manière des orateurs, mais celle des bons comédiens si nous voulons ne contracter aucune habitude vicieuse. Il nous faut aussi exercer notre mémoire en apprenant par cœur le plus possible, soit de nos propres ouvrages, soit des autres, et dans cet exercice je trouve qu’on ne fera pas mal, si on y est habitué, d’avoir recours à ces moyens, suggérés par l’art, qui se tirent de l’image des lieux et de la considération des objets. Enfin, notre éloquence s’est-elle suffisamment éprouvée à l’ombre du cabinet, il faut la produire sur l’arène, au milieu de la poussière et des cris, du tumulte et des combats du Forum; il faut qu’elle s’accoutume aux regards de la foule, à mettre en œuvre toute sa puissance, à dévoiler tous ses secrets. On doit aussi étudier les poètes, connaître l’histoire, lire et relire les bons écrivains et les maîtrès en tout genre; puis, pour se former le goût, les louer, les commenter, les corriger, les critiquer, les réfuter, soutenir successivement le pour et le contre, trouver et exprimer tout ce qu’un sujet peut fournil à l’orateur. Ajoutez la science du droit civil, l’étude des lois, là connaissance de l’antiquité, des usages du sénat, des principes de notre gouvernement, des droits des alliés, des traités, des conventions, des différents intérêts de l’empire. Enfin, il faut savoir assaisonner tout cela de cette grâce polie et railleuse, qui est comme le piquant du discours. Je viens de vous dire tout ce que je sais; le premier venu que vous auriez interrogé aurait pu vous enapprendre autant.»
XXXV.–Lorsque Crassus eut fini de parler, il se fit un moment de silence. Chacun, il est vrai, sentait qu’il en avait dit assez pour répondre aux questions qu’on lui avait faites; mais cependant il n’était personne qui n’eût désiré le voir s’exprimer d’unes manière moins succinte. Alors Scévola, s’adressant à Cotta: «Comment1vous gardez le silence? N’avez-vous donc plus rien à demander à Crassus?– C’est à quoi je pensais, répondit Cotta. Le discours de Crassus a été si prompt; les mots se succédaient! avec tant de rapidité, que j’en ai bien senti le mouvement et la force; mais c’est à peine si j’ai pu en suivre la marche et le développement. Je ressemble à un homme qui serait entré dans une maison magnifique et remplie des objets les plus précieux, mais dont les meubles, l’argenterie, les statues et les tableaux, couverts d’un voile, resteraient soigneusement cachés. Ainsi Crassus vient de nous montrer comme enveloppés et couverts sous le voile des paroles les trésors de son esprit. J’étais impatient de les contempler; à peine ai-je eu le temps de les apercevoir. Je ne saurais donc prétendre qu’ils me soient tout à fait inconnus, et je ne puis dire non plus que j’en aie une idée bien distincte.–Que ne faites-vous donc, reprit Scévola, comme vous feriez dans cette maison magnifique dont vous nous parliez, siles meubles en étaient voilés; désirant les voir, vous n’hésiteriez pas à prier le possesseur, surtout s’il était votre ami, de vous les montrer. Adressez-vous de même à Crassus; il a accumulé dans un espace trop étroit des richesses qu’il ne nous a laissé entrevoir qu’en passant; priez-le de nous les exposer en mettant chaque objet à la place qui lui convient. C’est à vous, Scévola, à nous rendre ce service; ni Sulpicius ni moi n’oserions faire cette demande à Crassus. Nous savons qu’il dédaigne ce genre d’entretien, et nous craindrions de l’interroger sur des choses qu’on n’enseigne qu’à des enfants. Mais vous-même, Scévola, soyez notre intercesseur, et obtenez de Crassus qu’il étende et développe ce qu’il a resserré dans un discours trop concis.–Si j’ai désiré, répondit Scévola, que Crassus parlât sur cette matière, c’était plutôt pour vous que pour moi; car j’ai merais mieux le voir plaider au barreau que l’entendre dans cette discussion. Cependant, comme nous avons plus de loisir que nous n’en avons jamais eu, c’est aussi en mon nom, Crassus, que je vous prie d’achever l’édifice que vous avez commencé; le plan que vous en avez tracé dépasse de beaucoup l’idée que je m’en étais faite, et je lui donne toute mon approbation.
XXXVI.–«Je ne puis assez m’étonner, reprit Crassus, que vous aussi, Scévola, vous exigiez de moi des explications sur un sujet que je suis loin de posséder comme les maîtres, et qui même, en fût-il ainsi, ne mériterait pas de fixer l’attention d’un homme aussi éclairé que vous.–Que dites-vous? répondit Scévola. Si vous pensez que ces préceptes vulgaires de la rhétorique sont à peine dignes d’intéresser ces jeunes gens, croyez-vous encore qu’il nous soit permis de négliger ces lumières, que vous regardez comme indispensables à l’orateur, la philosophie, la morale, l’art d’exciter ou de calmer les passions, l’histoire, l’antiquité, l’administration de l’Etat; enfin, le droit civil, dont j’ai fait une étude particulière? Je savais bien que votre esprit s’était enrichi de cette foule de connaissances; mais je ne croyais pas que l’orateur dût se composer un bagage aussi complet..
XL.–«Si donc sur tous ces points et d’autres semblables on ignore les lois de son pays, marcher fièrement la tête droite et haute, promenant de tous les côtés un regard satisfait et assuré, parcourir le Forum entouré d’un corlége nombreux, proposant, offrant à ses clients sa protection, à ses amis son appui, et presque à tous ses concitoyens le flambeau de son génie et de ses conseils, n’est-ce pas, il faut en convenir, le comble de l’effronterie?
XLI.–» Or, après avoir dit un mot sur la présomption de quelques hommes, faisons-les rougir encore de leur apathie et de leur paresse.–Que si, en effet, l’étude du droit était longue et pénible, les avantages qu’elle présente seraient encore suffisants pour nous faire surmonter l’ennui du travail. Mais, grand Dieu! pourquoi hésiter à le dire en présence de Scévola, puisqu’il en est convenu mille fois lui-même, il n’est point de connaissance plus facile à acquérir; et si on pense généralement le contraire, il est aisé d’en donner la raison. Premièrement, ceux qui dans les siècles précédents ont possédé cette science en ont fait un mystère pour augmenter leur crédit; ensuite, lorsqu’elle fut mieux connue et que M. Flavius eut exposé les diverses formes d’action, il ne se trouva personne qui sût donner à tous ces éléments un ordre méthodique. En effet, pour réduire en art des observations particulières, il ne suffit pas de bien connaître le sujet qu’on traite, il faut encore avoir le talent de réunir ces observations en un corps de doctrine. Mais peut-être qu’en voulant être précis je me suis exprimé d’une manière un peu obscure. Je vais m’expliquer et parler, s’il est possible, plus clairement.
XLII.–«Tous les éléments dont se compose aujourd’hui la théorie des arts étaient autrefois disséminés et sans liaison. Ainsi–pour la musique les mesures, les tons, les modes;–pour la géométrie, les lignes, les figures, les distances, les grandeurs;–pour l’astronomie, les révolutions du ciel, les mouvements, le lever et le coucher des astres;–pour la grammaire, l’explication des poètes, l’étude de l’histoire, la valeur des mots et leur prononciation;–enfin pour la rhétorique, l’invention et la disposition des pensées, les ornements du discours, la mémoire et l’action, tout cela était mal connu et dans une confusion générale. Il a donc été nécessaire d’avoir recours à une méthode particulière, méthode que revendiquent les philosophes, et qui, supérieure à celles des autres arts, a pu rapprocher ces éléments dispersés et les enchaîner par un lien commun.
«Commençons donc par définir le droit civil l’application d’une justice exacte et convenue aux intérêts, aux différends des citoyens. Ensuite nous distinguerons les genres et. les réduirons à un petit nombre. Or, le genre est ce qui renferme deux ou plusieurs parties semblables entre elles par une apparence commune, mais différentes, par quelque chose de particulier. Quant aux parties, elles sont les subdivisions du genre qui les comprend toutes, et il importe d’indiquer par des définitions le sens des noms qui expriment les genres ou les espèces. Une définition, en effet, n’est que l’explication courte et précise des qualités particulières à la chose que l’on veut faire connaître. J’ajouterais bien ici des exemples; mais je sais à qui je m’adresse. Qu’il me suffise d’exposer brièvement ce que j’ai avancé. Si je puis réaliser un projet que j’ai formé depuis longtemps, ou si, mes occupations m’en empêchant, quelque autre l’exécute à ma place; s’il parvient à ramener le droit civil à un petit nombre de genres, à distinguer leurs espèces, à donner à chacune d’elles la définition qui lui convient, vous aurez alors une histoire générale du droit civil, moins difficile ou obscure que simple et lumineuse. Or, en attendant que les membres épars de cette science aient été rapprochés, on peut encore, en les réunissant çà et là, en les rassemblant, s’en former une idée assez complète.
XLIII.–» Voyez, en effet, C. Aculéon, chevalier romain, qui est et fut toujours mon ami, homme, il est vrai, d’un esprit supérieur, mais peu versé dans les autres arts. Est-ce que pour le droit civil il n’en est pas venu à un tel degré de science que, si vous en exceptez celui qui nous écoute, aucun de nos jurisconsultes les plus habiles ne lui est préféré? C’est que dans l’étude du droit les choses sont comme exposées sous nos yeux. L’expérience journalière, le commerce des hommes, l’usage du barreau, tout contribue à nous instruire; et puis on n’a pas besoin de consulter de longs écrits et des ouvrages volumineux: les mêmes questions se sont souvent présentées, et elles ont été souvent traitées par les mêmes écrivains, presque dans les mêmes termes. Ajoutez, à cela, ce qu’on a peine à croire, que cette étude est accompagnée d’un charme particulier, qui en diminue la difficulté. Ainsi, avons-nous du goût pour l’érudition, les lois civiles, le recueil des Douze Tables, les livres des pontifes nous retracent à chaque instant les souvenirs de l’antiquité; nous y retrouvons le vieux langage de nos pères, et les exemples qui s’y rencontrent nous font connaître leurs mœurs et leurs usages. Veut-on s’attacher à la politique, cette science que Scévola croit étrangère à l’orateur, on la trouvera toute entière dans les Douze Tables, qui règlent ce qui concerne les intérêts et l’ordre des Etats. Enfin, si la philosophie, ce fondement glorieux des autres sciences, a pour vous quelque charme, j’ose dire que c’est dans les lois et le droit civil que vous trouverez le sujet de ses plus graves méditations. Ce sont elles, en effet, qui nous portent à être justes, lorsque nous les voyons décerner à la droiture, à la justice, à la probité, la renommée, les honneurs, les récompenses; tandis qu’elles flétrissent le vice et la mauvaise foi par des amendes, par l’ignominie, la prison, les verges, l’exil et la mort. Et ce n’est pas par de froides leçons, par des discussions vaines et obscures qu’elles nous instruisent, mais d’un mot leur autorité nous apprend à dompter nos passions, à mettre un frein à nos désirs, et, tout en défendant nos propriétés, à ne jamais porter sur celles d’autrui nos yeux, nos mains, notre pensée.
XLIV.–» Que tout le monde se récrie, je n’en dirai pas moins ce que je pense. Le petit livre des Douze Tables, source et principe de nos lois, me semble préférable à tous les livres des philosophes par son autorité imposante et par son utilité. Et si, comme la nature nous en fait un devoir, nous aimons notre patrie, si telle est la puissance de ce sentiment que le plus sage des héros préférait à l’immortalité sa misérable Ithaque, suspendue comme un nid sur la pointe des rochers, de quel amour ne devons-nous pas être enflammés pour une patrie qui, seule dans le monde entier, est comme le sanctuaire de la vertu, du commandement et de la gloire? Nous devons étudier avant tout son esprit, ses usages, ses institutions, et parce qu’elle est notre patrie, notre mère commune, et parce ce que nous devons être persuadés qu’elle a réglé les droits de ses enfants avec la même sagesse qui a présidé à l’accroissement de son empire. Outre cela, en vous livrant à cette étude, vous aurez encore le plaisir, l’orgueil de reconnaître la supériorité de nos ancêtres sur toutes les autres nations, si vous comparez nos lois avec celles de Lycurgue, de Dracon, de Solon. On ne saurait croire, en effet, quel désordre, à peine que je ne dise ridicule, règne dans presque toutes les législations, moins la nôtre. C’est un point sur lequel j’aime à insister, lorsque je veux prouver que les autres nations, et surtout les Grecs n’approchèrent jamais de la sagesse de nos Romains; et voilà pourquoi, Scévola, j’ai prétendu que la connaissance du droit civil était nécessaire à celui qui voulait devenir un parfait orateur.
XLV.–» Qui ne sait d’ailleurs combien celte science procure à ceux qui la possèdent d’honneurs, de crédit et de considération? Aussi, n’est-ce pas à Rome comme dans la Grèce, où pour un modique salaire, des hommes de la plus basse condition, sous le nom de praticiens, viennent offrir leurs services dans les tribunaux. Ici, au contraire, les citoyens les plus considérables, les plus illustres se livrent à cette étude. C’est ainsi que l’un d’eux, renommé pour son savoir en jurisprudence, a fait dire au poète:
Egregie cordatus homo, catus Æliu, Sextus;
et que beaucoup d’autres, tout en ne devant qu’à leur mérite leur réputation, ont obtenu cependant comme jurisconsultes une autorité qu’ils auraient demandée en vain à leur seul mérite; et puis, quelle occupation plus noble, plus digne! quel refuge plus honorable pour la vieillesse que l’interprétation des lois! Quant à moi, dès ma jeunesse je me suis ménagé cette ressource, soit pour la pratique du barreau, soit pour répandre quelque lustre, quelque gloire sur mes vieux jours, afin que lorsque mes forces commenceraient à diminuer, et ce moment, je le sens, n’est pas éloigné, je pusse au moins préserver ma demeure de cette solitude que l’âge fait autour de nous. Quoi de plus beau, en effet, pour un vieillard, après une carrière remplie d’honneurs, de dignités, que de pouvoir, comme Apollon dans Ennius, se glorifier de diriger par ses conseils, sinon les peuples et les rois, du moins tous ses concitoyens:
Suarum rerum incerti; quos ego mea ope ex
incertis certos, compotesque consilii
mitto, ut ne res temere tractent turbidas.
C’est que la maison du jurisconsulte est comme l’oracle de la cité; témoin Mucius, qui, malgré son grand âge et ses infirmités, n’en voit pas moins chaque jour une foule de citoyens des plus illustres encombrer ses portiques.
XLVI.–» Maintenant, je ne crois pas avoir besoin d’un long discours pour vous prouver que l’orateur doit aussi connaître ce qui fait loi dans Rome et dans l’empire, les événements historiques et les belles actions de nos ancêtres; car si, au barreau, celui qui défend la cause d’un particulier est souvent obligé d’emprunter ses raisonnements au droit civil, ce qui lui en rend, comme je l’ai dit plus haut, la science nécessaire, dans la discussion des intérêts publics devant les tribunaux, le peuple ou le sénat, c’est dans la connaissance exacte du passé, dans l’intelligence du droit commun et des principes du gouvernement que l’orateur devra également chercher ses matériaux. Il n’est point, en effet, question ici d’un avocat médiocre ou d’un obscur déclamateur, mais de nous représenter l’homme supérieur dans cet art, que la nature, il est vrai, a placé en germe dans notre âme, mais que nous avons préféré attribuer à un Dieu, afin que ce talent, bien que naturel en nous, y parût cependant moins le résultat du travail que d’une inspiration divine; de trouver un homme qui, sans caducée et n’ayant d’autre titre que celui d’orateur, n’ait rien à redouter d’une armée ennemie; dont la parole suffise pour livrer le crime à l’indignation publique et au châtiment des lois; qui par son éloquence puisse protéger l’innocent contre une injuste poursuite, ranimer un peuple engourdi, réveiller en lui le sentiment de l’honneur, le ramener de son égarement, l’irriter contre les méchants, ou détruire la haine qu’on lui a inspirée contre les bons; un homme, enfin, qui, n’importe la passion nécessaire à sa cause ou a son intérêt, sache par son discours la provoquer ou l’apaiser.
» Si quelqu’un s’imagine que les rhéteurs ont jamais dévoilé le secret d’une telle éloquence, ou que j’aie pu le faire moi-même en si peu de mots, il se trompe étrangement. Loin de connaître mon insuffisance, il ne soupçonne pas même la grandeur d’un pareil sujet. Il est vrai que, cédant à vos instances, j’ai cru devoir vous indiquer les sources où vous pourriez puiser et le chemin qui y conduit. Mais loin de prétendre vous servir de guide, ce qui serait prendre une peine infinie et superflue, j’ai voulu seulement, je le répète, vous indiquer le chemin et, comme on dit, vous montrer la source du doigt.
XLVII.–«Il me semble, Crassus, répondit Scévola, que vous en avez dit assez pour exciter le zèle de ces jeunes gens, si toutefois ils en ont un réel; car ainsi que Socrate aimait à répéter que sa mission était remplie du moment qu’il était parvenu à faire naître dans ses disciples le désir de connaître et de pratiquer la vertu, persuadé que lorsqu’on est résolu à la préférer à tout, on n’a plus besoin de leçons; de même pour ces jeunes gens, je trouve que s’ils veulent entrer dans la carrière ou les appelle votre discours, il leur sera aisé de parvenir au but en suivant la route que vous leur avez tracée.
–» Tout ce que nous venons d’entendre, dit alors Sulpicius, nous a été fort agréable; mais nous avons encore à vous demander, Crassus, quelques renseignements sur les règles de l’art, que vous n’avez fait qu’effleurer, en avouant cependant que vous étiez loin de les mépriser, et que même vous les aviez apprises. Si vous consentez à nous les développer, vous satisferez à un désir qui nous tourmente depuis long-temps; car si aujourd’hui nous savons ce qu’il nous faut étudier, ce qui est beaucoup sans doute, il nous reste à connaître le moyen ou la méthode qui peut nous l’enseigner.–Pour –vous retenir plus longtemps avec nous, reprit Crassus, j’ai plutôt consulté vos désirs que mon goût et mes habitudes. Je crois donc maintenant que nous ferons bien de nous adresser à Antoine, pour nous faire expliquer, ou plutôt révéler ces secrets de l’art qu’il possède et tient en réserve, et sur lesquels il regrettait tout-a l’heure d’avoir composé un ouvrage livré sans son aveu à la publicité.–Comme vous voudrez, répliqua Sulpicius; car en écoutant Antoine, nous entendrons vos propres sentiments.
–«Eh bien, Antoine, dit Crassus, puisque, sans égard pour notre âge et entraînés par leur désir de s’instruire, ces jeunes gens nous imposent une pareille obligation, souffrez que je m’unisse à eux, pour vous prier de nous dire ce que vous pensez sur le sujet qui nous est proposé.
XLVIII.–«Je me vois, répondit Antoine, engagé dans un mauvais pas. Non-seulement on me demande des’ choses que j’ignore et qui me sont f étrangères, mais ces jeunes gens me forcent de parler après vous, Crassus, ce que j’ai toujours soin d’éviter dans les causes que je défends. Quoi qu’il en soit, je me sens d’autant plus de confiance à : aborder cette discussion, que j’espère, comme dans mes discours ordinaires, ne pas être tenu à une diction étudiée. Je ne vous parlerai point, en effet, de l’art que je n’ai jamais appris, mais de mon expérience; et mon ouvrage lui-même ne contient pas autre chose, car les principes que j’y ai renfermés ne sont aucunement le produit de la science, mais de la connaissance des affaires que j’ai acquise au barreau. Si ma méthode vous paraît peu digne d’hommes aussi éclairés que vous, ne vous en prenez qu’à votre exigence, qui m’oblige à parler de choses que j’ignore; et sachez-moi gré au moins de ma complaisance, si, pour me rendre à vos désirs plutôt qu’à mon jugement, je ne vous ai pas fait une réponse satisfaisante.
–«Poursuivez, Antoine, dit Crassus. Vous n’avez rien à craindre; et vous parlerez, j’en suis sûr, avec une sagesse qui ne fera repentir aucun de nous de vous avoir provoqué à cette conversation.
–«Je vais donc continuer, reprit Antoine, et je commencerai par où devraient, ce me semble, commencer toutes les discussions. Je préciserai le sujet de la dispute de manière à empêcher que, nos observations ne portant pas sur un sujet commun, notre controverse ne tombe dans la confusion. En effet, si l’on venait à demander en quoi consiste la science d’un général, il me semble qu’il faudrait d’abord déclarer ce qu’on entend par général, et lorsqu’on serait convenu que c’est un homme chargé de diriger les opérations d’une guerre, nous traiterions successivement de l’armée, des campements, des manœuvres, des combats, de l’attaque des places, des convois, de l’art de dresser et d’éviter des embûches, enfin de tout ce qui concerne la guerre; et celui dont le génie pourrait embrasser tous ces objets, nous lui donnerions le nom de général, et nous citerions pour exemple Scipion, Fabius, Épaminondas, Annibal et d’autres guerriers illustres; de même, s’il était question du citoyen qui consacre à l’administration de la république ses soins, ses lumières et son expérience, je dirais: Celui qui sait reconnaître et employer les moyens d’assurer et d’augmenter la prospérité du pays, celui-là est le véritable homme d’État, capable de le diriger et de l’éclairer, et je nommerais P. Lentulus, cet illustre prince du sénat, Gracchus le père, Q. Metellus, Scipion l’Africain, Lélius, ainsi qu’une foule d’autres, soit parmi nous, soit parmi les différents peuples. Si, au contraire, on me disait: Qui doit-on désigner sous le titre de jurisconsulte? je répondrais celui qui, instruit des lois et des coutumes de son pays, peut donner des conseils aux citoyens qui le consultent, les diriger, défendre leurs intérêts, et je citerais Sex. Élius, M. Mamillus, et Scévola.
XLIX.–«Pour en venir à des arts moins importants, est-il question du musicien, du grammairien, du poète, je pourrais également déterminer ce qu’ils recherchent et ce qu’on est en droit de leur demander. Enfin, il n’est pas jusqu’au philosophe, dont la science a la prétention de tout embrasser, qu’il ne soit aussi possible de définir. Ainsi, j’appellerai de ce nom celui qui s’applique à connaître l’origine, la nature et l’action de toutes les choses divines et humaines, les conditions et la pratique d’une vie honnête. Quant à l’orateur, objet de nos recherches, je ne m’en fais pas la même idée que Crassus, qui me paraît avoir compris sous ce nom et sous ce titre une science presque universelle; pour moi, je ne lui impose d’autre obligation à la tribune ou au barreau, que de flatter l’oreille par son élocution, et contenter la raison par son jugement. Je veux encore qu’il soit doué d’un organe agréable, qu’il ait de la grâce dans son action. Tel est celui que j’appellerai orateur; au lieu que Crassus, à ce qu’il me semble, l’a moins défini d’après les limites de l’art que d’après l’étendue presque infinie de son talent. En effet, il met au nombre de ses attributions le gouvernement des États; sur quoi, Scévola, je m’étonne que vous lui accordiez cette prétention, vous qui, dans les délibérations les plus importantes, par quelques mots simples et précis avez si souvent entraîné le sénat à votre opinion. Au reste, le plus grand de nos hommes d’État, M Scaurus, se trouve en ce moment près d’ici à sa campagne. S’il apprenait, Crassus, que vous revendiquez l’autorité imposante de son caractère et de ses conseils pour en faire la propriété de l’orateur, je suis sûr qu’il viendrait au milieu de nous, et que sa présence, son regard suffirait pour comprimer notre bavardage; car, bien qu’il ne soit pas sans éloquence, c’est moins à l’art de parler qu’à sa haute raison qu’il doit son ascendant. Mais je suppose qu’on réunisse ces deux avantages, un homme n’est pas orateur par cela même qu’il est supérieur dans les conseils publics et au sénat, ou bien administrateur habile, parce qu’il est éloquent et disert; ces talenls si différents n’ont rien de commun. Ils ne sauraient être confondus, et ce n’est pas par les mêmes moyens que M. Caton, Scipion l’Africain, Q. Métellus, C. Lélius, tous hommes éloquents, faisaient de beaux discours et ajoutaient à la gloire de la république.
» En effet, ni la nature, ni les lois, ni l’usage n’empêchent que le même homme ne s’applique à la fois à plusieurs arts différents. Ainsi, de ce que Périclès fut le premier orateur d’Athènes, et présida pendant plusieurs années au gouvernement de cette ville, il ne faut pas en conclure que ces deux talents doivent être rapportés au même art et à la même personne; et si P. Crassus, homme éloquent, fut en même temps profond jurisconsulte, il ne s’ensuit pas que le talent de la parole donne la science du droit civil. Que si, en effet, parce qu’un homme supérieur dans un art est parvenu à se rendre habile dans un autre, on voulait en induire que le second fait partie du premier, autant vaudrait dire que la paume et le jeu de dames font partie du droit civil, parce que le jurisconsulte Scévola excellait dans ces deux jeux. On serait également fondé à soutenir que les physiciens, comme disent les Grecs, sont en même temps poètes parce que le physicien Empédocle a composé un beau poëme. Cependant les philosophes eux-mêmes, malgré leur prétention à s’arroger le monopole d’un savoir universel, n’osent pas faire entrer dans le domaine de la philosophie la géométrie et la musique, bien que Platon, de l’aveu de tous, ait été supérieur dans l’une et dans l’autre. Mais si l’on veut absolument que l’orateur réunisse toutes les connaissances, il sera plus rai– sonnable de dire que parce que le talent de la parole ne doit pas être sec et nu, mais nourri et relevé par tout ce qui peut y répandre une aimable variété, il importe à un bon orateur d’avoir beaucoup entendu, beaucoup vu, beaucoup lu, beaucoup médité; ne s’étant point approprié ces connaissances, mais les ayant effleurées. Je conviens, en effet, qu’il doit se montrer habile, instruit de toutes choses, élégant et poli dans ses manières.
LI.–» Ne croyez pas au reste, Crassus, m’avoir ébranlé par cette affirmation solennelle, si commune aux philosophes, que l’orateur ne parviendra jamais à soulever ou apaiser les passions, ce qui fait toute la puissance de son art, s’il n’a pénétré les secrets de la nature, le cœur de l’homme, les ressorts qui le font agir, et par conséquent s’il est demeuré étranger à la philosophie, dont nous voyons qu’une foule d’hommes de talent et de loisir ont fait l’occupation de leur vie entière. Je suis loin de mépriser l’étendue et la multitude de leurs connaissances, je l’admire, au contraire, beaucoup; mais pour nous, dont la mission au Forum est de parler au peuple, il nous suffit de savoir et de dire ce qui est conforme à la nature de l’homme. Quel est, en effet, l’orateur habile et chaleureux qui, voulant irriter le juge contre son adversaire, s’est jamais trouvé embarrassé parce qu’il ne savait pas si la colère est une effervescence de l’âme ou un désir de vengeance. Quel est celui qui, cherchant à souffler toute autre passion dans l’âme des juges ou parmi le peuple, a eu recours au langage employé par les philosophes. Les uns proscrivent absolument toute passion, et regardent comme un crime de les inspirer aux juges; d’autres, plus indulgents et moins étrangers à la vie réelle, ne permettent qu’une émotion légère et peu profonde. Au contraire, est-il dans la vie habituelle quelque chose qui passe pour mauvais, incommode ou dangereux, l’orateur par ses paroles le rend encore plus mauvais, plus repoussant; comme aussi tout ce qui provoque les vœux et l’empressement du commun des hommes, il l’embellit et en augmente les séductions. Il ne veut pas, en se montrant seul raisonnable au milieu d’insensés, se faire traiter par ceux qui l’écoutent de Grec babillard, ou qu’admirant le talent et la science de l’orateur ils soient humiliés de leur sottise. Mais il sait si bien se concilier les esprits, il est si habile à manier les âmes et les sentiments, qu’il n’a pas besoin de recourir aux définitions des philosophes, et de chercher dans ses discours si le souverain bien est dans l’âme ou dans le corps, .s’il se trouve dans la vertu ou dans le plaisir; s’il est possible de réunir et de concilier ces deux choses, ou bien encore, ainsi qu’on le prétend, s’il n’y a rien qu’on puisse concevoir, connaître, savoir d’une manière certaine: toutes questions qui, je l’avoue, peuvent être l’origine de nombreux et de profonds systèmes, d’explications étendues et variées. Mais ce que nous cherchons, Crassus, est bien différend, il nous faut un homme à qui la nature et l’expérience aient donné assez de finesse et de pénétration pour scruter avec adresse dans l’âme de ses concitoyens, ou de ceux qu’il veut persuader, l’objet de leurs sentiments, de leurs opinions, de leurs désirs.
LII.–» Il faut qu’il étudie les tendances naturelles de l’âge, du rang, de la naissance; qu’il sache flatter les passions ou les croyances de ceux à qui il adresse ou doit adresser ses discours. Quant aux livres des philosophes, il fera bien de les réserver pour occuper son repos et les loisirs de Tusculum; et s’il avait jamais à parler de la justice et de la vertu, il se gardera bien d’avoir recours à Platon, qui, voulant traiter le même sujet, rêva je ne sais quelle chimère de république, tant ses idées sur la justice étaient éloignées de la vie pratique et des mœurs des cités…
LX.–» Pour ce qui regarde l’histoire, le droit public, la connaissance de l’antiquité et ces exemples dont l’orateur doit faire provision, tout cela est utile sans doute; mais si je n’en ai besoin, qui m’empêche d’avoir recours aux lumières de mon ami Longinus, dont la complaisance égale l’érudition? Je ne m’oppose pas non plus à ce que ces jeunes gens, comme vous les y engagiez tout à-l’heure, lisent et apprennent beaucoup, étudient tous les arts, se forment à la politesse; mais il me semble qu’ils auront alors bien peu de temps pour faire tout ce que vous exigez d’eux. Vous leur imposez des lois trop rigoureuses peut-être pour cet âge, mais nécessaires pour atteindre le but qu’ils se proposent. En effet, parler sans préparation sur toutes sortes de sujets, composer des discours avec soin et réflexion, les écrire comme vous l’avez recommandé, en disant que la plume était le meilleur maître d’éloqueuce, tout cela exige un travail opiniâtre. Comme aussi pour comparer ses discours avec les écrits des autres, pour savoir de prime abord indiquer les beautés ou les défauts d’une harangue, soutenir ou réfuter une opinion, il ne faut manquer ni de mémoire, ni d’attention.
LXI.–» Mais ce qui me paraît effrayant, et plus propre à décourager qu’à exciter notre zèle, c’est votre prétention à vouloir que chaque orateur soit dans son genre un Roscius. Vous ajoutez encore que l’auditeur approuve moins ce qui est bon, qu’il n’imprime le blâme à ce qui est mauvais; cependant, je ne crois pas qu’on nous juge avec la même sévérité que les comédiens. Ainsi, qu’un orateur ait la voix enrouée, on l’écoutera encore avec attention, parce que la cause intéresse pour elle-même. Mais que cela arrive à Esope, tout le monde se récriera. En effet, ce qui n’avait d’autre objet que de charmer l’oreille vient-il à la blesser, soudain nous en sommes froissés. Au lieu que dans l’éloquence il y a plus d’une source d’intérêt; et si tout n’est point parfait, ce qui est digne d’éloges ne laisse pas d’être apprécié.
; «Ainsi donc, pour en revenir à ce que je disais au commencement, donnons, suivant la définition de Crassus, le nom d’orateur à celui qui sait parler de manière à persuader; mais que, se renfermant dans la pratique du barreau et la défense des intérêts de l’Etat, il renonce à toutes les autres connaissances, pour nobles et belles qu’elles soient; que jour et nuit il s’occupe de son art, et prennent pour modèle celui qui de tous s’est montré le plus entraînant des orateurs, l’Athémien Démosthène; on sait qu’à force d’ardeur et de travail il parvint à triompher de ses imperfections naturelles. C’est ainsi que né bègue, au point de ne pouvoir prononcer la première lettre de son art, il s’appliqua tellement à corriger ce défaut, que personne ne parlait plus nettement que lui; il avait la respiration courte: il s’exerça si souvent à la retenir qu’il parvint, comme ses écrits nous l’apprennent, à prononcer deux fois sans respirer la même période. On dit encore qu’il mettait des cailloux dans sa bouche et récitait d’une haleine el à haute voix une longue tirade de vers, non en se tenant à la même place, mais en se promenant et en montant sur des lieux élevés. C’est ainsi, Crassus, qu’il convient d’exhorter ces jeunes gens au travail, à l’étude. Quant à ces connaissances si variées et si étendues qu’à force de zèle vous êtes parvenu à acquérir, je crois qu’il est permis à l’orateur de s’en dispenser et de ne pas les comprendre dans son domaine.»
LXII.–Lorsque Antoine eut cessé de parler, Sulpicius et Cotta parurent ne savoir à laquelle des deux opinions ils donneraient la préférence. Crassus reprit: «Vous faites de l’orateur une espèce de mercenaire, Antoine, et je ne sais même si vous pensez ce que vous venez de dire, ou si vous n’avez pas voulu faire usage de ce talent de réfuter que personne ne possède mieux que vous. Il est vrai que l’orateur peut revendiquer cette faculté; mais elle est aussi commune aux philosophes, et principalement à ceux qui aiment à discourir sur toutes sortes de sujets, et soutiennent également le pour et le contre. Pour moi, j’ai pensé qu’en parlant devant de tels auditeurs je ne devais pas me borner à indiquer ce que pouvait être un simple avocat, toujours cloué sur les bancs du barreau, mesurant sa parole à ce que demande l’intérêt de sa cause. Je me suis fait de l’orateur une plus haute idée, persuadé surtout que dans notre république il ne doit rien négliger de ce qui peut orner son éloquence. Quant à vous, qui réduisez l’orateur à une condition beaucoup plus modeste, il vous sera plus facile de nous apprendre ce que vous exigez de lui et les devoirs que vous lui imposez. Mais ce sera pour demain, aujourd’hui il me semble que notre entretien s’est assez prolongé. Il est temps que Scévola, qui doit aller à sa campagne, se repose en attendant que la chaleur soit passée, et pour nous-mêmes l’heure est venue de donner à notre santé les soins qu’elle réclame.»
Tout le monde fut de cet avis. «Je regrette, dit alors Scévola, d’avoir promis à Lélius de me trouver aujourd’hui à Tusculum. J’eusse été heureux d’entendre notre ami Antoine.» Puis, s’étant levé, il ajouta en souriant: «Je lui en veux moins, en effet, de s’être montré si sévère pour notre droit civil que je ne lui sais gré de nous avoir confessé qu’il ne le savait pas.»