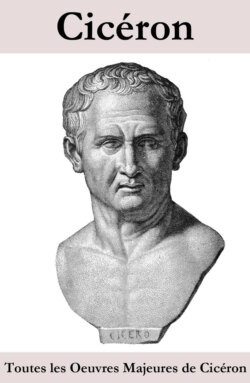Читать книгу Toutes les Oeuvres Majeures de Cicéron - Cicéron - Страница 10
LIVRE SECOND
ОглавлениеI. Crotone, célèbre par son opulence, et regardée comme une des plus heureuses villes d’Italie, voulut jadis orner de peintures excellentes le temple de Junon, sa divinité tutélaire. On fit venir à grands frais Zeuxis d’Héraclée, regardé comme le premier peintre de son siècle. Après avoir peint plusieurs tableaux, dont le respect des peuples pour ce temple a conservé une partie jusqu’à nos jours, l’artiste, pour donner dans un tableau le modèle d’une beauté parfaite, résolut de faire le portrait d’Hélène. Ce projet flatta les Crotoniates qui avaient entendu vanter le talent singulier de Zeuxis pour peindre les femmes ; et ils pensèrent que s’il voulait développer tous ses moyens et tout son talent, dans un genre où il excellait, il ne pouvait manquer d’enrichir leur temple d’un chef-d’œuvre.
Leur attente ne fut point trompée. D’abord Zeuxis demanda s’ils avaient de jeunes vierges remarquables par leur beauté. On le conduisit aussitôt au gymnase, où il vit, dans un grand nombre de jeunes gens, la figure la plus noble et les plus belles proportions : car il fut un temps où les Crotoniates se distinguèrent par leur vigueur, par l’élégance et la beauté de leurs formes, et remportèrent les victoires les plus éclatantes et les plus glorieuses dans les combats gymniques. Comme il admirait les grâces et la beauté de toute cette jeunesse : Nous avons leurs soeurs, vierges encore, lui dit-on ; ce que vous voyez peut vous donner une idée de leurs charmes. — Que l’on me donne les plus belles pour modèles dans le tableau que je vous ai promis, s’écria l’artiste, et l’on trouvera dans une image muette toute la vérité de la nature.
Alors un décret du peuple rassembla dans un même lieu toutes les jeunes vierges, et donna au peintre la liberté de choisir parmi elles. Il en choisit cinq ; les poètes se sont empressés de nous transmettre les noms de celles qui obtinrent le prix de la beauté, au jugement d’un artiste qui devait savoir si bien l’apprécier. Zeuxis ne crut donc pas pouvoir trouver réunies dans une seule femme toutes les perfections qu’il voulait donner à son Hélène. En effet, la nature en aucun genre ne produit rien de parfait : elle semble craindre d’épuiser ses perfections en les prodiguant à un seul individu, et fait toujours acheter ses faveurs par quelque disgrâce.
II. Et nous aussi, dans le dessein que nous avons formé d’écrire sur l’éloquence, nous ne nous sommes point proposé un modèle unique, pour nous faire un devoir d’en calquer servilement tous les traits, mais nous avons réuni et rassemblé tous les écrivains, pour puiser dans leurs ouvrages ce qu’ils renferment de plus parfait, pour en prendre en quelque sorte la fleur. Car si, parmi les écrivains dont le nom mérite d’être conservé, il n’en est aucun qui n’offre quelque chose d’excellent, il n’en est aucun aussi qui nous semble réunir toutes les parties. Il nous a donc paru que ce serait une folie de rejeter ce qu’il y a de bon dans un écrivain, à cause de quelques défauts, ou de le suivre dans ses erreurs, quand nous avons reçu de lui d’utiles préceptes.
Que si l’on voulait suivre cette marche dans les autres arts ; si, au lieu de s’asservir opiniâtrement à un seul maître, on voulait prendre de chacun ce qu’il a de meilleur, on verrait parmi les hommes moins de présomption, moins d’entêtement dans leurs erreurs et moins d’ignorance. Si j’avais pour l’éloquence le même talent que Zeuxis pour la peinture, peut-être mon ouvrage serait-il dans son genre supérieur au chef-d’œuvre sorti de son pinceau ; car j’ai eu à choisir parmi un plus grand nombre de modèles. Il n’a pu choisir, lui, que parmi les vierges d’une seule ville, et parmi celles qui vivaient à cette époque ; et moi, j’avais à ma disposition tous les écrivains qui, depuis l’origine de l’éloquence jusqu’à nos jours, ont donné des préceptes sur la rhétorique.
Aristote rassembla tous les anciens rhéteurs depuis Tisias, le premier inventeur de l’art, et recueillit avec le plus grand soin toutes leurs leçons. II les développe avec tant de détail et de netteté, l’élégance et la précision de son style lui donnent une telle supériorité sur les inventeurs eux-mêmes, que personne n’étudie plus les premiers rhéteurs dans leurs propres écrits,et que, pour connaître leurs préceptes, on s’adresse à ce philosophe, comme à un interprète plus clair et plus facile. Ce grand homme, en mettant sous nos yeux et son opinion et celle de ses prédécesseurs, nous apprend à les connaître en se faisant connaître lui-même ; et quoique les disciples sortis de son école aient, à l’exemple de leur maître, consacré presque tous leurs soins à l’étude des plus hautes questions de la philosophie, ils nous ont néanmoins laissé, comme lui, beau coup de préceptes sur l’éloquence. D’autres rhéteurs, sortis d’une autre école, ont aussi beaucoup contribué aux progrès de l’éloquence, si l’art y contribue en quelque chose ; car Isocrate, rhéteur habile et célèbre, était contemporain d’Aristote. Nous avons perdu ses leçons ; mais ses disciples et les imitateurs qui s’empressèrent de marcher sur leurs traces et sur celle de leur maître, nous ont transmis une foule de préceptes qui venaient de lui.
IlI. De ces deux écoles différentes, l’une, livrée à la philosophie, accordait aussi quelques moments à l’étude de l’art oratoire, et l’autre s’appliquait tout entière à la théorie et à la pratique de l’éloquence ; elles ont plus tard donné naissance à une troisième qui a emprunté des deux autres tous les secours qu’elles lui offraient. Pour moi, j’ai tâché de suivre en même temps, autant que je l’ai pu, et les plus anciens et ceux qui sont venus après eux, en mêlant quelquefois mes observations à celles de mes devanciers.
Si les préceptes que nous exposons dans cet ouvrage méritent tout le soin que nous avons apporté à les recueillir, nous ne saurions regretter un travail qui ne trouvera point d’improbateurs. Si pourtant nous avions dans notre empressement omis quelque chose, ou adopté quelque opinion peu fondée, il suffira de nous avertir de notre erreur pour que nous nous hâtions de la corriger ; car ce qui fait la honte, ce n’est pas l’erreur, mais la sotte opiniâtreté avec laquelle on s’y attache. L’une tient à la faiblesse humaine, l’autre est un vice particulier de caractère. Ainsi, sans rien affirmer, nous parlerons de chaque objet avec la circonspection du doute ; et si nous ne pouvons obtenir le petit avantage de passer pour avoir tracé nos préceptes avec assez de facilité et d’élégance, nous éviterons du moins l’écueil bien plus dangereux de donner à quoi que ce soit une approbation téméraire et arrogante. C’est un système que nous suivrons toujours, autant que possible, et aujourd’hui et dans tout le cours de notre vie. Maintenant, pour ne pas trop prolonger ces réflexions préliminaires, nous allons donner la suite des préceptes.
Avec la définition de la nature de l’éloquence, de son devoir, de sa fin, de sa matière et de ses parties, le premier Livre renfermait les différents genres de causes, l’art de trouver les moyens qu’elles renferment, les questions, les points à juger, enfin les parties de la composition oratoire, et des préceptes sur chacune d’elles. Tous ces sujets sont traités à part ; mais les règles de la confirmation et de la réfutation sont éparses parmi les autres. Nous allons donc donner, pour chaque genre de cause, des lieux distincts de confirmation et de réfutation ; et comme nous avons développé avec assez de soin, dans le premier Livre, la manière de traiter les preuves, nous nous contenterons d’exposer ici, avec simplicité et sans ornement, les raisons que chaque cause peut offrir. Ainsi on trouvera ici le fond des choses, et plus haut l’art de les développer. Ce que nous allons dire se rattache donc aux différentes parties de la confirmation et de la réfutation.
IV. Toute cause, ou démonstrative, ou délibérative, on judiciaire, doit nécessairement se rapporter à un ou à plusieurs des genres de questions établis plus haut. Quoiqu’on puisse donner pour tous des principes généraux, chaque genre a néanmoins des règles différentes et particulières ; car on ne saurait employer la même méthode pour louer, blâmer, accuser, défendre, ou pour énoncer une opinion. Dans le genre judiciaire, on cherche ce qu’exige la justice ; dans le démonstratif, ce que commande l’honneur ; dans le délibératif, l’honneur et l’intérêt, du moins à notre avis ; car d’autres veulent qu’en persuadant ou dissuadant, on n’ait d’autre but que de chercher et d’exposer ce qui est conforme à l’intérêt.
Des genres qui ont une fin, un but différents, ne peuvent donc avoir la même méthode. Ce n’est pas que nous prétendions qu’ils ne peuvent offrir des questions semblables ; mais le fond même et le genre de la cause est quelquefois de faire connaître la vie d’un homme ou d’énoncer une opinion. Ainsi, nous allons donner maintenant des préceptes sur le développement des points de discussion et sur le genre judiciaire ; on pourra aisément en appliquer le plus grand nombre aux différents genres de causes qui offriront les mêmes difficultés : nous traiterons ensuite de chaque genre en particulier.
Commençons par un exemple de la question de conjecture, ou question de fait : « Un voyageur rencontre un marchand qui s’était mis en route pour faire quelque acquisition, et qui portait avec lui de l’argent. Bientôt, comme c’est l’ordinaire, ils lient conversation, et une espèce d’intimité s’établit entre eux pour le reste du voyage. Ils s’arrêtent à la même hôtellerie, et annoncent l’intention de souper ensemble et de coucher dans la même chambre. Le repas terminé, ils se retirent ensemble. L’hôte (il en fit depuis l’aveu, quand il se vit convaincu d’un autre crime) avait remarqué celui qui portait de l’argent. Au milieu de la nuit, quand il juge que la fatigue les a plongés dans un profond sommeil, il entre dans leur chambre, tire l’épée du voyageur qui l’avait placée près de lui, égorge le marchand, s’empare de son argent, remet l’épée sanglante dans le fourreau, et va se mettre au lit. Cependant le voyageur, dont l’épée avait servi à commettre le crime, s’éveille longtemps avant le jour, et appelle à plusieurs reprises son compagnon de voyage. Comme il ne répondait point, il le croit endormi, prend son épée, son bagage, et se met seul en route. Bientôt l’aubergiste s’écrie qu’on a assassiné un homme, et poursuit avec quelques-uns de ses hôtes le voyageur qui venait de partir à l’instant même. Il l’atteint, l’arrête, tire son épée du fourreau, et la trouve ensanglantée. On ramène à la ville celui qu’on croit l’assassin, on le met en jugement. » Vous avez tué, dit l’accusateur. Je n’ai pas tué, répond le défendeur. De là naît la question. Le point de discussion, comme le point à juger, a-t-il tué ? appartient au genre conjectural, c’est-à-dire à la question de fait.
V. Nous allons maintenant traiter des lieux dont toute question conjecturale peut offrir quelques-uns, et nous ferons ici une remarque générale ; c’est que tous ne se rencontrent pas dans toutes les causes. Pour écrire un mot, on n’emploie que quelques lettres, et non pas l’alphabet entier. Ainsi, dans une cause, on ne se sert pas de toutes les espèces de raisonnements, mais de ceux-là seuls qui sont nécessaires. Toute conjecture doit se tirer du motif, de la personne, ou du fait même.
Dans le motif, on distingue la passion et la préméditation. La passion est une affection violente de l’âme, qui nous pousse à une action sans nous laisser le temps de réfléchir, comme l’amour, la colère, la douleur, l’ivresse, et en général tout ce qui peut ôter à l’âme le sang-froid et l’attention nécessaires pour examiner les choses, tout ce qui peut nous faire agir par emportement plutôt que par réflexion. La préméditation est un mûr examen des raisons qui peuvent nous engager à agir ou nous en détourner. On est en droit de soutenir qu’elle nous a guidés, quand notre con-, duite semble dirigée par des motifs certains, comme par l’amitié, la vengeance, la crainte, la gloire, l’intérêt, en un mot, pour embrasser tout à la fois, par toutes les choses qui peuvent conserver, augmenter les avantages dont nous jouissons, nous en procurer de nouveaux, ou au contraire éloigner, affaiblir ou éviter tout ce qui serait capable de nous nuire. En effet, soit que l’on ait souffert ’volontairement quelque dom-age pour se garantir d’un plus grand mal, ou se procurer un avantage plus grand, soit que le même motif nous fasse renoncer à quelque avantage, on retombe toujours dans l’un de ces deux genres.
Tel est le lieu qui sert comme de fondement à ce genre de cause ; car on ne prouve jamais un fait sans montrer les motifs qui l’ont amené. L’accusateur prétend-il que c’est la passion qui nous a fait agir, qu’il s’attache à développer par des pensées et des expressions énergiques toute la violence et l’activité de la passion qui nous a emportés ; qu’il prouve quelle est la puissance de l’amour, quel trouble porte dans l’âme la colère ou le sentiment qu’il dit avoir poussé l’accusé ; enfin, que des exemples et des comparaisons, que le développement de la passion elle-même, prouvent qu’il n’est point étonnant que l’âme, emportée par une affection si violente, se soit laissée aller au crime.
VI. L’accusé a-t-il agi, selon vous, non par passion, mais avec préméditation, démontrez les dommages qu’il voulait éviter, les avantages qu’il voulait acquérir ; amplifiez, autant qu’il sera possible, pour démontrer, si vous le pouvez, jusqu’à l’évidence, que l’accusé avait une raison suffisante de commettre une faute. Est-ce l’amour de la gloire qui l’a fait agir : montrez combien il se promettait de gloire. Est-ce l’ambition, l’intérêt, l’amitié, la haine ; développez ces motifs, et faites de même pour les causes, quelles qu’elles soient, que vous prêtez à sa conduite. Surtout attachez-vous moins à ce qui est vrai en soi, qu’à ce qui a pu être regardé comme tel dans l’opinion de l’accusé. Qu’importe, en effet, que l’avantage ou le dommage soit réel, si vous pouvez prouver que l’accusé en a jugé ainsi ? Car les hommes se trompent de deux manières, ou sur la nature de la chose, ou sur l’événement. L’erreur tombe sur la nature de la chose, quand ils prennent le mal pour le bien, ou le bien pour le mal ; pour bien ou mal, ce qui est indifférent ; ou pour indifférent, ce qui est bien ou mal.
Ce point établi, si l’on dit que l’intérêt ne doit être ni plus cher, ni plus sacré que la vie d’un frère, d’un ami, ou que le devoir : n’allez point le nier à l’accusateur. Vous refuser à des vérités si saintes, ce serait vous rendre aussi coupable qu’odieux. Mais soutenez que vous n’avez pas jugé ainsi ; et alors vous pourrez puiser votre défense dans les lieux qui appartiennent à la personne, et dont nous traiterons bientôt.
VII. L’erreur tombe sur l’événement, quand on prétend qu’il ne répond pas à l’attente de l’accusé. Vous soutenez que, trompé par la ressemblance, par de faux soupçons, par de fausses apparences, il a tué celui qu’il ne voulait pas tuer ; ou bien qu’il a tué un homme dont il se croyait légataire, quoiqu’il ne le fût point ; car, ajoutez-vous, il ne faut pas juger de l’intention par l’événement, mais bien plutôt quelle intention, quelles espérances ont conduit au crime, et il s’agit moins ici du fait que du motif.
L’accusateur doit, dans ce lieu, s’attacher surtout à démontrer que personne, excepté l’accusé, n’avait intérêt à commettre ce délit, ou du moins n’en avait un si grand et si pressant ; ou si quelque autre semble avoir eu quelque intérêt à le commettre, il n’en avait ni le pouvoir, ni les moyens, ni la volonté : le pouvoir ; son ignorance, son éloignement, un obstacle insurmontable l’arrêtait ; et il faudra le prouver : les moyens ; il n’avait ni plan, ni complices, ni secours, ni rien de ce qui était nécessaire pour réussir ; et on en donnera la preuve : la volonté ; son austère vertu se refuse à de pareilles actions ; et on fera l’éloge de son intégrité. Enfin, toutes les raisons que nous fournirons à l’accusé pour sa défense, l’accusateur pourra s’en servir pour justifier les autres ; mais qu’il soit bref, qu’il réunisse et resserre tous ses moyens, et ne paraisse pas accuser l’un pour défendre les autres, mais bien les justifier pour accuser le coupable.
VIII. Tels sont, à peu près, les moyens que doit étudier et développer l’accusateur. Le défenseur, de son cité, soutiendra d’abord que son client n’a point agi par passion ; ou, s’il est obligé d’en convenir, il tâchera d’affaiblir cet aveu, en montrant que cette passion était faible et légère, ou que d’ordinaire une telle passion ne produit point de semblables effets. C’est ici qu’il faut définir le caractère et la nature de la passion qu’on prétend avoir dirigé l’accusé, citer des exemples, des comparaisons ; s’attacher à montrer cette passion sous le point de vue le plus favorable, et dans ses effets les plus doux, pour ramener insensiblement le fait de la barbarie du crime et du trouble inséparable des passions, à des motifs plus calmes et plus tranquilles, sans blesser les sentiments et les dispositions secrètes de l’auditoire.
L’orateur affaiblira le soupçon de préméditation en montrant que l’accusé n’avait nul intérêt à commettre le délit dont on l’accuse, qu’il en avait peu, que d’autres en avaient un plus grand ou un égal, ou qu’il devait en retirer plus de mal que de bien ; en sorte qu’il n’y a aucune comparaison à établir entre l’avantage qu’on s’en promettait, et les dommages qu’on a éprouvés, ou le danger auquel on s’exposait : lieux communs qui seront traités de même, quand on voudra démontrer qu’on cherchait à éviter quelque dommage.
Si l’accusateur prétend que l’accusé, trompé dans ce qu’il a cru favorable ou contraire à ses intérêts, n’en a pas moins agi d’après cette fausse opinion, le défenseur doit prouver qu’il n’est personne assez stupide pour s’y méprendre. Accordez-vous encore ce point, n’accordez pas au moins que l’accusé ait eu le moindre doute sur ce qui l’intéressait ; affirmez qu’il a, sans balancer, jugé faux ce qui était faux, vrai ce qui était vrai : car s’il eût hésité, c’eût été, le comble de la folie que de s’exposer à un péril certain pour des espérances incertaines. L’accusateur, pour justifier les autres, se sert des lieux du défenseur : ainsi l’accusé se servira de ceux de l’accusateur pour se justifier en accusant les autres.
IX. On tire les conjectures de la personne, quand on considère attentivement tous les lieux attribués à la personne, et que nous avons développés dans le premier Livre. Le non même quelquefois peut faire naître quelques soupçons, et par le nom nous entendons aussi le surnom. En effet, il s’agit du mot propre et particulier pour désigner quelqu’un, comme si l’on disait, « Qu’un tel a été nommé Caldus, à cause de son emportement et de son impétuosité dans toutes ses actions ; » ou bien « Que tel autre s’est joué de l’inexpérience des Grecs, parce qu’il s’appelait ou Clodius, ou Cécilius, ou Mucius. » On peut former aussi quelques conjectures sur la nature ; car le sexe, la nation, les ancêtres, la famille, l’âge, le caractère, la complexion (toutes choses qui forment ce qu’on appelle la nature), peuvent donner matière à quelques soupçons. On en tire encore beaucoup du genre de vie, en examinant comment, chez qui, par qui l’accusé a été élevé et instruit ; quelles sont ses liaisons, son plan de vie, sa conduite, même dans son intérieur. La fortune peut aussi fournir des arguments : on considère alors si l’accusé est, a été, ou sera esclave ou libre, riche ou pauvre, Illustre ou Inconnu, heureux ou malheureux ; si c’est un simple particulier, ou s’il est revêtu de quelque dignité. Enfin, on s’attache à tout ce que l’on comprend sous le mot de fortune. Quant à la manière d’être, qui consiste dans quelque disposition physique ou morale, qui ne se dément point, comme la science, la vertu, et même leurs contraires ; le fait lui-même, quand l’état de la question est posé, montre quels soupçons peut faire naître ce lieu commun. Mais il est surtout facile de former des conjectures sur les résultats que peuvent produire les affections de l’âme, comme l’amour, la colère, le chagrin. On ne saurait s’y tromper, puisqu’on en connaît parfaitement la nature et les effets. Le goût, qui n’est qu’une volonté fortement prononcée, une application continuelle et soutenue à quelque objet, fournit également, et avec non moins de facilité, des raisons favorables à la cause. Il en est de même du dessein : c’est un plan arrêté de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. Quant à la conduite, aux événements et aux discours, qui, comme nous l’avons dit en traitant de la confirmation, peuvent s’envisager sous trois points de vue, il est facile de trouver les conjectures qu’ils offrent pour confirmer les soupçons.
X. Voilà tout ce qui a rapport aux personnes. En réunissant tous ces lieux en un seul faisceau, l’accusateur doit jeter de la défaveur sur l’accusé ; car les causes du fait sont par elles-mêmes de peu d’importance, si l’on ne jette sur l’accusé des soupçons qui rendent une telle conduite vraisemblable de sa part. En effet, s’il est inutile de reprocher à un homme de mauvaises intentions, quand il n’a point eu occasion de se rendre coupable, l’accusation n’a guère plus de fondement, si l’occasion du crime s’est présentée à un homme dont la vertu ne s’est jamais démentie. Aussi l’accusateur doit-il s’attacher surtout à répandre de la défaveur sur la vie de celui qu’il accuse, en rappelant sa conduite passée, et à montrer qu’il a déjà été convaincu d’un semblable délit. Cela n’est-il pas possible, faites voir qu’ils été déjà exposé à de semblables soupçons, ou plutôt, si vous le pouvez, dites que des motifs à peu près semblables l’ont rendu coupable d’une faute de même espèce, égale, ou plus grave ou plus légère : par exemple, si en l’accusant d’avoir été entraîné par la soif de l’or, vous prouvez qu’il a montré, dans certaine occasion, de l’avidité. On peut, dans quelque cause que ce soit, fortifier le motif qui fait agir l’accusé, par des conjectures tirées de la nature, de la manière de vivre, des goûts, de la fortune, ou de quelqu’un des lieux qui appartiennent aux personnes ; ou bien, si vous ne trouvez point, dans sa conduite passée, des fautes semblables à celles dont vous l’accusez aujourd’hui, faites naître de délits d’un genre différent des préventions contre lui. L’accusez-vous d’avoir été entraîné par la soif de l’or ; « si vous ne pouvez montrer qu’il est avare, prouvez qu’il est sujet à d’autres vices, et qu’il « n’est point étonnant qu’un homme vil, emporté, avide, se soit rendu encore coupable du délit dont vous l’accusez. » En effet, plus vous affaiblissez l’autorité et la réputation de sa vertu, plus vous rendez sa défense difficile. Si vous ne pouvez montrer que l’accusé soit sujet à quelqu’un de ces vices, engagez les juges à n’avoir aucune considération pour la réputation dont il a joui jusqu’alors ; car il dissimulait auparavant, et il vient de se montrer tel qu’il est. Sa vie antérieure ne doit donc pas justifier son action ; mais son action doit déposer contre sa vie antérieure. Il ne lui a manqué que le pouvoir ou l’occasion de faillir. Si ce moyen même est impraticable, dites, pour dernière ressource, qu’il n’est point étonnant que ce soit sa première faute : il faut bien qu’un homme pervers débute dans le crime. Sa vie antérieure est-elle inconnue, supprimez ce lieu, en exposant vos motifs, et appuyez tout de suite votre accusation par des raisonnements.
XI. Quant à ce qui concerne le défenseur, son premier devoir est de montrer, s’il le peut, que. jamais son client ne s’est écarté du sentier de la vertu : il y réussira, s’il prouve qu’il a rempli tous les devoirs connus et ordinaires envers ses parents, ses proches, ses amis, ses alliés ; ensuite, qu’il s’est distingué par des actions rares et éclatantes, en s’exposant, sans y être forcé, à de grandes fatigues, à de grands dangers, ou en bravant ce double obstacle, pour l’intérêt de la patrie ou de ceux auxquels il est uni par le sang ou par l’amitié ; enfin, qu’il n’a jamais failli ; que jamais les passions n’ont pu l’écarter de son devoir. Si vous pouvez montrer qu’il n’a jamais eu la volonté de faillir, quand il le pouvait impunément, vous ajoutez un nouveau poids à cette défense.
La justification sera plus évidente encore, si vous prouvez qu’il a toujours été à l’abri du soupçon sur le genre de délit dont on l’accuse ; que l’on donne l’avarice pour motif à un homme qui n’a jamais montré la moindre avidité pour les richesses. Alors plaignez-vous avec un ton d’indignation et de noblesse ; montrez combien il est adieux, combien il est indigne, de supposer qu’un homme vertueux, dont toute la vie a toujours été étrangère aux vices, ait pu se laisser aller au crime, par les mêmes motifs qui guident les hommes pervers et audacieux ; combien il est injuste, combien il est dangereux pour les honnêtes gens de n’avoir, dans de telles circonstances, aucun égard pour une vie consacrée tout entière à la vertu, en jugeant des hommes intègres sur une accusation soudaine, qu’il est si facile de supposer, plutôt que sur le témoignage irrécusable de leur vie passée, témoignage qu’on ne peut accuser d’imposture.
Sa vie passée offre-t-elle quelques actions honteuses, répondez qu’on s’est trompé dans la réputation qu’on a voulu lui faire, et rejetez-en la faute sur l’envie, la malveillance ou l’erreur ; ou bien attribuez les faiblesses qu’on lui reproche à l’imprudence, à la nécessité, à des conseils dangereux pour la jeunesse, ou à quelque passion qui n’ait rien de criminel, ou à un défaut différent de celui dont on accuse votre client, afin de le faire paraître, sinon innocent, du moins incapable d’un pareil délit. Si rien ne peut justifier la bassesse ou l’infamie de sa conduite, répondez qu’il ne s’agit point de ses mœurs et de sa conduite passée, mais uniquement du délit dont on l’accuse, et dont il faut s’occuper sans rappeler le passé.
XII. Pour tirer des soupçons de l’action même, il faut en examiner la marche dans tous les points. De ces soupçons, les uns naissent du fait en particulier, les autres tout à la fois du fait et de la personne. On les tire du fait, en examinant attentivement tout ce que nous avons rapporté aux choses. Il est facile de voir que ce point embrasse tous les genres et presque toutes leurs espèces.
Examinez d’abord les circonstances inhérentes au sujet, c’est-à-dire, qui en sont inséparables ; et il suffit pour cela de considérer ce qui a précédé, ce qui a donné l’espoir de réussir, quels ont été les moyens d’exécuter, quel est le fait lui-même, quelles en sont les suites.
Occupez-vous avec une égale attention des moindres détails qui ont rapport à l’exécution ; car ce lieu commun est le second de ceux que nous attribuons aux choses. Il faut alors examiner le lieu, le temps, l’occasion, le pouvoir : quatre points, dont nous avons expliqué avec soin la nature et la force, en traitant de la confirmation. Aussi, pour qu’on ne puisse pas nous reprocher de n’en point parler ici, ou de nous répéter, nous allons montrer en peu de mots ce qui, dans chacun d’eux, doit fixer l’attention. Dans le lieu, c’est la commodité ; dans le temps, la durée ; dans l’occasion, l’opportunité ; dans le pouvoir, l’abondance et la disposition des moyens indispensables pour l’exécution, ou qui la facilitent.
Considérez ensuite les circonstances, c’est-à-dire, ce qui est plus grand, moindre, égal ou semblable. On en peut tirer des conjectures, en considérant avec attention quelle est la tournure habituelle des choses plus grandes, moindres, égales ou semblables. C’est à ce lieu qu’il faut rapporter le résultat, je veux dire ce que produit d’ordinaire chaque chose, comme la crainte, la joie, l’incertitude.
Les conséquences forment le quatrième lieu que nous avons attribué aux choses. Elles comprennent ce qui dépend du fait, immédiatement ou non. C’est ici qu’il faut considérer quelle est la coutume, quelle est la loi, la formule d’accusation, la manière de poursuivre, l’usage ou l’habitude, l’intérêt ou la haine que l’action inspire, parce que ces moyens peuvent quelquefois conduire à des conjectures et à des soupçons.
XIII. Il est d’autres soupçons qui naissent tout à la fois et des lieux attribués aux choses, et des lieux attribués aux personnes ; car tout ce qui concerne et la fortune, et la nature, et la manière de vivre, les goûts, les actions, les événements, les discours, les intentions, enfin le physique et le moral, font partie de tout ce qui contribue à rendre un fait probable ou incroyable, et se joignent aux conjectures.
On doit surtout examiner dans cet état de question, d’abord si le délit est possible ; ensuite, si tout autre que l’accusé peut en être l’auteur ; puis on discute la facilité qu’il a eue de le commettre, point dont nous avons parlé plus haut ; si cette action était de nature à causer des remords, et en même temps quel espoir on avait de la cacher ; enfin la nécessité, qui montre si le fait ou les suites étaient inévitables. Presque tout ceci peut se rapporter à l’intention que nous attribuons aux personnes, comme dans la cause que nous avons établie. Cet abord familier dans la route, la conversation engagée, le choix de la même auberge, le souper commun, voilà pour les antécédents ; la nuit et le sommeil, voilà pour le fait. Le départ de l’accusé, seul, et sans compagnon de voyage ; son indifférence envers un homme avec qui il voyageait comme avec son ami, son épée ensanglantée, voilà pour les suites.
La plupart de ces détails appartiennent à l’intention. On examine si l’accusé avait étudié avec soin et préparé toutes ses démarches, ou s’il a agi avec assez d’imprudence pour qu’on ne puisse rien soupçonner de criminel dans sa conduite. C’est alors que l’on considère s’il ne pouvait point trouver quelque voie plus commode, si ce n’est point l’ouvrage du hasard. Car là où l’argent,les secours et les complices ont manqué, il ne paraît pas qu’il y ait eu faculté d’agir. C’est ici qu’avec un peu d’attention, on verra se réunir les lieux relatifs aux choses et les lieux relatifs aux personnes.
Il serait aussi difficile que superflu de tracer ici, comme nous l’avons fait plus haut, à l’accusateur et au défenseur, la marche que chacun doit suivre. Superflu : la question une fois posée, on verra facilement tout ce qui lui convient, si, en ne croyant pas trouver ici tous les cas prévus et développés, on met un peu d’intelligence et de soin à comparer sa cause avec les exemples donnés. Difficile : en effet, ou n aurait jamais fini de développer le pour et le contre sur chacun de ces nombreux sujets, qui se modifient suivant les circonstances. Il faut donc s’attacher à l’examen des points dont nous avons parlé.
XIV. Pour rendre l’invention plus facile, revenez souvent et avec soin sur la narration de votre adversaire et sur la vôtre, et en formant toutes les conjectures dont chaque point est susceptible, examinez pourquoi, dans quelle intention, avec quel espoir de réussite l’action a été commise ; pourquoi de telle manière plutôt que de telle autre ; pourquoi par celui-ci plutôt que par celui-là ; pourquoi sans complices, ou avec tel complice ; pourquoi avec ou sans confidents, ou précisément avec ceux-là ; pourquoi a-t-on ou n’a-t-on pas fait telle chose avant l’action ; pourquoi celle-ci pendant l’action même ; pourquoi celle-là après ; ce qu’on a fait à dessein, ou ce qui était une suite naturelle de l’action ; si le discours est d’accord avec le fait ou conséquent en soi, si tel signe indique plutôt ceci que cela, ou l’un et l’autre, ou lequel des deux ; ce qu’on a fait d’inutile, ce qu’on n’a pas fait de nécessaire.
Après cet examen rigoureux de toutes les parties du fait, on déploiera les lieux communs dont nous avons parlé, et qu’on tenait en réserve. Tantôt séparés, tantôt réunis, ils fourniront des arguments solides, dont les uns établiront la probabilité ; les autres, la nécessité du fait. Souvent les tortures, les témoins, les bruits publics fortifient les conjectures ; et chacune des deux parties doit, par les mêmes moyens, tâcher de les faire tourner à son avantage ; car on doit tirer des soupçons de la question, des témoins et des bruits publics, comme de la cause, de la personne, et du fait même.
Aussi, suivant nous, c’est une erreur égale de penser que cette espèce de soupçons n’a nullement besoin d’art, ou bien de donner pour chaque genre une méthode particulière. En effet, on peut tirer des mêmes lieux toutes sortes de conjectures ; on peut suivre la même marche pour vérifier les dépositions arrachées par la torture, celles des témoins, les bruits publics, et pour remonter à leur source : et dans toute cause, si une partie des arguments tirés de la cause même y sont inhérents, et ne peuvent facilement s’adapter à toutes les causes de la même espèce, il en est d’autres qui s’appliquent d’une manière plus vague à toutes celles de la même espèce, ou même à la plupart des causes.
XV. Ces arguments, qui conviennent à un grand nombre de causes, nous les appelons lieux communs ; car un lieu commun sert de développement à une chose douteuse ou certaine : certaine, si vous voulez, par exemple, montrer qu’un parricide est digne des plus grands supplices ; il faut, avant d’appuyer sur ce point, prouver le crime : douteuse, quand le contraire offre des raisons également probables ; par exemple : Il faut croire aux soupçons, ou bien il ne faut pas y croire. Parmi les lieux communs, les uns s’emploient pour exciter l’indignation ou la pitié, comme nous l’avons dit plus haut ; les autres, pour appuyer quelque point qui offre des raisons pour et contre.
Ces lieux communs répandent dans le discours beaucoup d’éclat et de variété, mais si on les emploie avec mesure, et seulement quand on aura gagné l’auditeur par des preuves plus convaincantes ; car il n’est permis de traiter une question générale que lorsqu’on a développé quelque point inhérent à lu cause, et pour préparer l’auditoire à ce qui suit, ou pour le délasser, quand on a épuisé la matière. On ne peut douter, en effet, que tout ce qui orne l’élocution, tout ce qui donne de l’agrément et du poids à un discours, de la dignité au style et aux pensées, ne se rapporte aux lieux communs. Aussi les lieux communs, qui appartiennent, comme nous l’avons dit, à toutes les causes, n’appartiennent pas également à tous les orateurs ; car celui qui, par une longue habitude de la parole, n’aura pas amassé un grand fonds de pensées et d’expressions, ne pourra point leur donner les ornements et la force qu’ils exigent. Ces observations peuvent s’appliquer à tous les lieux communs en général.
XVI. Pour revenir à la question de fait en particulier, voici les lieux communs qu’elle offre ordinairement : les soupçons, les bruits publics, les témoins, les aveux arrachés par la torture, méritent ou ne méritent pas notre confiance, selon la nature et l’intérêt de la cause, et on en donne les raisons. On peut avoir ou ne pas avoir égard à la conduite passée ; un homme déjà coupable d’un tel délit, peut être ou n’être pas capable de tel autre ; il faut s’attacher surtout aux motifs, ou ne point s’y arrêter. Ces lieux communs et tous les autres semblables,qui naissent du fond du sujet, peuvent s’employer pour et contre.
Mais il y a des lieux propres à l’accusateur, comme celui qui exagère l’atrocité du fait, et celui qui nous défend la pitié pour les méchants. Il y en a de propres au défenseur, comme celui qui excite l’indignation en dévoilant la mauvaise foi de l’accusateur, et qui cherche par les plaintes à exciter la compassion. On suit, à l’égard de ces lieux communs et de tous les autres, les mêmes règles que pour toutes les autres espèces de raisonnements. Mais ceux-ci exigent plus d’art et de finesse, et en même temps plus de simplicité ; les autres, plus de force, plus d’ornements, plus de pompe dans le style et dans les pensées. Car les uns n’ont d’autre but que de prouver ; les autres, quoiqu’ils servent aussi à prouver, ont pour but l’amplification. Passons maintenant à un autre état de cause.
XVII. La discussion porte-t-elle sur les mots : comme il faut les définir, c’est une question de définition. Prenons pour exemple la cause suivante : « Le consul C. Flaminius qui, pendant la seconde guerre Punique, mit la république dans un si grand danger, était tribun du peuple, lorsque, malgré le sénat, malgré l’opposition de tous les bons citoyens, il porta les Romains à se soulever, en leur proposant la loi agraire. Son père vient l’arracher de la tribune où il présidait l’assemblée du peuple. Il est accusé de lèse-majesté. » Voici l’accusation : « Vous êtes coupable de lèse-majesté ; vous avez arraché de la tribune un magistrat du peuple. La défense : — « Je ne suis point coupable de lèse-majesté. » La question : — « Est-il coupable de lèse-majesté ? » La preuve : — « J’ai usé de « l’autorité que j’avais sur mon fils. » La réfutation : — « Mais celui qui se sert de l’autorité paternelle, c’est-à-dire, d’une autorité privée, contre la puissance tribunitienne, c’est-à-dire, contre l’autorité du peuple, est coupable de lèse-majesté. » Le point à juger : — « Est-il coupable de lèse-majesté, celui qui emploie contre un tribun l’autorité paternelle ? » C’est à cela qu’il faut rapporter tous vos raisonnements.
Mais qu’on n’aille pas s’imaginer que nous ne voyons pas d’autre question dans cette cause. Nous n’envisageons ici que le point qui nous occupe ; mais lorsque, dans ce livre, nous aurons développé chaque partie, il sera facile, avec un peu d’attention, de trouver, dans quelque cause que ce soit, toutes les questions, toutes leurs parties et tous les points de discussion qui s’y rencontrent ; car nous ne voulons rien omettre.
Le premier lieu de l’accusateur est donc la définition courte, claire et conforme à l’opinion générale, du mot dont on cherche la valeur ; par exemple : « C’est se rendre coupable de lèse-majesté que d’attenter à la majesté, ou à la grandeur, ou à la puissance du peuple, ou de ceux que le peuple a revêtus de son autorité. » Fortifiez cette courte exposition de raisons bien développées, et montrez-en la justesse. Prouvez ensuite qu’elle s’applique parfaitement à l’action de l’accusé, et que, suivant la définition que vous avez donnée du délit, votre adversaire est coupable de lèse-majesté ; appuyez-vous alors d’un lieu commun qui excite l’indignation de l’auditoire, en exagérant l’atrocité ou l’indignité de l’action.
Il faut ensuite réfuter la définition de l’adversaire : vous la réfuterez en prouvant qu’elle est fausse. Vous citerez comme autorité l’opinion générale, en considérant de quelle manière et dans quel sens, soit en parlant, soit en écrivant, on emploie ordinairement ce mot. Vous la réfuterez encore en montrant qu’il serait aussi honteux que dangereux de t’admettre ; en faisant voir quelles en seraient les funestes conséquences ; et vous avez ici les lieux de l’honneur et de l’intérêt, que nous développerons en nous occupant des préceptes qui se rapportent au genre délibératif. Vous pouvez aussi comparer votre définition à celle de votre adversaire ; montrer que la vôtre est vraie, honnête, utile, et que la sienne est tout le contraire. Cherchez ensuite dans des causes d’une importance supérieure, ou du moins égale à celle de la vôtre, des exemples dont le rapport avec elle puisse étayer votre définition.
XVIII. Avez-vous plusieurs choses à définir, comme lorsqu’il s’agit de savoir « Si celui qui dérobe chez un particulier des vases sacrés, est voleur ou sacrilège ; » employez plusieurs définitions, et suivez pour le reste de votre cause la marche que nous venons d’indiquer. La perversité du coupable, qui s’arroge un pouvoir égal et sur les choses et sur les mots, pour faire ce qui lui plaît, et donner à ses actions le nom qui lui convient, vous offre un autre lieu commun.
Le premier lieu du défenseur est aussi la définition du mot, courte, claire et conforme à l’opinion générale ; par exemple : « C’est se rendre coupable de lèse-majesté que de se mêler de l’administration de l’État, quand on n’en a pus reçu le pouvoir. » Ensuite on appuie cette définition de raisons et d’exemples, puis ou prouve combien elle convient peu au fait dont il s’agit. Enfin, un lieu commun développe l’utilité ou l’honnêteté de l’action.
Vient ensuite la réfutation de la définition adoptée par l’adversaire qui se tire de tous les lieux que nous avons indiqués à l’accusateur. Tout le reste est également semblable, excepté le dernier lieu commun ; car le défenseur doit s’indigner que, pour le mettre en danger, l’accusateur ne se contente point de dénaturer les faits ; et s’efforce encore à changer les mots. Les lieux communs, qui montrent la perfidie de l’accusateur, qui excitent la pitié, l’indignation, et ceux qui nous mettent en garde contre la pitié, se tirent de la grandeur du danger et non du genre de la cause. Aussi, s’ils ne s’offrent point dans toutes les causes, ils s’offrent dans des causes de toute espèce. Nous en avons déjà parlé dans l’état de cause nommé conjectural, ou question de fait. Quant à l’induction, nous nous eu servirons si la cause le demande.
XIX. Si l’accusateur n’a pas droit d’intenter son action, si elle ne tombe pas sur le coupable, si le tribunal, le temps, la loi, l’accusation, la peine, offrent quelque irrégularité ; comme il faut que la cause soit changée et portée devant un autre tribunal, on l’appelle question de récusation. Il est inutile de donner des exemples de chaque genre de récusation ; ils nous entraîneraient trop loin, d’autant plus que la méthode est toujours la même. D’ailleurs plus d’un motif empêche que dans nos coutumes cet état de question se présente souvent ; car les édits de nos préteurs admettent plusieurs fins de non-recevoir ; et suivant notre droit civil, on perd sa cause quand on ne suit pas les formes prescrites. Aussi la plupart des récusations se font-elles devant le préteur ; car c’est à lui que s’adressent les demandes de fin de non-recevoir ; c’est lui qui donne, en quelque sorte, le pouvoir d’intenter une action, et qui règle la forme à suivre dans les affaires particulières. Les récusations ont donc rarement lieu devant les tribunaux ; et même, quand cela se rencontre, elles sont ordinairement peu fondées, et il faut, pour les appuyer, y joindre quelque autre état de question. Je citerai cet exemple « Dans une accusation d’empoisonnement, la cause présentée comme parricide et inscrite hors de son rang, les dépositions des témoins et les arguments de l’accusateur chargent le coupable de différents délits, et ne font que mentionner le parricide : il faut alors que le défenseur insiste vivement et longtemps sur ce point. Si l’on n’a pas prouvé le meurtre du père, c’est une injustice criante « que d’infliger le châtiment des parricides ; ce qui doit nécessairement arriver si nous sommes condamnés, puisque la cause est inscrite hors de son rang comme parricide. S’il est injuste d’infliger cette peine à l’accusé, il est également injuste de le condamner, puisque sa condamnation entraîne nécessairement cette peine. » Le défenseur, en demandant par la récusation le changement de la peine, détruira toute l’accusation ; et de plus, il appuiera sa récusation par la question de fait, en se justifiant sur tous les autres chefs dont on l’accuse.
XX. Prenons pour exemple de récusation, dans la cause, le fait suivant : « Des gens armés, venus pour faire une violence illégale, furent repoussés par d’autres gens armés, et un cavalier romain, en se défendant, eut la main coupée par un des agresseurs. Le blessé intente une accusation de voies de fait. L’accusé demande au préteur qu’on ajoute cette restriction : A MOINS QUE CE NE SOIT NUIRE A UN HOMME ACCUSÉ DE CRIME CAPITAL. L’accusateur veut un jugement simple ; l’accusé exige qu’on y ajoute cette restriction. — Faut-il admettre ou non la restriction ? voilà la question. — il ne faut point, dans une cause portée devant de simples commissaires, prononcer d’abord sur un crime qui regarde le tribunal chargé des assassinats. » Voilà la raison. — Voici la réponse : « Les voies de fait sont telles, qu’il serait indigne de ne pas prononcer le plus tôt possible un jugement. » Le point à juger est donc : « La « gravité des voies de fait est-elle une raison suffisante pour qu’on prononce, tandis qu’il ne s’agit encore que de cette cause, sur un délit plus grave, dont le jugement appartient à un autre tribunal ? » Voilà pour cet exemple. Mais les deux parties doivent, dans toute cause, chercher par qui, avec qui, de quelle manière et dans quel temps il faut intenter l’action ou porter le jugement.
Vous devez ici avoir recours au droit dont nous I parlerons plus bas, et montrer, par vos raisonnements, ce qu’il faut faire en pareille circonstance ; distinguer si, par malice, on n’a pas sous une fausse accusation caché la véritable ; si c’est par sottise ou par nécessité, dans l’impossibilité d’agir autrement, ou pour rendre son action plus facile, qu’on a suivi cette marche dans le jugement ou l’accusation ; enfin, si l’on n’a commis aucune erreur. Un lieu commun contre celui qui récuse, c’est qu’il cherche à éviter le jugement et la punition, parce qu’il se défie de sa cause. Il peut se défendre en montrant que tout ordre sera bouleversé, si l’on ne suit point, dans les procès et les jugements, la marche tracée par la ’loi ; si l’on souffre qu’un homme, sans aucun droit, intente une action suivant un mode ou dans un temps illégal ; que c’est vouloir confondre tous les tribunaux et tous les délits. Voilà comme on peut traiter ces trois questions, qui n’ont point de parties. Examinons maintenant la question de genre et ses différentes divisions.
XXI. Le fait et le nom qu’on lui donne, une fois convenus, quand la forme de l’accusation n’offre aucun point de discussion, on examine la valeur, la nature et le caractère du fait : c’est ce qu’on appelle question de genre. Nous la divisons d’abord, comme nous l’avons dit, en deux parties, matérielle et juridiciaire. Elle est matérielle, quand la discussion du droit porte sur le fait même. Par exemple, « Un homme a nommé pour son héritier un mineur ; le mineur est mort avant d’avoir atteint sa majorité. Les héritiers substitués du père et les agnats du mineur se disputent la succession échue au mirieur. Les héritiers substitués sont en possession. » Les agnats les attaquent, en disant : « Les biens sur lesquels celui dont nous sommes agnats n’a pas fait de testament, nous appartiennent. » On leur répond : « Non, c’est à « nous, qui, par le testament du père, sommes les seconds héritiers. » La question est de savoir « à qui ils appartiennent. » Voici la raison des héritiers : « Le père a fait son testament et pour lui et pour son fils encore mineur. Ainsi le testament du père nous donne nécessairement les biens du fils. » On les réfute en disant : « Le père n’a fait d’autre testament que « le sien. C’est à lui et non pas à son fils qu’il « a nommé des seconds héritiers. Ainsi son tes-« Lament ne peut vous donner que ce qui lui appartenait à lui-même. » Le point à juger est : « Peut-on tester pour un fils mineur, ou les seconds héritiers du père doivent-ils ne pas hériter aussi du fils mineur ? » Pour ne point oublier ou répéter sans cesse une observation générale, il me semble à propos de dire ici qu’une question simple peut offrir plusieurs raisons différentes ; ce qui arrive si, comme dans la cause dont nous parlons, on a plusieurs moyens pour justifier ou rendre probable le fait ou le droit qu’on défend. Supposons que les héritiers allèguent pour raison que « des causes différentes ne peuvent donner des droits sur le même héritage, et qu’il n’arrive jamais que la loi et un testament nomment deux héritiers différents du même bien ; » on peut leur répondre, « que l’héritage n’est point un, puisqu’une partie des biens était venue accidentellement au mineur, et que, s’il lui venait quelque chose, le testament n’en désigne point les héritiers ; que, pour le reste des biens, la volonté du père mort, qui, au décès du mineur, les donnait à ceux qu’il choisissait pour héritiers, avait la plus grande validité. »
« L’héritage est-il un ? » voilà le point à juger ; et si l’on accorde que « des causes différentes « peuvent donner des droits à un même héritage, » il faudra encore décider « si des branches différentes peuvent avoir les mêmes droits sur le même héritage. »
XXII. Ainsi vous voyez que dans une seule question il peut se rencontrer plusieurs raisons, plusieurs manières de les réfuter, et plusieurs points à juger. Voyons maintenant les règles de cette question. Les deux parties ou toutes, s’il s’en rencontre plus de deux, doivent examiner ce qui constitue le droit. Il est puisé dans la nature. L’utilité plus ou moins évidente de certaines choses les a fait passer en usage : une fois leur utilité démontrée par l’évidence ou par l’expérience, la loi les a confirmées. Il est un droit naturel qui n’est point fondé sur l’opinion, mais sur un sentiment inné, comme la religion, la piété, la reconnaissance, la vengeance, le respect ou la vérité. La crainte des dieux et les cérémonies de leur culte constituent la religion. La piété est le sentiment qui nous avertit de nos devoirs envers la patrie, nos parents, ceux qui nous appartiennent par le sang. La reconnaissance consiste dans les égards qu’inspirent le souvenir des bienfaits, des honneurs et de l’amitié, et le désir d’y répondre. La vengeance punit ou repousse la violence, ou l’affront fait à nous ou à ceux que nous devons chérir ; et c’est aussi par elle que nous punissons les crimes. On entend par le respect, les marques de déférence et de vénération que nous donnons à l’âge, à la sagesse, aux honneurs ou aux dignités. Par la vérité, nous tâchons que rien, dans le passé, le présent et l’avenir, ne démente ce que nous avons affirmé. Il est rare que, dans une cause de cette espèce, on ait recours aux droits naturels, dont le droit civil s’occupe peu, et qui ne sont point à la portée du vulgaire. Cependant on peut les employer, en plusieurs circonstances, dans la similitude ou dans l’amplification.
On appelle droit fondé sur la coutume, tout ce que le temps a consacré, du consentement universel, sans l’autorisation de la loi. La loi même contient plusieurs droits établis par le temps. Un grand nombre et même la plupart se trouvent renfermés dans les édits des préteurs. D’autres espèces de droit, au contraire, sont fondées sur la coutume, comme un contrat, l’équité, les jugements antérieurs. Un contrat est un traité entre différents individus, qu’on regarde comme si juste, qu’il est de droit de l’exécuter. L’équité donne un droit égal à tous. Un jugement antérieur est la décision déjà rendue par une ou plusieurs autorités. La loi nous fait connaître les droits légaux. 11 faut donc examiner tout ce que ces différentes parties du droit pourront vous fournir, ou dans le fait même, ou dans une affaire semblable, ou dans une plus ou moins importante, et fouiller pour ainsi dire chacune d’elles pour en tirer ce qui peut servir notre cause. Pour les lieux communs, qui forment, comme nous l’avons dit plus haut, deux espèces, dont l’une développe les choses douteuses, et l’autre les choses certaines, voyez ce qu’ils fournissent de secours à votre cause, ce que vous pouvez, ce que vous devez développer en lieu commun. On ne peut en établir qui conviennent à tous les sujets ; mais il est peu de causes dans lesquelles on ne puisse attaquer ou défendre l’autorité des jurisconsultes. Examinez surtout quels sont, outre ceux que nous avons indiqués, les lieux communs que vous offre la cause même. Passons maintenant au genre juridiciaire et à ses différentes parties.
XXIII. La question juridiciaire discute le droit ou le tort, décide si l’on mérite peine ou récompense. Elle se divise en question absolue et en question accessoire. Absolue, quand elle renferme en elle-même, non pas implicitement, comme la question matérielle, mais d’une manière évidente, l’examen du juste et de l’injuste. Prenons l’exemple suivant : « Les Thébains, vainqueurs de Sparte, avaient élevé un trophée d’airain, suivant l’usage des Grecs, qui, dans leurs guerres particulières, érigeaient un trophée sur les frontières, après la victoire, plutôt pour la constater clans le moment même, que pour perpétuer le souvenir de la guerre. » On les accuse au tribunal des Amphictyons, c’est-à-dire, devant le conseil général de la Grèce. « Ils ne le devaient point, » disent les accusateurs. — « Nous le devions, » répondent les accusés. — « Le devaient-ils ? » voilà la question. Voici la raison des Thébains : « La victoire que nous avons remportée est si glorieuse, que nous avons voulu en laisser à nos descendants un monument éternel. » On les réfute en disant « que les Grecs ne doivent point élever un monument éternel des discordes de la Grèce. » Le point à juger est de savoir, « si des Grecs qui, pour immortaliser leurs exploits, élèvent un monument éternel des discordes de la Grèce, font bien ou mal. » Nous ne donnons cette raison que pour faire bien connaître le genre de cause qui nous occupe ; car si nous répondions, comme ils le firent sans doute : « Votre guerre était impie et criminelle, » ce serait une récrimination, et nous n’en sommes point encore à ce sujet. Il est évident que ces deux questions se rencontrent dans cette cause, et que, pour celle-ci, on puise des raisonnements dans les mêmes lieux que pour une question matérielle. Quant aux lieux communs, la cause elle-même, si elle est susceptible d’exciter la pitié ou l’indignation, la nature et l’utilité du droit vous en fourniront un grand nombre de solides, que vous pourrez, que vous devrez même employer, si la dignité du sujet vous semble l’exiger.
XXIV. Examinons maintenant la question juridiciaire accessoire. La question juridiciaire est accessoire, quand les preuves ou la défense, trop faibles par elles-mêmes, s’appuient sur des motifs étrangers au fond de la cause. Elle offre quatre chefs : l’alternative, la récrimination, le recours et l’aveu du crime.
L’alternative justifie, par les motifs, un fait condamnable en lui-même. Par exemple : « Un général, enfermé par l’ennemi, et ne trouvant aucun moyen possible de s’échapper, obtient par une capitulation d’emmener ses soldats, à condition qu’il laissera ses armes et ses bagages. Le traité s’exécute. Il a perdu ses armes et ses bagages, mais il a sauvé son armée contre toute espérance. On l’accuse de lèse-majesté. »I ci s’offre une définition. Mais ne perdons point de vue l’objet qui nous occupe en ce moment.
« Il ne devait pas abandonner ses armes et ses bagages ; » voilà l’accusation. Le général répond « qu’il le devait. » La question est : « Le devait-il ? » Il donne pour raison, « que tous ses soldats auraient été égorgés. » On le réfute, ou par cette conjecture : « Ils n’auraient pas été égorgés ; » ou par cette autre « Ce n’était pas là votre motif. » Alors s’offrent ces points à juger : « Auraient-ils été égorgés ? était-ce là le motif de la conduite de l’accusé ? » ou cette alternative, dont nous nous occupons : « Fallait-il laisser périr son armée, plutôt que de livrer ses armes et ses bagages à l’ennemi ? » De là naît le point à juger : « Lorsqu’il fallait perdre son armée, ou souscrire à ce traité, valait-il mieux perdre son armée que de la sauver à ces « conditions ? »
Telle est la manière de traiter une cause de cette espèce. On peut suivre ici la méthode et les préceptes tracés pour les autres questions, et surtout réfuter, par des conjectures, l’alternative qu’établit l’accusé. Vous y parviendrez, en assurant que ce qu’il regarde comme nécessaire ne serait point arrivé s’il n’eût point agi comme il a fait, ou en démontrant que sa conduite a eu d’autres motifs que ceux qu’il avoue, et qu’elle est fondée réellement sur d’autres causes. La défense et la réfutation se prennent également dans la question de conjecture ; ou bien, si l’on qualifie le délit, comme dans cet exemple ou le général est accusé de lèse-majesté, il faut employer la définition et suivre les préceptes que nous avons donnés à ce sujet.
XXV. Il arrive souvent que, dans les causes de cette nature, on est obligé d’employer à la fois les conjectures et la définition. S’il s’y rencontre encore quelque autre genre, il faut également suivre les préceptes de ce genre. En effet, le but principal de l’accusateur est de réunir le plus de moyens qu’il pourra contre le fait que l’accusé veut justifier, et il lui sera facile d’y réussir, en multipliant le nombre des questions.
L’alternative, isolée des autres genres, peut être considérée en elle-même ; et alors vous démontrerez que le fait dont il s’agit n’était ni utile, ni honnête, ni nécessaire, ou du moins ne l’était réellement pas à un si haut degré.
Sachez ensuite distinguer le fait que vous imputez à l’accusé, de celui que le défenseur présente comme alternative, et démontrez que l’usage ne permet point de se conduire ainsi, et que nulle raison ne peut autoriser à livrer à l’ennemi, pour le salut d’une armée, les armes qui font son salut. Il faudra comparer ensuite les avantages et les inconvénients, opposer nettement ce que vous attaquez aux choses que le défenseur prétend justifier, ou dont il vent prouver la nécessité ; et, en affaiblissant l’avantage, exagérer le tort. Vous y réussirez en prouvant qu’il a pris le plus mauvais parti, au lieu de prendre le plus honorable, le plus utile et le plus nécessaire. Les règles de la délibération vous apprendront à connaître la nature et le pouvoir de l’honneur, de l’intérêt et de la nécessité.
Exposez ensuite cette cause d’alternative comme une cause délibérative, et suivez les règles du genre délibératif ; car, pour nous servir toujours du même exemple : « Toute l’armée devait périr, si l’on n’eût signé ce traité ; valait-il mieux la laisser périr que de le signer ? » Question qu’il faut développer suivant les règles du genre délibératif, comme une chose sur laquelle on vous demande votre avis.
XXVI. Les lieux dans lesquels l’accusateur a puisé les questions qu’il ramène à sa cause, fourniront aussi des armes au défenseur pour réfuter ces mêmes questions ; seulement il suivra une marche opposée à celle de son adversaire dans les lieux qui naîtront de l’alternative elle-même.
Les lieux communs seront, pour l’accusateur, d’exhaler son indignation contre la bassesse ou les inconvénients d’une action que l’accusé avoue honteuse ou funeste, on l’un et l’autre à la fois, en cherchant toutefois à la justifier. Le défenseur répondra qu’on ne peut juger des avantages, des inconvénients, de la bassesse ou de la gloire d’une action, sans en connaître la cause, le temps et l’intention. Ce lieu commun, bien développé, est, dans cette cause, un des plus puissants moyens de persuasion. Le développement de l’importance du service, qui se tire ordinairement de la nécessité, de l’honneur ou de l’utilité de l’action, vous offre un second lieu commun. Un troisième met sous les yeux de l’auditoire une peinture animée, qui lui persuade que, dans les mêmes circonstances, à la même époque et avec les mêmes motifs, il n’aurait pas agi autrement que vous. La récrimination a lieu lorsqu’en avouant le délit on se justifie, en montrant qu’on a été entraîné à le commettre par la faute d’un autre. Par exemple : « Horace, vainqueur des trois Curiaces, après la mort de ses deux frères rentre en triomphe dans la ville. Il voit que sa sœur, sans être affligée de la perte de ses frères, prononce de temps en temps, avec des pleurs et des sanglots, le nom d’un des Curiaces, auquel elle était fiancée. Dans le transport de son indignation,« il la tue. On le cite en justice. »
On l’accuse « d’avoir, sans aucun droit, tué sa soeur. » Il répond « qu’il en avait le droit. » C’est ce qu’il s’agit de décider. Voici son motif : « Elle pleurait la mort d’un ennemi, sans songer à celle de ses frères ; elle détestait ma victoire et celle du peuple romain. » On le réfute, en disant « que son frère ne devait pas néanmoins la tuer, sans qu’elle fût condamnée. » Voici le point à juger : « Horatia, indifférente à la mort de ses frères, pleurait celle des ennemis, et ne se réjouissait point de la victoire de son frère et du peuple romain : son frère avait-il le droit de la tuer, sans qu’elle fût condamnée ? »
XXVII. Dans ce genre de cause, on peut, ainsi que nous l’avons dit pour l’alternative, emprunter aux autres questions ce qui convient à celle que nous discutons. Il faut ensuite trouver, s’il est possible, quelque question qui puisse servir à la défense de celui sur qui l’accusé rejette le crime. On montre d’abord qu’il est moins grave que celui dont l’accusé est coupable. Ensuite, par la récrimination, on fait voir par qui, devant qui, de quelle manière, dans quel temps l’action devait être intentée, le jugement rendu ou la décision de cette affaire prononcée ; on prouve surtout qu’il ne fallait pas que la punition devançât le jugement. Puis on développe les lois et les jugements qui pouvaient punir légalement une faute dont l’accusé s’est déclaré le vengeur de sa pleine autorité. Dites ensuite qu’on doit rejeter toute accusation fondée sur un délit dont l’accusateur lui-même n’a pas voulu attendre le jugement, et regarder comme non avenu ce qui n’a pas été jugé. Insistez sur l’impudence de ceux qui accusent aujourd’hui devant les juges, celui qu’ils ont eux-mêmes condamné sans l’entendre, qui demandent un jugement contre celui qu’ils ont déjà puni. Prouvez qu’il n’y aura plus d’ordre dans les jugements, que les juges excéderont leur pouvoir, s’ils prononcent à la fois et sur l’accusé, et sur celui dont il vient devant eux se faire l’accusateur. Quels désordres ne produira point ce principe, une fois établi, de punir une faute par une autre faute, une injustice par une injustice ! Si l’auteur de l’accusation présente avait voulu suivre l’exemple de l’accusé, il n’aurait pas besoin non plus de jugement ; et si chacun agissait de même, il n’y aurait plus de tribunaux.
Voici un raisonnement que vous pouvez développer encore : Quand même Horatia, sur qui l’accusé rejette son crime, eût été légalement condamnée, était-ce à lui de la punir ? Et s’il ne l’a pas dû, quand elle eût été condamnée, combien est-il coupable de l’avoir fait, sans que personne ait jamais appelé sur elle la justice des tribunaux ! Demandez ensuite qu’il vous montre la loi qui le justifie.
Nous avons dit, en parlant (le l’alternative, que l’accusateur devait mettre tous ses soins à atténuer ce qu’on donne pour alternative. Il faut encore ici comparer la faute de celui sur qui l’on rejette l’accusation, avec le crime de celui qui prétend avoir suivi les règles de la justice. Alors vous aurez soin de démontrer que cette faute n’est point de nature à justifier le crime de l’accusé. Enfin, comme dans l’alternative, arrêtez-vous au point à juger, et développez-le, par l’amplification, suivant les règles du genre délibératif.
XXVIII. Le défenseur, de son côté, réfutera, par les lieux que nous avons indiqués, les moyens tirés des autres questions. Il soutiendra la récrimination, d’abord, en exagérant le crime et j l’audace de celui sur lequel il rejette le délit, en excitant, suivant son sujet, l’indignation ou la pitié par une peinture vive et animée, puis, comparant la faute et le châtiment, il montrera que la peine a été plus légère que ne le méritait le crime. Quant aux autres lieux que l’accusateur aura traités de manière qu’on puisse les rétorquer et les tourner contre lui, (et tels sont les trois derniers qu’il a employés,) suivez, pour les réfuter, une marche contraire à la sienne. La plus solide raison que l’accusateur ait à vous opposer, c’est le désordre général,que causerait le pouvoir de punir un homme qui n’aurait point été condamné : répondez, pour l’affaiblir, que le crime était tel qu’un homme, je ne dis pas vertueux, mais seulement un homme libre, ne devait point le souffrir ; si évident, que le coupable même n’osait essayer de le nier ; tel d’ailleurs, que c’était pour celui qui l’a puni plus que pour tout autre un devoir de le faire ; que la justice et l’honneur exigeaient plutôt qu’il fût puni comme il l’a été, et par celui qui l’a puni, que porté devant les tribunaux ; enfin qu’il a été si public qu’il n’était pas besoin de jugement. Ici vous prouverez, par des raisonnements et des comparaisons, qu’il y a plusieurs crimes si atroces et dont l’évidence est si frappante, qu’il n’est pas nécessaire, qu’il n’est pas même utile, d’attendre que les juges aient prononcé.
L’accusateur aura un lieu commun contre l’accusé qui, ne pouvant nier le délit qu’on lui impute, ose fonder quelque espérance sur le renversement de toute justice. Il démontrera l’utilité des tribunaux ; il plaindra le sort d’un malheureux qui subit le supplice sans avoir été condamné ; il exhalera son indignation contre l’audace et la cruauté de celui qui s’est fait l’exécuteur de ce supplice. Le défendeur s’indignera aussi contre l’audacieux qu’il a puni, et tachera de nous attendrir sur son propre sort. Il ne faut point juger de la chose par le nom qu’on lui donne, mais considérer l’intention de l’accusé, les motifs, le temps de l’exécution. Quels maux n’enfanterait point l’injustice ou le crime, si celui qu’on attaque dans son honneur, dans ses parents, dans ses enfants, enfin dans tout ce qui peut ou doit être cher à tous les hommes, n’avait puni un attentat si énorme et si public !
XXIX. Le recours rejette sur quelque autre personne ou sur quelque chose l’accusation intentée contre nous. Il y en a deux espèces ; car c’est tantôt la cause et tantôt le fait qu’on rejette. L’exemple suivant fera connaître la première : « Les Rhodiens ont nommé des députés pour se rendre à Athènes ; les trésoriers ne leur ont point remis d’argent comme ils le devaient, et les députés ne sont point partis. » On les cite en justice. « Ils devaient partir, » voilà l’accusation. Ils la repoussent, en disant « qu’ils ne le devaient pas. » La question est « Le devaient-ils ? » Ils donnent pour raison « que le trésorier ne leur a point remis l’argent qu’ils devaient recevoir du trésor public. « On les réfute, en disant : « Vous n’en deviez pas moins remplir les fonctions dont l’État vous avait chargés. » Il s’agit de décider « si des députés qui ne reçoivent pas du trésor public, les frais de voyage qui leur étaient dus, n’en sont pas moins tenus de remplir leur mission. » Examinez encore ici, comme dans les autres causes, ce que vous fournit la question de conjecture ou toute autre question. L’alternative et la récrimination vous offriront surtout des secours.
L’accusateur justifiera, s’il le peut, celui sur qui l’accusé rejette sa faute ; sinon il affirmera qu’elle est étrangère à ce dernier, et personnelle à celui qu’il accuse. D’ailleurs, chacun doit remplir ses devoirs ; et de ce que l’un est coupable, ce n’est pas une raison pour les autres de le devenir. Ensuite, celui sur qui vous rejetez votre cause est -il coupable, accusez-le à part comme je vous accuse, et ne confondez pas votre défense et son accusation.
Quand le défenseur aura traité toutes les questions incidentes, voici la marche qu’il suivra pour le recours. D’abord, il démontrera quel est l’auteur de la faute, et, outre que ce n’est point lui, qu’il n’a pas pu, qu’il n’a pas dû agir comme le prétend l’accusateur. Il ne l’a pas pu, ce qu’il prouvera par les raisons d’intérêt qui embrassent aussi la nécessité. Il ne l’a pas dû, l’honneur s’y opposait. Nous développerons mieux ces deux points, en traitant du genre délibératif. L’accusé a fait tout ce qui était en son pouvoir, et s’il n’a pas fait ce qu’il devait, la faute tout entière retombe sur un autre. Mais, en chargeant ce dernier, n’oubliez point de faire voir tout le zèle et toute la bonne volonté de l’accusé ; prouvez-le par l’empressement qu’on lui a toujours connu pour ses devoirs, par ses discours, par ses actions passées. D’ailleurs, il était aussi utile à ses intérêts de faire ce qu’on lui reproche de n’avoir pas fait, que dommageable de ne le pas faire ; et cette conduite s’accordait bien mieux avec le reste de sa vie, que cette négligence involontaire dont il faut accuser tout antre que lui.
XXX. Si l’on rejette la faute, non sur un homme, mais sur une chose ; si, pour nous servir du même exemple,on répond « que c’est la mort du trésorier qui a empêché de remettre l’argent aux députés, » en retranchant la récrimination, on peut se servir également des autres lieux communs, et prendre dans la concession ou aveu du crime, dont nous traiterons plus bas, ce qu’elle offre de favorable. Les lieux communs sont pour l’une et l’autre à peu près les mêmes que dans les précédentes questions accessoires. Quelques-uns néanmoins sont particuliers à celle-ci comme, l’indignation pour l’accusateur ; et, pour le défendeur, l’injustice qu’il y aurait à le punir d’une faute dont un autre est coupable.
Employer le recours pour rejeter le fait lui-même, c’est nier que l’action dont on nous accuse dépendît de nous en aucune manière, et affirmer que ce n’est point à nous qu’il faut attribuer ce qu’elle peut avoir de criminel. En voici un exemple : « Autrefois, lors de la conclusion d’un traité avec les Samnites, un jeune patricien fut chargé par le général de tenir la victime. Le sénat refusa de ratifier ce traité ; on livra aux ennemis le général, et un sénateur fut d’avis qu’il fallait aussi livrer celui qui avait tenu la victime. » - « » Il faut le livrer, » dit l’accusateur. « Il ne le faut pas, » répond le défenseur. « Le faut-il ? » voilà la question. « Il n’y a point de ma faute, dit le jeune homme pour se justifier ; mon âge et ma condition privée ne me donnaient aucun pouvoir, surtout en présence du général qui, revêtu d’une magistrature et d’une autorité suprême, devait juger si le traité était honorable ou non. » On le réfute ainsi : « Puisque vous avez pris part aux cérémonies religieuses qui consacrent un traité honteux, vous devez être livré. » - Voici le point à juger. « Un particulier, sans nul caractère public, qui, par l’ordre du général, a pris part au traité, et à toutes les cérémonies dont fut accompagné cet acte religieux, doit-il ou non être livré aux ennemis ? » - Ce qui distingue ces deux genres de cause, c’est que dans le premier, l’accusé accorde qu’il aurait dû faire ce que veut l’accusateur ; mais, sans employer la concession, il attribue à quelque chose ou à quelqu’un la cause qui a enchaîné sa volonté : nous montrerons bientôt que la concession emploie (les moyens plus victorieux. Dans le second, au contraire, il ne doit pas accuser un autre, mais démontrer que le fait n’est pas ou n’était pas en sou pouvoir, et ne le regardait nullement. Alors il arrive souvent que l’accusateur intente son accusation par le recours ; comme si, par exemple, « on mettait en justice un citoyen qui, pendant sa préture, quoique les consuls fussent à Rome, aurait appelé le peuple aux armes pour quelque expédition. » En effet, de même que dans l’exemple précédent, l’accusé déclarait que le fait n’était point en sa puissance, et que son devoir ne lui prescrivait pas de l’éviter : ainsi, dans la cause présente, l’accusateur appuie son accusation, en démontrant que le fait n’était point du ressort de celui qu’il accuse, et que son devoir ne lui prescrivait point de s’en charger. Chacune des deux parties doit chercher, par tout ce que fournit l’honneur et l’intérêt, par des exemples, des indices et des raisonnements, à établir ses devoirs, ses droits, son pouvoir, et examiner si sur tous ces points chacun a exercé des fonctions qui lui appartiennent. La nature du fait indiquera s’il faut employer les lieux communs de l’indignation ou du pathétique.
XXXI. La concession ou l’aveu du crime a lieu lorsque l’accusé, sans se justifier sur le fait, supplie qu’on lui pardonne. Il emploie le défaut d’intention et la déprécation. Par le défaut d’intention, il ne cherche point à se justifier du fait, mais de l’intention ; et alors il peut alléguer pour excuse l’ignorance, le hasard ou la nécessité.
Par l’ignorance, l’accusé assure qu’il ne connaissait pas telle ou telle chose. Voici un exemple de cette espèce de justification : « Un peuple avait défendu d’immoler des veaux à Diane. Des matelots, pendant une tempête, firent vœu, s’ils pouvaient entrer dans un port qu’ils apercevaient, d’immoler un veau à la divinité qu’on y adorait. Sur le port se trouvait par hasard le temple de cette Diane, à laquelle on ne pouvait. immoler des veaux. Les matelots débarquent, et, ne connaissant pas la loi, accomplissent leur vœu ; on les accuse. » - « Vous avez immolé un veau à Diane ; ce sacrifice était défendu, » dit l’accusateur. « Oui, mais nous l’ignorions, » répondent-ils en se justifiant par la concession ou l’aveu du crime. — On les réfute en disant : « Qu’importe ? puisque vous avez fait ce qui était défendu, la loi veut que vous soyez punis. » - Il s’agit de décider « si celui qui a enfreint une loi qu’il ne connaissait pas a mérite le châtiment. »
On allègue le hasard, quand on veut prouver que des événements imprévus se sont opposés à notre volonté. « A Lacédémone, la loi condamnait à mort celui qui s’était chargé de fournir les victimes pour certains sacrifices, s’il manquait à ses engagements. A l’approche d’un jour de fête où ces sacrifices devaient été célébrés, celui qui avait pris sur lui cette charge se disposait à faire conduire les victimes à la ville, quand tout à coup l’Eurotas, fleuve qui coule près de Sparte, gonflé par des pluies extraordinaires, se déborde avec tant de violence, qu’il fut impossible de faire passer les victimes. Le fournisseur, pour prouver sa bonne volonté, range toutes les victimes sur la rive, de manière qu’on pouvait les apercevoir de l’autre bord. Chacun était convaincu que le débordement du fleuve avait seul arrêté le zèle de cet homme : néanmoins on intente contre lui une accusation « capitale. » - On l’accuse « de n’avoir pas fourni les victimes qu’il devait pour le sacrifice. » Il se justifie par la concession, et sa raison est : « Le « débordement subit de l’Eurotas m’a empêché de les conduire à la ville. « On lui répond : « Vous n’en avez pas moins manqué à ce que prescrit la loi ; vous méritez donc d’être puni. » Voici le point à juger : « Le fournisseur a manqué à la loi ; mais le débordement du fleuve a seul arrêté son zèle : doit-il être puni ? »
XXXII. On allègue la nécessité, quand l’accusé montre qu’il n’a cédé qu’à l’ascendant d’une force irrésistible. « Une loi des Rhodiens ordonnait de faire vendre tout vaisseau armé d’un éperon qu’on trouverait dans leur port. Une tempête furieuse s’élève, et la violence du vent oblige un vaisseau de relâcher, malgré les efforts des matelots, dans le port de Rhodes. Le trésorier veut faire vendre ce vaisseau, comme appartenant au peuple. Le propriétaire s’oppose à la vente. » L’accusateur dit « qu’un vaisseau à éperon a été saisi dans le port. » L’accusé en convient, mais il répond « qu’il y a été poussé malgré lui par une nécessité insurmontable. » On le réfute en disant « qu’aux termes de la loi, le vaisseau n’en appartient pas moins au peuple. » Il s’agit de décider « si, lorsque la loi ordonne de vendre tout vaisseau armé d’un éperon qu’on saisira dans le port, un vaisseau que les vents y ont poussé, malgré l’équipage, doit être vendu. »
Nous avons réuni les exemples de ces trois genres, parce quels marche du raisonnement est la même pour chacun d’eux ; car, dans tous trois, l’accusateur doit, s’il est possible, employer les moyens de la question conjecturale pour faire soupçonner l’accusé de n’avoir pas fait sans intention une action qu’il prétend indépendante de sa volonté. Qu’il définisse ensuite la nécessité, le hasard ou l’ignorance ; qu’il appuie sa définition d’exemples frappants, fournis par l’un ou par l’autre de ces trois incidents ; qu’il les distingue bien du fait dont il s’agit ; qu’il montre la différence qui se trouve entre eux ; par exemple, l’affaire en question est bien moins importante, bien plus facile, et n’offre aucun prétexte d’ignorance, de hasard ou de nécessité. D’ailleurs il était facile de l’éviter ; il ne fallait que faire ou ne pas faire telle ou telle chose pour la prévoir et la prévenir ; et les définitions montreront qu’on ne doit point donner à une telle conduite les noms d’ignorance, de hasard ou de nécessité., mais l’appeler indolence, inattention et sottise.
Cette nécessité, qu’on allègue pour excuse, parait-elle entraîner quelque chose de honteux, prouvez alors, par un enchaînement de lieux communs, qu’il valait mieux tout souffrir, même la mort, que de se soumettre à une nécessité déshonorante. Établissez ensuite, d’après les lieux dont nous avons parlé dans la cause matérielle, la nature du droit et de l’équité ; et, comme dans la question juridiciaire absolue, considérez le fait isolément et en lui-même. C’est alors qu’il faut, si vous le pouvez, rassembler des exemples qui prouvent que de pareilles excuses n’ont point été reçues ; que cependant les circonstances leur donnaient un nouveau poids. Prouvez aussi, par les moyens du genre délibératif, qu’il y aurait de la honte ou du danger à pardonner une telle faute, et que la négligence de ceux qui ont le droit de la punir entraînerait les plus funestes conséquences.
XXXIII. Le défenseur peut rétorquer tous ces moyens contre son adversaire ; mais il s’occupera surtout de justifier l’intention, et de développer les obstacles qui ont arrêté sa bonne volonté. Il n’a pas été en son pouvoir d’en faire davantage : c’est l’intention qu’il faut en tout considérer. On ne peut le convaincre, on ne peut lui prouver que son cœur n’est pas innocent : si on le condamne, n’est-ce pas condamner en lui la faiblesse commune à tous les hommes ? Quelle indignité, quand on est exempt de la faute, de n’être pas exempt du supplice ! L’accusateur tirera des lieux communs, d’abord de l’aveu de l’accusé, et ensuite de la licence qu’on laisse au crime, si l’on établit une fois qu’il faut juger non le fait, mais l’intention. Le défenseur se plaindra d’un malheur causé non par sa faute, mais par une force supérieure, du pouvoir de la fortune, et de la faiblesse humaine : ce n’est pas l’événement qu’il faut envisager, mais sa conscience. En développant toutes ces idées, il aura soin d’exciter des mouvements de pitié pour son infortune, et d’indignation contre la cruauté de ses ennemis.
Et qu’on ne s’étonne point ici de voir mêler à cet exemple ou à d’autres la discussion du sens littéral de la loi. Nous traiterons plus bas cettequestion à part ; mais s’il est des causes qui doivent être considérées isolément et en elles-mêmes, il en est d’autres qui offrent une complication de différentes espèces de questions. Il ne sera donc point difficile, quand on les connaîtra toutes, d’appliquer à chaque cause les règles des genres qu’elle embrasse. C’est ainsi que, dans tous ces exemples de concessions, se trouve mêlée la question littérale, qui prend son nom de la lettre et de l’esprit : mais comme nous traitions de la concession ou de l’aveu du crime, nous eu avons donné les règles ; nous traiterons ailleurs de l’esprit et de la lettre. Voyons maintenant l’autre partie de la concession.
XXXIV. Par la déprécation, l’orateur ne cherche point à se justifier, mais il supplie qu’on lui pardonne. Je ne suis point d’avis d’employer ce moyen devant les tribunaux ; car, le crime une fois avoué, il est difficile d’en obtenir le pardon de celui dont le devoir est de le punir. Voulez-vous recourir à ce moyen de défense, ne l’employez que comme accessoire. Ainsi, en parlant pour un homme illustre, pour un héros qui a rendu à l’État de nombreux services, vous pouvez avoir recours à la déprécation, sans néanmoins paraître en faire usage, comme dans cet exemple : Juges, si, pour prix des services de « l’accusé, pour prix de son dévouement à vos « intérêts, il venait aujourd’hui, en faveur de « tant d’actions éclatantes, réclamer votre indulgence pour une seule faute, il serait digne de « votre clémence et de son courage d’accorder une « telle grâce à un tel suppliant. Vous pouvez ensuite exagérer ses services, et, par des lieux communs, disposer les juges à la clémence.
Quoique ce moyen ne soit que rarement employé dans les tribunaux, si ce n’est comme accessoire, toutefois, comme il peut être nécessaire d’y avoir recours et de l’employer dans toute la cause, devant le sénat ou devant une assemblée, nous en tracerons les règles. Ainsi, « lorsque le sénat et l’assemblée publique délibérèrent sur le sort de Syphax, et le préteur L. Opimius et son conseil sur l’affaire de Q. Numitorius Pullus, la décision fut longue, et Numitorius réussit moins à se justifier qu’à obtenir sou pardon. Il ne fut pas aussi facile de prouver, par la question de fait, qu’il avait été toujours dévoué aux intérêts de Rome, que d’obtenir par la déprécation le pardon de sa faute, en faveur de ses derniers services. »
XXXV. Demandez-vous donc qu’on vous pardonne ; rappelez, si vous pouvez, les services que vous avez rendus ; montrez, s’il est possible, qu’ils surpassent de beaucoup votre faute, pour prouver que vous avez fait plus de bien que de mal. N’oubliez point non plus d’exposer les services de vos ancêtres. Prouvez que vous n’étiez guidé ni par la haine ni par la cruauté ; mais que vous étiez égaré, séduit ; que vous aviez des motifs honorables, ou qui, du moins, n’avaient rien de criminel. Promettez, jurez qu’instruit par votre erreur même, affermi dans le chemin de la vertu par un pardon si généreux, on n’aura plus désormais rien de pareil à vous reprocher, et montrez l’espoir d’être quelque jour utile à ceux qui vous auront pardonné. Rappelez encore, si vous le pouvez, que les liens du sang ou l’amitié de vos ancêtres vous unissent étroitement à ceux dont vous implorez la générosité. Relevez votre dévouement, la haute naissance, la dignité de vos protecteurs ; usez, en un mot, de tous les lieux communs qui ont rapport à l’honneur et à la dignité des personnes. Employez les prières, et sans montrer jamais ni fierté ni hauteur, prouvez qu’on vous doit des récompenses plutôt que des châtiments. Nommez ensuite ceux à qui on a pardonne des délits plus graves. Un de vos moyens les plus victorieux sera de démontrer que, lorsque vous étiez armé de la puissance et de l’autorité, vous étiez bon et porté à la clémence. Atténuez aussi votre faute de manière à la rendre la plus légère possible, et à faire voir ainsi qu’il ne serait pas moins honteux qu’inutile de vous punir pour si peu de chose. Enfin pour attendrir vos auditeurs, employez les moyens que nous avons indiqués au premier livre.
XXXVI. L’adversaire, de son côté, exagérera la faute : le coupable n’a rien fait par ignorance, mais il a agi par méchanceté, par cruauté ; son caractère est impitoyable, superbe. Il a toujours été, dira-t-il, mon ennemi ; et rien ne pourra jamais changer ses sentiments envers moi. Ces services qu’il rappelle, est-ce à sa bienveillance ou à des vues intéressées que je les dois ? Ils ont été suivis d’une haine violente, il les a effacés par tout le mal qu’il m’a fait ; ou, ses services sont bien au-dessous des fautes qu’il a commises ; ou bien, ses services ont été récompensés ; il faut. punir ses fautes : le pardon serait aussi honteux qu’inutile. Quelle folie de ne point user de votre pouvoir sur celui que vous avez désiré si souvent avoir entre vos mains ! Rappelez-vous quels étaient pour lui vos sentiments, quelle était votre haine. L’indignation qu’inspire le crime de l’accusé fournit à l’orateur un lieu commun ; la pitié que réclame le malheur dû à la fortune, et non à sa propre faute, lui en fournira un second.
La multitude des divisions de la question de genre nous a forcés de nous y arrêter longtemps. Comme la différence et la variété des objets qu’elle embrasse pourraient nous jeter dans quelque erreur, il me paraît indispensable de prévenir ici de ce qui me reste à dire sur ce genre de question, et d’expliquer mes motifs. La question juridiciaire traite, avons-nous dit, du droit et du tort, des châtiments et des récompenses. Nous avons traité des causes où l’on s’occupe du droit et du tort ; il faut donc maintenant parler des peines et des récompenses.
XXXVII. Un grand nombre de causes ont pour but la demande d’une récompense ; car souvent les tribunaux s’occupent des récompenses dues à l’accusateur, et l’on en sollicite devant le sénat ou devant le peuple. Qu’on n’aille pas croire qu’en parlant d’affaires portées devant le sénat, nous sortions du genre judiciaire. En effet, la louange et le blâme, quand il s’agit de recueillir ensuite les suffrages et de porter un jugement, ne sont plus du genre délibératif, mais bien du genre judiciaire, puisqu’il faut énoncer un avis et prononcer sur un homme. Avec une connaissance approfondie de la nature de toutes ces causes, il est facile de voir qu’elles diffèrent entre elles par le genre, et par la variété des formes, mais qu’elles n’en sont pas moins liées mutuellement, dans une foule de détails, par les rapports les plus intimes. Occupons-nous d’abord des récompenses. « Le consul L. Licinius Crassus poursuit et parvient à détruire dans la Gaule citérieure des brigands qui, sous différents chefs obscurs et inconnus, dévastaient la province par des courses continuelles, sans que leur nombre et leur nom permissent de les considérer comme ennemis du peuple romain. Le consul, à son retour à Rome, demanda au sénat les honneurs du triomphe. »
Ici, comme dans la déprécation, il ne s’agit pas d’établir le point à juger par des raisonnements et des réfutations ; car, s’il ne se présente pas de question ni de partie de question incidente, le point à juger est simple et renfermé dans la demande elle-même. Dans la déprécation, on s’exprimerait ainsi : « Faut-il punir ? » Ici on dira : « Faut-il récompenser ? » Voyons maintenant quels lieux appartiennent à la question des récompenses.
XXXVIII. On la divise en quatre parties : les services, l’homme, le genre de récompense, et les richesses. On considère les services en eux-mêmes, relativement aux circonstances, à l’intention de celui qui les a rendus, et à la fortune. On examine les services en eux-mêmes ; s’ils sont importants ou non, faciles ou difficiles, rares ou communs, ennoblis ou non par leur motif : les circonstances ; si l’on nous a rendu des services quand nous en avions besoin ; quand les autres ne pouvaient ou ne voulaient nous en rendre ; quand nous avions perdu tout espoir : l’intention s’ils n’ont pas eu pour principe des vues intéressées, mais bien le désir sincère d’être utile : la fortune, s’ils ne sont point dus au hasard, mais à une volonté bien décidée, ou si la fortune ne s’opposait point aux effets de cette bonne volonté.
Quant à l’homme, on s’attache à découvrir sa conduite, à connaître quels frais ou quels soins lui a coûtés cette action ; s’il en a déjà fait une semblable ; s’il ne réclame point le prix d’une action dont un autre est l’auteur, ou qui n’est due qu’aux dieux ; s’il n’a pas lui-même refusé d’accorder une récompense méritée par les mêmes moyens ; si l’honneur qu’il s’est acquis par ses services ne l’a point assez récompensé ; s’il n’a pas été forcé d’agir comme il a fait ; ou si son action n’est point de nature à mériter une récompense, puisqu’il eût mérité d’être puni pour n’avoir pas fait cette action dont il se glorifie ; enfin s’il ne demande point trop tôt sa récompense, et ne vend point à un prix assuré des espérances incertaines ; ou s’il ne se hâte point de demander une récompense, pour se dérober à quelque peine par ce jugement anticipé.
XXXIX. Pour le genre de récompense, on examine la nature et l’importance de celle qu’on exige, l’action pour laquelle on la réclame, et le prix que mérite chaque action. On va chercher ensuite dans l’antiquité, à quels hommes et à quelles actions on a accordé un honneur qu’on ne doit pas d’ailleurs prodiguer. Celui qui s’oppose à ce qu’on accorde la récompense, a ici pour lieux communs, d’abord, que les récompenses de la vertu et du zèle dans l’accomplissement de ses devoirs sont sacrées ; qu’on ne doit point les accorder au crime ni les prodiguer à la médiocrité ; ensuite, que les hommes auront moins d’amour pour la vertu, si on les familiarise avec les récompenses, dont l’attrait seul nous fait trouver belles et agréables des actions difficiles et pénibles en elles-mêmes ; enfin, que si, dans l’antiquité, on rencontre quelques grands hommes dont le mérite supérieur a été honoré d’une pareille distinction, ne croiront-ils pas que l’on veut ternir leur gloire, en accordant la même récompense à des hommes tels que ceux qui la demandent aujourd’hui ? L’orateur comptera ces héros ; il les opposera aux adversaires. Celui qui demande la récompense développera son action, et la comparera avec celles qu’on a honorées d’une récompense. Enfin, il dira que c’est décourager la vertu, que de lui refuser le prix de ses efforts.
On parle des richesses, quand il s’agit d’une récompense pécuniaire. Alors on examine si le pays qui l’accorde est riche ou non en propriétés, en revenus, en argent comptant : les lieux communs sont, qu’il faut augmenter et non diminuer les richesses d’un État ; qu’il y a de l’impudence à ne point se contenter de la reconnaissance, et à trafiquer de ses bienfaits. L’adversaire répondra qu’une basse avarice peut seule calculer quand il s’agit d’être reconnaissant ; qu’il ne vend point ses services, mais qu’il désire qu’on l’en récompense par l’honneur qu’il a mérité. Mais c’est assez parler des questions ou états de cause : passons aux discussions qui portent sur le sens littéral.
XL. La discussion porte sur le sens littéral, quand le texte offre quelque chose de douteux : ce qui vient de termes ambigus, de la lettre et de l’esprit, de lois contraires, de l’analogie ou de mots mal définis. La question naît de l’ambiguïté des termes, quand le texte offre deux ou plusieurs sens qui empêchent de distinguer l’intention véritable de celui qui a écrit. Par exemple : « Un père de famille qui a institué son fils son héritier, lègue cent livres de vaisselle d’argent à « son épouse, en ces termes : QUE MON HÉRITIER DONNE A MA FEMME CENT LIVRES DE VAISSELLE D’ARGENT A SON CHOIX. Le père « mort, la mère demande à son fils la vaisselle la plus précieuse, les pièces les mieux travaillées. Le fils soutient qu’il ne doit lui donner que celles qu’il voudra. » Démontrez d’abord, s’il est possible, qu’il n’y a point d’ambiguïté dans les termes, puisque, dans la conversation, on emploie ce mot ou cette expression dans le sens que vous lui donnez. Prouvez ensuite que ce qui précède et ce qui suit rend clair l’endroit dont il s’agit. Si l’on considère chaque mot en particulier, tous, ou du moins le plus grand nombre, auront quelque chose d’ambigu ; mais si le sens du texte, dans son ensemble, est clair, il n’y a point d’ambiguïté. D’ailleurs, les autres écrits, les actions, les paroles, l’esprit, la conduite enfin de celui qui a rédigé, pourront vous éclairer sur son intention. Étudiez encore avec soin l’écrit dont il s’agit ; examinez-en toutes les parties, pour découvrir quelque chose de favorable au sens que sous y donnez, ou qui détruise celui de votre adversaire : car il n’est pas difficile, d’après le sens général de l’écrit, le caractère de celui qui l’a fait, et d’après les différents chefs qui appartiennent à la personne, de trouver ce qu’il a dû vraisemblablement écrire. Montrez ensuite, quand le sujet le permet, que le sens préféré par votre adversaire est beaucoup moins convenable que le vôtre, qu’il est impraticable, et qu’il n’atteint pas le but qu’on s’était proposé, tandis que le vôtre présente autant de facilité dans l’exécution que d’avantages dans le résultat. Supposons ( car rien ne nous empêche d’avoir recours à des suppositions, pour nous faire mieux comprendre ), supposons qu’une loi porte : UNE COURTISANE NE PEUT AVOIR UNE COURONNE D’OR ; EN A-T-ELLE UNE, QU’ON LA VENDE. On pourrait répondre à celui qui voudrait, aux termes de la loi, faire vendre la courtisane : « Proposer de vendre celle qui se vend tous les jours, est-ce un moyen raisonnable, et la loi serait-elle exécutée ? La vente de la couronne, au contraire, est aussi aisée « qu’utile, et on ne peut y trouver aucun obstacle. »
XLI. Examinez de plus si, en approuvant le sens de votre adversaire, on n’accuse pas l’auteur de l’écrit d’avoir négligé quelque chose de plus utile, de plus honnête ou de plus nécessaire. Montrez que si le sens que vous proposez est dicté par l’honneur, il n’est pas moins conforme à l’intérêt et commandé par la nécessité, et qu’il n’en est pas de même de celui de la partie adverse. Toutes les fois que la question naît ainsi de l’ambiguïté des termes d’une loi, attachez-vous à montrer qu’une autre loi a pourvu à l’objet que veut entendre votre adversaire. Il est encore important pour vous de faire voir quelles expressions eût employées le rédacteur de l’écrit, s’il eut voulu parler dans le sens qu’on vous oppose. Ainsi, dans la cause où il est question de vaisselle d’argent, la mère ne peut-elle pas dire que « le « testateur n’aurait point ajouté a SON CHOIX, s’il s’en fût rapporté à la volonté de l’héritier ? Son silence eût indiqué que le choix de la vaisselle était laissé à l’héritier. C’eût donc été une folie que d’ajouter, pour la sûreté de l’héritier, un mot dont la suppression ne blesserait en rien ses intérêts. » Dans de pareilles causes, servez-vous surtout de ce raisonnement : Si telle avait été son intention, il ne se serait point servi de ce mot, il ne l’aurait pas mis à cette place ; car c’est là surtout ce qui rend évidente l’intention du testateur. Examinez aussi dans quel temps il a écrit : les circonstances pourront vous aider à deviner son intention ; puis vous chercherez, par les moyens du genre délibératif, ce que l’honneur et l’intérêt prescrivaient à l’un d’écrire, et aux autres d’entendre ; et si l’on emploie l’amplification, les deux parties auront recours aux lieux communs.
XLII. Quand l’un s’attache à la lettre, et que l’autre, au contraire, ramène toutes les expressions à l’intention qu’il suppose à l’auteur de l’écrit, la question naît alors de l’esprit et de la lettre. Celui qui s’attache à l’intention, montrera que l’auteur de l’écrit n’a jamais eu qu’un seul but, qu’une seule volonté ; ou il tâchera, soit par le fait, soit par quelque incident, d’adapter le texte à la circonstance. Il prouvera que la volonté de l’auteur de l’écrit n’a jamais changé, comme dans cet exemple : « Un homme marié, mais sans enfants, a fait son testament en ces termes : Si J’AI UN OU PLUSIEURS FILS, ILS HÉRITERONT DE MES BIENS ; suivent les formules ordinaires. Puis il ajoute : Si MON FILS MEURT AVANT LA MAJORITÉ, VOUS SEREZ MON SECOND HÉRITIER. Il n’eut pas de fils ; ses parents disputent la succession à celui qu’il a déclaré héritier, dans le cas où le fils mourrait avant sa majorité. » On ne peut pas conseiller ici d’adapter la volonté du testateur au temps ou à quelque événement particulier ; car on ne peut lui en prêter qu’une seule, et c’est celle qui fait toute la force de celui qui attaque le texte pour défendre ses droits à l’héritage.
Il est encore une manière de défendre l’intention. On ne soutient pas que la volonté du testateur ait été toujours la même, indépendante des événements et dirigée vers le même but ; mais que, d’après certains faits, certains incidents, il faut l’interpréter suivant les circonstances ; et alors on puisera ses plus puissants moyens dans la cause juridiciaire accessoire. Tantôt on emploie l’alternative, comme pour défendre. « Celui qui, malgré la loi, a ouvert de nuit les portes, pendant la guerre, pour recevoir des troupes auxiliaires qui eussent été infailliblement accablées par l’ennemi campé sous les murs ; » tantôt la récrimination, comme à l’égard de « Celui qui, malgré la loi générale qui défend l’homicide, a tué son tribun militaire, pour se dérober à ses violences criminelles ; » tantôt le recours, comme en faveur de « Celui qui, nommé député, n’a pu partir au jour fixé par la loi, faute d’avoir reçu de l’argent du trésorier ; » enfin, l’aveu du crime pour s’excuser sur son ignorance, comme « Dans le sacrifice du veau ; » sur une force irrésistible, comme « Dans le vaisseau à éperon ; » sur le hasard, comme « Dans le débordement de l’Eurotas. » Ainsi développez l’esprit du texte, de manière à prouver que la volonté du testateur ou du législateur était une et invariable, ou qu’on peut la déterminer par telle ou telle circonstance, tel ou tel événement.
XLIII. Tous les lieux que nous allons indiquer, ou du moins le plus grand nombre, pourront servir à celui qui défend la lettre. Il commencera par l’éloge du législateur ou du testateur, et par un lieu commun sur la nécessité indispensable pour un juge, de s’en tenir à la lettre, surtout quand il s’agit d’un texte légal et authentique, comme, par exemple, d’une loi ou d’un écrit fondé sur la loi. Ensuite (et c’est surtout ici que la preuve devient puissante), l’orateur doit comparer la conduite ou l’intention de ses adversaires avec l’écrit lui-même, les définir l’un et l’autre, rappeler aux juges leur serment, lieu qui offre à l’éloquence une variété infinie. Tantôt il se demande avec étonnement à lui-même ce qu’on peut lui répondre ; tantôt, s’adressant aux juges une seconde fois, il semble chercher ce qu’ils pourraient encore attendre de lui ; enfin, apostrophant son adversaire, qu’il paraît accuser à son tour : Niez-vous, dira-t-il, que ce soit là le texte de la loi ou de l’écrit, ou que vous ayez agi dans un sens contraire, et que vous y portiez atteinte ? osez nier l’un ou l’autre, et je me tais. Accorde-t-il l’un et l’autre, sans se désister de ce qu’il avance, vous ne pouvez plus victorieusement prouver son impudence, qu’en vous arrêtant tout à coup, comme si vous n’aviez plus rien à dire, comme si l’on n’avait rien à vous répondre ; qu’il vous suffise alors de lire souvent à haute voix l’écrit qui fait l’objet de la discussion, et de comparer souvent avec cet écrit la conduite de votre adversaire ; adressez-vous aussi quelquefois au juge avec vivacité ; rappelez-lui son serment, ses devoirs, en ajoutant que l’obscurité du texte ou les dénégations de l’adversaire pouvaient seules le jeter dans l’incertitude. Mais puisque le texte est formel, que l’adversaire convient de tous les faits le devoir du juge est d’obéir à la loi, et non de, l’interpréter.
XLIV. Ceci bien établi, écartez toutes les objections qu’on pourrait vous faire. On vous réfutera en prouvant que les expressions du rédacteur ne sont pas d’accord avec sa volonté, comme il est arrivé dans l’exemple du testament ; ou, par la question accessoire, on montrera pourquoi l’on n’a pas pu ou dû s’en tenir rigoureusement au texte. Si l’on soutient que les expressions et l’intention du rédacteur ne s’accordent pas, celui qui s’en tient à la lettre dira qu’il ne nous appartient pas de raisonner sur la volonté d’un homme qui, pour nous empêcher d’interpréter ses voeux, nous en a transmis l’expression. Que d’inconvénients ne se présenteront pas, si l’on pose une fois en principe que l’on peut s’écarter de la lettre ! Ceux qui écriront leurs volontés, croiront qu’on ne les observera pas, et les juges n’auront plus de règle sûre, une fois qu’ils seront habitué, à s’éloigner du sens littéral. Vous voulez suivre la volonté du rédacteur ; mais ce n’est pas moi qui m’en écarte, c’est mon adversaire : car celui qui juge l’intention d’un homme d’après ses expressions, est bien plus fidèle à ses volontés, que celui qui ne s’en rapporte point aux expressions que le rédacteur nous a laissées comme le tableau fidèle de ses intentions, et qui prétendrait les comprendre ou les interpréter mieux que lui-même.
Si celui qui s’attache à l’esprit, expose quelque raison, répondez d’abord qu’il est absurde de convenir qu’on a enfreint la loi, et de chercher à justifier sa conduite. Dites ensuite que tout est bouleversé : autrefois c’était l’accusateur qui prouvait aux juges que l’accusé était coupable, qui établissait les motifs de son crime ; aujourd’hui c’est l’accusé lui-même qui montre pourquoi il est coupable. Chaque partie de la division suivante vous fournira encore un grand nombre de réfutations. D’abord, aucune loi ne permet d’alléguer des raisons contraires au texte de la loi ; ensuite, quand toutes les autres lois le permettraient, celle dont il s’agit ferait seule exception ; enfin, quand cette loi même le permettrait, la raison qu’on allègue ne doit être nullement accueillie.
XLV. Voici à peu près les moyens dont on peut appuyer la première partie. Le rédacteur ne manquait ni (le l’esprit, ni des lumières, ni des se-. cours nécessaires pour exprimer clairement sa volonté. S’il avait cru que le cas où se trouve votre adversaire méritât quelque exception, rien n’était plus simple et plus facile que de l’exprimer : les législateurs n’ont ils pas l’usage de faire des exceptions ? Lisez ensuite les lois qui portent des exceptions ; examinez surtout si la loi dont il s’agit n’en renferme aucune, ou si le même législateur n’en a point fait ailleurs quelques autres ; ce qui prouvera qu’il ne les aurait point omises ici, s’il avait cru qu’elles fussent nécessaires. Prouvez ensuite qu’admettre les raisons de l’adverse partie, c’est anéantir la loi, puisque, si on les admet une fois, on ne peut les considérer d’après une loi qui n’en parle pas ; que si l’on adoptait cette maxime, on offrirait à chacun les moyens et l’occasion de devenir criminel, puisqu’on jugerait alors les délits d’après le caprice du coupable, et non d’après la loi que l’on a juré d’observer ; enfin, que s’écarter de la loi, c’est renverser les principes qui guident les magistrats dans leurs jugements, et les citoyens dans leur conduite. En effet, qui pourra diriger les juges, s’ils s’écartent de la lettre ? comment pourront-ils condamner les autres, eux qui auront jugé contre la loi ? Et les citoyens sauront-ils ce qu’ils doivent faire, si chacun, sans respect pour les lois générales de l’État, ne suit dans sa conduite d’autre règle que son caprice et sa volonté ? Demandez aux juges pourquoi ils font le sacrifice de tous leurs instants aux affaires d’autrui ; pourquoi ils s’occupent du bien de l’État, tandis qu’ils pourraient se livrer tout entiers à leurs intérêts et à leurs plaisirs ; pourquoi ils emploient une formule de serment ; pourquoi ils s’assemblent et se séparent à des heures fixes et réglées ; pourquoi, s’ils sont obligés de se dérober quelquefois aux affaires publiques, ils n’allèguent d’autres causes que celles qui ont été formellement exceptées par la loi : est-il juste que la loi leur impose un joug si pesant dont ils permettront à nos adversaires de s’affranchir ? Si le coupable, direz-vous encore, voulait ajouter à la loi l’exception qui peut justifier sa conduite, le souffririez-vous ? N’est-il pas mille fois plus indigne et plus impudent d’enfreindre la loi, que d’y ajouter ? Supposons que vous-mêmes, juges, vous vouliez le faire, le peuple le souffrira-t-il ? Et n’est-il pas plus indigne de changer une loi par le fait même et par votre jugement, que d’en altérer le texte et les expressions ? Quelle indignité de déroger à la loi, de l’abroger, ou d’y faire le plus léger changement, sans que le peuple puisse en prendre connaissance, l’approuver ou le rejeter ! Cette innovation ne sera-t-elle pas dangereuse pour les juges ? Ce n’est ni le temps ni le lieu de corriger les lois ; c’est devant le peuple, c’est par le peuple qu’elles doivent être modifiées. Si l’on fait ce changement, dites que vous voulez savoir quel législateur s’en chargera, quels citoyens l’approuveront ; dites que vous prévoyez les suites de cette innovation, et que vous vous y opposez. Quand même les dispositions de la loi actuelle seraient aussi honteuses que funestes, les juges n’en doivent pas moins observer cette loi, quel qu’en soit le caractère. S’ils y trouvent quelque chose à reprendre, c’est au peuple à la corriger. Enfin, si nous n’avions point ce texte, cet écrit, nous mettrions tous nos soins à le découvrir ; et nous n’en croirions pas l’adversaire sur sa parole, ne fût-il pas accusé. Maintenant que nous l’avons, quelle folie d’en croire plutôt le coupable que les paroles mêmes de la loi ! C’est par ces raisons, et par d’autres semblables, qu’on prouve qu’il ne faut point admettre d’exceptions qui ne se trouvent pas dans la loi.
XLVI. Dans la seconde partie, vous avez à montrer que. quand même les autres lois seraient susceptibles d’exceptions, celle-ci ne saurait en admettre. Prouvez, pour y parvenir, que cette loi embrasse les objets les plus utiles, les plus importants, les plus nobles et les plus sacrés ; qu’il serait honteux, funeste ou sacrilège de ne pas observer scrupuleusement la loi dans une semblable affaire, ou que la loi est si exacte, a si bien prévu tous les cas et toutes les exceptions possibles, qu’il est ridicule de supposer qu’on ait omis quelque chose dans une loi rédigée avec tant de soin.
Enfin, celui qui défend la lettre, a pour troisième lieu commun, et c’est le plus important, que s’il convient quelquefois d’admettre des raisons qui combattent le texte, il ne faut pas du moins s’arrêter à celle que son adversaire propose. Ce point est d’autant plus essentiel, que toujours celui qui attaque la lettre doit avoir pour lui les apparences de la justice. Ne serait-ce pas le comble de l’impudence que d’attaquer un texte sans s’appuyer sur l’équité ? Si donc l’accusateur parvient à jeter des doutes sur ce point à l’égard de l’accusé, l’accusation paraîtra bien plus juste et bien mieux fondée ; car tout ce qui précède ne tendait qu’à mettre les juges dans la nécessité de se prononcer, même malgré eux, contre l’adversaire : ici il faut leur en inspirer le désir, même quand ils n’y seraient pas forcés. Vous y réussirez si, puisant aux mêmes lieux que l’adversaire a mis en œuvre pour sa justification, l’alternative, le recours, la récrimination ou la concession (lieux que j’ai développés plus haut avec tout le soin dont j’étais capable), vous employez, à l’aide de ces mêmes lieux communs, les moyens que vous fournit votre cause pour réfuter l’accusé ; si vous alléguez les raisons et les motifs pour lesquels la loi ou le testament renferme de telles dispositions, de sorte que vous paraissiez avoir pour vous la pensée et la volonté du rédacteur, aussi bien que le texte même de l’écrit. Vous pourrez encore attaquer le fait par d’autres états de question.
XLVII. Celui qui parle contre la lettre, établit d’abord l’équité de sa cause ; il montre quelle a été son intention, ses motifs, l’esprit qui l’a dirigé ; et, quelques raisons qu’il apporte, il suivra, dans sa défense, les principes que nous avons donnés sur la question accessoire. Après avoir, en développant ces moyens, exposé ce qui l’a fait agir, et démontré, par l’amplification, l’équité de sa cause, il soutiendra par les lieux suivants qu’il faut admettre des exceptions. Il prouvera que la loi n’ordonne jamais rien d’injuste ou de funeste, et que les peines qu’elle prononce sont établies pour punir le crime ou la méchanceté ; que le rédacteur, s’il existait encore, approuverait une telle action ; qu’il, en aurait fait autant dans les mêmes circonstances. Juges, dira-t-il, si le législateur exige que ceux qui siègent dans les tribunaux soient d’un certain ordre de citoyens, qu’ils aient atteint un certain âge, ce n’est pas pour qu’ils répètent ses paroles, ce que pourrait faire un enfant, mais pour qu’ils soient en état de deviner son intention, pour qu’ils soient les interprètes de sa volonté. Si le rédacteur en eût abandonné l’expression à des juges barbares et ignorants, il eût prévu tous les cas avec le plus grand soin ; mais, comme il savait quels hommes on chargerait des fonctions de juges, il n’a point parlé de ce qui lui semblait évident, persuadé que vous ne vous contenteriez point de répéter ses paroles, et que vous chercheriez plutôt à interpréter sa volonté. Ensuite, s’adressant à ses adversaires, qu’il leur demande : Si j’avais fait telle chose, si tel événement était arrivé (et il ne citera ici que des actions honnêtes ou d’une nécessité inévitable), m’auriez-vous accusé ? et cependant la loi ne parle point de cette exception. Elle ne les fait donc pas toutes ; il en est donc d’assez évidentes pour qu’elles soient, en quelque sorte, tacites. Enfin, dans la conversation, dans les habitudes domestiques, dans les ordres qu’on donne chez soi, aussi bien que dans la loi et dans un contrat, à combien d’erreurs ne serait-on pas exposé tous les jours, si l’on voulait s’en tenir à la lettre, sans se prêter à l’intention de celui qui a parlé !
XLVIII. Prouvez ensuite, par les lieux communs de l’honneur et de l’intérêt, combien ce que vous devez ou vous auriez dû faire, suivant vos adversaires, serait honteux ou funeste ; combien, au contraire, ce que vous demandez ou ce que vous avez fait est utile et honorable. L’orateur fera aussi cette réflexion : ce qui nous est cher dans la loi, ce n’est point seulement les expressions, marques faibles et obscures de la volonté, mais l’importance des choses, mais la sagesse et la prudence du législateur. Définissez ensuite la loi ; montrez qu’elle ne consiste pas dans les mots, mais dans le sens, et que le juge qui s’attache à l’esprit et non à la lettre, n’en est pas moins fidèle à la loi. Quelle indignité de punir du même supplice le scélérat dont l’audace criminelle a enfreint la loi, et celui que des motifs honnêtes, ou une nécessité insurmontable, ont écarté, non pas du sens, mais de la lettre de la loi ! C’est par ces raisons et d’autres semblables que l’orateur prouvera qu’il faut admettre des exceptions, les admettre pour la loi dont il s’agit, et admettre celle qu’il demande.
Si rien n’est plus utile, comme nous l’avons dit, pour celui qui défend la lettre, que de répandre du doute sur l’équité dont se pare son adversaire, il ne l’est pas moins, pour ce dernier, d’appeler à son secours le texte même, ou d’y montrer quelque ambiguïté, de justifier celui des deux sens qui est le plus avantageux à sa cause, ou de tourner en sa faveur, par la définition, l’expression la plus défavorable, ou enfin de tirer du texte, par induction, ce qui ne s’y trouve pas expressément : nous parlerons plus bas de ce moyen de preuve. Lorsqu’on peut ainsi tirer de la lettre même un moyen de défense, quelque faible qu’il soit, pourvu que la cause soit juste, ce moyen sera nécessairement très avantageux, puisqu’en renversant le point d’appui de l’adversaire, on ôte à ses preuves tout leur nerf et toute leur vivacité. L’un et l’autre pourront puiser leurs lieux communs dans la question accessoire. Celui qui défend la lettre pourra dire encore qu’il ne faut point interpréter la loi suivant l’intérêt du coupable ; que rien n’est plus sacré que la loi. Son adversaire répondra que la loi ne consiste point dans les mots, mais bien dans l’intention du législateur et dans l’intérêt général ; qu’il serait souverainement injuste de se prévaloir des expressions du législateur contre l’équité dont il avait l’intention de prendre la défense.
XLIX. Quand deux ou plusieurs lois semblent contradictoires, le point de discussion naît de cette opposition ; par exemple, une loi porte : LE MEURTRIER D’UN TYRAN RECEVRA LE MÊME PRIX QUE LES VAINQUEURS DES JEUX OLYMPIQUES, ET LE MAGISTRAT LUI ACCORDERA CE QU’IL VOUDRA DEMANDER. Une autre loi ordonne, qu’APRÉS LA MORT D’UN TYRAN, LE MAGISTRAT FASSE MOURIR SES CINQ PLUS PROCHES PARENTS. « Thébé, épouse d’Alexandre, tyran de Phères, égorge, pendant la nuit, son mari qui reposait à ses côtés. Elle demande pour récompense le fils qu’elle a eu du tyran. Quelques citoyens prétendent que la loi veut la mort de l’enfant. Tel est le point sur lequel il faut prononcer. » Les mêmes lieux communs, les mêmes préceptes conviennent ici à chacune des deux parties, puisqu’il s’agit, pour l’une et pour l’autre, d’établir la loi favorable à sa cause, et d’infirmer celle qui lui est contraire. Il faut d’abord les comparer, examiner celle qui traite de plus grands intérêts, je veux dire d’objets plus utiles, plus honnêtes et plus nécessaires. On conclut alors que si l’on ne peut conserver deux ou plusieurs lois qui se contredisent, il faut donner la préférence à celle dont les dispositions embrassent de plus grands intérêts. On recherche ensuite quelle est la loi la plus récente : c’est ordinairement la plus importante et celle qu’il faut préférer. On distinguera la loi qui permet, et celle qui ordonne ; car on est obligé de faire ce qui est ordonné expressément ; on est plus libre à l’égard de ce qui est permis. Puis on examine laquelle des deux punit la désobéissance, ou celle qui la punit avec le plus de sévérité ; car il faut conserver de préférence la loi qu’on a environnée de plus de précautions. Observez ensuite laquelle ordonne, et laquelle défend ; car la loi prohibitive ne semble, le plus souvent, qu’une exception de la loi impérative. Après quoi l’orateur s’arrête à la loi générale et à la loi particulière ; à celle qui s’applique à plusieurs circonstances ; à celle qui ne s’applique qu’à un seul cas : on voit, en effet, que la loi particulière et celle qui ne parle que d’un seul cas, tiennent de plus près à la cause, et peuvent être plus favorables au jugement. On examine encore celle qui ordonne sur-le-champ, et celle qui accorde quelques délais et quelques retards ; car il faut obéir avant tout à ce qui ne souffre point de délais. Tâchez ensuite de paraître fidèle à la lettre de votre loi, tandis que votre adversaire est obligé de choisir entre deux sens, ou de recourir à l’analogie, à la définition : une loi dont le sens est clair, a bien plus de poids et d’autorité. Montrez aussi l’accord de la lettre et de l’esprit dans la loi que vous invoquez ; essayez de ramener au sens de votre loi celle dont s’appuie votre adversaire, et de montrer, si la cause le permet, qu’elles ne sont point contradictoires ; que, dans votre sens, on peut les conserver l’une et l’autre, tandis qu’en adoptant celui de votre adversaire, il faut nécessairement ne point tenir compte de l’un des deux. Pour les lieux communs, vous n’oublierez point de voir ceux que la cause elle-même peut vous fournir, et, en développant les lieux féconds de l’honneur et de l’intérêt, vous montrerez surtout, par l’amplification, à laquelle des deux lois on doit obéir de préférence.
L. C’est une question d’analogie quand, de ce qui se trouve dans la loi, on déduit ce qui ne s’y trouve pas. LA LOI MET UN FURIEUX ET TOUS SES BIENS SOUS LA TUTELLE DE SES PARENTS DU CÔTÉ PATERNEL, ET DE SES PARENTS DU CÔTÉ MATERNEL. Une autre loi PERMET AU PÈRE DE FAMILLE DE LÉGUER A QUI IL VOUDRA SES ESCLAVES ET SES BIENS. Enfin, une troisième porte que, SI UN PÈRE DE FAMILLE MEURT INTESTAT, SES, ESCLAVES ET SES BIENS APPARTIENNENT A SES PARENTS DU CÔTÉ PATERNEL, ET A SES PARENTS DU CÔTÉ MATERNEL. « Un homme est condamné pour parricide ; aussitôt, comme il n’avait pu s’enfuir, on lui met des entraves, on lui enveloppe la tête dans un sac de cuir, et on le mène en prison, jusqu’à ce qu’on ait préparé le sac où l’on doit l’enfermer pour l’abandonner à la merci des flots. Cependant quelques amis lui apportent des tablettes dans la prison, amènent des témoins, et écrivent les noms de ceux qu’il institue ses héritiers. On signe le testament, et le coupable est conduit au supplice. Les agnats disputent la succession à ceux que le testament a nommés héritiers. » On ne peut ici produire aucune loi qui ôte formellement à ceux qui sont en prison le pouvoir de tester. Il faut donc par analogie chercher, et d’après les lois qui ont condamné le parricide, et d’après celles qui prononcent sur la validité des testaments, si le coupable avait ou non le pouvoir de tester.
Voici à peu près les lieux communs qu’offre ce genre de cause et de raisonnement. L’orateur commence par louer et établir l’écrit qu’il produit ; il compare ensuite ce qui est douteux dans la question présente avec ce qui est certain, de manière à faire regarder le douteux et le certain comme absolument semblables. Il s’étonne qu’en regardant l’un comme juste, on rejette l’autre qui l’est bien davantage, ou, du moins, qui l’est autant. Si le législateur n’en fait point mention, ajoute-t-il, c’est qu’il a pensé qu’après ce qu’il avait écrit sur un point, le doute n’était plus permis sur l’autre. D’ailleurs, les lois ne sont-elles pas remplies d’omissions auxquelles on ne s’arrête point, parce qu’on peut, d’après ce qui est écrit, suppléer ce qui manque ? Démontrez ensuite la justice de votre cause, comme dans la question juridiciaire absolue.
L’adversaire, de son côté, pour chercher à affaiblir les rapports que l’on veut établir, prouvera que les deux termes comparés diffèrent de genre, de nature, d’essence, d’étendue ; qu’ils ne sont applicables, ni pour le temps, ni pour le lieu, ni pour la personne, ni pour l’opinion. L’orateur marquera le rang et la place qu’on doit assigner à chacun de ces termes ; il en fera sentir la différence, et démontrera ainsi qu’on ne doit point avoir la même idée de l’un et de l’autre. Veut-il employer aussi l’analogie, et en a-t-il le moyen, qu’il se serve de celles que nous avons indiquées. S’il ne le peut, il affirmera qu’on doit s’en tenir à ce qui est écrit ; que toutes les lois seront exposées à des altérations, si l’on veut admettre les rapports proposés. On ne trouvera presque rien qui ne ressemble à quelque autre chose ; parmi tant d’objets, il y a cependant des lois particulières pour chacun, et l’on peut trouver partout des rapports et des différences. Quant aux lieux communs destinés à établir l’analogie, ils consistent à passer, avec le secours de la conjecture, de ce qui est écrit à ce qui ne l’est pas. Il n’est personne qui puisse tout prévoir, tout embrasser ; et c’est mettre dans la rédaction toute l’exactitude possible, que de faire conclure une chose d’une autre. Pour réfuter cette proposition, on dira qu’il n’appartient qu’aux devins de conjecturer, et qu’un étourdi peut seul ne pas prévoir tous les cas qu’il avait l’intention d’exprimer.
LI. La définition a lieu quand il se trouve dans le texte quelque mot dont on cherche la valeur.
Par exemple : LA LOI DÉPOUILLE CEUX QUI, DANS UNE TEMPÊTE, ABANDONNENT LEUR VAISSEAU, ET DONNE LE BÂTIMENT ET SA CARGAISON A CEUX QUI NE LE QUITTENT PAS. « Deux hommes, dont l’un était propriétaire du navire, et l’autre de sa cargaison, rencontrèrent en pleine mer un malheureux naufragé qui, en nageant, implorait leur secours. Touchés de compassion, ils allèrent à lui, et le prirent à bord. Bientôt la tempête devint si furieuse que le propriétaire du navire, qui était en même temps pilote, se jette dans l’esquif, et fait tous ses efforts pour diriger le vaisseau à l’aide du câble qui l’attache à sa barque. Le propriétaire des marchandises,qui n’avait pas quitté le vaisseau, se jette de désespoir sur son épée. Celui qu’ils avaient recueilli tous deux s’empare alors du gouvernail et emploie tous ses efforts à sauver le bâtiment. Enfin les flots s’apaisent, le temps change. et l’on arrive au port. La blessure de celui qui s’était percé de son épée n’était pas dangereuse ; il fut bientôt guéri. Chacun de ces trois hommes réclame le navire et sa cargaison ; chacun d’eux fonde ses prétentions sur le texte de la loi. » La contestation naît du sens qu’on attache aux mots ; il faut définir ce qu’on entend par abandonner le bâtiment, ce qu’on entend par y rester ; et enfin, ce qu’on entend par le bâtiment lui-même. On emploiera ici les mêmes lieux que pour la question de définition.
Maintenant que nous avons exposé les règles qui peuvent s’appliquer au genre judiciaire, nous traiterons des genres délibératif et démonstratif ; nous en tracerons les préceptes, et nous indiquerons les lieux qu’ils fournissent pour l’argumentation : non pas que toute cause ne se rattache nécessairement à une question ; mais ces causes ont des lieux communs qui leur sont propres, et qui, sans s’écarter de quelqu’une des questions, s’appliquent spécialement au caractère de ces genres.
On veut que le genre judiciaire ait pour but l’équité, c’est-à-dire, une partie de l’honnêteté. Aristote donne pour but au délibératif l’utile, et nous, l’honnête et l’utile ; au démonstratif, l’honnête. Aussi, pour ce dernier genre, aux préceptes généraux et communs sur les divers moyens de confirmation, nous joindrons quelques règles particulières, appropriées au but vers lequel doit tendre tout le discours. Nous n’hésiterions pas à donner un exemple de chaque question, si nous n’étions persuadés que les développements qui répandent du jour sur les sujets obscurs, peuvent aussi rendre obscures des choses évidentes par elles-mêmes. Occupons-nous d’abord des préceptes du genre délibératif.
LII. Tous les objets qui peuvent exciter les désirs de l’homme se divisent en trois genres ; il en est trois aussi des objets qu’il doit éviter. En effet, les uns, forts de leur secrète puissance, nous attirent à eux, moins par l’attrait des charmes qu’ils nous offrent, que par l’ascendant de leur dignité : telles sont la vertu, la science, la vérité. On désire les autres choses plutôt par intérêt et pour leur utilité que pour elles-mêmes : telles sont les richesses. D’autres enfin, qui participent des deux premières, nous séduisent par leur dignité naturelle et par une apparence d’utilité qui leur donne un nouveau prix : comme l’amitié, une bonne réputation. Il est facile, malgré notre silence, de reconnaître quels objets leur sont opposés. Pour abréger, nous allons donner un nom à chacun de ces genres. Tout ce qu’embrasse le premier, s’appelle honnête ; le second renferme l’utile ; le troisième se compose également de quelques parties des deux premiers ; mais comme il n’est pas étranger à l’honneur, principe bien supérieur à l’autre, nous lui donnerons le nom le plus honorable, et nous l’appellerons aussi honnête. Nous conclurons de là que l’honneur et le bien sont le principe des choses désirables, et la honte et le mal, le principe de celles qu’on doit rejeter. A ces deux principes, il faut en ajouter deux autres non moins puissants, ! a nécessité et les circonstances. Dans l’un, on considère la force ; dans l’autre, les objets et les personnes : nous les développerons plus bas. Maintenant expliquons ce qui constitue l’honneur.
LIII. Nous appellerons honnête, ce qu’en tout ou en partie on recherche pour soi-même. On divise en deux classes ce qui concerne l’honnêteté de nos actions : l’une embrasse seulement l’honnêteté ; et l’autre, l’honnêteté et l’utilité. Occupons-nous d’abord de la première. La vertu, sous un seul mot et sous une seule nature, comprend tout ce qui a rapport à l’honnêteté ; car la vertu est une disposition naturelle de l’âme, conforme à la raison. Si donc nous connaissons la vertu dans toutes ses parties, nous aurons une définition complète de ce seul mot, honnêteté. La vertu a quatre parties : la prudence, la justice, la force, et la tempérance. La prudence est la connaissance du bien et du mal, et de ce qui n’est ni l’un ni l’autre. Elle se compose de la mémoire, de l’intelligence, et de la prévoyance. Par la mémoire, l’âme se rappelle le passé ; l’intelligence examine le présent ; la prévoyance lit dans l’avenir. La justice est une disposition de l’âme, qui, sans blesser l’intérêt général, rend à chacun ce qui lui est dû. Elle a sa source dans la nature ; ensuite l’utilité a fait de certaines choses autant de coutumes ; enfin la crainte des lois et la religion ont sanctionné l’ouvrage de la nature, confirmé par l’habitude.
Le droit naturel n’est point fondé sur l’opinion ; nous le trouvons gravé dans nos cœurs, comme la religion, la piété, la reconnaissance, la vengeance, le respect et la vérité. La religion nous enseigne à consacrer un hommage et un culte à une nature suprême, qu’on appelle divine. La piété est l’exact accomplissement de nos devoirs envers nos parents et les bienfaiteurs de notre patrie. La reconnaissance est le souvenir de l’attachement et de l’affection d’un autre, et le désir de lui rendre service pour service. La vengeance repousse et punit la violence, l’injustice et tout ce qui peut nous nuire. Le respect consiste dans les marques de déférence qu’on témoigne aux hommes supérieurs en mérite et en dignité. La vérité est le récit et comme l’image fidèle du présent, du passé ou de l’avenir.
LIV. Le droit fondé sur la coutume consiste, ou dans le développement et la force que l’usage donne à des notions naturelles, comme à la religion, ou dans les choses que nous inspire la nature, confirmées par l’habitude, et que le temps et l’approbation du peuple ont changées en coutumes, comme un contrat, l’équité, un jugement antérieur. Un contrat est un traité entre deux ou plusieurs individus. L’équité donne un droit égal à tous. Un jugement antérieur est la décision déjà rendue par une ou plusieurs personnes. Le droit civil est renfermé dans ces lois écrites, qu’on ex-pose à la vue du peuple, pour qu’il s’y conforme.
La force brave les dangers et soutient les travaux, dont elle connaît l’étendue. Elle comprend la grandeur, la fermeté, la patience, la persévérance. La grandeur exécute avec éclat les nobles et vastes projets qu’elle a formés pour atteindre le but élevé que s’est proposé son ambition. La fermeté est une juste confiance de l’âme en elle-même, dans l’exécution de projets grands et honorables. La patience supporte volontairement de longs et pénibles travaux, pour arriver à un but utile et honnête. La persévérance persiste dans le parti qu’elle a embrassé après de mûres réflexions.
La tempérance règle et dirige, d’une main ferme et sûre, toutes les passions et tous les désirs de l’âme. Elle comprend la continence, la clémence et la modération. La continence assujettit les passions au joug de la sagesse. La clémence calme, par la douceur, l’emportement de la haine. La modération donne à une honnête pudeur un ascendant qu’on aime et qui dure longtemps. On doit rechercher toutes ces vertus pour elles-mêmes, et sans aucune vue d’intérêt. Le démontrer, serait nous écarter de notre plan, et de la brièveté qui convient aux préceptes.
On doit éviter, toujours pour eux-mêmes, non seulement les vices contraires à ces vertus, comme la lâcheté opposée au courage, l’injustice à l’équité, mais encore ceux qui, tout en paraissant plus proches et plus voisins de la vertu, n’en sont pas moins très éloignés. La faiblesse, par exemple, est opposée à la fermeté, et par cela même est un vice. L’audace ne lui est pas opposée : elle se rapproche de la vertu, et pourtant elle est un défaut. Ainsi, à côté de chaque vertu, on trouvera toujours un vice, tantôt désigné par un mot propre, comme l’audace voisine de la fermeté, l’opiniâtreté de la persévérance, la superstition de la religion ; tantôt sans dénomination particulière. Nous les mettons, comme tout ce qui est contraire aux vertus, au nombre des choses à éviter. En voilà assez sur le genre d’honnêteté qu’on recherche absolument pour elle-même.
LV. Occupons-nous maintenant du genre qui nous offre à la fois l’honnête et l’utile et auquel nous donnons aussi le nom d’honnête. Il est bien des choses qui nous attirent, et par leur éclat, et par les avantages qu’elles nous offrent, comme la gloire, la dignité, l’élévation, l’amitié. La gloire occupe souvent, et d’une manière honorable, la voix de la renommée. La dignité donne une autorité fondée sur l’honneur ; elle nous concilie les hommages, le respect. L’élévation est fondée sur la puissance, la majesté, ou d’immenses richesses. L’amitié est le désir d’être utile à celui qu’on aime, le retour dont il paye l’affection qu’on lui porte et les vœux qu’on fait pour son bonheur. Comme nous parlons ici des causes civiles, nous ne séparons point de l’amitié les vues d’intérêt qui peuvent nous la faire rechercher ; mais qu’on n’aille point nous blâmer et croire que nous parlons de l’amitié en général. Il n’en est pas moins vrai que les uns, dans l’amitié, ne voient que les avantages qu’elle peut leur procurer ; d’autres la recherchent uniquement pour elle-même ; quelques-uns enfin, pour elle-même et pour ces avantages. Nous déciderons ailleurs quelle est la définition qui lui convient le mieux. Accordons maintenant à l’orateur qu’on peut la rechercher pour ces deux motifs. Mais comme elle est tantôt consacrée par la religion, tantôt profane, tantôt fortifiée par une longue habitude, tantôt récente, fondée ou sur des services rendus, ou sur des services reçus, sur d’importants bienfaits, ou sur des obligations légères, elle doit être jugée d’après toutes ces considérations.
LVI. L’utilité est personnelle ou extérieure : cependant presque tout s’y rapporte au bien-être personnel, comme dans la république, où certaines choses constituent pour ainsi dire le corps de l’État, telles que le territoire, les ports, l’argent, les flottes, les matelots, les soldats, les alliés ; enfin tout ce qui sert au maintien de son indépendance et de son intégrité. D’autres sont d’une utilité plus spécieuse et moins nécessaire, comme une ville immense et magnifique, des richesses brillantes, des amis et des alliés nombreux. Comme tous ces avantages ne servent pas seulement à maintenir l’intégrité et l’indépendance des États, mais à les rendre forts et puissants, on peut envisager deux choses dans l’utilité, la sûreté et la puissance. La sûreté nous protège et nous défend contre les dangers. La puissance est la possession des moyens propres à conserver ses avantages et d’obtenir ceux d’autrui. Il faut encore, dans tout ce que nous avons dit, considérer le plus ou le moins de facilité. Ce qui ne demande que peu ou point de peine, de frais, de fatigue et de temps, est facile. Ou regarde comme difficile ce qu’il est possible d’achever et de conduire à sa fin, mais à force de peines, de frais, de fatigues et de temps, en bravant toutes les difficultés plus ou moins nombreuses, plus ou moins considérables, qui s’opposent à l’exécution.
Après avoir traité de l’honnête et de l’utile, il nous reste à parler de la nécessité et des circonstances, qui nous ont semblé, comme on l’a vu plus haut, devoir être jointes à ces deux premiers mobiles.
LVII. J’appelle nécessité, une force irrésistible qu’aucune puissance ne saurait ni changer ni adoucir. Des exemples rendront notre définition plus claire, et feront mieux connaître la nature et l’empire de la nécessité : « Le bois doit nécessairement être combustible. L’homme doit nécessairement mourir un jour ; » aussi nécessairement que l’exige la force irrésistible de cette nécessité qu’aucune puissance ne saurait ni adoucir ni changer, et telle que nous la définissions tout à l’heure. Quand l’orateur rencontre de tels obstacles, il peut les appeler nécessités. S’il trouve des difficultés,. il considérera, d’après la question précédente, s’il est possible de les surmonter. Il me semble encore qu’il y a des nécessités accessoires, et d’autres simples et absolues. Car nous ne disons pas dans le même sens : « Il est nécessaire que les Casiliniens se rendent à Annibal, » et « il est nécessaire que Casilinum tombe au pouvoir d’Annibal. » Dans le premier cas, la nécessité accessoire est celle-ci : « A moins qu’ils n’aiment mieux mourir de faim ; » car s’ils aiment mieux prendre ce parti, il n’y a plus de nécessité. Il n’en est pas de même dans le second exemple ; car, soit que les Casiliniens se rendent, soit qu’ils aiment mieux mourir de faim, il n’en est pas moins nécessaire que Casilinum tombe au pouvoir d’Annibal. Cette distinction de nécessité est-elle utile ? Sans doute, surtout quand le premier cas se présente ; car si la nécessité est simple et absolue, il n’y a presque rien à dire, puisque rien ne peut en adoucir la rigueur. Mais n’y a-t-il nécessité que pour éviter ou obtenir quelque chose, considérons ce que cette nécessité accessoire offre d’honnête ou d’utile. En effet, si vous voulez y prendre garde, en bornant toutefois cet examen aux divers objets de la vie civile, vous ne trouverez aucune action nécessaire, que par une cause que nous appelons accessoire. Mais, d’une autre part, vous trouverez bien des choses nécessaires sans aucun accessoire semblable. Par exemple : « Il est nécessaire que l’homme né mortel meure ; » il n’y a point d’accessoire. « Il n’est pas nécessaire qu’il mange, » à moins qu’on n’ajoute cet accessoire : « Excepté s’il ne veut pas mourir de faim. » Il faudra donc, comme nous l’avons dit, considérer toujours la nature des accessoires ; car, dans toutes les circonstances, il faut exposer la nécessité fondée, ou sur l’honnêteté, comme : « Cela est nécessaire, si nous voulons être fidèles à l’honnêteté ; » ou sur la sûreté. « Cela est nécessaire, si nous vous Ions être en sûreté ; » ou sur le bien-être : « Cela est nécessaire, si nous voulons vivre sans aucune contrariété. »
LVIII. La nécessité la plus impérieuse est celle que prescrit l’honnêteté ; vient ensuite celle de la sûreté ; la troisième, et la moins importante, est celle du bien-être, qu’on ne peut nullement opposer aux deux autres. Mais il est quelquefois utile de comparer ensemble la sûreté et l’honneur, pour décider (quoique l’honneur l’emporte réellement) à quel parti, dans telle ou telle conjoncture, on doit donner la préférence. Il semble qu’on peut établir sur ce point une règle générale. Quand, en s’occupant de sa sûreté, on espère recouvrer quelque jour, par ses talents et par son mérite, ce qu’on a pour le moment sacrifié de l’honneur, il est peut-être permis de préférer sa sûreté ; sinon la victoire doit toujours rester à l’honneur.
Ainsi, même alors, nous pouvons dire que nous avons suivi la route que nous traçait l’honneur, puisqu’en sacrifiant notre sûreté, nous n’aurions pu le recouvrer. C’est le moment de céder à une force supérieure, de se soumettre à la condition imposée par un autre, ou bien de se condamner à une inaction passagère, et d’attendre une occasion plus favorable. Pour le bien-être, il faut considérer seulement si ce qu’exigent nos intérêts mérite que l’on déroge à ce que réclament la véritable grandeur et l’honnêteté. Le plus essentiel, selon moi, c’est d’examiner la nature de l’objet qui, si nous voulons l’obtenir ou l’éviter, rend telle chose nécessaire, c’est-à-dire, quel est l’accessoire, afin de se décider ensuite en conséquence, en regardant comme plus nécessaire ce qui nous importe le plus.
Par circonstances, on entend les changements amenés par l’issue des événements, par la manière de conduire une entreprise, par les motifs qui nous dirigent ; changements dont il résulte que les faits ne sont plus tels qu’auparavant, ou tels qu’ils sont d’ordinaire. Ainsi : « Il est honteux de passer à l’ennemi, mais non pas quand c’est dans le même dessein qu’Ulysse. C’est une sottise de jeter son argent dans la mer, mais non pas quand c’est pour le même motif qu’Aristippe. » Il est donc des choses qu’il faut juger non en elles-mêmes, mais d’après le temps et l’intention. Considérez alors ce qu’exigent les conjonctures ou. les personnes ; ne vous attachez point à l’action, mais aux motifs, au temps, à la durée. Tels sont les lieux communs que l’on peut employer pour exposer et soutenir une opinion.
LIX. La louange et le blâme se tirent des lieux attribués aux personnes, et que nous avons développés plus haut. Voulez-vous les traiter d’une manière moins générale, vous pouvez les diviser en lieux propres à l’âme, lieux propres au corps, lieux propres aux objets extérieurs. La vertu dont nous avons parlé tout à l’heure appartient à l’âme ; la santé, la dignité, la force, la légèreté, au corps ; l’illustration, les richesses, la naissance, les amis, la patrie, la puissance, et tout ce qui leur ressemble, forment les lieux extérieurs. Ici, comme dans toutes les autres parties de l’art oratoire, il faudra appliquer la règle générale des contraires, et le blâme se formera de toutes les choses opposées.
Mais pour avoir le droit de louer ou de blâmer, attachez-vous moins aux choses physiques ou extérieures qu’à la manière dont on en use ; car louer un homme de ce qu’il tient du hasard, c’est une sottise ; l’en blâmer, c’est un sot orgueil : mais tout ce qui dépend de l’âme peut être loué avec honneur, ou blâmé avec véhémence.
Maintenant que nous avons enseigné la manière de trouver des preuves pour tous les genres de causes, il ne nous reste plus rien à dire sur l’Invention, la première et la plus importante des parties de la rhétorique. Comme nous avons terminé cette partie, qui occupe déjà le Livre précédent, et que celui-ci est assez étendu, nous traiterons dans les Livres suivants de ce qui nous reste à développer.