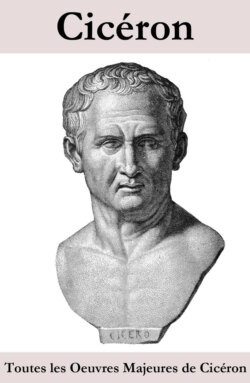Читать книгу Toutes les Oeuvres Majeures de Cicéron - Cicéron - Страница 8
LIVRE PREMIER
ОглавлениеI. J’ai souvent examiné dans de longues méditations, si le talent de la parole et l’étude approfondie de l’éloquence ont été plus avantageux que nuisibles à l’homme et à la société. En effet, si je considère les maux qui ont déchiré notre patrie, si je me rappelle les catastrophes qui ont bouleversé autrefois les cités les plus florissantes, partout je vois la plus grande partie de ces malheurs causée par des hommes éloquents. Mais lorsque je veux, avec le secours de l’histoire, remonter à des époques plus reculées, je vois la sagesse, et plus encore l’éloquence, fonder des villes, éteindre les guerres, établir des alliances durables, et serrer les nœuds d’une sainte amitié. Ainsi, après un mûr examen, la raison elle-même me porte à croire que la sagesse sans l’éloquence est peu utile aux États, mais que l’éloquence sans la sagesse n’est souvent que trop funeste, et ne peut jamais être utile. Aussi l’homme qui, oubliant la sagesse et le devoir, s’écartera des sentiers de l’honneur et de la vertu, pour donner tous ses soins à l’étude de l’éloquence, ne peut être qu’un citoyen inutile à lui-même, et dangereux pour sa patrie ; mais s’armer de l’éloquence pour défendre, et non pour attaquer les intérêts de l’État, c’est se rendre aussi utile à soi-même qu’à son pays, et mériter l’amour de ses concitoyens.
Si vous voulez remonter à l’origine de ce qu’on appelle éloquence, soit que vous la regardiez comme un fruit de l’étude, un effet de l’art ou de l’exercice, ou un talent naturel, vous trouverez qu’elle doit sa naissance à la plus noble cause et aux motifs les plus honorables.
II. En effet, il fut un temps où les hommes, errant dans les campagnes comme les animaux, n’avaient pour soutenir leur vie qu’une nourriture sauvage et grossière. La raison avait peu d’empire ; la force décidait de tout. Ces barbares n’avaient nulle idée de leurs devoirs envers la Divinité ni envers leurs semblables ; point de mariage légal point d’enfants dont on pût s’assurer d’être le père ; on ne sentait point encore les avantages de l’équité. Aussi, au milieu des ténèbres de l’erreur et de l’ignorance, les passions aveugles et brutales asservissaient l’âme, et abusaient, pour se satisfaire, des forces du corps, leurs pernicieux satellites. Sans doute, dans ces temps de barbarie, un homme s’est rencontre d’une sagesse et d’une vertu supérieures, qui reconnut combien l’esprit humain était propre aux plus grandes choses, si l’on pouvait le développer et le perfectionner en l’éclairant. A sa voix, les hommes dispersés dans les champs, ou cachés dans le fond des forêts, se rassemblent et se réunissent dans un même lieu. Il inspire tous les goûts honnêtes et utiles à ces cœurs farouches, qui veulent rejeter d’abord un joug dont la nouveauté les révolte mais qui pourtant, sensibles à l’éloquence de la sagesse, deviennent enfin humains et civilisés, de féroces et barbares qu’ils étaient auparavant. Et ce n’était point, ce me semble une sagesse muette et sans éloquence, qui pouvait opérer une révolution si prompte, arracher les hommes à l’empire de l’habitude, et les amener à un genre de vie si différent du premier. Mais, les villes une fois établies, comment apprendre aux hommes à respecter la justice, à pratiquer la bonne foi, à obéir volontairement aux autres, à supporter les plus pénibles travaux, à sacrifier leur vie même pour le bien public, si l’éloquence n’était venue leur persuader les vertus découvertes par la raison ? Oui, sans doute, il fallut tout le charme d’une éloquence à la fois profonde et séduisante, pour amener sans violence la force à plier sous Ie joug des lois, à descendre au niveau de ceux sur lesquels elle pouvait dominer, à renoncer enfin aux plus douces habitudes dont le temps avait fait une seconde nature. Tels furent l’origine et les progrès de l’éloquence, qui, par la suite, décida des plus grands intérêts, et dans la paix et dans la guerre, et rendit aux hommes les plus importants services. Mais quand une facilité dangereuse cachée sous le masque du talent, dédaignant les sentiers de la sagesse, se livra tout entière à l’étude de la parole, alors la perversité des orateurs abusa des dons de l’esprit pour bouleverser les villes, et faire le malheur de leurs concitoyens.
III. Puisque nous avons développé la cause des bienfaits de l’éloquence, tâchons d’expliquer les causes de sa dépravation. Il me semble naturel de croire que d’abord on n’abandonna point l’administration des affaires à des hommes sans sagesse et sans éloquence, et que ceux qui réunissaient ces deux avantages ne se livraient point à la discussion des intérêts particuliers ; mais que, tandis que les hommes supérieurs s’occupaient des affaires de l’État, des hommes qui n’étaient point tout à fait dépourvus de talent, discutaient les intérêts privés et domestiques. Accoutumés, dans ces débats obscurs, à soutenir le mensonge contre la vérité, leur audace s’accrut par l’habitude de la parole ; et il fallut que les premiers citoyens s’occupassent de les contenir, et de défendre tout ce qui les entourait contre les entreprises de ces pervers. Bientôt, comme l’orateur qui dédaignait l’étude de la sagesse, pour se livrer tout entier à l’éloquence, paraissait souvent marcher le rival des autres, et quelquefois même s’élever au-dessus d’eux, la multitude séduite le jugeait, comme il le pensait lui-même, digne de gouverner la république. Dès lors il ne fallut pas s’étonner que, sous des pilotes sans expérience et sans modération, la patrie éprouvât les plus grands et les plus funestes naufrages. Ces désordres jetèrent tant de défaveur et d’odieux sur l’éloquence, que les hommes les plus favorisés de la nature, fuyant le tumulte et les orages du forum, se réfugièrent au sein des études paisibles, comme dans un port assuré contre ces tempêtes. C’est ce qui répandit tant d’éclat sur les sciences philosophiques et morales, auxquelles les hommes les plus distingués consacrèrent leurs loisirs ; et l’on renonça au talent de la parole, dans le temps où il importait le plus d’en conserver et d’en augmenter lu salutaire influence ; car, plus l’audace et la témérité de l’ignorance et du crime profanaient un talent si noble et si juste, en le tournant contre la patrie, plus il fallait leur résister avec énergie, et défendre la république.
IV. Voilà ce qui n’avait point échappé à notre grand Caton, à Lélius, à Scipion l’Africain, qu’il est permis de regarder comme leur disciple, ni aux Gracques, petits-fils de Scipion, tous hommes supérieurs, dont le mérite éclatant augmentait l’autorité, et en qui l’éloquence, qu’ils consacraient à la défense de la patrie, rehaussait les plus brillantes qualités. Je suis persuadé comme eux que, bien loin de négliger l’étude de l’éloquence, à cause de l’abus criminel qu’on en fait chaque jour dans les affaires publiques et particulières, il faut s’y livrer avec plus de zèle, pour s’opposer au dangereux ascendant qu’usurpent des orateurs pervers, au grand dommage des gens de bien, et pour la ruine commune de tous ; et on le doit d’autant plus, que l’éloquence est le principal ressort des affaires publiques et privées, puisqu’elle seule nous conduit avec honneur et sans danger dans les sentiers de la gloire et du bonheur. N’est-ce pas elle qui, dirigée par la sagesse, dont la voix doit nous guider en toutes choses, rend les États florissants ? N’est-ce pas elle qui rassemble sur ceux qui la cultivent, la gloire, les honneurs, les dignités ? N’est-ce pas elle enfin qui offre à leurs amis la protection la plus sûre et la plus puissante ? N’est-ce point la parole qui donne aux hommes d’ailleurs si faibles et si misérables, une supériorité si marquée sur la brute ? Aussi, qu’il est beau de s’élever au-dessus de l’homme parce qui l’élève lui-même au-dessus des animaux ! Si donc on ne doit pas seulement l’éloquence à la nature et à l’exercice, mais aussi à l’étude de l’art oratoire, il ne sera peut-être pas inutile de mettre sous les yeux les préceptes que nous ont laissés les rhéteurs.
Mais, avant de parier des préceptes oratoires, nous expliquerons d’abord ce que veulent dire ces mots de genre de devoir, de fin de matière, de parties. Cette connaissance abrége et facilite l’étude de chaque objet en particulier et permet de considérer l’art dans son ensemble.
V. La science du gouvernement se compose d’une foule de connaissances importantes. Une des principales et des plus étendues est cette éloquence artificielle qu’on nomme rhétorique. Car, sans être de l’avis de ceux qui croient l’éloquence inutile au gouvernement d’un État, nous pensons encore moins que la science du gouvernement soit renfermée tout entière dans l’art du rhéteur. Mais nous dirons que le talent oratoire fait partie de la science du gouvernement ; que le devoir de l’orateur est de parler de manière à persuader que la fin du devoir est la persuasion par le moyen de la parole. Il y a cette différence entre la fin et le devoir, que le devoir indique la marche, et la fin le but qu’on se propose. Le devoir du médecin est de soigner ses malades comme il convient pour les guérir, et la fin, de les guérir par ses soins. Ainsi, pour expliquer ces mots, devoir et fin de l’orateur nous dirons que par devoir nous entendons ce qu’il doit faire, et par fin, le but qu’il veut atteindre.
On appelle matière de l’art la réunion des choses qui appartiennent, soit à l’étude, soit à la pratique d’un art en général. On dit, par exemple, que les maladies et les blessures sont la matière de la médecine, parce que la médecine est tout occupée de ce double objet. Nous dirons pareillement que tout ce qu’embrassent l’art et le talent de l’orateur est la matière de la rhétorique. Cependant les rhéteurs ont assigné des limites plus ou moins étendues à leur domaine. Gorgias le Léontin, un des premiers qui enseignèrent les règles de l’éloquence, voulait que l’orateur fût capable de très bien parler sur tous les sujets qu’on lui proposerait. Il donne ainsi à la rhétorique une matière infinie, et presque sans bornes. Mais Aristote, à qui nous devons tant de si belles et de si excellentes leçons, a jugé que le devoir du rhéteur embrassait trois genres de causes ; le démonstratif, le délibératif et le judiciaire. Le genre démonstratif, qui s’attache aux personnes, a pour but l’éloge ou le blâme. Le délibératif, qui repose sur une question, sur une discussion politique, renferme une opinion. Le genre judiciaire, qui roule sur un jugement à prononcer, comprend l’attaque et la défense, ou les fonctions de demandeur et de défendeur. Nous croyons, comme Aristote, que dans la division de ces trois genres se trouve renfermée toute la matière de la rhétorique.
VI. Hermagoras, en effet, semble ne point songer à ce qu’il dit, et ne pas comprendre tout ce qu’il promet, quand il divise la matière de l’éloquence en cause et en question. Il définit la causa un sujet de controverse soumis à la parole, avec intervention de personnes, objet que nous avons aussi renfermé dans le domaine de l’orateur, par notre précédente division des genres démonstratif, délibératif et judiciaire. Il appelle question un sujet de controverse soumis à la parole, sans intervention de personne, comme Est-il quelque autre bien que la vertu ? Faut-il s’en rapporter au témoignage des sens ? Quelle est la figure du monde ? la grosseur du soleil ? questions qui doivent assurément paraître fort étrangères au devoir de l’orateur. N’est-ce pas, en effet, une insigne erreur que d’attribuer à l’éloquence, comme des sujets à traiter en passant, des questions que le génie de nos philosophes les plus profonds, soutenu d’un travail infatigable n’a pu encore éclaircir ? Quand même l’étude et des connaissances immenses auraient aplani pour Hermagoras toutes ces difficultés, il n’en aurait pas moins, plein de confiance dans une vaste instruction, mal défini le devoir de l’orateur, et tracé les limites de ses connaissances, et non pas celles de l’art. Mais telle est, à dire vrai, l’idée qu’on doit avoir de cet homme, qu’il serait plus facile de lui ôter le titre de rhéteur que de lui accorder celui de philosophe. Ce n’est pas que le traité de rhétorique qu’il a publié me semble renfermer beaucoup d’erreurs ; car il recueille et dispose avec autant de goût que d’exactitude les meilleurs préceptes des anciens, et il lui arrive même quelquefois d’y mêler des observations qui lui appartiennent ; mais, parler sur l’art oratoire (et c’est ce qu’il a fait ) n’est rien pour l’orateur il doit surtout parler suivant les règles de cet art et il est facile de le voir, ce talent manquait à Hermagoras. Ainsi nous adoptons l’opinion d’Aristote sur la matière de la rhétorique.
VII. Les parties sont, comme on l’a si souvent répété, l’invention, la disposition, l’élocution, la mémoire et le débit. L’invention trouve les moyens vrais ou vraisemblables qui peuvent soutenir la cause. La disposition est l’art de les distribuer et de les mettre en ordre. L’élocution revêt des idées et des expressions convenables les choses créées par l’invention. La mémoire retient d’une manière sûre et inaltérable les pensées et les mots. Le débit règle le geste et la voix, et les proportionne aux idées et aux paroles.
Ces principes une fois posés en peu de mots, je remets à un autre temps ce que j’aurais à dire sur le genre, le devoir et la fin de la rhétorique ; car j’aurais besoin de longs développements qui n’appartiennent pas si intimement à l’exposition des préceptes de l’art ; et, pour faire un traité de rhétorique, il faut s’occuper surtout de la matière de l’art et de ses différentes parties. Telle est mon opinion, et il me semble convenable de traiter ces deux objets à la fois. Je vais donc parler de la matière et des parties de l’art. Comme l’invention est la première de toutes, nous commencerons par la considérer dans tous les genres de causes.
VIII. Tout ce qui contient quelque sujet de controverse de débat ou de discussion, renferme une question ou de fait, ou de nom, ou de genre, ou d’action. La question d’où naît la cause s’appelle état de cause ou de question. L’état de question est le premier conflit des causes ; il naît de la défense « Vous avez fait cette chose. Non, ou j’ai eu droit de la faire. » La discussion roule-t-elle sur les faits comme les conjectures appuient votre cause, c’est un état de question conjectural ; sur le nom comme il faut définir le sens des mots, c’est un état de définition. Quand il s’agit de qualifier la chose même, comme la discussion roule sur son genre et sa nature, c’est un état de question de genre. Si le demandeur n’a pas droit d’intenter son action, s’il accuse celui qu’il ne doit pas accuser, s’il n’a pas bien choisi son tribunal, le temps, la loi, l’accusation, comme il faut que la cause soit changée et portée à un autre tribunal, l’état de question s’appelle état de récusation. Toute cause doit offrir nécessairement quelqu’une de ces questions, ou bien il n’y a pas de point de discussion, et par conséquent pas de cause.
La discussion du fait peut se rapporter à tous les temps Au passé : « Ulysse a-t-il tué Ajax ? » Au présent : « Les habitants de Frégelles sont-ils bien disposés pour les Romains ? » A l’avenir « Si nous laissons subsister Carthage, en résultera-t-il quelque inconvénient pour la république ? »
C’est une question de nom quand, en convenant du fait, on cherche quel nom il faut lui donner. Si l’on conteste sur le nom ce n’est pas qu’on ne soit d’accord sur la chose, que le fait ne soit pas constant ; mais comme chacun voit ce fait sous un point de vue différent, chacun lui donne un nom différent. Dans les causes de cette espèce, il faut recourir à la définition, à une courte description. Par exemple : « On a dérobé des vases sacrés dans un lieu profane ; le coupable doit-il être jugé comme voleur ou comme sacrilège ? »Dans ce cas, il faut, des deux côtés, définir le vol, le sacrilège, et montrer par sa définition que les adversaires ne donnent pas au délit dont il s’agit le nom qui lui convient.
IX. Si le fait est constant, si l’on est d’accord sur le nom qu’on doit lui donner, et que néanmoins on examine son étendue, sa nature, en un mot quel il est, s’il est juste ou injuste, utile ou nuisible, sans disputer sur le nom qu’il mérite, sans chercher autre chose que son véritable caractère, c’est une question de genre.
A cette division Hermagoras rattache quatre espèces la question délibérative, la question démonstrative, la question juridiciaire, et la question matérielle. Cette erreur assez grossière me semble mériter d’être réfutée, mais en peu de mots. La passer sous silence serait laisser croire que je me suis écarté sans raison de l’opinion de ce rhéteur ; une trop longue discussion sur cet objet me retarderait inutilement, et m’empêcherait de tracer en liberté la suite de ces préceptes.
Si le genre délibératif et le genre démonstratif sont des genres de cause, on ne peut sans erreur les regarder comme des espèces de quelque genre. La même chose peut bien être appelée genre par les uns, espèce par les autres ; mais elle ne saurait, pour le même juge, être genre et espèce à la fois. Or le délibératif et le démonstratif sont des genres car, ou il n’y a pas de genre, ou il n’y en a pas d’autre que le judiciaire, ou bien il y a le délibératif le démonstratif et le judiciaire. Avancer qu’il n’y a pas de genre de cause, mais qu’il y a différentes causes, et donner des préceptes pour les traiter, est une folie. D’un autre côté, comment le genre judiciaire pourrait-il exister seul lorsque le délibératif et le démonstratif, si différents entre eux, ont encore moins de rapport avec le judiciaire, lorsque chacun d’eux se propose un but particulier ? il en faut conclure qu’ils sont tous trois des genres ; on ne peut donc considérer le démonstratif et le délibératif comme les espèces de quelque genre. C’est donc à tort qu’Hermagoras les a considérés comme des espèces de la question de genre.
X. Que si l’on ne peut les considérer comme des espèces d’un genre de cause, on se trompe plus lourdement encore en les faisant espèces d’espèces. Car la question entière est une partie de la cause, puisque ce n’est pas la cause qui s’applique à la question, mais la question à la cause. Mais si le délibératif et le démonstratif, parce qu’ils sont des genres, ne peuvent être considérés comme les espèces d’un genre de cause, encore moins doit-on les regarder comme des espèces d’espèces, ainsi que l’a fait Hermagoras. D’ailleurs, si repousser une accusation constitue la question elle-même, ou une partie de la question, ce qui ne repousse pas l’accusation ne peut être ni la question, ni une partie de la question. Or si ce qui ne repousse pas l’accusation ne peut être ni la question, ni une partie de la question, le délibératif et le démonstratif ne sont ni la question, ni une partie de la question. Si donc repousser l’accusation constitue, ou la question, ou une partie de la question, le délibératif et le démonstratif ne sont ni la question, ni une partie de la question. Mais Hermagoras prétend que repousser une accusation constitue la question. Qu’il dise donc aussi que le délibératif et le démonstratif ne sont ni la question ni une partie de la question. Et soit qu’il appelle question les premiers moyens dont s’appuie l’accusateur ou la première défense de l’accusé, il se trouve toujours dans le même embarras ; car il rencontre toujours les mêmes écueils.
Ensuite, une cause de conjecture ne peut à la fois, sur le même point, et dans le même genre, être cause de conjecture et cause de définition. D’un autre côté, une cause de définition ne peut à la fois, sur le même point, et dans le même genre, être cause de définition et cause de récusation. Nulle question enfin, nulle partie de question ne peut en contenir une autre, parce que chacune d’elles est prise en elle-même, et considérée isolément d’après son essence. Ajoutez-en une nouvelle, le nombre des questions est augmenté, mais la question n’a pas plus d’étendue. Mais une cause délibérative renferme ordinairement, sur le même point, et dans le même genre, une et quelquefois plusieurs questions de conjecture, de genre, de définition et de récusation. Elle n’est donc ni la question elle-même, ni une partie de la question. Il en est de même pour le démonstratif. Il faut donc les considérer comme des genres de cause, et non comme des espèces de quelque état de question.
XI. Ainsi, ce que nous appelons question de genre renferme deux parties : la question juridiciaire, qui discute le droit et le tort, qui décide si l’on mérite peine ou récompense ; la question matérielle, où l’on examine tout ce qui appartient au droit civil et à l’équité. Cette dernière est du domaine des jurisconsultes.
La question juridiciaire se subdivise elle-même en absolue et en accessoire. Elle est absolue quand elle renferme l’examen du droit ou du tort ; accessoire, si la défense, faible par elle-même, s’appuie sur des moyens étrangers au fond de la cause. Elle offre alors quatre chefs : l’aveu du crime, le recours, la récrimination et l’alternative. L’accusé, en avouant le crime, implore-t-il son pardon, c’est l’aveu du crime. Alors il emploie ou le défaut d’intention ou la déprécation. Par le défaut d’intention, il convient du fait, sans s’avouer coupable, et rejette la faute sur son imprudence, sur le hasard, sur la nécessité. Par la déprécation, l’accusé avoue son crime, et convient même de la préméditation, mais il implore la pitié des juges. Il est très rare de pouvoir employer ce moyen. Par le recours, on se disculpe en rejetant l’accusation sur un autre, en démontrant que la faute ne saurait retomber sur nous. On y parvient en imputant à autrui ou la cause ou le fait : la cause, quand nous avons obéi à une puissance, à une autorité étrangère ; le fait, quand on dit qu’un autre a dû ou a pu commettre la faute. Dans la récrimination, on soutient qu’on a eu droit d’agir comme on l’a fait, parce qu’on a été injustement provoqué. Si l’on allègue que l’action incriminée avait pour but quelque autre action utile ou honorable, on emploie l’alternative.
Dans la quatrième question, que nous appelons de récusation, il s’agit de connaître si l’accusateur a droit d’intenter son action, s’il l’a fait devant le tribunal, suivant la loi, dans la forme et dans le temps convenables ; enfin, si quelque irrégularité peut faire porter la cause devant un autre tribunal, ou annuler l’accusation. Hermagoras passe pour l’inventeur de cette question ; non qu’une foule d’orateurs ne s’en soient servis avant lui, mais parce qu’elle avait échappé aux premiers rhéteurs, et qu’ils ne l’avaient point mise au nombre des questions. On a, depuis, contesté souvent à Hermagoras l’honneur de cette découverte, moins, je crois, par ignorance (la chose est assez évidente par elle-même) que par jalousie, et par envie de nuire à sa réputation.
Nous avons fait connaître et les questions et leurs différentes parties. Il nous sera plus facile de donner des exemples de chacune d’elles quand nous traiterons des arguments qui leur conviennent ; et la méthode des arguments sera aussi plus claire, quand on pourra l’appliquer sur-le-champ au genre et au caractère de la cause.
L’état de question une fois établi, il faut examiner si la cause est simple ou complexe. Quand elle est complexe, elle peut se composer de plusieurs questions, ou renfermer une comparaison. Elle est simple, quand elle ne contient qu’une seule question absolue ; par exemple : « Déclarerons-nous la guerre aux Corinthiens, ou non ? » Dans la cause complexe, composée de plusieurs questions, on a plusieurs points à examiner ; par exemple : « Faut-il détruire Carthage, la rendre aux Carthaginois, ou bien y envoyer une colonie ? » Dans la cause complexe par comparaison, on examine et l’on discute de deux partis lequel est le plus avantageux, lequel est préférable ; par exemple : « Doit-on envoyer une armée en Macédoine,contre Philippe, pour défendre nos alliés, ou la faire rester en Italie, afin d’avoir le plus de forces possible pour combattre Annibal ? »
XIII. Il faut ensuite examiner si la discussion porte sur le raisonnement ou sur le sens littéral, c’est-à-dire, sur ce qui est écrit. Ce dernier genre de cause se divise en cinq espèces, qu’il ne faut pas confondre avec les questions. Tantôt les expressions de l’auteur de l’écrit ne semblent pas d’accord avec son intention ; tantôt deux ou plusieurs lois sont en contradiction, ou bien le texte a deux ou plusieurs sens différents ; ou l’on peut déduire de ce texte ce qu’il n’exprime point ; ou enfin, comme dans la question de définition, on peut n’être point d’accord sur la valeur des termes. Ainsi la première espèce s’occupe du sens littéral et de l’intention de l’auteur de l’écrit ; la seconde, des lois contradictoires ; la troisième, des termes ambigus ; la quatrième, de l’analogie ; et la cinquième, de la définition. Dans les causes de raisonnement, la question ne porte pas sur le sens littéral, mais sur la manière d’argumenter.
Dès qu’on a examiné le genre de la cause, posé l’état de la question, distingué si elle est simple ou complexe, si elle porte sur le sens littéral ou sur un raisonnement, il faut trouver le point de discussion, le raisonnement, le point à juger, et la preuve confirmative. Tout cela doit naître de l’état de la question. Le point de discussion est le débat produit par le choc des causes : Vous n’aviez point le droit de le faire. — Je l’avais. Le choc des causes établit l’état de la question. C’est donc de l’état de la question que naissent ces débats que nous appelons points de discussion : « Avait-il droit de le faire ? » Le raisonnement est ce qui constitue la cause : ôtez-le, il n’y a plus de débat. Ainsi, pour nous en tenir à un exemple facile et connu : Oreste est accusé d’avoir tué sa mère. S’il ne répond point : « J’en avais le droit, parce qu’elle avait tué mon père, » il ne peut se défendre ; et sans défense, il n’y a point de débat. Le raisonnement sur lequel reposera sa cause sera donc celui-ci : « J’en avais le droit, parce qu’elle avait tué Agamemnon. » De l’attaque et de la défense naît le point à juger. Et pour continuer à nous servir de l’exemple d’Oreste, s’il donne pour raison : « Elle avait tué mon père. — Mais, réplique l’accusateur, était-ce à vous, à son fils, de lui donner la mort ? Fallait-il punir un crime par un crime ? »
XIV. Le développement des raisons produit ce chef Important que nous appelons point à juger : « Oreste a-t-il eu le droit de tuer sa mère, parce qu’elle avait tué le père d’Oreste ? »
La preuve confirmative est la plus ferme défense de l’accusé ; elle détermine surtout le point à juger. Ainsi Oreste peut dire : « Les sentiments de ma mère pour son époux, pour moi-même, pour mes soeurs, pour notre empire, pour la gloire de notre famille, étaient tels, que ses enfants avaient plus que tout autre le droit de la punir. » Telle est la manière de trouver dans tout état de question le point à juger. Néanmoins, dans la question de conjecture, comme il n’y a pas de raisonnement, puisqu’on n’accorde pas le fait, le point à juger ne peut naître du développement des raisons. Alors le point de discussion et le point à juger ne forment nécessairement qu’un. Le fait existe. — Il n’existe pas. — Existe-t-il ? Autant il y a dans une cause d’états ou de subdivisions d’états de question, autant il doit nécessairement y avoir de points de discussion, de raisonnements, de points à juger et de preuves confirmatives.
Toutes ces divisions établies, considérez isolément chacune des parties de la cause entière, et n’allez point vous occuper de chaque chose dans l’ordre suivant lequel vous devez en parler. Voulez-vous que vos premiers mots se lient bien, et soient dans une harmonie parfaite avec le fond de la cause, faites-les naître de ce qui doit suivre. Quand l’art, l’étude et la méditation vous auront montré le point à juger, et tous les raisonnements qui l’appuient, que vous les aurez approfondis et fortifiés, ordonnez alors les différentes parties de votre discours. Il y en a six en tout, à ce qu’il nous semble : l’Exorde, la Narration, la Division, la Confirmation, la Réfutation et la Péroraison. Nous commencerons par donner les règles de l’exorde, puisque l’exorde se présente le premier.
XV. L’Exorde est cette partie du discours où l’on essaye de préparer favorablement l’auditeur. On y réussit quand on parvient à lui inspirer de la bienveillance, de l’attention, de l’intérêt. Aussi l’orateur, pour faire un bon exorde, doit-il connaître parfaitement la nature de sa cause. Les causes sont honnêtes, extraordinaires, honteuses, douteuses ou obscures. La cause est honnête, quand l’auditoire est, de lui-même, et avant que nous prenions la parole, prévenu en notre faveur ; extraordinaire, quand les esprits sont indisposés contre nous ; honteuse, si l’auditeur la dédaigne et n’y attache pas grand intérêt ; douteuse, si le point à juger est incertain, ou si la cause, tout à la fois honnête et honteuse, prévient également pour et contre elle ; obscure enfin, si elle se refuse à l’intelligence des auditeurs, ou si la multiplicité des incidents y répand de la confusion. Chacun de ces genres de causes si différents demande donc un exorde différent. Et d’abord, nous distinguerons en général deux sortes d’exordes : l’exorde direct, et l’exorde par insinuation. Le premier cherche ouvertement, et dès les premières paroles, à disposer l’auditoire à la bienveillance, à l’attention et à l’intérêt. L’insinuation se cache avec adresse, et, par des détours presque inaperçus, se glisse dans l’esprit de l’auditeur.
Dans une cause extraordinaire, si les esprits ne sont pas tout à fait indisposés contre vous, tâchez de vous les rendre favorables par l’exorde direct. Sont-ils violemment animés, vous êtes forcé de recourir & l’insinuation ; car demander ouvertement à un homme encore irrité son indulgence et son amitié, c’est le plus sûr moyen, non seulement d’être refusé, mais de l’irriter encore et d’enflammer sa haine. Dans une cause honteuse, pour éloigner le mépris, il faut fixer l’attention de l’auditeur. La cause est-elle douteuse, si le point à juger est incertain, commencez par le point à juger ; si elle est tout à la fois honnête et honteuse, pour vous concilier la bienveillance, ne la montrez que sous le jour le plus avantageux. Dans une cause honnête, vous pouvez omettre l’exorde, ou si vous le jugez à propos, commencer par la narration, par la citation de la loi, ou par quelque raisonnement solide pour appuyer vos paroles ; ou, si vous voulez un préambule, employez les moyens de bienveillance pour achever de gagner votre auditoire. Dans une cause obscure, que l’exorde direct rende d’abord les esprits dociles et attentifs.
XVI. Nous venons de montrer quel est le but de l’exorde ; enseignons maintenant les moyens d’en assurer le succès.
L’orateur a quatre moyens de captiver la bienveillance : il parle de lui-même, de ses adversaires, de ses juges, enfin de la cause même. S’il parle de lui, il sera modeste en rappelant sa conduite et ses services ; il repoussera les accusations, les honteux soupçons répandus sur son compte ; il retracera les malheurs qu’il a éprouvés, ceux qui le menacent encore ; enfin, il aura recours aux prières les plus humbles et aux supplications les plus pressantes. Parle-t-il de ses adversaires, il répandra sur eux l’envie, la haine et le mépris. Pour les rendre odieux, il cite des preuves de leur turpitude, de leur orgueil, de leur cruauté, de leur méchanceté. Veut-il en faire un objet d’envie, qu’il mette au jour leurs violences, leur puissance, leur fortune, leurs alliances, leurs richesses : leur arrogance en abuse insolemment ; ils comptent bien plus sur tous ces moyens que sur la justice de leur cause. Rendez-les méprisables en dévoilant leur paresse, leur indolence, leur lâcheté, leurs frivoles occupations, leur molle et voluptueuse oisiveté. Pour tirer ses moyens de bienveillance de la personne des juges, l’orateur loue, sans montrer pourtant trop de complaisance, leur courage, leur sagesse, leur bonté ; il assure qu’ils répondront à la noble estime et à l’attente du public. Enfin, la cause elle-même devient une source de bienveillance, lorsqu’en montrant par ses éloges tout ce qu’elle a d’honorable et de juste, on fait ressortir par le contraste tout ce qui déshonore celle des adversaires.
Voulez-vous rendre l’auditeur attentif, annoncez que vous allez traiter un sujet grand, neuf, incroyable, qui intéresse tous les citoyens, ou votre auditoire en particulier, ou quelques héros, ou les dieux immortels, ou la république tout entière. Promettez de développer bientôt votre cause, et d’abord faites connaître le point, ou, si par hasard il s’en trouve plusieurs, les points à juger. Soyez clair et concis dans l’exposé de la cause, c’est-à-dire, du point de discussion, et vous préparerez l’auditoire à vous entendre avec intérêt ; car je ne sépare point l’intérêt de l’attention, puisque le mieux disposé à vous entendre est celui qui promet le plus d’attention.
XVII. Comment faut-il traiter l’exorde par insinuation ? voilà ce qui doit ensuite nous occuper. Il faut l’employer dans les causes extraordinaires, c’est-à-dire, comme nous l’avons établi plus haut, quand l’auditoire est indisposé contre nous. Cette prévention naît de trois motifs : ou la cause a quelque chose de honteux, ou l’auditoire paraît déjà convaincu par ceux qui ont parlé, ou nous prenons la parole lorsque son attention parait fatiguée ; circonstance qui parfois ne le dispose guère mieux que les deux autres pour l’orateur.
Si la bassesse de la cause peut blesser l’auditoire, à la personne ou à la chose sur qui tombe le mépris, on peut substituer une personne ou une chose qui intéresse ; ou bien à la personne, substituez une chose, ou à la chose une personne, pour amener insensiblement l’auditeur de ce qui le blesse à ce qui lui plaît. Dissimulez d’abord l’intention de défendre ce qu’on vous reproche ; et quand l’auditoire sera calmé, commencez insensiblement votre justification ; dites que vous partagez l’indignation de vos adversaires contre l’action incriminée, et quand vous aurez adouci vos juges, montrez qu’aucun de ces reproches ne peut tomber sur vous. Protestez de vos égards pour vos accusateurs ; annoncez que vous ne voulez dire ni telle chose, ni telle autre ; enfin, sans blesser ouvertement des hommes environnés de la faveur publique, tâchez, par des attaques indirectes, de la leur enlever. Vous pouvez aussi rappeler un jugement rendu dans une affaire semblable, ou l’autorité de quelque précédent, et montrer que l’affaire était à peu près ou entièrement semblable à la vôtre, ou qu’elle était plus grave, ou qu’elle l’était moins.
Le discours de votre adversaire a-t-il persuadé l’auditoire (ce qu’il est facile d’apercevoir quand on sait par quels moyens s’opère la conviction ), il faut promettre de détruire avant tout la preuve sur laquelle il a le plus insisté et qui a fait le plus d’impression sur l’auditoire. On pourra tirer encore son exorde des paroles mêmes de l’adversaire, surtout des dernières, ou paraître incertain sur ce qu’on doit répondre d’abord, ou embarrassé sur le choix des réfutations qui s’offrent de toutes parts. L’auditeur qui vous croyait vaincu et terrassé ne peut se persuader que tant de confiance n’ait aucun fondement, et s’accuse plutôt d’une folle crédulité.
Si l’attention est fatiguée, on promettra d’abréger sa défense, de ne point imiter dans ses longs développements l’orateur qu’on vient d’entendre. Quand le sujet le permet, il n’est pas mal de commencer par quelque chose de neuf ou de singulier qui naisse de la circonstance, comme un cri, une exclamation ; ou même qui soit médité, comme un apologue, un conte, un sarcasme. Si la gravité du sujet vous ôte cette ressource, frappez d’abord les esprits de tristesse, d’étonnement ou de terreur. C’est un grand avantage ; car si la douceur ou l’amertume des mets flatte ou pique un palais engourdi par le dégoût et la satiété, la surprise ou la gaieté savent aussi réveiller l’attention déjà fatiguée.
XVIII. Telles sont les règles particulières de l’exorde direct et de l’insinuation : celles qu’il me reste à tracer sont courtes et leur sont communes à tous deux. L’exorde se propose surtout de donner à l’auditoire une idée favorable de l’orateur : il sera donc plein de gravité, de noblesse, semé de sentences ; rien de brillant, rien de fleuri, rien d’affecté ; ce serait faire soupçonner qu’il y entre de l’art, de l’étude, du travail ; et c’est ôter au discours la persuasion, et à l’orateur toute confiance.
Voici maintenant les défauts les plus communs de l’exorde : on doit les éviter avec soin. L’exorde est ou banal, ou commun, ou d’échange, ou trop long, ou étranger, ou d’emprunt, ou contraire aux préceptes. Il est banal, s’il s’applique indifféremment à plusieurs causes ; commun, quand il convient également aux deux parties ; d’échange, si l’adversaire, avec de légers changements, peut l’employer contre nous ; il est trop long, s’il renferme plus de mots ou de pensées qu’il n’est nécessaire ; étranger, s’il ne naît point de la cause même, et ne fait pas corps avec elle ; il est d’emprunt, quand il produit un effet différent de celui qu’exige le genre de la cause ; si, par exemple, il dispose seulement l’auditeur à écouter, quand il s’agit de se concilier sa bienveillance ; ou s’il est direct, quand l’insinuation est nécessaire. Enfin, il est opposé aux préceptes, s’il ne produit rien de ce qu’on attend de l’exorde, et s’il ne concilie ni l’attention, ni l’intérêt, ni la bienveillance de l’auditoire ; ou, ce qui est plus fâcheux encore, s’il l’indispose contre nous. Mais c’en est assez sur l’exorde.
XIX. La Narration est l’exposé des faits tels qu’ils se sont passés, ou qu’ils ont pu se passer. Il y a trois sortes de narrations. La première renferme la cause même et le point de discussion. La seconde s’éloigne du sujet afin de l’agrandir, de l’orner, pour y ajouter mi moyen d’accusation, établir un rapprochement, sans toutefois s’écarter trop loin. La dernière, qui n’a point de rapport au barreau, est, pour apprendre à écrire ou à parler, un exercice aussi agréable qu’utile. Elle se partage en deux espèces, dont l’une regarde les choses et l’autre les personnes. Celle qui s’occupe des choses a trois parties, la fable, l’histoire, les hypothèses. On appelle fable, ce qui n’est vrai ni vraisemblable, comme :
J’ai vu de grands serpents ailés attelés sous le joug.
L’histoire est le récit de faits véritables, mais éloignés de notre siècle. Par exemple : Appius déclara la guerre à Carthage. L’hypothèse est une chose supposée, mais vraisemblable ; comme dans Térence :
Aussitôt que mon fils fut sorti de l’enfance, mon cher Sosie.
Dans la narration qui regarde les personnes, on doit reconnaître, avec les faits, le langage et les passions des personnages ; par exemple :
Mon frère vient souvent me crier : Que faites-vous, Mition ? Pourquoi nous perdre ce jeune homme ? pourquoi a-t-il une maîtresse ? pourquoi boit-il ? pourquoi fournissez-vous à ses folles dépenses ? Vous l’habillez trop magnifiquement ; vous êtes trop faible pour lui. Mon frère est trop sévère ; il l’est plus que la justice et le bien ne l’exigent.
C’est là qu’on doit trouver réunis la variété, les grâces du style, la peinture des passions et des mouvements du cœur, la sévérité, la douceur, la crainte, l’espoir, le soupçon, le désir, la feinte, l’erreur, la compassion, des révolutions, des changements de fortune, des revers soudains, des succès inattendus, et un agréable dénouement. Mais c’est en traitant de l’élocution que nous enseignerons l’art d’employer tous ces ornements du style. Occupons-nous maintenant de la narration qui renferme l’exposition de la cause.
XX. Brièveté, clarté, vraisemblance, voilà les trois qualités de la narration. Elle a le mérite de la brièveté, si l’orateur commence où il faut commencer, sans remonter trop haut ; s’il ne donne point des détails, quand il ne faut que des résultats ; car souvent il suffit d’énoncer un fait sans en développer les circonstances ; s’il s’arrête au moment de dire des choses inutiles ; s’il ne s’égare pas dans des digressions ; s’il s’exprime de manière à ce qu’on puisse, de ce qu’il dit, conclure ce qu’il ne dit point ; s’il omet non seulement tout ce qui lui est défavorable, mais encore tout ce qui ne lui est ni avantageux ni nuisible ; enfin s’il ne se répète jamais, s’il ne revient jamais sur ses pas. Mais n’allez pas vous laisser tromper par un air de concision. Que de gens ne sont jamais plus longs que quand ils se piquent de brièveté’ Ils tâchent de dire beaucoup de choses en peu de mots, au lieu de se borner à un petit nombre de choses essentielles ; car souvent on regarde comme concision de s’exprimer ainsi : « J’approche de la maison, j’appelle son esclave ; il me répond ; je lui demande son maître ; il m’assure qu’il n’y est pas. Il est impossible de dire plus de choses en moins de mots ; mais c’est encore être long, puisqu’il suffisait de dire qu’il n’y était pas. » Fuyez donc cette prétendue concision, et retranchez les circonstances inutiles avec autant de soin que les mots parasites.
La clarté de la narration consiste à exposer d’abord ce qui s’est fait d’abord, à suivre l’ordre des temps et des faits, à se conformer à la vérité ou à la vraisemblance. Il faut prendre garde de n’être ni confus ni entortillé ; ne point divaguer ; ne point remonter trop haut ; ne pas aller trop loin, et ne rien omettre d’essentiel ; en un mot, tous les préceptes donnés pour la brièveté peuvent s’appliquer à la clarté ; car souvent l’on est inintelligible plutôt à force d’être long qu’à force d’être obscur. Il faut aussi n’employer que des expressions claires ; mais nous parlerons de ce mérite en traitant de l’élocution.
XXI. La narration a de la vraisemblance, quand elle offre tous les caractères de la vérité ; quand elle observe fidèlement les convenances des personnes ; quand elle montre les causes des événements ; quand elle prouve qu’on a pu faire ce dont il s’agit ; que le temps était favorable, suffisant, le lieu commode ; enfin quand elle ne blesse point les mœurs connues des parties, l’opinion publique et les sentiments de l’auditoire. Voilà ce qui donne aux narrations un air de vérité.
Un autre point non moins important, c’est de savoir supprimer la narration quand elle est nuisible, ou seulement inutile ; c’est de prendre garde qu’elle ne soit déplacée, ou qu’elle ne se présente pas sous un jour favorable. Elle est nuisible, quand l’exposition du fait élève contre nous une forte prévention qu’il faut, dans le cours du plaidoyer, détruire par des raisonnements. Dispersez alors votre narration partie par partie dans le discours, et appuyez chaque circonstance de tout ce qui peut la justifier : c’est donner le contrepoison avec le venin, et ramener les esprits au moment qu’ils s’éloignent. Si la narration de votre adversaire est telle que vous n’ayez aucun intérêt à la recommencer, même en d’autres termes ; si l’auditoire a si bien envisagé les faits, qu’il vous importe peu de les lui présenter sous un autre point de vue, alors la narration est inutile, et il faut la supprimer. Elle est déplacée, quand elle n’occupe pas dans le discours la place qui lui convient ; mais ceci appartient à la disposition, et nous en parlerons en traitant de cette partie. La narration n’est pas dans un jour favorable, quand elle expose avec clarté, quand elle embellit ce qui peut servir notre adversaire, quand elle est obscure et négligée dans ce qui nous est avantageux. Pour éviter cet écueil, ramenez tout à l’intérêt de votre cause ; supprimez, autant qu’il est possible, toutes les circonstances défavorables ; glissez légèrement sur tout ce qui est dans l’intérêt de votre adversaire ; mais développez avec soin, avec clarté tout ce qui peut vous servir. Je crois en avoir assez dit sur la narration ; passons maintenant à la division.
XXII. Une division bien faite rend tout le discours clair et lumineux. La Division a deux parties, toutes deux également nécessaires pour développer la cause et fixer le point de discussion. La première établit en quoi nous sommes d’accord avec l’adversaire, et ce que nous lui contestons ; c’est elle qui indique à l’auditeur ce qui doit fixer son attention. L’autre renferme l’analyse rapide et la distribution de ce qui va faire la matière du discours ; c’est elle qui annonce à l’auditeur que le discours sera terminé, quand nous aurons traité tels et tels points. Nous allons indiquer en peu de mots la manière d’employer l’une et l’autre de ces divisions.
La première, celle qui établit en quoi nous sommes ou non d’accord avec l’adversaire, doit tourner en faveur de la cause ce dont on est tombé d’accord avec lui. Vous convenez, par exemple, qu’Oreste a tué sa mère ; « mais l’accusateur convient aussi que Clytemnestre avait assassiné. Agamemnon. » C’est ainsi que chacun est tombé d’accord sur un point, sans négliger l’intérêt de sa cause. Établissez ensuite le point de discussion en posant l’état de la question : nous avons indiqué plus haut la manière de le trouver.
Les caractères de cette autre partie de la division qui présente l’analyse et la distribution de la cause sont la brièveté, l’exactitude et la justesse. La brièveté n’admet aucun mot inutile, parce qu’il s’agit d’attacher l’auditeur, non par des ornements étrangers, mais par le fond même et les parties de la cause. L’exactitude embrasse tous les genres que renferme la cause : un défaut capital qui détruit tout l’effet du discours, c’est d’omettre quelque point essentiel, qu’on serait obligé ensuite de placer hors de la division. La justesse établit les genres, sans les mêler et les confondre avec les espèces. Car le genre embrasse plusieurs espèces, comme animal : l’espèce est comprise dans le genre, comme cheval ; mais souvent le même objet est à la fois genre et espèce : homme, par exemple, est espèce d’animal, et genre par rapport aux Thébains ou aux Troyens.
XXIII. J’insiste sur cette règle, parce que la division des genres, une fois clairement établie, aide beaucoup à la justesse. En effet, l’orateur qui dit : « Je montrerai que les passions, l’audace l’avarice de mes adversaires, sont la source de tous les maux de la république, » ne s’aperçoit pas que dans sa division il confond le genre et les espèces. Passion est genre pour tous les désirs déréglés de l’âme, et l’avarice est évidemment une de ses espèces.
Évitez donc, surtout dans une division, de joindre au genre une de ses parties, comme un genre différent. Que si le genre comprend plusieurs espèces, contentez-vous de l’exposer d’abord dans la division de la cause, pour le développer à loisir, quand la marche de votre discours vous aura conduit à ce point. La justesse nous apprend encore à ne pas promettre de prouver plus qu’il ne faut ; à ne pas dire, « Je démontrerai que mes adversaires ont eu le pouvoir et la volonté de n commettre ce délit, et qu’ils l’ont commis : » il suffit de prouver qu’ils l’ont commis. La cause est-elle assez simple pour ne point admettre de division, gardez-vous de vouloir diviser ; mais ce cas est extrêmement rare.
Il est encore d’autres préceptes sur la division ; préceptes qui n’appartiennent pas proprement à l’art oratoire, mais qui s’appliquent aussi à la philosophie, à qui nous avons emprunté en ce genre tout ce qu’elle nous offrait d’utile, et que nous n’avons trouvés dans aucune autre rhétorique.
Quelque sujet que vous traitiez, souvenez-vous toujours de ces principes de la division, et suivez dans la marche du discours l’ordre qu’elle aura une fois établi. Quand chacune des parties sera développée, songez à terminer votre discours ; vous n’avez plus à ajouter que la conclusion. Voyez, dans l’Andrienne de Térence, comme Simon, quand il expose ses desseins à son affranchi, établit en peu de mots et avec clarté sa division :
Ainsi tu connaîtras la conduite de Pamphile, unes desseins, et ce que j’attends aujourd’hui de ton zèle.
Il ne s’écarte point dans son récit de l’ordre établi dans sa division ; il commence par la conduite de son fils :
Lorsqu’il sortit de l’adolescence, mon cher Sosie, je lui laissai plus de liberté.
Ensuite il expose son dessein :
Maintenant je voudrais…
Il termine par la dernière partie de sa division, ce qu’il attend de Sosie :
Ce que j’attends aujourd’hui de toi
Ainsi nous devons, à son exemple, traiter successivement, et dans l’ordre que nous nous sommes tracé, chacun des points établis dans la division, et terminer quand ils sont tous développés. Nous allons maintenant donner les règles de la confirmation, puisque notre sujet nous y conduit naturellement.
XXIV. La Confirmation persuade l’auditeur par le raisonnement, établit la vérité de la cause, et trouve les preuves qui la font triompher. Elle a pour base des principes certains, que nous classerons suivant les différents genres de causes. Toutefois il n’y aura pas, ce me semble, d’inconvénient à exposer d’abord pêle-mêle, et sans ordre, tout ce qui a rapport à ce sujet, et à montrer ensuite comment on doit tirer de cette espèce d’arsenal des raisonnements pour chaque genre de cause.
Tous les raisonnements naissent des choses ou des personnes. Nous regardons comme attachés aux personnes le nom, la nature, le genre de vie, la fortune, la manière d’être, les affections, les goûts, les desseins, la conduite, les événements et les discours. Le nom est le mot propre et distinctif assigné à chaque personnage, le terme habituel dont on se sert pour l’appeler. Quant à la nature, il est difficile de la définir : il sera plus court de faire l’énumération de celles de ses différentes parties dont nous avons besoin pour ces préceptes.
Entre ces parties, les unes embrassent les dieux, les autres, les mortels. Les hommes et les animaux composent les mortels. Dans les hommes, on considère le sexe, masculin ou féminin ; la nation, la patrie, la famille et l’âge : la nation, si l’accusé est Grec ou Barbare ; la patrie, d’Athènes ou de Sparte ; la famille, quels sont ses parents, ses aïeux ; l’âge, s’il est dans l’enfance, dans la jeunesse, dans l’âge mûr ou dans la vieillesse. Ajoutez encore tous les avantages ou les défauts que l’âme et le corps tiennent de la nature : la force, la faiblesse, la grandeur, la petitesse, la beauté, la laideur, la lenteur, la légèreté, la pénétration, la stupidité, la mémoire, la douceur, l’empressement à obliger, la pudeur, la patience, et les défauts opposés. En un mot, considérez dans la nature tout ce que, pour l’âme et le corps, nous tenons de la nature ; car tout ce que donne l’application se rapporte à 1a manière d’être, dont nous parlerons bientôt.
XXV. Dans le genre de vie, considérez comment, par qui, d’après quels principes un homme a été élevé, quels maîtres il a eus pour les arts et pour la morale, quelles sont ses liaisons, quelle est sa profession, son art, son commerce, comment il gère ses affaires, enfin quel il est dans son intérieur.
Dans la fortune, on cherche s’il est riche ou pauvre, libre ou esclave, homme privé ou puissant ; puissant, s’il doit son élévation à son mérite ou à l’intrigue ; s’il est environné de gloire, comblé des faveurs de la fortune, ou dans la honte et le malheur ; quels sont ses enfants ; enfin, s’il ne s’agit pas d’un homme vivant, on peut considérer quel a été son genre de mort.
On appelle manière d’être, quelque perfection physique ou morale,comme une vertu qui ne se dément point, une connaissance approfondie d’un art ou d’une science, ou quelque avantage corporel, que nous devons moins à la nature qu’à l’art et à l’étude.
Les affections sont les changements soudains qu’éprouvent l’âme et le corps, comme la joie, le désir, la crainte, le chagrin, la maladie, l’abattement, et tout ce qui dépend du même genre. Le goût est une volonté fortement prononcée, une application continuelle et soutenue, à la philosophie, par exemple, à la poésie, à la géométrie, aux lettres. Le dessein est un plan arrêté pour faire ou ne pas faire telle ou telle chose. Pour la conduite, les événements et le discours, ils peuvent être envisagés sous le triple apport du passé, du présent et de l’avenir. Voilà pour ce qui concerne les personnes.
XXVI. La substance même du fait, les accessoires, les circonstances et les conséquences, voilà ce qu’il faut considérer dans les choses. La substance du fait constitue le fait en lui-même ; elle en est inséparable. On caractérise d’abord le fait dans son ensemble, et l’on n’a besoin pour cela que de peu de mots qui exposent le fait même. Par exemple : il s’agit d’un parricide, d’un crime de haute trahison. On cherche ensuite la cause, les motifs et les moyens ; on reprend tout ce qui a précédé le fait jusqu’au moment de l’exécution ; on examine toutes les circonstances qui l’ont accompagné, et enfin tout ce qui l’a suivi.
Le lieu, le temps, l’occasion, la manière, les moyens ; voilà les accessoires : c’est le second des lieux attribués aux choses. Et d’abord, quant au lieu, théâtre de l’action, on examine quelle facilité il offrait pour l’exécution ; et, pour juger de cette facilité, on examine son étendue, sa distance, son éloignement, sa proximité, s’il est isolé ou fréquenté, sa nature même et tout le pays qui l’avoisine ; enfin, s’il est sacré ou profane, public ou privé ; s’il appartient ou s’il a appartenu ou non à l’accusé.
Le temps, comme nous l’envisageons ici (car il serait difficile d’en donner une définition générale), est une partie de l’éternité, désignée par les mots d’année, de mois, de jour et de nuit. Il embrasse le passé ; et dans le passé les événements qui, perdus dans la nuit des siècles, nous semblent incroyables, et sont mis au rang des fables, et les événements éloignés de notre siècle, mais qui, appuyés sur le témoignage irrécusable de l’histoire, méritent notre croyance, aussi bien que les événements récents dont chacun peut avoir connaissance, et ce qui a précédé immédiatement, le présent même, et l’avenir qui peut être plus ou moins éloigné. On considère encore d’ordinaire la durée du temps, car souvent il est nécessaire de le comparer avec le fait, pour juger s’il a pu suffire à une action si longue on à tant d’actions différentes. Or, dans le temps on examine l’année, et le mois, et le jour, et la nuit, et la veille, et l’heure, ou enfin quelqu’une de leurs parties.
XXVII. L’occasion est une partie du temps qui renferme la facilité de faire ou de ne pas faire une action ; c’est ce qui la distingue du temps ; car il est facile de voir qu’ils ne font qu’un genre. Le temps est la durée qui embrasse ou plusieurs années ou une seule année, ou seulement une partie de l’année. L’occasion, à l’idée de durée, joint celle du moment favorable pour agir. Ainsi tous deux appartiennent au même genre, et ne sont point la même chose. Ils diffèrent sous un point de vue, et, comme nous l’avons dit, par l’espèce. L’occasion se distingue en publique, en commune, en particulière : publique, quand elle rassemble toute une ville, comme des jeux, une fête, la guerre ; commune, quand il s’agit d’une chose qui arrive à tout le monde à peu près dans le même temps, comme la moisson, la vendange, l’été, l’hiver ; particulière, quand il s’agit d’un des événements de la vie privée, comme un mariage, un sacrifice, des funérailles, un festin, le sommeil.
Le mode ou la manière développe les autres détails de l’action, le caractère qu’on lui donne, et l’intention de celui qui l’a faite. On peut y faire entrer, comme subdivisions, la prudence et l’imprudence. La prudence s’appuie des actions publiques et privées, des voies de douceur ou de violence employées pour réussir. L’imprudence, compagne ordinaire des passions, de la colère, de la douleur, de l’amour, et de toute affection semblable, s’emploie dans la justification. Les preuves qu’elle fournit se tirent surtout de l’ignorance, du hasard et de la nécessité.
Les moyens, dernière partie des accessoires, empêchent ou facilitent l’exécution.
XXVIII. Par circonstances, on entend ce qui est plus grand, plus petit que le fait dont ils agit, ce qui lui est pareil, égal, contraire, contradictoire ; enfin son genre, son espèce et son issue. La grandeur en plus ou en moins, et l’égalité, se jugent, pour ainsi dire, par la force, l’ordre et la figure de l’affaire. C’est un corps. dont on mesure la taille.
Les points de comparaison établissent la ressemblance : on les trouve par le rapprochement, et dans la conformité de nature. Deux choses sont contraires quand, placées dans des genres différents, elles sont très éloignées l’une de l’autre, comme le froid et la chaleur, la vie et la mort. Elles sont contradictoires, quand elles répugnent entre elles ; par exemple : « Être sage, n’être pas sage. » Le genre embrasse plusieurs espèces, comme passion, par exemple. L’espèce est une division du genre, comme l’amour, l’avarice. L’issue est la fin d’une action ; on cherche quel en a été, quel en est, quel en sera le résultat. Aussi, pour le trouver plus facilement, faut-il considérer quels sont les effets ordinaires de chaque chose, comme : « La haine naît de l’arrogance ; l’arrogance, de l’orgueil. »
Les conséquences sont le quatrième point qu’il faut, comme nous l’avons dit, considérer dans les choses. Elles comprennent tout ce qui dépend du fait une fois accompli : d’abord quel nom il faut lui donner ; quels en sont les auteurs, les chefs, les approbateurs, les imitateurs ; quelle est son importance ; quelle est sur ce point la loi, la coutume, la formule d’accusation, les jugements, ce qu’offrent la science et l’art ; ensuite quelle est sa nature ordinaire et habituelle ; s’il est commun, ou rare et extraordinaire ; s’il est soutenu par l’approbation générale ; ou si une semblable action a coutume d’exciter des sentiments de haine ; enfin tout ce qui a un rapport plus ou moins éloigné avec un fait tel que celui qu’on examine. Cherchez aussi avec attention tout ce qu’il peut offrir d’honnête ou d’utile, ce que nous développerons avec plus de détail en traitant du genre délibératif. On attribue aux choses tout ce que nous venons d’indiquer : tels en sont du moins les principaux caractères.
XXIX. Tout raisonnement tiré des lieux dont nous avons parlé sera ou probable ou nécessaire ; car, pour le définir en peu de mots, un raisonnement est une preuve qui rend un fait probable, ou en démontre la nécessité. Il est démontré nécessaire quand il est impossible de prouver qu’il soit arrivé autrement qu’on le dit ; par exemple : « Si elle est mère, c’est qu’elle a eu commerce avec un homme. » Cette manière de raisonner, qui prouve la nécessité du fait, s’emploie surtout sous la forme de dilemme, d’énumération ou de simple conclusion.
Le dilemme est un argument qui vous presse de deux côtés : « Si cet homme est un méchant, pourquoi en faire votre ami ? S’il est vertueux, pourquoi l’accuser ? »
L’Énumération expose plusieurs choses qu’elle nie toutes ensuite, à l’exception d’une seule, dont elle démontre la nécessité. Par exemple : « Il faut que l’accusé ait tué cet homme par haine, par crainte, par espérance, ou pour servir un ami ; s’il n’est animé par aucun de ces motifs, il ne l’a point tué ; car on ne commet point gratuitement un crime. Mais il n’était point son ennemi, il n’avait rien à craindre de lui, rien à espérer de sa mort, indifférente aussi pour les amis de l’accusé. Il ne reste donc rien à conclure, sinon qu’il ne fa pas tué. »
On appelle simple conclusion la conséquence nécessaire de ce qu’on avance : « A l’époque du délit dont vous m’accusez, j’avais passé la mer ; donc, bien loin de l’avoir commis, je n’ai pas même eu la possibilité de le commettre, » Prenez garde surtout ( car ce serait donner des armes contre vous) que votre preuve n’ait pas seulement la forme d’un raisonnement, une apparence de conséquence nécessaire, mais que votre raisonnement naisse de raisons rigoureusement nécessaires.
Un fait, vrai ou faux, est probable quand il est naturel ou conforme aux idées reçues, ou qu’il a du moins avec ces idées quelque similitude.
Ainsi, il est probable, parce qu’il est naturel, que, Si elle est mère, elle aime son fils ; que, « S’il est avare, il tient peu à sa parole. » Il est probable, parce que les idées généralement répandues doivent faire admettre cette probabilité, que : « L’impiété est punie dans les enfers. » Et, par la même raison, il est probable encore que : « Les philosophes ne reconnaissent point la pluralité des dieux. »
XXX. La Similitude s’établit surtout entre des choses contraires, pareilles, ou qui ont le même principe. Exemple, des contraires : « Si l’on doit pardonner un tort involontaire, doit-on de la reconnaissance à un service forcé ? » De choses pareilles : « Si une côte sans port n’offre point d’asile aux vaisseaux, un cœur sans bonne foi n’offre point de sûreté à l’amitié. » Dans les choses qui ont le même principe, on établit ainsi la probabilité : « S’il n’y a point de honte pour les Rhodiens d’affermer leur port, il n’y en a point n pour Hermacréon d’en prendre le bail. » Les probabilités sont plus ou moins fondées ; elles peuvent être, ou réelles, comme : « Une cicatrice est la preuve d’une blessure ; » ou vraisemblables, comme : « Une chaussure poudreuse indique qu’on arrive de voyage. »
Or, pour ne pas procéder au hasard, toute probabilité employée dans le raisonnement s’appuie sur des indices, sur l’opinion, sur les préjugés, ou sur une comparaison. On appelle indice tout ce qui tombe sous les sens, en indiquant quelque circonstance qui sort du fait même, qui l’a précédé, accompagné on suivi, et qui néanmoins a besoin d’être confirmé par quelque témoignage plus sûr, comme le sang, la fuite, la pâleur, la poussière. L’opinion, conforme aux idées de l’auditoire, n’a pas besoin de la déposition des témoins. « Il n’est personne qui ne souhaite à ses a enfants la santé et le bonheur. » Le préjugé naît de l’assentiment, de l’autorité, de la décision d’un seul ou de plusieurs. Il peut être considéré comme religieux, ou vulgaire, ou constaté. Il est religieux, quand il s’appuie sur un jugement sanctionné par l’autorité du serment et des lois ; vulgaire, quand il est conforme à la coutume et au sentiment général, comme le respect pour la vieillesse, la pitié pour les suppliants. La troisième espèce est l’autorité qui donne à une chose d’abord douteuse une approbation solennelle : par exemple, le peuple romain nomma consul, après sa censure, le père des Gracques, parce que, dans cette dernière magistrature, il n’avait rien fait que de concert avec son collègue. La comparaison établit quelques points de rapport entre des chose` différentes. Elle a trois parties : l’image, le parallèle et l’exemple. L’image démontre la ressemblance du corps ou de la nature. Le parallèle rapproche deux choses par leurs points de ressemblance. L’exemple soutient ou infirme le fait, en s’appuyant de l’autorité d’un homme ou d’un événement. Nous donnerons des exemples et des définitions de toutes ces règles, quand nous traiterons de l’élocution.
Nous avons, autant que nous le permettaient nos faibles talents, et avec toute la clarté que comportait la nature du sujet, indiqué les sources où doit puiser l’orateur pour la confirmation. Quant à la manière de traiter chaque question, chaque partie de question, toute discussion portant sur le raisonnement ou sur le sens littéral, et quant aux arguments qui leur conviennent le mieux, nous développerons chacun de ces points en particulier dans notre second Livre. Nous nous contentons maintenant d’indiquer confusément et sans ordre le nombre, les formes et les parties de l’argumentation ; puis nous choisirons et nous distinguerons celles qui sont propres à chaque genre de cause.
Voilà les lieux dans lesquels on pourra puiser des arguments de toute espèce ; mais l’art de les orner et de les distribuer avec ordre, art aussi agréable qu’utile, a été négligé entièrement par tous les rhéteurs. Nous allons donc en parler ici, pour joindre dans nos préceptes, à la manière de trouver l’argument, la manière de le perfectionner. L’importance de cette matière, et la difficulté d’en exposer les principes, exigent ici le plus grand soin et la plus scrupuleuse attention.
XXXI. Dans l’Argumentation, on emploie l’induction ou l’épichérème, appelé par les Latins ratiocinatio. L’Induction, en nous faisant convenir de choses évidentes, tire de ces aveux le moyen de nous faire convenir de choses douteuses, mais qui ont du rapport avec les premières. C’est ainsi que Socrate, dans un dialogue d’Eschine, son disciple, fait raisonner Aspasie qui s’entretient avec la femme de Xénophon et avec Xénophon lui-même. « Dites-moi, je vous prie, épouse de Xénophon, si votre voisine a de l’or d’un titre au-dessus du vôtre, lequel préférerez-vous ? — Le sien. — Si elle a des ajustements, une parure plus riche que la vôtre, laquelle préférerez-vous ? — La sienne. — Et si son mari vaut mieux que le vôtre, lequel préférerez-vous ? » La femme de Xénophon rougit pour toute réponse.
Aspasie s’adresse ensuite à Xénophon lui-même : « Dites-moi, je vous prie, Xénophon, si votre voisina un cheval meilleur que le vôtre, lequel préférerez-vous ? — Le sien. — S’il a une terre d’un meilleur produit que la vôtre, laquelle préférerez-vous ? — La sienne. — Et s’il a une femme meilleure que la vôtre, laquelle préférerez-vous ? » Xénophon, à son tour, garda le silence. « Puisque chacun de vous, reprit Aspasie, n’a pas voulu me répondre sur le seul point que je désirais savoir, je vais répondre pour vous deux. Vous, vous désirez le meilleur des époux ; et vous, Xénophon, la meilleure des femmes. « Si vous ne réussissez à devenir, l’un, l’homme le plus parfait, et l’autre, la femme la plus accomplie, vous regretterez toujours de n’avoir point fait un meilleur choix. » Ainsi, par l’enchaînement de ses questions, en les faisant convenir de choses évidentes, elle a réussi à les faire tomber d’accord sur des choses qui leur auraient semblé douteuses, si elle ne leur avait fait que des questions isolées.
C’était la manière habituelle de Socrate ; il cherchait moins à convaincre par ses propres raisons celui avec lequel il s’entretenait, qu’à le conduire insensiblement, par une suite d’aveux qu’il ne pouvait lui refuser, à une conclusion qui devait en être la conséquence nécessaire.
XXXII. Le premier principe de cette manière de raisonner, c’est qu’il doit être impossible de ne pas nous accorder la première partie de notre induction ; car la proposition qu’on établit pour faire convenir d’une chose douteuse ne doit pas être douteuse elle-même. Ensuite, l’objet que nous voulons prouver par l’induction doit être semblable à ce que nous avons posé d’abord pour certain. En effet, à quoi peut nous servir ce qu’on nous accorde, s’il n’a point de rapport avec la conclusion que nous voulons obtenir ? Enfin, il faut cacher sa marche, et ne pas laisser voir le but auquel doivent conduire les premières inductions. Autrement, celui qui voit, dès la première question, qu’en accordant ce qu’on lui demande, il lui faudra nécessairement accorder ce dont il ne veut pas convenir, vous empêchera, par son silence ou par une mauvaise réponse, de pousser plus loin vos questions. Il faut donc que ces questions le conduisent, sans qu’il s’en aperçoive, de ce qu’il vous accorde à ce qu’il ne veut pas accorder : alors vous le réduisez au silence, ou à l’alternative de nier ou d’avouer. S’il nie, montrez-lui l’identité de ce qu’il accorde et de ce qu’il n’accorde pas, ou servez-vous d’une autre induction. S’il avoue, concluez. Garde-t-il le silence, ou arrachez-lui une réponse, ou, puisque le silence est un aveu, concluez comme s’il avait avoué. Ainsi cet argument se divise en trois parties. La première se compose d’une ou de plusieurs similitudes ; la seconde, du point que nous voulons qu’on nous accorde, et pour lequel nous employons ces similitudes ; et la troisième, de la conclusion qui confirme la concession, ou montre ce qu’on en peut déduire.
XXXIII. Mais peut-être ne trouverait-on pas cette démonstration assez claire, si nous ne donnions un exemple de l’induction appliquée à une cause civile. Il me semble qu’un exemple de ce genre sera aussi de quelque utilité, non que l’usage en diffère dans la conversation et dans le discours, mais pour satisfaire ceux à qui un exemple d’un seul genre ne saurait suffire. Prenons la cause d’Épaminondas, général thébain ; cause si célèbre dans la Grèce. Ce grand homme n’avait point remis le commandement entre les mains du général nommé suivant la loi pour lui succéder ; mais il l’avait retenu pendant quelques jours, malgré la loi, pour achever d’abattre la puissance de Lacédémone, et il y avait réussi. L’accusateur peut employer l’induction pour défendre le sens littéral de la loi contre l’interprétation qu’on lui donnait : « Si l’on voulait, juges, ajouter au texte de la loi cette exception, qu’Épaminondas soutient avoir été dans l’intention du législateur, excepté le cas où l’intérêt de la patrie aurait déterminé le général à retenir le commandement, le souffririez-vous ? Je ne le pense pas. Que si vous-mêmes, et cette pensée est bien bonde votre sagesse et de votre respect pour la loi, vous vouliez, par honneur pour ce général, ajouter, sans l’ordre du peuple, cette exception à la loi, le peuple thébain le souffrirait-il ? Non, sans doute. Eh quoi ! pensez-vous qu’il soit permis d’agir comme si la loi renfermait une exception que vous regarderiez comme un crime d’y ajouter ? Non, Thébains, je connais trop votre sagesse ; vous ne pouvez penser ainsi. Et si le peuple, si vous-mêmes ne pouvez changer l’expression de la volonté du législateur, ne seriez-vous pas mille fois plus coupables de changer, par le fait et par votre jugement, une loi dont vous ne pouvez pas même changer les termes ? » Mais c’est assez, je crois, parler de l’induction pour le moment ; examinons maintenant la force et la nature de l’épichérème.
XXXIV. L’Épichérème tire du fond même du sujet une proposition probable qui, une fois connue et développée, se soutient par sa propre force et sa propre raison. Les rhéteurs qui ont parlé avec le plus de soin de cet argument, d’accord sur son usage dans l’éloquence, ne le sont pas tout à fait sur les préceptes qu’ils donnent à ce sujet ; car les uns le divisent en cinq parties, les autres ne lui en donnent que trois. II ne me semble pas inutile de faire connaître leur opinion et les raisons dont ils l’appuient. La digression sera courte. D’ailleurs, les uns et les autres ne manquent pas de motifs ; et c’est un point assez important dans l’art oratoire, pour mériter qu’on s’y arrête quelques instants.
Ceux qui lui donnent cinq parties veulent qu’on établisse d’abord la proposition, base de l’épichérème. Ainsi : « Les choses gouvernées avec prudence sont bien mieux conduites que celles où la prudence ne se trouve point. » C’est, suivant eux, la première partie. Elle doit être soutenue de différentes preuves, et amplifiée avec abondance et fécondité : « Une maison administrée avec sagesse est mieux montée, mieux approvisionnée qu’une maison en désordre et abandonnée au hasard. Une armée dirigée par un général plein de sagesse et d’expérience a un avantage immense sur une armée livrée à l’ignorance d’un chef présomptueux. Il en est de même pour un vaisseau : celui qui a le meilleur pilote fait la plus heureuse traversée. » La majeure ainsi prouvée, ce qui fait déjà deux parties du raisonnement, il faut tirer en troisième lieu, du sein même de la proposition, ce que vous voulez démontrer. Ainsi, pour suivre le même exemple : « Or rien n’est mieux conduit que l’univers. » C’est la troisième partie. La quatrième renferme les preuves de cette assomption : « Car le cours des astres est soumis à un ordre régulier ; leurs révolutions annuelles, asservies à une loi nécessaire et immuable, sont toujours dirigées vers le bien universel ; et la succession constante des jours et des nuits n’a jamais éprouvé le moindre désordre, ni exposé ainsi le monde à de funestes catastrophes. Preuves évidentes qu’une sagesse supérieure préside à la marche de l’univers. » La cinquième partie est la conclusion. Ou elle renferme simplement la conséquence des quatre autres parties qui ont précédé, ce qui peut se faire de cette manière : « Ainsi l’univers est gouverné avec sagesse ; ou elle résume en peu de mots la proposition et l’assomption, auxquelles elle ajoute la conséquence. » Voici quelle serait alors la conclusion du même exemple : « Que si les choses gouvernées avec prudence sont bien mieux conduites que celles où la prudence ne se trouve pas, et si rien n’est mieux conduit et gouverné que tout l’univers, il s’en suit que l’univers est gouverné par une secrète sagesse. » C’est ainsi que les rhéteurs dont je viens d’exprimer l’opinion croient devoir donner cinq parties à l’épichérème.
XXXV. Ceux, au contraire, qui n’en comptent que trois, ne suivent point une marche différente dans leur argument, mais seulement dans leur division. Ils ne veulent point qu’on sépare la proposition et l’assomption de leur preuve. Si on les sépare, ces deux parties, selon eux, seront incomplètes. Ainsi, ce que les autres divisent en proposition et en preuve, ils n’en forment qu’un seul tout ; c’est la proposition. Si cette proposition n’est point prouvée, ce ne peut pas être la proposition d’une argumentation régulière. Il en est de même pour l’assomption et sa preuve, que les premiers rhéteurs ont soin de distinguer, mais que ceux-ci appellent seulement assomption. C’est ainsi qu’ils divisent le même argument, les uns en trois, les autres en cinq parties : aussi la différence se fait-elle moins sentir dans la pratique que dans la théorie.
Pour moi, la division en cinq parties, suivie par tous les disciples d’Aristote et de Théophraste, me semble préférable ; car si l’école de Socrate avait adopté la première manière d’argumenter, qui procède par induction, Aristote, les péripatéticiens et Théophraste donnaient la préférence à l’épichérème ; et c’est aussi là le système suivi par les rhéteurs les plus subtils et les plus versés dans la connaissance de leur art.
Mais il faut justifier le choix que nous faisons ici, afin d’éviter le reproche d’une prédilection aveugle, et le justifier en peu de mots, pour ne pas nous arrêter sur de pareils détails plus longtemps que ne l’exige l’ordre de nos préceptes.
XXXVI. S’il est des arguments où il suffit d’établir la proposition, sans qu’il soit nécessaire d’y joindre la preuve, il en est d’autres où la proposition n’a de force qu’autant qu’elle est soutenue par la preuve. La proposition et la preuve sont dune deux choses différentes ; car un accessoire qu’on peut ajouter ou retrancher ne saurait être la même chose que l’objet auquel on l’ajoute ou dont on le retranche. Or, dans le raisonnement, tantôt la proposition n’a pas besoin de preuve ; tantôt, comme nous le montrerons, elle ne saurait s’en passer ; donc la preuve n’est pas la même chose que la proposition. Voici comme nous prouvons ce que nous avons avancé.
Une proposition évidente et dont tout le monde ne peut s’empêcher de convenir, n’a pas besoin de preuve. Par exemple : « Si j’étais à Athènes le jour que ce meurtre a été commis à Rome. je n’ai pu y prendre part. » Voilà qui est évident, qui n’a pas besoin de preuve. Aussi peut-on ajouter tout de suite l’assomption : « Or, j’étais à Athènes ce jour-là. » Si ce fait n’est pas constant, il faut le prouver, et ensuite vient la conclusion : « Donc je n’ai pu prendre part à ce meurtre. » Ainsi, il est des propositions qui n’ont pas besoin de preuve. Montrer que d’autres en ont besoin, serait inutile ; c’est un fait trop évident. Ou peut alors en conclure, comme de l’exemple cité, que la proposition et la preuve sont réellement deux choses différentes. Or, s’il en est ainsi, il est faux que cet argument n’ait que trois parties.
Nous verrons de même qu’il faut distinguer l’assomption de la preuve ; car, s’il suffit quelquefois, dans un raisonnement, de poser l’assomption sans y joindre la preuve, si d’autres fois elle n’a de poids qu’autant que la preuve y est jointe, la preuve et l’assomption sont des choses différentes : or, il est des arguments où l’assomption n’a pas besoin de preuve ; d’autres, au contraire, comme nous le montrerons, où elle ne peut s’en passer ; donc il faut distinguer l’assomption de la preuve. Voici comme nous prouvons ce que nous venons de dire.
Une assomption, qui renferme une vérité évidente pour tous les esprits, n’a pas besoin de preuve. Par exemple : Si la sagesse est nécessaire, il faut se livrer à l’étude de la philosophie. Cette proposition a besoin d’être prouvée ; car elle n’est pas évidente, puisque bien des gens regardent la philosophie comme inutile, quelques-uns même, comme nuisible. Mais l’assomption est évidente : Or la sagesse est nécessaire. Une vérité si évidente n’a pas besoin de preuve ; elle se sent et se voit d’elle-même ; ainsi l’on peut ajouter tout de suite la conclusion : Donc il faut se livrer à l’étude de la philosophie. Il est donc des assomptions qui n’ont pas besoin de preuve ; mais il est clair pour tout le monde qu’il y en a qui ne peuvent s’en passer. L’assomption et la preuve ne sont donc pas une seule et même chose. Il est donc faux que cet argument n’ait que trois parties.
XXXVII. D’après ces principes, il est constant qu’il y a certains arguments dont ni la proposition ni l’assomption n’ont besoin de preuve. En voici un exemple aussi court qu’évident : « S’il faut rechercher avant tout la sagesse, il faut avant tout éviter l’imprudence. Or, il faut rechercher avant tout la sagesse ; donc il faut éviter avant tout l’imprudence. » Ici la proposition et l’assomption sont incontestables : aussi n’ont-elles pas besoin de preuve. Tous ces exemples nous montrent clairement que la preuve peut tantôt s’ajouter, tantôt se retrancher. Elle n’est donc renfermée ni dans la proposition, ni dans l’assomption ; mais chacune de ces parties a une place et un caractère propre et particulier. Ainsi ceux qui divisent l’épichérème en cinq parties, ont suivi la division la plus exacte.
L’argument appelé épichérème, ou raisonnement, a donc cinq parties : la proposition ou la majeure, qui expose en peu de mots la pensée sur laquelle est fondé tout l’argument ; la preuve de la proposition, qui appuie la pensée énoncée en peu de mots, et lui donne plus de probabilité et d’évidence ; l’assomption ou la mineure, qui tire de la proposition ce qu’on doit démontrer ; la preuve de l’assomption qui la soutient et l’appuie de raisons ; enfin la conclusion, qui exprime d’une manière précise et rapide la conséquence que l’on tire de tout l’argument. L’argument le plus compliqué se compose de ces cinq parties. Il en est aussi de quatre, de trois et de deux, quoiqu’on n’adopte pas généralement cette dernière division. Quelques-uns même prétendent qu’un argument peut n’avoir qu’une seule partie.
XXXVIII. Nous donnerons donc quelques exemples des divisions reçues, et nous alléguerons plusieurs raisons en faveur des autres.
Voici un exemple d’un raisonnement à cinq parties : « Toutes les lois, juges, doivent se rapporter à l’intérêt de la patrie ; c’est dans le sens du bien général qu’il faut les interpréter plutôt que dans le sens littéral ; car vous connaissez assez la sagesse et la vertu de nos ancêtres pour croire qu’en établissant des lois, ils n’avaient d’autre but que le salut et l’intérêt de la patrie. Leur intention n’était pas d’y rien insérer de nuisible ; et ils étaient convaincus que, s’ils l’eussent fait, la découverte de leur erreur devait abroger la loi. Ce n’est pas, en effet, pour la loi elle-même qu’on veut que la loi soit inviolable, mais pour la république, dont la sûreté repose sur les lois. C’est d’après ce principe, qui rend les lois inviolables, qu’on doit en interpréter le texte. Oui, si nous n’avons d’autre but que l’intérêt de la patrie, si nous sommes en quelque sorte les esclaves de son bonheur et de sa gloire, ce même intérêt que nous portons à la patrie doit nous guider dans l’interprétation des lois. Si l’on doit croire que la médecine n’a d’autre but que de rendre la santé, puisque tel est le motif qui l’a fait inventer, les lois, on doit le croire aussi, n’ont d’autre but que l’intérêt de la patrie, puisque tel est le motif qui les a fait établir. Cessez donc, juges, cessez, dans cette cause, de vous attacher au sens littéral de la loi, et que l’intérêt de la patrie soit, comme il est juste, le seul point de vue sous lequel vous l’envisagiez. Eh ! que pouvait-il y avoir jamais de plus utile pour Thèbes que l’abaissement de Sparte ? Épaminondas, général des Thébains, ne devait-il pas, avant toute autre considération, songer à rendre les Thébains victorieux ? Que devait-il préférer à une gloire si brillante pour les Thébains ? à qui devait-il sacrifier un triomphe si beau, si éclatant, un si noble trophée ? Ne devait-il pas suivre l’intention du législateur, plutôt que le texte de la loi ? Nous avons suffisamment établi qu’aucune loi n’avait d’autre but que l’intérêt de la patrie. Épaminondas regardait donc comme le comble de la démence de ne pas prendre le salut de son pays pour règle dans l’interprétation d’une loi établie pour le salut de son pays. Que s’il faut rapporter toutes les lois à l’intérêt de la république, et si Épaminondas a été utile à la république, certes il n’a pu en même temps être utile à la fortune publique et désobéir aux lois. »
XXXIX. Le raisonnement n’a que quatre parties quand on retranche la preuve, soit de la proposition, soit de l’assomption ; et c’est ce qu’il faut faire quand la proposition est évidente, ou l’assomption assez claire pour n’avoir pas besoin d’être prouvée. Voici un exemple d’un raisonnement à quatre parties, où la proposition n’a pas de preuve : « Juges, qui devez à la loi ce pouvoir judiciaire, sanctionné par votre serment, votre premier devoir est d’obéir à la loi. Or vous ne pouvez lui obéir, si vous vous écartez du sens littéral de la loi. Eh ! quel témoignage plus authentique le législateur a-t-il pu nous laisser de sa volonté, que ce qu’il a écrit avec soin, avec l’attention la plus scrupuleuse ? Si ce texte ne « subsistait pas, nous ferions tous nos efforts pour le trouver, afin de connaître la volonté du législateur ; quand nous avons le texte de la loi sous les yeux, bien loin de permettre qu’Épaminondas, accusé, interprète la volonté du législateur dans le sens de sa cause, plutôt que dans le sens littéral, nous ne le souffririons pas, même quand il serait hors de l’atteinte de la loi. Que si votre devoir, juges, est d’obéir à la loi, et si vous ne le pouvez qu’en suivant religieusement le sens littéral de la loi, qui peut vous empêcher encore de prononcer que l’accusé a enfreint la loi ? »
Voici un exemple d’un raisonnement à quatre parties, où la preuve de l’assomption est supprimée : « Nous ne pouvons avoir confiance aux discours de ceux qui nous ont souvent trompés. En effet, si leur perfidie nous cause quelque tort, nous ne pourrons en accuser que nous-mêmes. Se laisser tromper une fois est un malheur ; deux, une sottise ; il serait humiliant de l’être trois fois. Or, les Carthaginois nous ont déjà souvent trompés. Le comble de la démence serait donc de compter sur la fidélité de ces perfides, nous qui avons été si souvent victimes de leurs parjures. »
Supprimez les deux preuves, votre raisonnement n’a plus que trois parties. On peut en juger par cet exemple : « Il faut craindre Carthage, si nous la laissons subsister, ou il faut la détruire ; or, il ne faut pas la craindre ; il ne reste donc qu’à la détruire. »
XL. Quelques rhéteurs prétendent que l’on peut, que l’on doit même quelquefois supprimer la conclusion, quand la conséquence est évidente, ce qui réduit le raisonnement à deux parties. « Si elle est mère, elle n’est point vierge. Or, elle est mère. » Il suffit, disent-ils, d’établir la proposition et l’assomption, la conséquence étant si claire que la conclusion devient inutile. Pour moi, il me semble que tout raisonnement doit avoir une conclusion ; j’ajoute seulement qu’il faut éviter ce qui leur déplaît avec raison, et ne jamais donner à ce qui est évident la forme d’une conclusion.
Pour éviter cet écueil, il faut connaître les différents genres de conclusions. Tantôt la conclusion se forme de la réunion de la majeure et de la mineure. Par exemple « Que si toutes les « lois doivent avoir pour but l’intérêt de la patrie, et si l’accusé a sauvé la patrie, certes il ne peut pas tout à la fois avoir sauvé la patrie et désobéi aux lois. » Tantôt elle se tire des contraires : « Le comble de la démence serait donc de compter sur la fidélité de ceux dont la perfidie nous a si souvent trompés. » Ou bien l’on n’exprime que la conséquence seule : « Donc il faut détruire Carthage. » On peut encore se contenter d’exprimer ce qui suit nécessairement la conséquence. Ainsi, dans ce raisonnement : « Si elle est mère, elle a eu commerce avec un homme ; or, elle est mère ; » la conséquence inévitable est celle-ci : « Donc elle a eu commerce avec un homme. » Mais si vous ne voulez pas exprimer cette conséquence, et que vous vous borniez à ce qui la suit : « Donc elle a été incestueuse, » vous concluez votre raisonnement, et vous évitez une conclusion trop évidente.
Ainsi, un raisonnement est-il long, il faut conclure par la réunion des prémisses ou par les contraires ; est-il court, exposez seulement la conséquence. Quand elle est trop évidente, ne vous y arrêtez pas et n’exprimez que ce qui la suit.
Ceux qui prétendent qu’un argument peut n’avoir qu’une seule partie, le posent ainsi, et prétendent que c’est assez pour le raisonnement : « Puisqu’elle est mère, elle a eu commerce avec un homme ; » car de cette manière il n’est besoin ni de proposition, ni d’assomption, ni de preuve, ni de conclusion. Mais l’ambiguïté du mot argumentation produit leur erreur ; car ce mot, qui se prend dans un double sens, signifie en même temps et les raisons qui rendent une chose probable ou nécessaire, et l’art de les exposer. Ainsi, lorsqu’ils disent simplement : « Puisqu’elle est mère, elle a eu commerce avec un homme, » ils donnent la raison, mais sans art ; et nous ne nous occupons ici que de l’art et de ses parties.
XLI. Cette objection est donc frivole ; et la distinction que nous venons d’établir réfute tout ce qu’on pourrait dire contre notre division, en prétendant qu’on peut supprimer la proposition ou l’assomption. Les raisons qui la rendent probable ou nécessaire, doivent faire impression sur l’auditoire, de quelque manière qu’elles soient exposées ; mais si l’on ne s’attachait qu’à cet effet, sans s’inquiéter de la manière d’exposer les raisons une fois trouvées, la différence qu’on établit entre le talent et la médiocrité serait chimérique.
Il faudra surtout varier vos tournures ; dans tous les genres, l’uniformité enfante le dégoût. Pour le prévenir, ne suivez point toujours la même marche, et répandez d’abord de la variété dans la forme de vos arguments : employez tantôt l’induction, tantôt l’épichérème. Que votre raisonnement même ne commence pas toujours par la proposition, ne soit pas toujours divisé en cinq parties ; ne suivez pas constamment le même plan dans l’amplification et les ornements de vos divisions : mais commencez tantôt par l’assomption, tantôt par une des deux preuves ou par toutes les deux. Employez tantôt une conclusion, tantôt une autre. Rien n’est plus facile ; et pour s’en convaincre, il suffit d’écrire ou de s’exercer sur quelques-uns des exemples que nous avons proposés.
Nous avons, ce me semble, assez développé les différentes parties du raisonnement. Nous n’ignorons pas, et il n’est peut-être pas inutile de le dire en cet endroit, nous n’ignorons pas que la méthode philosophique enseigne d’autres moyens aussi nombreux que subtils de développer les arguments ; mais nous les croyons étrangers à l’art oratoire. Tout ce qui nous a semblé appartenir à l’éloquence, nous ne prétendons pas l’avoir mieux traité que les autres ; mais nous y avons apporté plus de soin et d’exactitude. Maintenant, continuons notre route en suivant l’ordre que nous avons établi.
XLII. La réfutation détruit, ou du moins affaiblit par des arguments les assertions de l’adversaire. Elle puise aux mêmes sources que la confirmation ; car les mêmes lieux qui servent à confirmer une chose peuvent servir aussi à l’infirmer. Il ne faut doue encore ici considérer que les choses et les personnes ; et l’on peut appliquer à cette partie de l’éloquence les préceptes que nous avons tracés sur la manière de trouver et d’établir des arguments. Néanmoins, pour donner une théorie sur ce sujet, nous développerons les différentes espèces de réfutations : suivez ces principes, et vous détruirez, ou vous affaiblirez du moins sans peine toutes les objections de vos adversaires.
On réfute un raisonnement en n’accordant pas une ou plusieurs des choses que renferment les prémisses ; ou, si l’on accorde les prémisses, en niant la conclusion qu’on en tire, ou en montrant que le genre même du raisonnement est vicieux ; ou en opposant à une raison solide une objection aussi forte, ou même plus solide encore. Voulez-vous ne pas accorder à votre adversaire ce qu’il avance d’abord, niez que ce qu’il établit comme probable ait la moindre vraisemblance ; niez que ses comparaisons offrent le moindre rapport avec te sujet ; donnez un autre sens aux jugements qu’il cite, ou condamnez-les absolument ; rejetez ce qu’il regarde comme des indices ; attaquez sa conséquence sous un ou plusieurs rapports ; démontrez que son énumération est fausse, ou, s’il emploie une simple conclusion, prouvez qu’elle manque de justesse ; car ce sont là, comme nous l’avons enseigné ci-dessus, les lieux où l’on puise tout ce qui peut rendre un fait probable ou nécessaire.
XLIII. On réfute une chose donnée pour probable, soit quand elle est d’une fausseté évidente, comme : « Il n’est personne qui ne préfère l’argent à la sagesse ; » soit quand le contraire est aussi probable : « Pour qui le devoir n’est-il pas plus sacré que l’intérêt ? » soit lorsqu’elle est tout à fait incroyable ; par exemple « Qu’un homme d’une avarice reconnue a, sans motifs importants, négligé un gain considérable ; » ou bien si l’on généralise ce qui n’est vrai que de certains individus ou de certaines choses ; comme : « Tous les pauvres préfèrent l’intérêt au devoir.— Ce lieu est désert ; c’est là qu’on a dû commettre le meurtre. — Comment un homme a-t-il pu être tué dans un lieu fréquenté ? ou si l’on regarde comme impossible ce qui n’arrive que rarement, comme Curion, dans son discours pour Fulvius : « La vue seule d’un objet, un coup d’œil, ne suffisent pas pour inspirer de l’amour. »
Pour les indices, les mêmes lieux qui servent à les établir, serviront à les attaquer. lI faut d’abord en démontrer la vérité ; puis, qu’ils sont propres à la chose dont il s’agit, comme, k sang est l’indice d’un meurtre ; ensuite prouver qu’oit a fait ce qu’on ne devait pas faire, ou qu’on n’a pas fait ce qu’on devait faire ; que l’accusé était sur ce point parfaitement instruit de la loi et de la coutume ; car tout cela appartient aux indices. Nous en parlerons avec plus d’étendue quand nous traiterons particulièrement de la question de conjecture. Il faut donc, dans la réfutation, démontrer que chacun de ces indices ne prouve rien ; qu’il est peu important, qu’il fait plus pour nous que pour nos adversaires, qu’il est absolument faux, ou même qu’il pourrait conduire à d’autres soupçons.
XLIV. Votre adversaire a-t-il établi une comparaison, il cherche entre deux faits ou deux causes des rapports que vous devez détruire pour le réfuter. Vous y réussirez en montrant des différences frappantes dans le genre et la nature, la force et la grandeur, le temps et le lieu, les personnes et l’opinion ; en appréciant, en remettant chacune à sa place des choses qu’on vous présente comme semblables. Faites ensuite ressortir les différences, et concluez que l’on doit juger bien différemment ces deux faits ou ces deux causes. Vous trouverez surtout l’occasion d’employer ces moyens, lorsque vous aurez à détruire quelque raisonnement fondé sur l’induction.
Si l’on vous oppose quelque jugement antérieur, comme on ne manque pas de le fortifier de l’éloge de ceux qui l’ont rendu, des rapports qui se trouvent entre les deux affaires, de ce que, loin d’être contredit, il a été généralement approuvé,enfin de son importance et des difficultés qu’il présentait, bien supérieures à celles qui se rencontrent dans l’affaire dont il s’agit, on ne peut l’infirmer que par des lieux contraires, si la vérité ou du moins la vraisemblance le permettent. Ayez soin surtout de prendre garde si par hasard le jugement cité n’offre aucun rapport avec votre affaire ; évitez enfin, avec la plus grande attention, de vous appesantir sur un jugement où les mêmes juge aient commis quelque faute ; car on pourrait croire que vous voulez juger les juges eux-mêmes. N’allez pas non plus, quand un grand nombre de jugements prononcent contre vous, en choisir un seul, et qui ne tombe que sur une espèce rare, pour l’opposer à vos adversaires ; car ce serait leur donner les armes plus fortes pour infirmer l’autorité de la chose jugée. Telle est la manière de répondre aux arguments qui établissent la probabilité.
XLV. Il n’est pas difficile de réfuter un argument qui n’a que la forme d’un raisonnement rigoureux, sans en avoir la justesse ; et voici comme il faut s’y prendre. Si le dilemme, qui vous presse également des deux côtés, est vrai, n’y répondez pas. Est-il faux, on le réfute de deux manières : par la rétorsion, ou en infirmant l’une des deux propositions. Exemple de la rétorsion :
S’il a de la pudeur, pourquoi accuser un homme de bien ? S’il porte un cœur inaccessible à la honte, pourquoi accuser un homme qui s’inquiétera peu de vos reproches ?
Ainsi, qu’on le suppose vertueux ou incapable de pudeur, on conclut qu’il ne faut pas l’accuser. Vous rétorquez l’argument en disant : « C’est au contraire une raison pour l’accuser ; car s’il conserve encore quelque pudeur, accusez-le : il ne méprisera point votre accusation. A-t-il perdu toute pudeur, accusez-le, puisqu’il n’est pas vertueux. » Vous pouvez encore infirmer l’une des deux propositions : « S’il a conservé quelque pudeur, l’accusation pourra le ramener n dans le sentier de la vertu. »
Une énumération est vicieuse, quand vous pouvez répondre qu’on a passé sur quelque chose que vous voulez accorder, ou qu’on y a compris des raisons faibles, que vous pouvez tourner contre votre adversaire, ou que vous n’avez pas de motif raisonnable de ne pas accorder. Par exemple, voici une énumération qui n’est pas complète : « Puisque vous avez ce cheval, ou vous l’avez acheté, ou vous l’avez acquis par héritage, ou il vous a été donné en présent, ou il est né dans votre maison ; ou, si rien de tout cela n’est vrai, il faut que vous l’ayez dérobé. Or, vous ne l’avez ni acheté ni acquis par héritage ; il n’est point né chez vous, on ne vous l’a point donné en présent ; donc il faut que vous l’ayez dérobé. » ll est facile de réfuter ce raisonnement, si vous pouvez dire que ce cheval a été pris sur l’ennemi, et que vous l’avez reçu dans le partage du butin. Vous renversez toute l’énumération en rétablissant ce qu’elle avait omis.
XLVI. Vous pouvez encore attaquer une des parties de l’énumération, si vous êtes en mesure de le faire, et prouver, pour nous en tenir à l’exemple déjà cité, que vous avez eu ce cheval par héritage. Vous pouvez enfin convenir d’une chose qui n’a rien de honteux. Qu’un adversaire vous dise : « Ou vous méditiez une trahison, ou vous étiez guidé par la cupidité, ou vous aviez trop de complaisance pour un ami ; » pourquoi n’avoueriez-vous pas que vous avez agi par complaisance pour un ami ?
On peut réfuter une conclusion simple quand la conséquence n’est pas la suite nécessaire des antécédents. Si vous dites : « Cet homme respire, donc il vit. Le soleil brille, donc il fait jour, » le rapport de l’antécédent et du conséquent est sensible. Mais si vous dites : « Elle est mère, donc elle aime ses enfants ; — Il a commis quelques fautes, donc il est incorrigible, » il suffira, pour vous réfuter, de montrer qu’il n’y a pas de liaison nécessaire entre l’antécédent et le conséquent.
La théorie du raisonnement en général et de la réfutation a bien plus de profondeur et d’étendue que nous ne lui en donnons ici. Mais telle en est la nature qu’on ne peut la joindre à quelque partie de l’art oratoire, et qu’elle exige seule une étude particulière et une longue et sérieuse méditation. Aussi nous nous réservons de la développer ailleurs et dans un autre but, si nos faibles talents nous le permettent. Bornons-nous maintenant aux préceptes que donne la rhétorique sur l’éloquence. Nous venons d’exposer la manière de réfuter notre adversaire en niant une de ses propositions.
XLVII. Si vous les accordez toutes deux, vous pouvez encore attaquer la conséquence, et la comparer avec les prémisses. Vous dites, par exemple, que « vous étiez parti pour l’armée. » On vous répond par cet argument : « Si vous étiez venu à l’armée, vous auriez été vu par les tribuns militaires ; or, ils ne vous ont point vu ; donc vous n’étiez point parti pour l’armée. » Ici vous accordez la proposition et l’assomption, mais vous niez la conséquence, qui n’est pas exacte.
Pour nous rendre plus clairs, nous avons choisi un exemple où ce défaut était saillant ; mais souvent on se laisse vaincre par un raisonnement faux, mais subtil, soit parce qu’on oublie ce qu’on a accordé, soit parce qu’on accorde une proposition douteuse. Admettez-vous, dans le sens que vous lui donnez, une chose douteuse que votre adversaire, dans sa conclusion, envisage sous un autre point de vue, démontrez qu’il ne tire point sa conséquence de ce que vous lui accordez, mais de ce qu’il établit. L’exemple suivant donnera une idée de ce genre de réfutation : « Si vous avez besoin d’argent, vous n’en avez pas ; si vous n’avez pas d’argent, vous êtes pauvres : or, vous avez besoin d’argent, autrement vous n’auriez point embrassé le commerce ; donc vous êtes pauvres. » Il est facile de répondre : Quand vous me dites : « Si vous avez besoin d’argent, vous n’en avez pas ; » j’entends : « Si vous êtes dans un dénuement absolu, vous n’avez point d’argent, » et voilà pourquoi je vous l’accorde. Quand vous ajoutez : « Or, vous avez besoin d’argent ; » je comprends : « Vous voulez en avoir davantage ; » et de ces deux propositions que je vous accorde, il ne faut pas conclure : « Donc vous êtes pauvres : » conclusion qui serait juste, si j’étais demeuré d’accord avec vous que « celui qui veut augmenter son argent n’a pas d’argent. »
XLVIII. Souvent on suppose que vous avez oublié ce que vous avez accordé, et l’on fait entrer dans la conclusion, comme conséquence, ce qui ne l’est nullement ; par exemple : « S’il avait des droits à sa succession, il est probable qu’il est son assassin. » On prouve longuement la majeure ; ensuite on ajoute : « Or il y avait des droits ; donc il est son assassin ; » ce qui n’est nullement la conséquence de ce qu’on a établi.
Aussi faut-il donner la plus grande attention et aux prémisses et à la conséquence.
Quant au genre du raisonnement, on prouve qu’il est défectueux, lorsqu’il renferme quelque vice en lui-même, ou qu’il est mal appliqué. Le vice est en lui-même, s’il est absolument faux, commun, vulgaire, futile, tiré de trop loin ; si la définition n’est pas juste ; s’il est litigieux, trop évident, contesté ; enfin, s’il renferme quelque chose de honteux, d’offensant, de contraire, d’incohérent ou de contradictoire. il est faux, quand le mensonge est grossier : « Celui qui méprise l’argent ne saurait être sage ; or Socrate méprisait l’argent, donc il n’était point sage ; » commun, quand il ne fait pas moins pour notre adversaire que pour nous : « Peu de mots me suffisent, juges, parce que ma cause est bonne ; » vulgaire, quand ce qu’on accorde peut s’appliquer également à une chose peu probable, comme : « Si sa cause n’était pas bonne, juges, il ne s’abandonnerait pas à votre sagesse ; futile, quand l’excuse est déplacée ; » par exemple : « Il ne l’aurait point fait, s’il y avait pensé ; » ou quand on s’efforce de jeter un voile transparent sur une action dont la honte est évidente :
Pendant que chacun vous recherchait avec ardeur, je vous ai laissé sur un trône florissant ; maintenant on vous abandonne ; seule, malgré le péril, je dispose tout pour vous y replacer.
XLIX. L’argument est tiré de trop loin, quand on remonte plus haut qu’il n’est nécessaire : « Si P. Scipion n’eût point donné sa fille à Tibérius Gracchus, si de cette union n’étaient point nés les deux Gracques, jamais on n’aurait vu ces cruelles séditions ; ainsi c’est sur Scipion qu’en doit retomber la faute. » Ces vers pèchent par le même défaut :
Plût aux dieux que jamais dans les forêts du Pélion la hache n’eût couché les sapins sur la terre !
C’est reprendre les choses de trop haut. La définition est défectueuse, quand elle peut s’appliquer à différents objets ; ainsi : « Qu’est-ce qu’un séditieux ? un citoyen dangereux et nuisible ; » ce qui ne désigne pas plutôt le séditieux que le calomniateur, l’ambitieux ou tout autre mauvais citoyen ; ou quand elle est fausse : « La sagesse est le talent de s’enrichir ; » ou quand elle n’a ni gravité ni étendue, comme : « La folie est une soif insatiable de gloire ; » car c’est définir une espèce de folie, et non pas la folie en elle-même. Quand on donne une preuve douteuse, l’argument est litigieux :
Eh ! ne le sais-tu pas ? les dieux, dont la puissance fait mouvoir à son gré les cieux et les enfers, savent assurer entre eux la paix et la concorde.
La preuve est trop évidente, quand elle porte sur un point non contesté. C’est, en accusant Oreste, démontrer qu’il a tué sa mère. L’argument, au contraire, est contesté, quand on amplifie ce qu’il faudrait prouver, comme si, par exemple, « en accusant Ulysse, on s’arrête longtemps à dire que c’est une indignité qu’un héros, qu’Ajax soit mort de la main du plus lâche des hommes. » Il est honteux, quand il est indigne du lieu où l’on parle, de celui qui parle, de la circonstance, des auditeurs, du sujet lui-même, et qu’il semble répandre sur la cause quelque chose de déshonorant. Il est offensant, quand il blesse l’auditoire, comme « si l’on citait devant des chevaliers jaloux de siéger sur un tribunal, la loi de Cépion sur les jugements. »
L. Condamnez-vous la conduite de ceux qui vous écoutent, le raisonnement est contraire. C’est ce que ferait un orateur qui, parlant en présence d’Alexandre de Macédoine, destructeur de Thèbes, dirait « que rien n’est plus affreux que de détruire une ville. » L’argument est peu d’accord avec lui-même, quand l’orateur se contredit, s’il prétend, par exemple, « que la sagesse fait seule le bonheur, » et ensuite, « qu’il n’y a pas de bonheur sans la santé ; » ou que « la tendresse l’amène auprès de son ami, démarche qu’il ne croit pas inutile à ses intérêts. » Il est opposé, s’il renferme quelque chose de nuisible à la cause : « N’allez point, en exhortant votre armée au combat, exagérer la force, le nombre et le bonheur des ennemis. »
Voici en quoi pèche un raisonnement dont quelque partie est mal appliquée. Ou vous avez avancé plus que vous ne prouvez, ou vous ne parlez que d’une partie, quand il s’agit du tout ; par exemple : « Les femmes sont avares ; car Eriphyle a vendu la vie de son époux. » Ou vous ne vous justifiez point du crime dont on vous accuse : « On vous reproche des brigues et des intrigues, et vous parlez de votre courage. » Ainsi, « Amphion, dans Euripide et dans Pacnvius, pour défendre la musique, vante la sagesse. »
Ou vous rejetez sur la chose les défauts de l’homme, comme « si l’on s’autorisait des défauts d’un savant pour accuser la science ; » ou, dans un éloge, vous parlez de la fortune et non des talents de votre héros ; ou, dans la comparaison de deux objets, vous ne croyez pas pouvoir louer l’un sans dénigrer l’autre, ou sans le passer sous silence ; ou vous quittez votre sujet pour vous jeter dans des lieux communs : « On délibère s’il faut ou non faire la guerre ; vous vous occupez de l’éloge de la paix, avant de montrer que la guerre est inutile ; » ou vous donnez des raisons fausses ; par exemple : « L’argent est un bien, parce qu’il nous rend heureux ; » ou des raisons faibles, comme Plaute, quand il dit :
C’est une chose odieuse de reprendre un ami d’une faute qu’il a commise ; mais c’est quelquefois une chose utile et profitable dans la vie ; car moi-même je châtierai aujourd’hui mon ami pour la faute qu’il a commise.
Ou des raisons qui n’ajoutent rien ; par exemple : « L’avarice cause de grands maux à l’homme ; car l’amour de l’argent le jette en de grands malheurs ; » ou peu convenables : « L’amitié est le plus grand des biens ; car elle offre une foule d’amusements. »
LI. Le quatrième mode de réfutation est d’opposer à un raisonnement solide un raisonnement aussi fort ou même plus solide encore. On l’emploie surtout dans le genre délibératif : nous accordons que l’avis contraire est juste ; mais nous prouvons que le nôtre est nécessaire : nous avouons que ce qu’on propose est utile ; mais nous démontrons que notre conseil est dicté par l’honneur. Voilà ce que nous avions à dire de la réfutation. Il nous reste à parler maintenant de la péroraison.
Avant la péroraison, Hermagoras place la digression ; et dans cette digression, étrangère au fond de la cause et à l’intérêt du jugement, il veut que l’orateur insère son éloge, blâme son adversaire, ou traite quelque sujet qui lui fournisse, plutôt par l’amplification que par le raisonnement, de nouvelles armes pour attaquer ou se défendre. Si l’on veut considérer la digression comme une partie du discours, on peut suivre le sentiment d’Hermagoras ; car nous avons donné ou nous donnerons à leur place des préceptes pour amplifier, louer ou blâmer. Quant à nous, nous ne jugeons point convenable de compter la digression au nombre des parties du discours, parce qu’il ne faut jamais s’éloigner de sa cause que dans les lieux communs dont nous aurons bientôt à parler. Nous ne croyons pas non plus que l’éloge et le blâme doivent se traiter à part ; et il nous semble plus convenable de les fondre dans les raisonnements. Passons donc à la péroraison.
LII. La péroraison complète et termine tout le discours. Elle a trois parties : l’énumération, l’indignation et la plainte. L’énumération réunit et rassemble les faits et les arguments dispersés dans le discours ; elle les place sous un même point de vue pour en rappeler le souvenir. Si, en traitant cette partie, vous suivez toujours la même marche, il ne sera pas difficile d’y reconnaître l’art. Pour en effacer jusqu’aux moindres traces, pour prévenir le dégoût, employez la variété. Tantôt, et cette méthode, comme la plus facile, est la plus usitée, récapitulez en les effleurant tous vos raisonnements ; tantôt, et l’on rencontre ici plus de difficultés, vous retracez votre division et les différents points que vous aviez promis de traiter, et vous rappelez les raisons dont vous avez appuyé chacun d’eux. L’orateur quelquefois s’adresse à l’auditoire, et lui demande ce qu’il veut qu’on lui démontre encore, et il ajoute : n Voilà ce que nous vous avons appris, voilà ce n que nous avons prouvé. Ainsi vous rafraîchissez la mémoire de l’auditeur, et vous lui persuadez qu’il ne doit rien attendre de plus.
Ici vous pouvez, comme nous l’avons dit plus haut, rappeler vos raisonnements à part, ou, ce qui exige plus de talent, y joindre les objections qu’on vous a faites, en reproduisant votre confirmation, et en montrant à chaque preuve comment vous avez réfuté votre adversaire. Ainsi, une courte comparaison rappelle à l’auditoire et la confirmation et la réfutation. Pour tous ces résumés, on a surtout besoin de varier les formes et les tournures du style. Au lieu de faire vous-même l’énumération, de rappeler ce que vous avez dit et en quel lieu vous l’avez dit, vous pouvez la placer dans la bouche de quelque personnage ou de quelque objet inanimé que vous mettez en scène, Voici un exemple de la première manière : « Si le législateur paraissait tout à coup et vous demandait : Pourquoi hésitez-vous encore ? qu’auriez-vous à répondre, quand on vous a démontré ?… » Et vous pouvez alors, aussi bien que si vous parliez en votre propre nom, tantôt passer en revue tous vos raisonnements l’un après l’autre, tantôt rappeler la division, tantôt demander à l’auditoire ce qu’il attend encore, ou comparer vos preuves aux objections de l’adversaire.
Faites-vous parler une chose inanimée, alors c’est une loi, une ville, un lieu quelconque, un monument, que vous chargez de l’énumération : « Si la loi pouvait parler, ne se plaindrait-elle pas, ne pourrait-elle pas vous dire : Qu’attendez-vous.. encore, juges, quand on vous a démontré que ?… » Et vous avez ici les mêmes ressources. Sous quelque forme que vous présentiez votre énumération, comme vous ne pouvez rapporter vos raisonnements en entier, contentez-vous de rappeler en peu de mots ce qu’ils ont de plus solide ; car il s’agit de rafraîchir la mémoire, et non pas de recommencer le discours.
LIII. Le but de l’indignation est d’exciter notre haine contre un homme, ou de nous inspirer de graves préventions contre quelque fait. Souvenez-vous d’abord qu’on peut, pour la traiter, employer tous les lieux que nous avons indiqués par la confirmation ; car elle se forme, comme l’amplification, de tout ce qui a rapport aux personnes et aux choses. Cependant nous allons considérer les principes et les lieux communs qui appartiennent à l’indignation en particulier.
Le premier lieu se tire de l’importance et de la dignité d’une chose, prouvée par l’intérêt qu’y prennent les dieux immortels, ou les hommes dont l’autorité est la plus respectable. Il s’appuie sur la divination, les oracles, les hommes inspirés des dieux, les prodiges, les phénomènes, les réponses des aruspices, aussi bien que sur l’histoire de nos ancêtres, des rois, des cités, des nations, sur l’autorité des sages, du sénat, du peuple et des législateurs. Le second lieu montre, par l’amplification, quels sont ceux que le délit dont on parle intéresse le plus ; si c’est la société entière, ou la majeure partie de la société, ce qui annonce un crime atroce ; ou des supérieurs, c’est-à-dire, ceux qui nous ont fourni le premier lieu commun, celui de la gravité et de l’importance, ce qui est une indignité ; ondes égaux en courage, en fortune, en avantages corporels, ce qui est une injustice ; ou des inférieurs, ce qui est le comble du despotisme et de l’inhumanité. Dans le troisième lieu, on cherche ce qui pourrait arriver, si d’autres imitaient cet exemple ; on montre combien l’indulgence pour ce fait produirait d’imitateurs de cette coupable audace ; enfin, on en développe les funestes conséquences. Le quatrième lieu démontre que bien des gens attendent avec impatience la décision de cette affaire, pour juger, d’après ce qu’on accordera à un coupable, de ce qu’ils pourront se permettre en pareille occasion. Le cinquième prouve que, dans d’autres cas, si l’on se trompe et que la vérité triomphe ensuite, le mal n’est pas irréparable ; mais qu’ici, le jugement une fois prononcé, ni un jugement contraire, ni aucune puissance ne saurait corriger le mal qu’il aurait fait. Le sixième lieu fait voir que le délita été commis à dessein et de propos délibéré ; on ajoute que si l’erreur a quelquefois des droits à l’indulgence, il ne faut jamais pardonner une méchanceté volontaire. Dans le septième lieu, l’horreur, la cruauté, l’atrocité inouïe d’un crime enfanté par la violence toute-puissante, d’un crime qui viole toutes les lois et l’équité naturelle, enflamment le courroux de l’orateur.
LIV. Le huitième lieu démontre que le crime dont il s’agit n’est point un crime vulgaire, ni même un crime habituel aux plus grands scélérats, mais un forfait inconnu aux hommes les plus cruels, aux nations les plus barbares, aux bêtes les plus féroces : telle est la cruauté envers nos parents, nos enfants, nos époux, nos alliés, envers des suppliants ; au second rang on place les violences envers des vieillards, un hôte, un ami, un voisin, un homme avec qui nous avons passé notre vie ; envers ceux qui nous ont élevés, qui nous ont instruits ; envers un mort, un malheureux digne de pitié, ou un homme illustre, revêtu d’honneurs et de dignités ; envers des gens qui ne peuvent ni attaquer ni se défendre, comme des enfants, des vieillards, des femmes. L’indignation qu’excitent toutes ces circonstances peut allumer, dans le cœur des auditeurs et des juges, la haine la plus vive contre le coupable.
Le neuvième lieu, en comparant le délit sur lequel on va prononcer avec d’autres délits reconnus comme tels, montre, par la comparaison, combien il est plus atroce et plus abominable encore. Le dixième, en rassemblant toutes les circonstances de l’action, et tout ce qui l’a suivie, fait ressortir, par l’indignation qu’excitent les moindres détails du fait, tout ce qu’ils ont de révoltant et de criminel, et par le tableau frappant qu’il met sous les yeux des juges, leur rend le crime aussi odieux que s’ils l’avaient vu commettre eux-mêmes. Dans le onzième, faites voir que le coupable devait moins qu’un autre commettre un pareil délit, qu’il était même de son devoir de l’empêcher, si un autre eût voulu le commettre. L’orateur, dans le douzième, s’indigne d’être la première victime d’un crime jusqu’alors inconnu. Le treizième lieu, en montrant que l’outrage se joint à l’injustice, rend odieux l’orgueil et l’arrogance du coupable. Par le quatorzième, l’orateur supplie ses auditeurs« de se mettre à sa place, de se supposer eux-mêmes victimes de l’injure dont il souffre, de penser à leurs enfants, s’il s’agit d’un enfant ; à leurs épouses, s’il s’agit d’une femme ; à leurs pères, à leurs parents, si c’est un vieillard qui a été outragé. Enfin il dira, dans le quinzième, que l’ennemi public ou particulier le plus implacable serait indigné de ce que nous avons souffert. Tels sont à peu près les lieux les plus propres à exciter l’indignation.
LV. Voici maintenant les lieux d’où l’on peut tirer la plainte, dont le but est de chercher à exciter la pitié de l’auditeur. Il faut donc l’attendrir d’abord, et le préparer à des émotions plus douces, si nous voulons le rendre sensible à nos plaintes. Pour y réussir, développez des lieux communs sur la puissance irrésistible de la fortune, et sur la faiblesse des mortels. Ces pensées, exprimées d’un style grave et sentencieux, font sur les esprits une impression profonde, et les disposent à la compassion. Le malheur d’autrui leur rappelle leur propre faiblesse.
Le premier lieu qu’on emploie pour exciter la commisération oppose notre prospérité passée à notre malheur présent. Le second, embrassant plusieurs époques différentes, montre de quels maux nous avons été, nous sommes et nous serons les victimes. Le troisième appuie sur chacune des circonstances qui aggravent votre malheur. Vous perdez un fils, et vous rappelez les plaisirs innocents de son âge, son amour, vos espérances, les consolations qu’il vous donnait, le soin de son éducation. Ce sont tous ces détails qui, dans une disgrâce quelconque, rendent votre malheur plus touchant. Le quatrième lieu fait connaître les affronts, les humiliations, les traitements déshonorants et indignes de notre âge, de notre naissance, de notre fortune, de nos honneurs passés, de nos bienfaits, que nous avons soufferts, ou dont nous sommes menacés. Le cinquième est le tableau de chacun de nos malheurs, tableau si vif et si animé, que l’auditeur semble les voir, et se laisser attendrir moins par le récit que par la vue de nos disgrâces. Le sixième montre que nous sommes tombés dans le malheur au moment où nous nous y attendions le moins, et que nous avons été précipités dans cet abîme de maux quand nous nous bercions d’un vain espoir de bonheur. Par le septième, l’orateur applique à l’auditeur sa propre infortune ; il le supplie de se rappeler, en le voyant, le souvenir de ses enfants, de ses parents, de ceux qui doivent lui être chers. Dans le huitième, nous disons qu’on a fait ce qu’on ne devait pas faire, ou qu’on n’a pas fait ce qu’on devait faire ; par exemple : « Je n’étais pas près de lui, je ne l’ai pas vu, je n’ai point entendu ses dernières paroles, je n’ai point recueilli ses derniers soupirs. » Ou bien : « Il est mort entre les mains des barbares, il est étendu sans sépulture sur une terre ennemie ; longtemps exposé à la voracité des bêtes sauvages, il a été privé des honneurs de la sépulture, honneurs qu’on ne refuse à personne. » Le neuvième s’adresse à des choses muettes ou inanimées, à un cheval, une maison, un vêtement ; artifice qui touche profondément l’auditeur, en lui rappelant des souvenirs attendrissants. Le dixième expose notre pauvreté, notre faiblesse, notre isolement. Dans le onzième, on recommande à la bienveillance publique ses parents, ses enfants, le soin de sa sépulture, ou quelque chose de semblable. Dans le douzième, on se plaint d’être privé d’une personne avec qui on aimait à vivre, d’un père, d’un fils, d’un frère, d’un ami. Dans le treizième, on mêle l’indignation à la plainte, en rappelant que nous éprouvons ces cruels traitements de ceux dont nous devrions le moins les attendre ; par exemple, de la part de nos proches, de nos amis, de ceux que nous avons obligés, ou dont nous attendions du secours ; de ceux enfin pour qui c’est le plus noir des crimes, d’un esclave, d’un affranchi, d’un client ou d’un suppliant.
Le quatorzième lieu emploie l’obsécration : par des prières, par un langage humble et soumis, nous implorons la pitié des auditeurs. Dans le quinzième, nous prouvons que nous nous plaignons moins de notre infortune que de celle des personnes qui nous sont chères. Dans le seizième, nous nous montrons sensibles pour les autres, mais supérieurs à tous les malheurs qui fondent sur nous ; notre cœur est et sera inaccessible à l’abattement, à la faiblesse ; et cette fermeté ne se démentira jamais : car souvent le courage et la grandeur d’âme, qui s’expriment avec noblesse et dignité, savent mieux nous attendrir que l’humiliation et les prières. Mais les esprits une fois émus, gardez-vous d’être prolixe dans vos plaintes ; car, comme l’a dit le rhéteur Apollonius, rien ne sèche plus vile que les larmes.
Mais comme nous avons, à ce qu’il nous semble, assez développé toutes les parties oratoires, et que ce Livre nous parait assez long, il convient de renvoyer au Livre second la suite de nos préceptes.