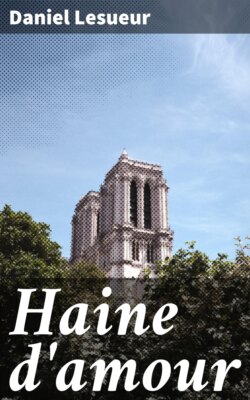Читать книгу Haine d'amour - Daniel Lesueur - Страница 4
I
ОглавлениеSous un soleil tendre, mouillé de brumes légères, par un matin charmant d’avril, un landau de grande remise descendait les Champs-Élysées. Au premier coup d’œil, on reconnaissait la classique voiture de noce,—non pas la berline doublée de satin blanc et aux lanternes argentées des mariées de boutique, mais l’équipage plus sobre que préfère la bourgeoisie à prétentions mondaines, et qui généralement s’accompagne d’un petit coupé pour les époux.
La destination de ce landau se trahissait d’ailleurs moins par l’astiquage des harnais un peu fatigués, par la toilette soignée des chevaux et par on ne sait quel air de gala, que par l’éclair d’une cravate et d’un plastron blancs, que l’on voyait étinceler à l’intérieur, entre les revers d’un habit noir.
Un jeune homme, dans un angle du large véhicule, s’enfonçait et s’effaçait, comme gêné, à cette heure matinale et parmi l’activité ambiante, par son costume de soirée, que dissimulait à peine un élégant par-dessus clair. Certainement ce jeune homme avait devant lui quelque journée de bombance et de paresse; aussi put-il voir s’allumer d’envie, sur son passage, le regard des employés qui s’arrêtaient une seconde, avant d’entrer, avec un soupir d’ennui, sous le porche du Ministère de la Marine.
Pourtant c’était à une véritable corvée—telle du moins il la désignait en lui-même—que se rendait Vincent de Villenoise.
Garçon d’honneur!... Quelle fonction dépourvue de sens et d’intérêt, décorée de quel titre absurde!—«Je suis garçon d’honneur!» Pouvait-on, sans les faire suivre d’une exclamation énervée, formuler ces trois mots d’un jargon ridicule,—ces trois mots qui représentaient pour lui quinze heures de piétinement, de parade et de fadaises?...
Et c’était pour cela, pour ce supplice bête, que Vincent renonçait au programme ordinaire d’une de ses journées: à sa promenade à cheval dans les allées du Bois; à quelque intéressant assaut chez Ruzé ou à deux ou trois bons cartons chez Gastinne; et surtout à ses chers moments de rêverie et d’étude, dans la pénombre recueillie de son immense et sévère cabinet de travail, au premier étage de son hôtel, rue Jean Goujon! Il le voyait, son hôtel, qu’il venait à peine de quitter. Il se tenait devant la porte... Il y rentrait par la pensée... Il montait le large escalier, où, sur la moquette, ses pas s’assourdissaient... Il pénétrait dans sa pièce préférée, dans son sanctuaire d’âme... Et tout de suite, de la multitude des volumes alignés le long des murs, comme des œuvres artistiques çà et là dispersées, émanait, vers son esprit impersonnel et attentif, tout ce que l’humanité, à travers les âges, élabora de réflexions, de chimères et d’hypothèses. Sur son bureau, il apercevait un livre ouvert, un livre latin: les Astronomiques de Manilius. Puis, à côté, des feuillets couverts d’écriture: la traduction commencée,—cette traduction qui devait, en faisant mieux connaître le poète romain, mettre à sa véritable place, à côté de Lucrèce, ce philosophe de fatalisme et d’impassibilité que fut Manilius.
Vincent regretta de n’être point devant ce bureau, la plume suspendue sur ces feuillets, prête à tracer, puis à raturer souvent, les mots laborieux. Mais le caractère même de ses travaux de prédilection, à ce moment, le frappa d’une tristesse.
«Traduire... Jamais produire...» soupira-t-il.
Car—il en avait conscience, trop clairement—sa ferveur, sa docilité d’érudit, venaient de son manque d’originalité intellectuelle, de sa radicale impuissance à créer.
Vincent de Villenoise avait la curiosité de la pensée des autres. Il n’était pas possédé par cette curiosité différente, celle de l’inconnu, qui précipite un esprit en avant, dans les abîmes et malgré les vertiges, en lui inspirant, au contraire, le dédain de ce que déjà les autres ont exploré, découvert.
Mais, comme—dans ce landau qui le menait chercher une invitée de la noce—il énonçait avec mélancolie cette espèce de jeu de mots, devise forcée de son intelligence: «Traduire... Jamais produire...» ses yeux rencontrèrent une affiche. Et la coïncidence lui parut tellement saisissante d’ironie, que Vincent rit à demi-voix, comme avec une personne vivante, de la moquerie que lui lançaient les choses.
Elle était, cette affiche, d’une vulgarité criante.
Étalée sur la palissade en planches où s’enfermaient les travaux d’une maison en construction, elle représentait une gigantesque et rutilante bouteille, se détachant comme en relief sur un fond du jaune le plus vif. Une étiquette enroulée aux flancs de cette bouteille portait deux mots, écrits en lettres d’un pied: APÉRITIF BERTET. Et, tout au bas, sur le fond jaune, on lisait encore cette recommandation, d’un style tellement concis qu’elle en devenait inoubliable: Le meilleur des apéritifs.
C’était tout. Mais cette affiche-là, Vincent savait qu’à la première palissade en planches de la prochaine maison en construction il allait la retrouver; que, s’il prenait un train quelconque, pour n’importe quelle direction, l’affiche flamboierait devant ses yeux à toutes les stations de la ligne; que, s’il descendait en n’importe quelle ville d’Europe, il verrait surgir l’affiche le long des murs; qu’il apercevrait des réductions de l’affiche aux vitres de tous les cafés; que, dans les théâtres, il verrait descendre l’affiche, pendant l’entr’acte, avec le rideau-annonce. Il savait encore que, s’il s’embarquait sur un paquebot, dans un port quelconque, l’affiche, reproduite sur toile vernie, et circonscrite en un cadre de bois, voyagerait avec lui, suspendue dans un coin de la salle à manger; que, s’il abordait au Caire, dans les Indes, au Japon, ou jusque dans quelque île à peine explorée des archipels océaniens, la première chose qui frapperait ses regards dès qu’il aurait mis pied à terre, ce serait la bouteille de pourpre sur fond d’or, avec son cachet de cire en guise de cimier, l’écartèlement de son étiquette blanche, et sa devise en exergue: Le meilleur des apéritifs. Car cette affiche paraissait être le blason du monde civilisé, de ce monde moderne qui pourrait cependant plus que tout autre se passer d’apéritif, tant est dévorante la faim de jouissances qui le rend esclave de ses entrailles.
«Traduire... Jamais produire...» répéta Vincent de Villenoise. «Mon père, lui, a produit quelque chose... l’APÉRITIF BERTET.» C’est avec une ironie à l’égard de cette facile invention, un mouvement de rage contre sa propre impuissance et d’humeur contre l’insolence de cette énorme affiche suggestionnant l’humanité avec deux mots et la silhouette d’une bouteille, que le jeune homme émit pour lui-même cette réflexion. Cependant il était injuste, puisque son immense fortune, son hôtel de la rue Jean Goujon, son château de Villenoise—dont, après les formalités légales, son père, Armand Bertet, avait pris et lui avait légué le nom,—tout, jusqu’à son instruction raffinée, jusqu’à ses studieux loisirs, était sorti de la panse arrondie de cette purpurine bouteille. Pourquoi donc la haïssait-il, souffrait-il tant de la voir?... Au point que s’il eût connu quelque région habitable où ne se fussent point glissées les réclames de l’APÉRITIF BERTET, Vincent s’y serait réfugié; non pas pour toujours—il aimait trop Paris—mais de temps à autre, en guise de cure morale, pour éliminer de son organisme le jaune et le rouge de cette affiche, dont la sensation l’exaspérait.
Peut-être... (bien que l’accoutumance au bien-être et l’ingratitude envers ses causes soient tellement naturelles qu’il semble inutile de les expliquer), peut-être Vincent de Villenoise sentait-il confusément que, malgré son rôle de corne d’abondance, la bouteille de l’affiche avait eu des torts envers lui. Sans cet incroyable flot d’or que, de ses gros flancs de verre glauque, de son goulot commun, elle avait déversé dans la misérable arrière-boutique d’Armand Bertet, le petit Vincent aurait reçu une éducation bien différente. Au lieu d’être, pendant dix-huit ans, comprimé dans le moule où se réalise le type du «monsieur» et du «savant», tel que le concevait son père,—l’ancien garçon épicier Armand, devenu Bertet le marchand de produits chimiques, puis M. Bertet l’inventeur de l’apéritif, puis M. Bertet de Villenoise, directeur d’usine, et enfin M. de Villenoise, châtelain et maire de sa commune;—au lieu d’avoir plié sa souple intelligence et son trop docile caractère à la discipline du lycée, des précepteurs particuliers, de l’École Normale et de l’École de Droit; au lieu de n’avoir vu rien de plus glorieux au monde que le maximum des points dans les examens, que les soutenances de thèse, que les titres de docteur et d’agrégé, Vincent eût de bonne heure engagé la lutte pour la vie. Et quelque chose lui disait que, dans cette lutte, il n’eût pas été vaincu. Doué comme il l’était, comme il l’avait montré dès sa petite enfance, peut-être ne lui avait-il manqué qu’un peu de volonté, un certain esprit d’initiative pour devenir vraiment «quelqu’un». Mais cette volonté, cet esprit d’initiative, doivent, avec le genre d’éducation moderne, être poussés jusqu’à l’indépendance outrée, l’instinct de contradiction, la révolte, pour ne pas s’éteindre sous l’effroyable amas des idées toutes pensées et des opinions toutes faites, sous l’amoncellement des connaissances tout élaborées, et dans le laminoir des examens identiques écrasant à la même mesure les esprits les plus dissemblables. C’est même sans doute parce que de telles qualités d’énergie triomphent seulement lorsqu’elles ont l’exagération d’un défaut, que tous les hommes illustres sont contraints d’avouer aux enfants, dans les distributions de prix, qu’ils ont été des «cancres» au collège. Vérité presque à coup sûr, mais vérité bien dangereuse à dire devant des auditeurs de douze ans.
Vincent de Villenoise, loin d’être un cancre, avait porté sur son front d’adolescent tous les lauriers universitaires. Bien légères, ces couronnes de papier doré! Toutefois de quel poids fabuleux, de quel cercle de plomb elles écrasent et enserrent de plus en plus l’intelligence humaine, la volonté humaine! Heureusement on ne les propose pas partout comme but suprême aux efforts des générations qui grandissent.
De pareilles réflexions s’ébauchaient à peine, en ce matin d’avril, dans l’esprit de M. de Villenoise, tandis que le landau de noce le transportait vers une personne inconnue de lui, Mme Pirard, qu’il devait ramener chez le général Méricourt, où le cortège s’assemblait. Pourtant, il avait déjà craint de découvrir en lui-même une certaine impuissance à vouloir; et cette crainte lui redevenait sensible précisément parce qu’il allait assister, ce jour-là même, au mariage de son meilleur ami, Robert Dalgrand, avec Mlle Lucienne Méricourt, la fille du général.
Oui, Robert se mariait. Robert avait pu prendre cette détermination énorme de changer radicalement sa vie, de risquer son bonheur, pour une seule chance de bonheur plus grand, contre vingt chances de malheur possible. Robert avait accepté de jouer sa sécurité morale, son indépendance, tout son avenir, à pile ou face, avec l’inconnu pour enjeu. Et cela tranquillement, presque brusquement, sans les hésitations, les retards, les tourments d’incertitude qui, pour Vincent, eussent accompagné un acte d’une telle importance.
Se marier!... Depuis deux ans que sa trentaine avait sonné, Vincent, parfois, avait entrevu ce que pourrait devenir son existence s’il parvenait à hausser sa volonté jusqu’à une décision pareille. Mais, outre que des circonstances très spéciales semblaient—à son point de vue du moins—lui interdire de songer au mariage, son antipathie pour les résolutions irréparables et l’insuffisance des données d’après lesquelles se serait déterminé son choix, suffisaient pour couper court aux fantaisies nuptiales de son imagination.
Il admirait donc Robert—comme un homme qui a peur de l’eau admire le nageur qui pique une tête: sans l’envier précisément.
Cependant M. de Villenoise n’eut pas le loisir d’analyser pourquoi son état d’esprit tournait à un vague mécontentement de lui-même. Il arrivait chez cette Mme Pirard, qu’on l’envoyait quérir,—une tante veuve d’un certain âge, qui le fit attendre assez longtemps au salon parce que sa toilette n’était pas terminée. Tandis que, dans le secret de la chambre à coucher, la couturière élargissait à la hâte un corsage de satin grenat dans lequel, au dernier moment, la dame ne pouvait pas entrer, Vincent, qui, machinalement, feuilletait des albums de photographies, profita de sa solitude pour bâiller jusqu’aux larmes; puis il murmura entre ses dents:
«Sacristi! voilà des corvées qui convertiraient à l’union libre!»
Mais la veuve parut, montrant, sous les frisures grisonnantes de ses cheveux, un visage presque aussi grenat que sa cuirasse de satin. La couturière venait de lui dire: «Madame ne porte pas trente ans.» Et la grosse personne, qui savourait cette phrase, fut saisie d’un attendrissement à se trouver tout à coup face à face avec un jeune homme. Vincent, à sa vue, se leva, reprit sur une table son claque, dont le ressort serrait un de ses gants, et s’inclina, sans se douter que, sous ce corsage sanglé à outrance, un cœur encore sensible venait de précipiter ses battements, au grand risque d’une congestion pour la dame. Pourtant, si, lorsqu’elle eut soupiré très fort pour reprendre sa respiration et qu’il la suivit à travers l’antichambre et l’escalier, Vincent se fût avisé du danger de suffocation qu’elle venait de courir, il eût peut-être volontiers convenu tout bas que sa jolie barbe en était cause.
C’était sa coquetterie, en effet, et le principal charme de sa physionomie, cette fine mousse blonde, qui, savamment taillée, allongeait en pointe son visage, foisonnait et frisait au-dessus de sa lèvre, et s’en allait, presque rasée vers le haut des joues, se perdre en léger coup d’estompe sous les cheveux à peine plus foncés. C’était elle qui donnait de la douceur à ses yeux bruns, de l’affinement à ses traits, un air d’élégance et d’énergie à toute sa personne. Grâce à cette barbe si bien plantée, coupée avec art, Vincent avait la tête amoureuse et martiale d’un gentilhomme du xvie siècle, et pouvait porter crânement son nom de Villenoise. D’ailleurs, à part une secrète prédilection pour ce mâle ornement de son visage, le jeune homme n’avait aucune fatuité.
Remonté en voiture, cette fois à côté de la grosse Mme Pirard, il faisait des efforts pour écouter poliment. Car elle jugeait à propos de causer. Vincent ne s’intéressait guère aux détails qu’elle lui donnait sur la famille de son cousin le général. Et il s’exaspérait intérieurement à l’idée que ce bavardage n’était que le commencement d’un supplice destiné à se prolonger jusqu’à minuit. Mais, s’apercevant qu’il ne lui donnait pas la réplique, la dame le questionna directement. Elle voulut savoir quelle était la demoiselle d’honneur de M. de Villenoise.
—Mlle Gilberte Méricourt, madame.
—Ah! ma petite Gilberte... La sœur de Lucienne. Car vous savez sans doute que la fiancée de votre ami s’appelle Lucienne?
—Je l’avais oublié, madame.
—Tiens! Et vous avez retenu le nom de Gilberte?
—C’est que je l’avais écrit... pour le faire broder sur un mouchoir que je lui offre, comme c’est l’usage, avec le bouquet.
—Vous connaissez déjà mes deux petites cousines?
—Je les ai vues une fois, avec leur père, à l’Opéra. Mon ami Robert Dalgrand m’a conduit dans leur loge.
—Une fois?... C’est tout?... Vous n’étiez donc pas à la soirée de contrat?
—Non, madame. Je vais dans le monde aussi peu que possible. Aujourd’hui, si ce n’était pas pour le meilleur de mes camarades d’enfance...
—Oh! votre amitié pour M. Dalgrand remonte aux années de collège?
—D’école communale, madame. J’ai suivi l’école avant d’entrer au lycée.
—Et M. Dalgrand a continué d’être votre compagnon d’études?
—Robert Dalgrand n’a jamais suivi les cours du lycée, madame.
—Où donc a-t-il passé ses examens?
—Il n’a jamais passé d’examens, madame.
La stupéfaction et le désappointement se peignirent sur les traits de Mme Pirard. Elle demanda, en baissant la voix, comme s’il se fût agi pour M. Dalgrand d’une circonstance déshonorante:
—Est-ce que mon cousin, M. Méricourt, le sait?
—Le général, madame, connaît toute la vie du fiancé de sa fille.
—Pauvre Lucienne! murmura Mme Pirard. Pourvu que cet homme la rende heureuse!
—Cela dépendra beaucoup de Mlle Lucienne, remarqua Vincent.
—Oh! reprit Mme Pirard en pinçant les lèvres, ma cousine est une jeune personne si supérieure! Elle a tous ses brevets. Le plus grand malheur pour elle serait de tomber sur un mari d’esprit peu cultivé, qui ne la comprendrait pas, qui la ferait végéter dans un milieu vulgaire...
M. de Villenoise, en ce moment, s’amusait. Aussi laissait-il Mme Pirard exhaler son hostilité subite et sa méfiance contre ce Robert Dalgrand qui ne rentrait plus à ses yeux dans aucun compartiment du casier social. Pas de diplômes!... Et on lui donnait le titre d’ingénieur! Mais c’était donc un imposteur, un aventurier, cet homme-là, quelque chevalier d’industrie! Et il osait épouser la fille d’un général! D’où sortait-il? Avait-on seulement pris des renseignements? La grosse dame ne pouvait se retenir de montrer toutes ses craintes même devant l’ami intime de cet inquiétant personnage. Elle les résuma dans un soupir:
—Moi qui le trouvais si bien! Et l’on m’assurait que c’est un garçon très distingué!
—Plus que distingué, madame, dit Vincent d’une voix douce. Il a du génie.
Mme Pirard le regarda et, du coup, suspendit l’averse de ses paroles. Ce jeune homme à la barbe blonde se moquait d’elle, évidemment. Mais pourquoi? N’avait-elle pas parlé en femme sensée, en parente soucieuse du bonheur de sa jeune cousine et plus au fait des choses de ce monde qu’un général manœuvrant dans la vie civile comme un hanneton dans une carafe? Elle fut si visiblement déconcertée que M. de Villenoise eut pitié d’elle. En quelques mots—quitte à n’être pas compris—il lui fit le portrait de Robert Dalgrand.
Non, c’était vrai, son ami n’avait même point passé le baccalauréat, et se trouverait fort en peine pour décliner rosa, la rose. Mais cela ne l’empêchait pas d’être l’un des grands constructeurs de son temps, et d’avoir établi des voies ferrées, élevé des viaducs, jeté des ponts sur des rivières, plus rapidement et à moins de frais qu’on ne l’avait fait avant lui. Ses succès venaient surtout de son habileté merveilleuse à manier les hommes, de la faculté qu’il possédait de faire accomplir à vingt ouvriers, sans excès de travail, la besogne de cinquante. Mais la science ne lui manquait pas. Oh! non point la science superficielle et encyclopédique des écoles dites «spéciales»... Mais les connaissances acquises par l’observation, par les expériences progressives, par les voyages techniques. Tout petit garçon, dans l’atelier où son père, l’ouvrier Dalgrand, réparait des machines pour une Compagnie de chemin de fer; plus tard, quand lui-même, après l’obtention d’un simple certificat d’études, fut devenu l’un des employés inférieurs de cette Compagnie, Robert trouvait des aliments à sa passion pour la mécanique. Ce qu’il admirait surtout, ce qui remplissait ses rêves, c’étaient les colossales œuvres de fer, et aussi l’activité formidable et précise des machines. Dès qu’il avait quelque loisir, il profitait des facilités de circulation que lui donnait son emploi pour aller suivre sur place des travaux qui l’intéressaient. Parfois il risquait des conseils, élaborait des projets, dressait des plans. On finit par le retirer des bureaux, par lui confier une équipe de terrassiers; et, quand il eut achevé en deux semaines un nivellement pour lequel un ingénieur sorti de l’École des Mines demandait un mois avec le double d’hommes, ce fut un étonnement. Mais aussitôt des jalousies l’entravèrent. Des chefs et sous-chefs, plus ou moins brevetés, se scandalisèrent devant la supériorité de cet indépendant sur des professionnels; la hiérarchie menacée entra en lutte avec lui. Robert céda, quitta l’Europe. Aussi bien, une occasion s’offrait; un ingénieur qui partait pour établir une voie ferrée en Asie Mineure l’emmena comme contremaître. Cet homme pensait exploiter le jeune Dalgrand; mais celui-ci ne fut pas dupe. Connaissant les devis de son patron, il en combina d’autres, où les dépenses se trouvaient réduites des deux tiers. Il se faisait fort de gagner plusieurs kilomètres sur la longueur de la ligne, sans avoir à creuser des terrains plus résistants, et de se servir exclusivement d’ouvriers indigènes, qui coûtaient fort peu, sans prolonger d’un seul jour le temps calculé pour des Européens, que l’on eût engagés à grands frais. L’ingénieur craignit qu’il ne portât son projet aux ministres du Sultan avant que le sien, à lui, fût agréé de façon officielle. Il lui proposa une association. Robert y consentit. Malgré toutes les finesses de son collaborateur, il réalisa des bénéfices considérables. Ce fut pour lui le commencement de la fortune. Depuis lors—c’est-à-dire au cours de dix années—le nom de Robert Dalgrand s’était attaché à des travaux dont quelques-uns comptaient parmi les plus hardis de ce dernier quart de siècle. Mais la plupart avaient été exécutés à l’étranger. Aussi la célébrité du jeune homme, d’ailleurs assez spéciale, n’était-elle pas établie à Paris, où l’on n’admet guère, à quelques éclatantes exceptions près, que les gloires du boulevard. Aujourd’hui Robert avait trente-trois ans, il était riche, et il nourrissait une ambition: c’était de se consacrer à quelque œuvre française, de vaincre au profit de sa renommée les préjugés d’une patrie où fleurissaient à son encontre la hiérarchie, le fonctionnarisme et les diplômes.
Vincent de Villenoise achevait à peine d’ébaucher ce récit, quand le landau s’arrêta devant la maison du boulevard Malesherbes où demeurait le général Méricourt. D’autres voitures, du même style banal, mêlées de quelques victorias ou coupés de maître, stationnaient en longue file au bord du trottoir. Près de la porte cochère, des badauds s’attroupaient. Un petit patronnet, sa manne sur la tête, ricana lorsqu’il eut vu passer Mme Pirard:
—Ah! là, là... Mince de tourte!... J’vas recommander le moule au patron.
En bas, le vestibule était transformé en un buisson de plantes vertes, entre lesquelles un passage donnait accès à l’escalier. C’était une grande maison de rapport, dont le général n’occupait que le troisième étage. Aux deux premiers paliers, parmi d’autres plantes vertes, les locataires entr’ouvraient leurs portes pour voir descendre le cortège.
Mme Pirard s’arrêta; la respiration lui manquait. Vincent saisit cet instant pour lui dire:
—Pardon... Mais je ne suis pas au courant de la famille... Je ne voudrais pas commettre d’impair. La générale Méricourt est morte, n’est-ce pas?
La dame inclina la tête, désespérant de dire: «Oui». Et elle n’avait pas encore repris haleine assez pour parler quand, avec elle, Vincent de Villenoise entra dans le grand salon.
Une foule de toilettes claires mêlées à des habits noirs papillotèrent devant les yeux du jeune homme. Il hésitait. Mais tout de suite quelqu’un s’avança, lui prit la main, et la lui serra d’une telle étreinte qu’il en fut remué. C’était Robert Dalgrand.
—Toi, enfin!... mon cher Vincent... Quel bonheur!
—Mon vieux Robert... Tous mes vœux, tu sais... De toute mon âme!...
A dire cela, de Villenoise s’émut lui-même, en découvrant avec quelle vivacité de désir, quelle chaleur d’affection, il souhaitait le bonheur de son ami. L’ennui qu’il éprouvait tout à l’heure de la «corvée» de cette noce s’effaçait dans la commotion profonde de cette poignée de main.
Troublé de se sentir brusquement tout autre, il s’inclinait maintenant devant le général. Celui-ci était en costume civil, n’ayant pas remis son uniforme depuis plus de deux ans qu’il avait pris sa retraite. C’était un homme âgé, marié fort tard, et connu pour le culte qu’il gardait à la mémoire de sa femme, comme pour la passion de tendresse dont il enveloppait ses deux filles. Vincent remarqua sa haute taille, sa grosse moustache blanche, ses petits yeux expressifs et bons, puis, à son cou, la cravate rouge de la Légion d’honneur.
Mais aussitôt Robert l’entraînait à l’écart.
—Je suis heureux, Vincent... Oh! si tu savais comme je suis heureux!
A cette affirmation, une sorte de frisson interne refroidit M. de Villenoise. L’ardeur qu’il avait mise à souhaiter la félicité de son ami venait-elle donc de ce que, tout à l’heure encore, il doutait de cette félicité? D’où procède cette vague mais indéniable souffrance que cause l’affirmation trop éclatante du bonheur des autres? Est-ce la jalousie simple et basse, ou le sentiment que notre existence et notre affection sont alors réduites au minimum d’importance pour eux?
Comme son ami s’éloignait pour souhaiter la bienvenue à d’autres personnes, Vincent le suivit du regard.
Le héros de la fête dépassait plus ou moins par la taille tous les hommes qui se trouvaient là. Le général seul était presque aussi grand que lui. Mais le général, auprès de son futur gendre, semblait un peuplier dans le voisinage d’un chêne. Robert avait des épaules proportionnées à sa haute stature, des membres d’athlète, dont on voyait, sous le drap fin de l’habit noir, jouer les muscles avec une aisance robuste qui n’était pas sans grâce; hors de son col blanc s’érigeait un cou solide, et, surmontant ce cou, une tête brune et douce, aux traits réguliers, aux yeux d’enfant. Il portait la barbe, ainsi que son ami de Villenoise, mais une barbe plus drue, moins élégante, et foncée comme la coque d’une châtaigne mûre. C’était un superbe garçon, chez qui peut-être on eût découvert plus vite que chez l’autre les traces de l’hérédité plébéienne. La simplicité de ses manières, l’intelligence de sa physionomie, le charme persuasif de sa voix, lui donnaient, il est vrai, une toute particulière distinction. Mais il n’avait pas l’affinement que de Villenoise devait à de plus lointaines habitudes de luxe ainsi qu’à tous les sports les plus choisis de l’esprit et du corps.
Cependant, parmi les nombreux invités réunis dans ce salon, les conversations languissaient; les yeux se tournaient vers une porte intérieure; des messieurs regardaient leur montre; la mariée se faisait attendre. Et sa sœur Gilberte, la demoiselle d’honneur de Vincent, l’aidait sans doute à terminer sa toilette, car le jeune homme l’avait en vain demandée à Robert.
Lui seul, de Villenoise, ne sentait pas cet énervement de l’heure qui passe, car, ne connaissant personne parmi tout ce monde, il s’enfonçait en lui-même, se perdait dans ses souvenirs d’enfance, où se mêlait l’image de Dalgrand.
Dans ce recul, cette image lui paraissait presque plus familière. En effet, durant les dernières années, Robert, ayant vécu presque constamment hors de France, s’enveloppait d’un peu d’inconnu pour l’affection dépaysée de son ancien camarade.
Maintenant Vincent le revoyait gamin de six ans, dans la cour de l’école communale, qui lui tendait la moitié de sa tartine de quatre heures.
Oh! cette moitié de tartine... Parfois elle avait apaisé les affres d’une faim véritable chez le chétif garçonnet qu’il était alors lui-même. Car la misère, chez les Bertet, avait été épouvantable, alors que, pour lancer l’apéritif, l’inventeur en arrivait aux expédients désespérés. La réclame, après avoir dévoré le fonds de commerce, les économies, le crédit du négociant, absorbait les meubles, les vêtements, la nourriture du ménage: elle épuisa le sang et la vie de Mme Bertet, qui en mourut. Et nulle clientèle ne venait à l’apéritif. Alors, comme il ne pouvait pas en vendre, son inventeur en donna. Il distribua sa liqueur aux cafetiers, aux débitants de boissons; il en fit charger à bord des navires, qui l’emportèrent dans le monde entier. Les marchands, désormais ayant tout à gagner, forcèrent la vente. Et la hantise du mot finalement opéra... C’était bien sur cela qu’il avait compté, le petit droguiste que ses voisins traitaient de fou. Il jouait une martingale avec la destinée. L’important était—comme pour toute martingale—qu’il pût renouveler ses enjeux jusqu’à ce que la chance eût tourné. Il ne possédait plus un centime, et il cherchait autour de son taudis un clou pour se pendre, quand la première commande lui arriva. Le lendemain il en vint dix, le surlendemain trente... Et ce fut une marée sans reflux: le flot des millions monta, creva sa porte, envahit tout. A peine avait-il agrandi son établissement, qu’il lui fallait agrandir encore, jusqu’à ce qu’il acquît le château et fonda l’usine de Villenoise, cette usine où travaillait, à l’heure même, pour son fils et son héritier unique, une population d’ouvriers.
Plus d’une fois Vincent avait repassé dans son esprit les péripéties de cette étrange fortune, mais jamais avec des évocations de détails plus précises qu’en cette matinée de noce, où il regardait aller et venir, parmi le chatoyant fouillis des robes de soie et de velours, la grande silhouette aux gestes tranquilles de son ancien camarade.
Enfin une porte, au fond, s’ouvrit toute grande; un remous creusa la foule des invités, sur les lèvres desquels courut un murmure de sympathie et d’admiration. Et, tout à coup, M. de Villenoise vit s’avancer, d’une démarche muette et glissante, la plus charmante incarnation de la grâce virginale, de l’innocence et du ravissement.
C’était la mariée, celle qui se nommait encore Mlle Lucienne Méricourt, et qui, dans une heure, s’appellerait Mme Robert Dalgrand.
Sous son voile de tulle, aussi léger qu’une vapeur, on voyait, sur ses joues délicatement roses, l’ombre de ses cils abaissés. Sa bouche, dans un indéfinissable sourire, trahissait la joie qui lui remplissait l’âme. Quelque chose d’adorable et de suave émanait de ce sourire, à cause de la pudeur qui s’efforçait de fermer les fines lèvres et de l’extase qui les entr’ouvrait. Quand on avait vu ce sourire, qui prenait le cœur tout d’abord, les regards, irrésistiblement, se portaient vers la petite touffe d’oranger presque perdue dans les fortes ondes des cheveux châtain clair. Et la signification de cette fleurette, couronnant toute cette vivante et mouvante blancheur, effaçait les autres pensées. Une curiosité aiguë s’emparait des spectateurs... Curiosité qui, par son objet et sa nature, par les images qu’elle évoquait, eût, sous le masque d’élégance, intérieurement ramené tous ces êtres à des instincts d’animalité brutale, si pour chacun ne s’y fussent mêlés des souvenirs, des espérances, des déceptions, et cette fumée de mélancolie qui, dans le cœur, invinciblement s’élève devant tous les mystères humains.
Lucienne, saluant de la tête sans lever les yeux sur personne, marcha droit vers son père. Elle lui prit le bras, à deux mains, d’une façon câline. Et le général, pour donner le signal du départ, eut un geste brusque de commandement militaire, sans doute parce qu’il redoutait quelque assaut de son émotion.
Un jeune homme, debout à la porte, se mit à faire l’appel des noms, deux par deux, suivant l’ordre où les couples devaient descendre et prendre place dans les voitures.
M. Méricourt sortit en tête avec Lucienne. La longue traîne de satin blanc mit un intervalle. Puis l’on vit s’avancer, donnant le bras à une dame, le premier témoin de la mariée,—un chef d’armée célèbre, également en costume civil, mais avec le cordon de grand-croix en sautoir sous son gilet. Robert Dalgrand venait ensuite, accompagné de sa mère,—grande vieille femme, aux traits rustiques, un peu durs, mais empreints d’une singulière dignité.
Cette ancienne paysanne, veuve d’un ouvrier mécanicien, ne montrait ni gaucherie ni étonnement dans ce milieu supérieur où son fils l’avait élevée par son génie et où il allait lui donner pour bru la fille d’un général. C’est que Mme Dalgrand était trop la mère de Robert par la lucidité de l’intelligence et l’énergie de la volonté pour n’avoir pas pressenti devant son enfant quelque merveilleux avenir, et pour ne pas s’être inconsciemment préparée de longue date à tenir partout et toujours sa place à côté de lui.
A la voir passer, toute droite et fière, avec son air de matrone biblique, Vincent recommençait à se souvenir, à rêvasser, l’esprit perdu au fil de sa songerie. Mais tout à coup il entendit son nom et tressaillit; on l’appelait avec sa demoiselle d’honneur.
«M. Vincent de Villenoise... Mlle Gilberte Méricourt.»
Où était-elle? Comment allait-il savoir? Il se retourna, effaré.
Tout près de lui, une jeune fille lui souriait, tendant la main pour lui prendre le bras. Mais, dans sa surprise, il ne songeait pas à l’offrir. Elle lui dit:
—Vous ne me reconnaissez pas?... Venez, dépêchons-nous!
D’elle-même, elle posa la main sur sa manche, l’entraîna presque vers l’escalier. Alors il crut devoir lui exprimer quelque plaisir d’être son cavalier pour la journée entière. La phrase lui vint plus spontanée, plus sincère qu’il ne l’aurait attendue un instant auparavant. Son appréhension d’une corvée disparaissait devant le désir de produire une impression favorable.
Mlle Gilberte répondit:
—Moi aussi, je suis contente de vous avoir pour garçon d’honneur. Tous, nous vous aimons déjà. M. Dalgrand nous a tant parlé de vous!
Ils descendirent. Comme elle lui donnait le bras, leurs deux têtes se trouvaient si proches qu’il n’osait la regarder. Il ne voyait que le bouquet et l’aumônière qu’elle tenait à la main:—un bouquet tout blanc, garni comme une collerette par le point à l’aiguille du mouchoir que M. de Villenoise avait choisi très beau pour nouer autour de ces fleurs, et une aumônière faite de la même étoffe que sa robe et attachée par les mêmes rubans. Ils étaient, ces rubans et cette robe, de deux nuances délicieuses: l’étoffe, du ton jaune pâle, presque blanc, de l’avoine mûre; et les étroites bandes de velours, du vert tendre et argenté de cette avoine avant que le soleil l’ait rendue bonne pour la moisson. Le chapeau de paille portait des nœuds de ce velours et des touffes de primevères de la même couleur que la robe. Tout de suite, dès qu’il avait aperçu la jeune fille debout à son côté, M. de Villenoise avait eu les yeux comme caressés par l’harmonie et la fraîcheur de cette toilette.
Mais ce fut seulement une fois installé en face d’elle, dans le landau, qu’il eut la vision distincte de Mlle Gilberte Méricourt.
Encore... fut-ce bien la vision distincte?... Voit-on jamais d’une façon précise les êtres ou les objets dont le premier abord provoque l’éveil d’un sentiment? Ce qui attire ou ce qui éloigne fortement le cœur a-t-il jamais pour le regard cette netteté de couleurs et de contours qui supporte la description?
Ce que Gilberte avait de plus séduisant, c’était le coloris plein de délicatesse et d’éclat de son teint, de ses yeux, de ses cheveux, de ses lèvres, de ses dents. Le brun profond, le rose vif, le blanc nacré, contrastaient et s’avivaient sur sa physionomie, dans une splendeur indicible de jeunesse. La pourpre de sa bouche un peu grande fleurissait sur des dents éblouissantes; ses sourcils foncés soulignaient son front blanc; les narines de son petit nez irrégulier mais joli prenaient, comme l’ourlet de ses fines oreilles, des transparences rosées de coquillage; et la masse de sa chevelure d’un brun franc se relevait sur sa nuque pâle et soyeuse, où s’estompaient quelques courtes mèches frisottantes. Ses prunelles mêmes n’offraient pas une de ces nuances indécises, changeantes ou troublées, qu’ont si souvent les yeux humains; elles étaient d’une couleur sombre et pure, comme les yeux des gazelles.
Durant le court trajet du boulevard Malesherbes à la mairie de la rue d’Anjou, Mlle Gilberte ne parla pas à Vincent. Quand on fut descendu de voiture et que le cortège, au bas de l’escalier, se forma pour monter à la salle des mariages, le jeune homme sentit comme un souffle de plaisir lui caresser le cœur au moment où, de nouveau, elle glissa un bras sous le sien.
Ce qu’il éprouvait l’étonna. Mais il trouva la sensation douce et, pour ne pas la faire évanouir, se refusa tout de suite à l’analyser. Et aussitôt, dans ses manières avec Gilberte, se montra cette grâce émue, qui, même silencieuse, devient pour une femme le plus vif et le plus éloquent hommage.
Pendant la cérémonie du mariage civil, comme le maire lisait les articles du code, Vincent, dont le regard porté droit devant lui, en apparence, épiait de côté sa demoiselle d’honneur, crut voir pâlir ce visage au teint si fin. Il se tourna vers elle avec une expression de sollicitude. La jeune fille ne remarqua même pas son mouvement. Mais Lucienne et son fiancé se levèrent pour prononcer le «oui» qui devait les unir. Alors le sang reparut au visage de Gilberte, et, en même temps, deux gouttes brillantes vinrent lui mouiller les cils.
Vincent ne put s’empêcher de s’avancer en s’inclinant vers elle, pour rencontrer son regard et se faire, par les yeux au moins, le confident de ce chagrin naïf. Et il fut charmé de la voir lui sourire, en secouant la tête d’un geste imperceptible, le doigt levé jusqu’à ses lèvres comme pour lui recommander le silence. C’était entre eux un petit secret d’émotion, et c’était aussi une promesse de délicate et confiante causerie, car il lui demanderait, et elle lui dirait sans doute, de quelle intime source avaient jailli ces deux larmes.
Déjà le cortège se reformait pour se rendre à l’église de la Madeleine. Assis de nouveau l’un en face de l’autre dans le landau, Gilberte et Vincent ne se parlaient guère plus que dans le premier trajet; mais à plusieurs reprises leurs yeux se cherchèrent; et il lui sembla remarquer qu’elle se reposait, par la confidence plaintive que lui envoyait son regard, de la gaieté dont elle faisait montre avec tout le monde, et surtout lorsqu’elle se trouvait à proximité de son père ou de sa sœur.
Décidément, M. de Villenoise ne jugeait plus ennuyeux son rôle de garçon d’honneur. Un intérêt très vif captivait son imagination. La jolie fille dont il devait s’occuper matériellement à toute minute n’absorbait pas moins désormais sa pensée intime que son attention superficielle. Et ce n’était pas seulement par le petit mystère d’une tristesse qu’elle dissimulait à tous hors à lui-même, c’était par le simple mouvement de sa personne gracieuse, par des tours de tête, par des finesses d’expression, par des sourires divers suivant les interlocuteurs, par des agenouillements à l’église, avec un joli geste des épaules et l’inclinaison de sa nuque si blanche sous ses vivants et lourds cheveux bruns.
«Est-ce qu’elle est pieuse?» se demandait Vincent, debout près de la jeune fille prosternée. «Que dit-elle à Dieu dans ce moment? Que se passe-t-il dans cette petite tête? Comment envisage-t-elle le mariage de sa sœur? Elle rêve du sien peut-être?... Qu’en attend-elle?»
Dans toute autre circonstance, cette sorte de curiosité eût éloigné mentalement le jeune homme de Mlle Méricourt. Sous l’artificielle candeur des jeunes filles, Vincent devinait avec une sorte d’effroi l’extravagance de leurs rêves, dont c’est le triste rôle du mari de les désillusionner; et il se sentait parfaitement résolu à ne jamais jouer ce rôle. Pour rien au monde il n’eût voulu associer à son existence un de ces pauvres êtres, qui en sont réduits à la ruse pour deviner la vie, où, brusquement ensuite, on les jette, sans transition entre la brutalité de cette vie et le vague univers providentiel et maniéré, dans lequel on les tenait en cage. Il les plaignait et les dédaignait, comme des créatures factices, dont la femme, plus tard, se dégagera sous l’influence de la passion et de la vie, mais qui, dans leur uniforme insignifiance, ne peuvent donner à prévoir ce que sera cette femme un jour.
Et voilà, parce que Gilberte Méricourt avait un certain visage, un certain regard, et, sur sa peau fraîche, certaines nuances exquises, que Vincent commençait à lui prêter une valeur intime, déniée de parti pris à toutes ses pareilles.
Peut-être aussi subissait-il la suggestion de la cérémonie religieuse, dont la beauté, la solennité, donnaient tant d’importance au mariage qui s’accomplissait là, et tant de prix, par suite, à la virginité, qui se symbolisait toute blanche, devant les somptuosités de l’autel, éblouissant d’orfèvreries, de lumières et de fleurs.
Lorsque Robert Dalgrand glissa l’alliance au doigt de Lucienne, dont la petite main dégantée mit une rose lueur de chair sous le nuage mystique du voile, M. de Villenoise éprouva comme une vague nostalgie, comme un mécontentement de sa propre existence, et un désir indistinct de quelque chose qui lui aurait manqué.
Un instant après, le suisse étant venu s’incliner devant lui, en murmurant deux ou trois mots, il vit Gilberte se lever. Elle lui tendit son bouquet, et il comprit qu’il s’agissait de faire la quête. Alors il prit une main de la jeune fille, qui, de l’autre, présentait son aumônière. Elle allait de rang en rang, se penchait en allongeant le bras d’un geste souple, et se redressait avec un sourire de remerciement, tandis que les pièces de métal tintaient en tombant les unes sur les autres. Et cela recommençait toujours, car la vaste église était remplie de monde; quand ils eurent fini d’un côté il leur fallut changer de main et remonter dans l’autre sens.
Or c’était justement les minutes que Vincent considérait d’avance avec le plus d’appréhension dans cette journée de noce, celles de cette quête, où le garçon d’honneur ne peut tenir que la plus gauche des attitudes, tandis que la demoiselle exhibe sa toilette et se soucie de recueillir plus d’œillades admiratives pour elle-même que de pièces blanches pour la paroisse.
Maintenant, s’il leur reprochait quelque chose, à ces minutes charmantes, c’était de fuir trop vite. Il marchait dans un rêve très doux, pas à pas sur ce tapis rouge d’église, avec la main de cette jolie fille appuyée sur sa main. Quand Gilberte s’inclinait pour tendre l’aumônière aux personnes les plus éloignées, Vincent serrait un peu les doigts pour la retenir et sentait au bras le poids de son jeune corps; puis il pliait le coude et la redressait en l’attirant vers lui. Et il éprouvait la sensation d’être très loin, seul avec elle, et de lui prêter, d’une façon efficace, nécessaire, la protection de sa force. Lorsque la quête fut finie, tous deux revenus à leur place, et que Mlle Méricourt s’isola pour s’agenouiller sur le prie-Dieu, Vincent eut comme un tressaillement de réveil, comme un serrement de cœur désappointé.
Pourtant, au cours de cette journée qu’il avait prévue si longue et qui passa comme un éclair,—au lunch, et durant la réception de l’après-midi chez le général, et au dîner de l’Hôtel Continental où elle fut sa voisine, et dans le bal où la valse les enlaça,—il ne lui fit pas la cour. Aussi fut-il étonné de surprendre par instants, dans les yeux bruns de Gilberte, comme un rayonnement attendri qui répondait à quelque chose au fond de son âme à lui, quelque chose qu’il ne s’expliquait pas et qu’il ne croyait pas avoir trahi le moins du monde. Toutefois, c’était bien une réponse et non point une offensive de coquetterie, ce joli regard un peu moqueur, un peu troublé, mais d’une si spontanée confiance, dont parfois elle accueillit celles de ses phrases qu’il aurait jugées les plus banales. M. de Villenoise commença donc—mais bien tard—à se surveiller avec rigueur; car, s’étant interdit, pour des raisons qu’il s’imaginait indestructibles, de songer au mariage, il s’interdisait également de laisser deviner à cette jeune fille l’immense sympathie qu’elle lui inspirait.
Ils parlèrent ensemble fort peu d’ailleurs, la parole ne servant à rien lorsque entrent en jeu les mystérieuses affinités d’où va naître l’amour. Cette façon de se consulter sur ses goûts réciproques, de découvrir que l’on aime l’un et l’autre la musique ou les voyages, que l’on éprouve un égal ennui dans les réunions mondaines et qu’on leur préfère la solitude des bois et autres beautés de la nature; tous ces préliminaires d’une attraction simultanée ne sont que des symptômes, sous couleur d’être des moyens. On ne se plaît pas parce que l’on s’est exprimé des penchants identiques; mais on s’exprime des penchants identiques, et même on croit les posséder, parce que l’on se plaît ou que l’on veut se plaire.
M. de Villenoise apprit donc, sans que son cœur, déjà secrètement touché, en battît plus ou moins vite, que Gilberte ne prenait aucun plaisir aux quadrilles, mais trouvait la valse une chose très amusante; qu’elle avait encore des professeurs de littérature anglaise, de piano et d’italien; qu’elle adorait l’Opéra-Comique, mais qu’elle préférait l’équitation.
Il était beaucoup plus curieux de savoir pourquoi elle avait pleuré à la mairie et pourquoi son visage, à plusieurs reprises, s’était voilé d’une tristesse contre laquelle elle semblait se défendre.
Comme elle ne pouvait guère lui parler confidentiellement que pendant qu’ils dansaient, ce fut en valsant qu’elle le lui expliqua.
—Ma sœur Lucienne et moi, dit-elle, nous ne nous quittions jamais. Nos leçons, nos promenades, nos emplettes, nous les faisions ensemble. Qu’est-ce que je vais devenir sans ma petite Luce? Voyez-vous, monsieur, quand j’y pense, la vie me semble tellement triste que je voudrais mourir.
Il sourit à ce mot, que prononcent si vite les désespoirs de la vingtième année.
Elle reprit:
—Vous ne me croyez pas? C’est parce que vous n’avez pas de sœur. Mais l’idée de retrouver sa chambre vide!... (La voix de Gilberte s’étrangla.) Ah! si ce n’était pas pour mon père... je voudrais vraiment mourir ce soir.
—Mais vous vous marierez à votre tour.
Elle rougit, haussa légèrement les épaules.
—Bah! qui sait?
—Comment, qui sait? dit-il en riant. Auriez-vous prononcé des vœux devant l’autel de sainte Catherine?
—Oh! non.
—Alors?
Elle se tut d’un petit air mystérieux. M. de Villenoise insista.
—Vous voulez savoir?... dit-elle avec un regard sincère de ses beaux yeux bruns. Eh bien, moi, je ne consentirai à me marier que comme Lucienne, seulement avec quelqu’un qui me plaira tout à fait.
—Et... vous ne prévoyez donc pas qu’on puisse vous plaire... tout à fait?
Elle répondit—peut-être un peu trop vivement:
—Oh! si...
Puis elle resta interdite une seconde, rougit plus fort, et ajouta:
—Mais je connais bien la vie, allez. Celui qui me plaira, je ne lui plairai pas. C’est toujours ainsi.
—Toujours?... Non. Voyez votre sœur et mon ami Robert.
—Oh! Lucienne est plus jolie et meilleure que moi. D’ailleurs, il y a des exceptions. Et cette chance-là ne se rencontrera pas deux fois dans une même famille.
—Vous êtes donc modeste, mademoiselle Gilberte? Voilà une qualité presque invraisemblable chez une jeune fille.
—Ces pauvres jeunes filles! Vous avez l’air de leur en vouloir. Qu’est-ce qu’elles vous ont fait?
—Elles me font peur.
Gilberte eut un rire d’enfant.
—Quelle plaisanterie! Ainsi, moi, est-ce que je vous fais peur?
—Plus que vous ne croyez.
Gilberte baissa les yeux et un silence suivit. Comme ils étaient l’un devant l’autre dans un angle du salon et que la musique faisait encore tourner les autres couples, elle leva les mains et lui dit:
—Valsons.
Il l’entraîna d’un élan presque rageur, fâché contre lui-même et aussi contre elle, sans savoir au juste pourquoi.
Mais tout à coup, après avoir ramené la jeune fille à sa place, M. de Villenoise s’aperçut que les mariés étaient partis. Alors il eut la vision du coupé qui emportait Robert et Lucienne. Il se les imagina, dans l’ombre de cette voiture close, savourant les premières minutes de solitude. Il se représenta la lenteur et l’hésitation des premières tendresses... Et cette virginale robe blanche enserrée par ce robuste bras vêtu de drap noir... D’un grand effort, il tâcha de réveiller son scepticisme à l’égard du mariage, son culte pour l’indépendance et sa haine de tout lien, en même temps que sa méfiance des virginités de corps obtenues par l’atrophie ou la déviation des âmes. Il ne put pas. Tout cela faisait place à un malaise de désir indistinct, à un sourd désenchantement de ce qui, jusque-là, suffisait à occuper sa fantaisie, sinon à lui remplir le cœur.
Cependant, le général, désireux de se retirer, cherchait sa fille cadette. Il s’arrêta devant le garçon d’honneur de Gilberte, qui se leva aussitôt.
—Je n’ai pas eu le loisir de causer avec vous, monsieur, dit le vieillard. Je le regrette. Mon gendre nous a dit de vous tant de bien! Mais nous nous retrouverons. Vous êtes des nôtres désormais.
—Mon général, c’est beaucoup d’honneur...
—Vous êtes un lettré, un travailleur, reprit M. Méricourt. Mon cousin, le membre de l’Institut,—vous l’avez vu? le second témoin de ma fille Lucienne,—estime beaucoup vos œuvres. J’admire cela infiniment chez un jeune homme dans votre grande situation de fortune. Tant d’autres ne songeraient qu’à s’amuser...
—Mais cela m’amuse, mon général.
M. Méricourt chercha une autre phrase d’éloge. Toutefois, sur ce terrain, il était mal à l’aise, ne sachant pas au juste la nature des travaux aux-quels se livrait Vincent, et se rappelant avoir passé, dans la Revue des Deux Mondes, des articles signés de lui sur «l’Alexandrinisme dans la littérature romaine». Le titre l’avait effrayé; il ne les avait pas lus.
Brusquement donc, il aborda un autre sujet.
—Vous montiez, ces jours-ci, un beau cheval, monsieur. Il a des lignes superbes, beaucoup de branche, des jambes de cerf; et il se rassemble, m’a-t-il paru, à galoper sur le bord d’un chapeau.
—Ah! ma jument alezane... Gipsy. Oui, une bonne bête. Où donc l’avez-vous vue, mon général?
—Au Bois. Je vous ai aperçu à plusieurs reprises. Mais... de loin. Car vous ne fréquentez pas l’avenue des Poteaux, ni celle des Acacias.
—Non, j’avoue que la foule...
—Ne vous attire pas. Moi non plus. Du moins la foule des bipèdes. Mais celle des quadrupèdes m’intéresse. Je connais tous les beaux chevaux de Paris. J’aime à les rencontrer là. Puis ma fillette est contente de se voir saluer par tous les officiers.
—Alors Mme Dalgrand va se trouver privée. Car mon ami Robert...
—Oh! interrompit le général—tombant au piège de Vincent, qui voulait le faire parler de Gilberte,—ce n’est pas de ma fille aînée qu’il s’agit. Lucienne est une écuyère médiocre; elle manque du feu sacré. Mais c’est la petite!... On dirait qu’elle est née à cheval, cette gamine-là. Vous la verrez... Elle est étonnante.
—Est-ce que Mlle Gilberte aimerait chasser à courre? Nous avons ce qu’il faut, dans mes modestes bois de Villenoise.
—Merci, monsieur. Je vous suis bien reconnaissant. Mais ce sont là des goûts de haut luxe que je ne voudrais pas lui donner.
M. Méricourt expliqua même qu’il désirait plutôt modérer cette passion chez Gilberte. Car pourrait-elle monter plus tard, quand elle serait mariée? C’était douteux. Avec les jeunes filles et les difficultés de leur établissement, on ne peut jamais savoir. Sans sa position spéciale dans l’armée,—car il restait un maître et un arbitre en matière d’équitation, et pouvait encore, par exceptionnelle faveur, choisir ses montures dans les écuries de l’École Militaire,—sa fortune personnelle ne lui permettrait guère, à lui comme à sa fille, que les rosses de manège. Le général dit tout cela fort simplement, sauf l’allusion un peu emphatique à sa renommée d’écuyer hors ligne, rival des comte d’Aure et des Baucher.
—Ah! jeune homme, je ne connais pas vos moyens, mais je ferais le pari de rester encore, à mon âge, plus longtemps que vous en selle aux allures vives, et de vous faire demander grâce. Aux dernières manœuvres que j’ai dirigées,—il y a de cela quatre ans au plus,—je semais derrière moi mes aides de camp...
Lorsque le général abordait un sujet, il ne l’abandonnait pas de sitôt. De sorte qu’au lieu d’emmener Gilberte, il laissa s’organiser un cotillon: quelques figures improvisées seulement, car on manquait d’accessoires. Les jeunes gens prirent des fleurs dans les corbeilles pour les échanger avec les jeunes filles. Vincent reçut un brin de réséda et la mission de danser avec la demoiselle qui portait un brin semblable. Il la trouva tout de suite. C’était Gilberte.
—Mais, dit-elle, avant de valser, nous devons échanger nos fleurs.
Elle accepta celle du jeune homme, et, à son tour, lui fixa la sienne au revers de l’habit. Puis ils valsèrent sans mot dire. Ensuite, comme c’était la dernière danse et qu’une débandade s’opérait parmi les invités, ils se dirent au revoir.
Un instant après, comme un groupe de gens empêchait M. de Villenoise d’approcher du vestiaire, il aperçut encore Mlle Méricourt à qui l’on passait sa sortie de bal. Avant de la fermer, elle ôta les fleurs du cotillon, épinglées sur son corsage, et qui, s’écrasant sous le manteau, auraient taché sa robe délicate. Elle les enlevait vivement, les laissait tomber à terre sans regarder autour d’elle, ne se sachant pas observée par lui, qui s’effaçait derrière d’autres personnes. Machinalement, il attendait qu’elle touchât le brin de réséda. Elle le prit et parut le jeter comme les autres. Mais, lorsqu’une seconde après elle éleva la main vers son cou pour remonter son col garni de plumes frisées, Vincent aperçut distinctement la fleurette qu’elle dissimulait dans sa paume.
Un désir ardent le prit de s’assurer qu’elle la gardait pour de bon, qu’elle l’emportait en souvenir.
Il rejoignit la jeune fille et le général, s’inquiéta s’ils avaient une voiture. Il avait commandé son coupé, et il le mettait à leur disposition. M. Méricourt refusa, disant qu’il avait fait attendre un des landaus de la noce. Déjà le chasseur de l’hôtel partait pour faire entrer la voiture sous la voûte.
Tandis que tous trois se tenaient sur le trottoir du péristyle, Vincent remarqua que Gilberte gardait obstinément sa main droite cachée sous sa sortie de bal, où elle l’avait glissée d’un geste vif en le voyant s’approcher.
Un fracas ébranla les murs; les pas des chevaux sonnèrent sur les dalles, et, dans la cour, le landau tourna, s’arrêta devant eux. Alors le jeune homme se découvrit pour accepter la main que lui offrait le général. Comme il restait le bras à demi étendu, Gilberte comprit qu’il attendait de sa part une semblable faveur. Gauchement, pour lui présenter sa main libre, elle appuya du coude contre sa poitrine un éventail qu’elle tenait. L’éventail glissa. Gilberte eut un mouvement involontaire; et, sous la sortie de bal, une seconde écartée, M. de Villenoise vit distinctement qu’elle n’avait pas lâché sa fleur.
Ce fut sans doute à cause de cela que, dans son coupé, en revenant chez lui, il ôta le brin de réséda piqué dans sa boutonnière, s’y caressa la moustache avec un geste lent et rêveur de la tête, puis, l’étalant de façon à le froisser aussi peu que possible, il le glissa dans son porte-cartes.