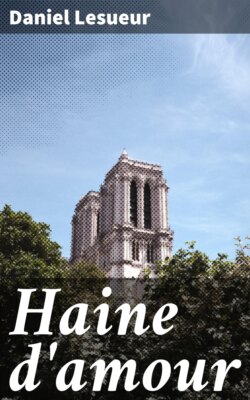Читать книгу Haine d'amour - Daniel Lesueur - Страница 5
II
ОглавлениеLa rue Jean Goujon s’étendait, déserte et sèche, entre les façades de ses maisons bleuies de nuit claire et écrasées de silence, lorsque le coupé de M. de Villenoise y réveilla des sonorités inattendues.
Il était une heure du matin. Tout dormait ou semblait dormir, dans ce quartier riche, où l’épaisseur des murs doublés de tentures somptueuses défend et appesantit le repos des habitants. Aussi la voix du cocher sonna-t-elle avec une étrangeté presque lugubre quand il cria, tout à travers cet engourdissement de sommeil:
—La porte, s’il vous plaît!
Après le déchirement de ce cri, tout sembla plus muet et plus mort. Mais, presque aussitôt, deux battants s’écartèrent, ouvrant dans la nuit une baie de clarté. La voiture s’y engouffra. Vincent mit pied à terre dans un grand vestibule, où une seule lampe électrique, enfermée dans un calice de verre jaune, éclairait le pied d’un escalier et quelques palmes d’un camœrops gigantesque, en laissant au delà tout un enfoncement d’obscurité.
—Monsieur, dit un valet qui tendait un plateau sur lequel apparaissait, parmi plusieurs lettres, le rectangle bleu d’un télégramme, cette dépêche est arrivée voilà deux heures à peine. Autrement, je l’aurais portée à Monsieur, soit chez M. Méricourt, soit à l’Hôtel Continental.
Vincent prit les papiers sans répondre, jeta un coup d’œil sur les écritures des enveloppes; puis, sans se presser, il ouvrit la dépêche. Comme il n’attendait rien de pénible ou d’heureux, ce télégramme, qui cependant ne venait pas de Paris,—car ce n’était pas la carte fermée des communications pneumatiques,—ne lui causait nul sursaut d’émotion ou de curiosité.
Il le lut d’un regard froid et continua de le regarder ensuite, sans qu’à cette contemplation aucun éclair s’allumât dans ses prunelles. Pourtant, il ne composait sa physionomie pour personne, pas même pour Prosper, son valet de chambre, qui, aussitôt les lettres remises, était monté dans le cabinet de toilette, afin de toucher le commutateur des lumières électriques et de préparer l’eau chaude.
La dépêche était datée de Cannes et contenait ces mots:
Portrait terminé. Serai à Paris dans trois ou quatre jours. Ne puis plus attendre joie de vous revoir.
Sabine.
Ces deux lignes, que composaient les caractères détachés et sans expression du télégraphe, retenaient, comme par une fascination morne, les regards et les pensées de Vincent. Le jeune homme restait d’une immobilité de statue, sans un tressaillement de plaisir ou d’impatience, sans un sourire, ou une nervosité, ou un dédain. A la fin, une grande pitié triste monta dans ses yeux. Il murmura:
—Pauvre femme!
Puis il monta l’escalier, lentement, avec une hésitation de tout le corps où se trahissait bien l’indécision, l’anémie de la volonté, qui était comme la diathèse de son âme.
Pourtant, il ne songeait point à s’imposer une ligne de conduite nouvelle. Nul effort nécessaire ne sollicitait son énergie. Sa vie était organisée suivant les exigences de certains devoirs aux-quels Vincent ne rêvait point, même un instant, de se soustraire. Mais la seule résolution d’examiner si, tout au fond de lui-même, un sentiment ne venait pas de s’éveiller qui lui rendrait peut-être pénible désormais l’accomplissement de tels devoirs, lui semblait difficile à prendre. S’interroger virilement lui apparaissait comme essentiel et cependant lui coûtait trop. Que deviendrait-il s’il découvrait qu’il aimait, ou tout au moins qu’il était capable d’aimer?... Alors qu’il avait cru si bien engourdir son cœur pour le livrer jusqu’à la mort, sans flamme ardente mais toutefois sans regret, et comme l’acquit d’une dette d’honneur, à cette Sabine, dont il avait involontairement brisé la vie.
Certes, il le lui devait, ce cœur. Et ce n’était pas trop, croyait-il, payer la fantaisie passionnée que Sabine expiait de son côté par la perte d’une fortune, d’un beau nom, et par l’ironique mépris dont l’avait accablée le monde.
Elle qui, durant huit années, fut la comtesse de Rovencourt, était, depuis son divorce, redevenue tout simplement Sabine Marsan. Au lieu de son ancien hôtel au parc Monceau, elle habitait un rez-de-chaussée rue de la Pompe. Et tous les millions de M. de Villenoise, dont sa fierté n’acceptait pas un centime, étaient impuissants à l’empêcher de travailler pour vivre, de peindre des fleurs et des portraits à l’aquarelle afin d’entretenir le modeste luxe qui, pour cette créature dédaigneuse et fine, représentait le strict nécessaire.
Il est vrai—et Vincent se l’était dit déjà, dans l’état de froide clairvoyance où met la moindre parole maladroite d’une femme dont on n’est plus épris,—il est vrai que cet étalage de labeur et de rigoureuse dignité pouvait être un calcul pour contraindre Vincent à la seule démarche qui lui eût permis de partager sa fortune avec Sabine, c’est-à-dire au mariage. Mais certaines circonstances, fort atténuantes pour lui, l’empêchaient de se croire tenu à une si complète réparation. Et il restait réfractaire à toute suggestion tendant à le mener vers un tel acte d’héroïsme, que sa très rigide et délicate conscience elle-même jugeait exagéré.
En effet, il avait eu jadis des raisons sérieuses de croire qu’il n’était pas le premier homme pour qui la comtesse de Rovencourt eût trompé son mari. Certains propos qui la lui firent croire presque facile, et les coquetteries qu’elle se permit à son égard, plus encore peut-être que la force d’un entraînement irrésistible, l’avaient décidé à lui faire la cour. Et si le prestige du titre, si le reflet de noblesse émané d’un très spécial milieu avait, pour l’héritier de l’Apéritif, ajouté une forte séduction à la grâce très captivante de Sabine, toutefois, même alors, il s’était rendu compte du rien de cabotinage et de bohème dont cette femme sans race, épousée pour sa beauté par le comte de Rovencourt, imprégnait l’atmosphère d’une aristocratique résidence.
Épouser Sabine... Chaque fois qu’un réveil de passion ou qu’une crise de pitié tendre pour les souffrances d’orgueil devinées chez sa maîtresse amenait M. de Villenoise à envisager cette résolution, un souvenir, tout à coup, le faisait bondir en arrière. C’était l’image d’une scène abominable: l’évocation du petit appartement que, six années auparavant, il avait mis tant d’amoureuse coquetterie à parer pour y recevoir la comtesse de Rovencourt, et dans lequel, un inoubliable soir, il avait eu la rage et l’humiliation de la voir s’écraser, dans la brutalisation de toutes ses pudeurs de femme, sous le mépris de son mari et la curiosité froidement outrageante des hommes de police. Ah! la dégradation dans son propre cœur de cette malheureuse—dont pourtant il causait la honte—et le sentiment de son impuissance à lui!... Jamais cela ne s’effacerait. Ce n’était pas l’obstacle légal du flagrant délit qui empêchait M. de Villenoise de donner son nom à Sabine. Car le comte de Rovencourt, satisfait par le honteux châtiment de la constatation, n’avait pas été jusqu’à réclamer la flétrissure d’un jugement correctionnel. Il avait retiré sa plainte, et réclamé le divorce pour simple incompatibilité d’humeur, sans alléguer l’adultère. Par pitié ou par dédain, il laissait à sa femme coupable la possibilité d’épouser celui pour qui elle l’avait trompé. Mais le scandale n’en avait pas moins amusé tout Paris. Et l’écœurant souvenir n’en restait pas moins fixé dans le cœur de Vincent.
Cette nuit, dans sa chambre, dans son grand lit drapé où vivement il s’était réfugié pour mieux réfléchir, cette lassitude d’une liaison rendue indissoluble par les circonstances lui courbatura l’âme tout à coup, l’écrasa sous une pesanteur de fatalité. Ainsi donc Sabine allait revenir... Dans trois jours, quatre au plus, Vincent recevrait un autre télégramme—daté de Paris celui-là—ou bien quelque billet apporté au galop par un commissionnaire. Alors il mettrait son chapeau, il retournerait rue de la Pompe, il reprendrait les habitudes interrompues pendant deux mois... Une minutieuse vision lui montrait tous les détails de cette visite, semblable à tant d’autres qui suivraient... Il se voyait quittant à pied son hôtel pour parcourir d’un pas hygiénique le joli trajet de la rue Jean Goujon jusqu’à la mairie de Passy, toute voisine de la maison où habitait Mme Marsan. Ce trajet, il en connaissait les moindres accidents; sa mémoire faisait défiler devant lui des physionomies familières de maisons, et des coins de verdures pimpantes, des ovales éclatants de corbeilles fleuries, dans les petits jardinets de l’avenue Henri Martin. Même en pensée, il s’attardait, flânait dans ce décor parisien, observait les nuances changeantes de l’heure ou de la saison, sans hâte bien vive d’arriver au but. Pourtant, au coin de la rue de la Pompe, sa démarche se précipitait, il parcourait allègrement les derniers mètres. C’est que, soudain, il songeait à la bonne minute de l’accueil, à l’exclamation de joie dont Sabine le saluerait, et à cette charmante silhouette de femme, immobilisée d’émotion, debout dans ce cadre d’art et de fantaisie qu’était l’atelier où elle passait presque toute son existence.
Hélas! le court frisson d’attendrissement dont le secouait par avance la spontanéité de l’étreinte, l’oubli de toutes les misères communes dans la chaude joie du revoir, s’atténuait, s’évanouissait bien vite sous l’anxiété de ce qui allait suivre. Il prévoyait trop le recommencement de la sourde lutte où, depuis le divorce de Sabine, tous deux, avec un acharnement absurde, piétinaient, écrasaient leur pauvre amour. Car, si la maîtresse ne se consolait pas de sa déchéance, l’amant ne lui pardonnait pas les droits que, de par cette déchéance, elle croyait avoir sur lui. Et chacun faisait d’autant plus souffrir l’autre, qu’ils avaient à leur disposition les armes par lesquelles ils pouvaient réciproquement se blesser au plus profond du cœur. En effet, la froide inertie de Vincent exaspérait l’âme impatiente et passionnée de Sabine autant que l’âpre impétuosité de cette âme glaçait et irritait M. de Villenoise.
C’était après des scènes pénibles, après des bouderies sans fin à peine tempérées par de mornes politesses, que Sabine Marsan s’était décidée à partir pour le Midi. La commande d’un portrait d’enfant pour une famille qui passait l’hiver à Cannes lui fournissait le prétexte et la possibilité de ce voyage. Elle s’y décida comme à une mesure de haute politique: car elle se figurait punir Vincent par son absence, le forcer à s’apercevoir qu’elle lui était indispensable et à trembler de la perdre un jour tout à fait. Ainsi peut-être lui ferait-elle accomplir un pas vers le mariage, auquel il se refusait, et qui pour elle, soit amour, soit ambition, soit désir de revanche contre la destinée, était devenu l’idée fixe, le but suprême,—un but vers lequel elle se lançait d’une volonté aveugle, violemment et maladroitement.
Mais Sabine était trop soumise aux impulsions de ses réflexes nerveux et à la fougue de son caractère pour mettre en œuvre la diplomatie qui, généralement, se trouve à la portée des femmes. Son départ, qui lui coûta d’ailleurs beaucoup,—car elle souffrait loin de Vincent d’une façon différente mais bien plus amère qu’auprès de lui,—son départ devait produire un effet contraire à celui qu’elle en attendait. Elle l’effectuait trop tard, après avoir laissé trop se tendre leurs quotidiennes relations, si bien que son éloignement, au lieu de se faire sentir comme une intolérable privation, agit comme une délivrance. Les deux mois qui venaient de s’écouler avaient été pour M. de Villenoise une période d’apaisement, durant laquelle il s’était absorbé tout à loisir dans ses chères études, le cœur mort ou du moins engourdi, l’imagination calme, l’esprit triomphant et lucide. Sa correspondance avec Sabine s’était poursuivie régulièrement sans troubler ce délicieux état d’âme,—délicieux au moins pour lui, pour son dandysme intellectuel et sentimental, pour sa curiosité d’érudit, pour son scepticisme à l’égard des grandes passions, qu’il considérait volontiers comme des crises physiologiques propres aux tempéraments mal équilibrés. Les lettres de Mme Marsan et ses propres réponses ne révélaient nulle hostilité amoureuse, pas même une sorte de paix armée entre ces singuliers amants. On y eût découvert plutôt cette confiance que l’extinction des sentiments passionnés laisse éclore entre deux époux vers les dernières années d’une union sans reproche. C’était le bavardage à peine tendre mais très intime de deux êtres enchaînés par l’indestructible réseau de longues habitudes communes, et qui ont acquis le besoin de se parler de tout, même des moindres puérilités extérieures. Si M. de Villenoise eût joui moins profondément de l’accalmie que cette séparation mettait dans son orageuse liaison avec la violente Sabine, il se fût inquiété peut-être de reconnaître, aux mille indices de cette minutieuse correspondance, avec quelle force le liait une chaîne que pour le moment il ne sentait plus. Mais il était si reconnaissant de ne pas recevoir à chaque courrier des pages de protestations, de reproches ou de plaintes, qu’il s’abandonnait au plaisir d’écrire tout naturellement, sans apprêt comme sans réticences, des lettres dont il n’était pas tenu de faire des lettres d’amour.
Peut-être commençait-il à croire que, de son côté, Sabine enfin se convertissait à cette camaraderie charmante, et que la tyrannique affection de ce cœur féminin s’apaisait en une amitié plus compréhensive, plus capable de désintéressement, lorsqu’il reçut—au retour de l’inoubliable journée de noce—le télégramme de Mme Marsan. La soudaine impatience qu’elle y témoignait de le revoir—cette impatience dont elle ne parlait même pas dans sa lettre de la veille et qu’elle manifestait ainsi tout à coup—lui prouva qu’il allait la retrouver toute pareille à elle-même. Car, à ce petit fait, il reconnaissait trop Sabine. Comme c’était bien d’elle cette brusque frénésie d’un sentiment qui paraissait dormir et qui, d’une minute à l’autre, la dominait, devenait irrésistible! Vincent pressentait, même à une telle distance, la fièvre dont était brûlée la pauvre femme,—cette fièvre qui s’emparait d’elle chaque fois qu’elle avait pris la résolution de parler ou d’agir, et qui la rendait incapable de toute temporisation, de toute mesure. Une fatalité de sa nature impulsive empêchait Sabine de traverser sans se dévorer intérieurement l’intervalle de temps, si court fût-il, que demandait sa pensée pour se transformer en acte. Sans doute elle avait pu supporter avec la fermeté tranquille affichée dans sa correspondance l’exil de deux mois; mais, du moment qu’elle avait décidé son retour, elle ne patienterait pas sans torture durant les deux journées qui l’en séparaient encore.
Était-ce donc parce qu’il pensait aux ardeurs douloureuses de ce cœur tourmenté, ou dans un sentiment de compassion pour cette existence à jamais assombrie, ou par la prévision d’un plus cruel avenir, qu’il murmura en lisant la dépêche datée de Cannes, et plus d’une fois encore, durant une longue nuit sans sommeil:
«Pauvre Sabine!... Pauvre femme!...»
Quoi qu’il en fût, dès le lendemain matin, la première action de Vincent tendit au bonheur de celle qu’il plaignait d’une si étrange pitié. Sans attendre que son valet de chambre entrât chez lui, à sept heures, suivant la consigne, dès six heures et demie M. de Villenoise sonna.
Prosper parut, et, sur l’ordre de son maître, ouvrit les volets. Une fraîcheur d’avril, une clarté bleue et rose, pénétrèrent dans la grande pièce tendue de velours sombre, obscurcie de boiseries anciennes, et, çà et là seulement, égayée par des bibelots en ivoire ou en porcelaine de Saxe, par un panneau de glace au-dessus de la cheminée en chêne sculpté, par quelques bergeries galantes du XVIIIe siècle, dues à des pinceaux de maîtres et espacées le long des murs.
—Donnez-moi mon buvard, de l’encre, une plume, dit M. de Villenoise.
Assis dans son lit, le genou soulevé pour soutenir son buvard, il griffonna:
«Madame Sabine Marsan, hôtel Beau-Rivage, Cannes.
«Suis bien heureux. Vous souhaite bon voyage et vous attends avec impatience. A bientôt.
«Vincent.»
—Tenez, dit-il au domestique, faites porter cela et revenez préparer mon tub. Ah!... s’exclama-t-il comme Prosper allait quitter la chambre.
Le valet se retourna. M. de Villenoise eut une courte hésitation. A la fin il demanda, mais avec une ombre de gêne:
—La jument n’est pas sellée, n’est-ce pas?
—Je ne pense pas. Est-ce que monsieur l’a commandée plus tôt ce matin?
—Non... Au contraire, je ne sortirai pas à sept heures et demie comme d’habitude. Passez à l’écurie et dites à Andrew de seller seulement pour... mettons pour... neuf heures.
Prosper sortit, étonné de l’espèce d’embarras qu’avait manifesté son maître en donnant un ordre si simple. Mais ce n’était pas à l’égard de ses gens que M. de Villenoise éprouvait ce vague sentiment de confusion: c’était vis-à-vis de lui-même. Car, s’étant demandé depuis la veille comment il était possible que, dans ses quotidiennes promenades à cheval, il n’eût jamais rencontré le général et Mlle Méricourt, qui, de même, allaient au Bois chaque matin, il avait réfléchi que, sans doute, une jeune fille et un vieillard choisissaient des heures plus tardives que les siennes. Il possédait d’ailleurs ce renseignement qu’on avait chance de les voir plutôt dans les allées fréquentées, tandis que lui-même préférait les grands espaces déserts du côté de Longchamps et de Bagatelle; il sentait donc, sans se le dire encore, qu’il allait changer son itinéraire comme il changeait le moment de sa promenade. Cette petite stratégie absorbait maintenant toute sa pensée, tandis que, de bonne foi, il se croyait occupé d’autre chose. Jusqu’à neuf heures il se tint dans son cabinet de travail. Ce n’était pas par l’image de Sabine qu’il cherchait à combattre ses souvenirs d’hier et son absurde espoir de ce matin. Non... Sabine... Il était quitte envers elle depuis cette réponse télégraphiée qu’il avait voulue sincère et qu’il justifierait dans deux jours—comme si elle l’avait été—par toutes les attitudes d’une tendresse devenue, hélas! un devoir. D’ailleurs, il eût été impossible à Vincent de mettre en face l’une de l’autre, même dans la plus inconsciente évocation, Sabine Marsan et Gilberte Méricourt... L’une, cette maîtresse, jetée définitivement dans ses bras et dans sa vie par une scandaleuse catastrophe... L’autre, cette enfant que, malgré tous ses partis pris et toutes ses préventions contre les jeunes filles, il jugeait d’une ingénuité, d’une fraîcheur d’âme semblable à sa merveilleuse fraîcheur de chair, à sa beauté de fleur candide. Il était lié à la première, soit! et par d’indissolubles liens. Mais en quoi cela pouvait-il l’empêcher d’admirer secrètement la seconde? Pourquoi ne pas goûter le charme du rêve qu’elle éveillait en lui? Après tout, la vie que nous vivons ne tient pas tout entière dans la réalité. Si notre volonté le plus souvent reste impuissante contre les fatalités extérieures, nous sommes du moins les maîtres de nos songes.
Telles étaient les pensées flottantes en l’esprit distrait de M. de Villenoise, tandis qu’il se croyait adonné tout entier à l’éclaircissement d’un vers douteux de Manilius. Machinalement son intelligence suscitait des mots et presque des idées équivalant au texte latin, tant le fonctionnement de son cerveau approchait, à force de savante discipline, de la perfection mécanique.
Cependant son regard, parfois, se levait de la page commencée, errait autour de cette bibliothèque où il avait concentré toutes ses joies intellectuelles depuis qu’il avait renoncé à remplir son existence par les joies du cœur. Elle tenait, cette bibliothèque, en sa plus longue dimension, toute la largeur de l’hôtel, et peu s’en fallait qu’elle ne fût carrée. Les hautes fenêtres à petites vitres nombreuses s’obscurcissaient de stores du côté de la rue, tandis qu’en arrière elles s’ouvraient sur la verdure d’un jardin où fleurissaient des marronniers énormes. Et rien ne pouvait charmer une âme disposée à la rêverie et à l’étude comme les couleurs et les parfums de ces arbres puissants épanouis dans un ciel pur, venant imprégner le recueillement de cette pièce immense, aux murailles tapissées de livres, aux consoles et aux vitrines toutes chargées d’objets d’art.
Dans la cour, sous les fenêtres, tout à coup un cheval s’ébroua. On entendit des fers heurter impatiemment le pavé, et la voix, aux inflexions britanniques, d’un palefrenier qui calmait l’animal. M. de Villenoise leva les yeux vers un cartel, et vit que neuf heures allaient sonner. Il descendit.
Sous la voûte il se mit en selle,—vivement, parce que Gipsy se montrait nerveuse au montoir. Et il la retint quelques secondes, comme elle prenait son élan, pour lui apprendre à ne pas partir sans ordre, avec une fougue brutale, ainsi qu’une bête mal élevée.
—N’ai-je pas l’étrier gauche plus court que l’autre, Andrew? Voyez donc si c’est au dixième point.
—Au dixième point, oui, monsieur, dit le groom en examinant l’étrivière.
—Allons maintenant, ma belle, fit le jeune homme en flattant de la main le cou de son cheval.
Gipsy, s’efforçant d’être sage, partit d’un pas raisonnable. Mais, dans la rue, à la première bouffée d’air, à la première vision d’espace ensoleillé, ce fut plus fort qu’elle: ses jambes fines se détendirent, puis se replièrent bien haut comme pour mieux battre le sol; et elle dansait, l’encolure arrondie, les oreilles droites, une grande mèche dorée voltigeant sous le frontal, entre ses beaux yeux noirs, où s’affolait le plaisir de la course attendue.
Vincent rendit complètement la main; les rênes tombèrent de toute leur longueur. Il habituait ses chevaux à ne lui donner un départ que dans le rassemblé. Gipsy comprit que, pour le moment, elle risquerait un châtiment si elle insistait. Elle allongea le cou et se mit au pas.
Cependant, une fois dehors, M. de Villenoise ne songea plus qu’à la façon dont il rencontrerait Mlle Méricourt. Cela se passerait peut-être dans l’allée des Poteaux, ou encore tout de suite, dans l’avenue du Bois. Car Vincent, au lieu de gagner le Trocadéro et d’entrer dans le Bois, comme il le faisait habituellement, par la porte de la Muette, remontait vers l’Étoile. Et déjà il se figurait la silhouette de l’amazone, le geste dont elle lui rendrait son salut, l’exclamation bienveillante du général, qui lui proposerait de chevaucher un instant avec eux pour bavarder d’équitation.
Cette perspective qui, d’abord, amusa M. de Villenoise et lui fit prendre patience, l’obséda, puis finit par l’énerver à mesure que les quarts d’heure passèrent sans qu’elle se réalisât. Chaque fois que, de loin, il croyait voir une jeune femme à cheval à côté d’un vieux monsieur, il se figurait que c’était Gilberte. Aussitôt il mettait Gipsy au petit galop. Puis, lorsqu’il arrivait près des cavaliers, il reconnaissait qu’il s’était trompé. Parfois même le monsieur n’était pas vieux et la femme n’était plus jeune. Mais quoi! c’était agaçant aussi... Jamais il n’avait vu M. Méricourt ni Mlle Gilberte à cheval. Il ne connaissait ni leur physionomie sous cet aspect, ni la robe de leurs bêtes, ni la nuance de leur costume. Et, de loin, il pouvait les confondre avec les premiers cavaliers venus.
Vincent, vers onze heures et demie, rentra chez lui de mauvaise humeur. Heureusement pour Gipsy, il n’était pas de ces gens qui soulagent leurs nerfs en tourmentant leur monture, et elle avait plutôt pris plaisir aux nombreux petits temps de galop à la poursuite d’un vieux monsieur et d’une jeune demoiselle. Aussi rentra-t-elle plus satisfaite que son maître, de son beau pas cadencé, humant de loin la bonne odeur de sa litière fraîche, dans son box élégant, et le bouquet de son avoine.
Le soir, M. de Villenoise reçut une lettre de Sabine. Il y reconnut l’état d’esprit que le télégramme lui avait fait pressentir: une fébrilité, dont l’approche, au simple contact de ce papier, déjà crispait ses propres nerfs; une impatience de le revoir sous laquelle il croyait deviner moins une vraie tendresse que le despotique vouloir de le monter au même diapason. Sabine avait une façon de lui dire: «N’est-ce pas que nous allons être heureux? N’est-ce pas que c’est trop affreux, deux mois passés l’un sans l’autre, et que nous ne pourrons plus nous quitter... jamais?» à travers laquelle il lisait, à tort ou à raison, comme une leçon dictée, comme un programme de sentiments qu’on lui imposait, bien plus que l’expression d’un simple et sincère élan d’amour.
«Elle veut donc toujours me suggestionner!» pensa-t-il. «Mais elle n’a pas en elle-même la force calme qu’exige un pareil rôle.»
Puis, après quelques minutes de réflexion, il se dit encore:
«Je serai ce que je dois être et ce que je puis être. Voilà tout.»
Sabine lui annonçait son retour pour le surlendemain. Elle arrivait à neuf heures du matin. Mais elle le suppliait instamment de ne pas venir à la gare.
«Si elle m’aimait avec sa tendresse plus qu’avec sa vanité,» rumina-t-il, «elle voudrait me voir dès son arrivée. Mais elle est trop coquette pour se montrer après dix-huit heures de voyage. Eh bien, tant mieux! Je ne manquerai pas ma promenade au Bois.»
Le raisonnement de Vincent n’était pas juste. Car, chez une femme de trente-cinq ans telle que Sabine, que torture déjà le souci de sa décroissante beauté, c’est souvent un héroïsme d’amour qui fait sacrifier à des considérations de coquetterie la joie de voir l’aimé quelques instants plus tôt. Mieux vaut le sevrer d’un bonheur, ce trop fragile amour, que l’aventurer sans ses armes ordinaires, c’est-à-dire sans cette grâce du visage qui lui est indispensable pour vaincre et pour durer.
Toutefois cette mesure de prudence adoptée par Mme Marsan se tourna contre elle, car ce fut précisément ce matin-là qu’enfin M. de Villenoise, au Bois, rencontra Mlle Méricourt.
C’était dans une allée cavalière presque tout à fait déserte. Vincent aperçut la jeune fille de loin, et de dos, car elle allait dans le même sens que lui. Pourtant, cette fois, il fut tellement certain que c’était bien elle, qu’il éprouva une stupéfaction d’avoir jamais pu s’y tromper.
A quelques foulées en avant de son père—qui suivait au pas le bord de l’allée, dans l’ombre des jeunes feuillages—Mlle Méricourt faisait faire, au trot, des contre-changements de main de deux pistes à son cheval.
Elle exécutait cet exercice—un des plus difficiles de l’équitation, et assurément le plus difficile pour une femme, à cause de l’inégalité des aides—avec une précision qui étonna Vincent. Tout de suite il se rendit compte que le général n’avait rien exagéré en parlant de sa fille comme d’une écuyère remarquable. En même temps le jeune homme apprécia la modestie de l’amazone qui, dans cette allée solitaire, ne travaillait pas pour la galerie.
Avec ses mouvantes et parfaites attitudes, sous la fine pluie d’or verdi qui tombait des grêles verdures d’avril ensoleillées, Gilberte formait la silhouette la plus délicieuse. Elle avait juste la taille qui est jolie à cheval, sans trop de sveltesse ni d’embonpoint. Les épaules étaient relativement larges, d’une ligne à peine tombante; les bras descendaient d’un mouvement aisé, sans raideur; le buste long s’amincissait à la ceinture, et les hanches se dégageaient, d’une courbe très fine, reposant d’aplomb sur la selle. Contre le flanc gauche du cheval, la courte jupe noire se collait, grâce à la fixité du genou et du pied passé dans l’étrier, qui ne la soulevaient d’aucun pli. Au-dessus du corsage sombre paraissait la ligne claire d’un col droit; et un petit chapeau en gros paillaisson blanc, étroitement bordé de noir, surmontait la masse brune des cheveux tordus, dans laquelle, parfois, quelque rayon de soleil allumait une flambée rousse.
Du côté droit au côté gauche de l’allée, puis du côté gauche au côté droit, cette charmante amazone semblait voltiger lentement, d’un trot rythmé qui appuyait à peine sur le sol. Le cheval, placé parallèlement au bord de la route, ne procédait pas par petits bonds de côté, mais croisait les pieds comme un maître de danse, ainsi qu’il convenait pour la perfection de ce difficile travail. En venant comme il faisait, par derrière, Vincent ne voyait pas bouger le bras gauche de Mlle Méricourt, ce qui prouvait la justesse avec laquelle ses doigts devaient donner les indications de rênes. Et la cravache s’écartait à peine du flanc de la bête, pour aller à droite, comme la jambe s’en écartait invisiblement pour aller à gauche, tant était légère autant que précise l’action des aides inférieures.
M. de Villenoise, au petit pas, se gardait de rejoindre trop vite M. Méricourt. Il préférait laisser à ses yeux le loisir de savourer le gracieux spectacle, et à son cœur le temps de goûter le quelque chose d’attendri et d’immatériel que ce spectacle éveillait en lui. Une tentation même lui venait de tourner bride et de s’en aller, en sentant croître jusqu’à une intensité presque aiguë le charme qui l’envahissait. Oui, décidément, il y avait un danger dans des sensations pareilles. Mais, après tout, qu’éprouvait-il? Ce n’était pas un commencement d’amour, certes, puisqu’il ne courait pas vers cette jeune fille, puisqu’il ne ressentait pas même le désir de lui parler. Non... Seulement il eût voulu la suivre ainsi, sans être aperçu, et la voir toujours devant lui. Eh bien, ce n’était qu’une admiration d’artiste, une émotion tout intellectuelle. N’importe, il ferait mieux de s’en aller... C’était plus sage. Il s’en irait dans une minute... Il s’en irait quand Mlle Méricourt aurait atteint ce gros arbre là-bas... Oh! elle y arriverait bientôt... Encore deux lacets de droite à gauche, et de gauche à droite, elle y serait. Alors Vincent détournerait Gipsy dans une allée de traverse...
Le jeune homme aurait-il vraiment tenu cette résolution? Qui pourrait le dire? Il n’en sut jamais rien lui-même. Car, avant que Gilberte eût achevé le dernier contre-changement de main à la hauteur du gros arbre, son père, averti par le pressentiment qu’éveille en nous une présence voisine qui nous intéresse, se retourna sur sa selle et vit M. de Villenoise.
Les deux hommes se saluèrent. Le général retint son cheval et Vincent pressa le sien. Ils se trouvèrent côte à côte.
Puis M. Méricourt s’écria:
—Gilberte!... Une bonne rencontre!... Viens dire bonjour à ton garçon d’honneur.
Mlle Méricourt, à la voix de son père, arrêta sa monture et la retourna par une demi-pirouette souple et correcte. Mais elle ne devait pas avoir compris, car son visage, calme et rosé lorsqu’il apparut, changea d’expression dès qu’elle aperçut Vincent. Elle pâlit, puis rougit; et la gêne visible qu’elle éprouva de cette rougeur colora ses traits plus vivement encore.
Quand il la vit rougir ainsi, Vincent se troubla. C’est à peine s’il eut la présence d’esprit d’ôter son chapeau, puis de le passer dans la main gauche pour toucher de la droite celle que la jeune fille lui tendait.
Afin de donner cette poignée de main, Gilberte avait rapproché son cheval par un appuyé qui témoignait de l’obéissance de sa bête autant que de sa propre habileté. Mais Vincent ne le remarqua même pas. Vainement il cherchait quelque chose à dire, alors que des compliments à l’écuyère étaient un sujet tout indiqué.
Ce fut M. Méricourt qui parla le premier, et—tout naturellement—d’équitation; il vanta de nouveau les belles formes et le rassemblé parfait de Gipsy.
—Mais ne lui ôtez-vous pas un peu de son perçant, monsieur, dit-il, à la maintenir ainsi toujours en main?
—Cette jument est tellement équilibrée, mon général, répondit M. de Villenoise, que la mise en main est presque sa position la plus naturelle. J’ai de la peine, au contraire, à la faire s’étendre lorsque je veux allonger son pas.
—Elle a une robe ravissante, s’écria Gilberte. Elle est dorée comme on avait doré artificiellement le cheval de l’empereur Galba, dans la pantomime de Néron, à l’Hippodrome.
—Si cela vous amusait de la monter, mademoiselle, vous lui feriez beaucoup d’honneur. Vous me laisserez seulement le temps de l’essayer en dame dans un manège, pour m’assurer qu’elle supporte bien la jupe.
—Vous mettriez une jupe? demanda Gilberte égayée.
—Bien entendu.
Elle éclata de rire.
—Ah! je voudrais bien vous voir.
—Pour cela, non, dit Vincent, qui se tourna pour lui sourire.
Leurs yeux se rencontrèrent.
Ce sont toujours les yeux qui trahissent l’affinité inconsciente de deux êtres l’un pour l’autre. Ce mystère, que le cœur peut ignorer longtemps, les prunelles aussitôt le reflètent. Elles n’en savent point garder le secret.
Les regards de Vincent et de Gilberte s’effleurèrent en un de ces contacts imprévus, involontaires, et si poignants, que l’âme, ensuite, ne peut plus, sans hypocrisie vis-à-vis d’elle-même, conserver sa sécurité.
Ils se détournèrent aussitôt l’un de l’autre. Mais cet «aussitôt» était encore trop tard. Et tel fut l’oubli des choses extérieures où cette révélation de leurs prunelles plongea les deux jeunes gens, qu’ils crurent sortir d’un songe quand ils entendirent M. Méricourt prononcer d’un ton placide:
—Je ne suis pas du tout certain, moi, monsieur, que cette jument, telle qu’elle est mise, conviendrait à une dame, car vous me paraissez la monter avec beaucoup de jambe.
Vincent dut faire un effort pour percevoir le sens net des mots, et il ouvrait enfin la bouche pour répondre, lorsque le général reprit:
—Vous avez parfaitement raison d’ailleurs. S’il y a une chose détestable, c’est l’équitation sans jambe. Mais à notre époque et dans notre pays, où l’on ne trouve plus guère de gens ayant assez d’empire sur eux-mêmes pour en avoir sur leurs bêtes, on ne dresse plus les chevaux à comprendre la jambe. Que dis-je?... On ne les dresse même plus à la supporter. Oui, monsieur, le croiriez-vous? Un lieutenant, l’autre jour, à l’École de Guerre, a eu le toupet de me dire: «Mais, mon général, si je me servais de mes jambes, je ferais emballer ma jument. D’ailleurs, avec elle, je n’en ai pas besoin, elle a déjà trop d’impulsion sans cela.» Il croyait que les jambes servent seulement à augmenter l’impulsion!... Ah! l’animal!... Mais moi, monsieur, je donne toutes les indications à mon cheval avec les jambes!... Oui, toutes... depuis l’arrêt jusqu’au galop de charge, et jusqu’au changement de pied. Voyons, je vous le demande, comment conçoit-on que, sans jambe, on puisse équilibrer un cheval?
Ce «je vous le demande» n’était heureusement qu’une figure de rhétorique dans la bouche du général, qui, une fois empoigné par son sujet favori, ne s’arrêtait plus, même pour laisser la place aux répliques de son interlocuteur. L’autorité qu’on ne lui discutait pas en pareille matière, et l’habitude de s’adresser à des officiers hiérarchiquement inférieurs que le respect retenait de l’interrompre, déterminaient chez lui cette tendance au monologue. M. de Villenoise eut à l’en bénir, ce matin-là. Car le jeune homme se sentait aussi incapable que possible de soutenir une conversation. Tandis qu’il pouvait à loisir, sous l’attention extérieure prêtée à ce bruit de paroles, bercer le plus délicieux des rêves.
L’allée cavalière dans laquelle ils marchaient donnait exactement passage à leurs trois chevaux de front. Même quelques branches les frôlaient; et c’est pourquoi il avait pris à Mlle Méricourt la place en dehors, laissant ainsi la jeune fille entre son père et lui-même. Il se trouvait à gauche et parfois le pied de Gilberte effleurait sa botte. Ni lui ni elle ne tournaient la tête, mais tous deux tendaient leurs regards en avant, comme n’osant plus croiser leurs prunelles. Toutefois ils avaient si fortement la sensation de leur présence réciproque qu’ils ne pouvaient penser à autre chose. Et les délicates verdures d’avril, dans lesquelles leurs yeux s’enfonçaient, ne leur devenaient visibles que parce qu’elles prenaient aussitôt des significations correspondant à leurs sentiments intimes, à l’espèce de gêne oppressante et douce qui leur étreignait le cœur. Ils ne devaient plus revoir cette nuance de feuilles jeunes, cette perspective d’allée sous bois mollement sablée d’un épais sable roux et colorée de cette couleur de soleil, sans se rappeler cette promenade.
Cependant ils débouchèrent dans l’avenue des Acacias. Les feuillages, brusquement, s’espacèrent, dévoilant une large nappe de ciel bleu. La lumière s’étala, violente, entre les hautes cimes plus tardivement verdoyantes que les taillis. Des voitures filaient sur la chaussée; des cavaliers galopaient; deux officiers saluèrent. La jolie sauvagerie et l’intimité du décor disparurent. En même temps disparut aussi l’espèce de charme qui scellait les lèvres et détournait les yeux de Gilberte et de Vincent. Ils se sentirent plus éloignés l’un de l’autre. Alors ils se regardèrent, ils se parlèrent. Mais avec un regret de leur étrange et délicieuse angoisse...
—C’est comme leur façon de comprendre la théorie de la main fixe, continuait le général. C’est très bien, la main fixe... Mais encore faut-il s’entendre!... Ça ne veut pas dire la main de bois, car alors, plantez-moi un crochet dans l’arçon de la selle et attachez-y les rênes, ça sera la même chose. La main parle à la bouche du cheval. Et comment une main de bois pourrait-elle parler?...
—Mademoiselle, demanda Vincent à Gilberte, faites-vous aussi des contre-changements de main de deux pistes au galop?
—Pas correctement, non, monsieur. Je n’y suis jamais arrivée.
—Et tu n’y arriveras jamais, reprit le général. Une femme ne peut pas. C’est là qu’il en faut des jambes, pour le soutien de l’allure et pour les changements de pied!...
Il s’interrompit.
—Ah! dit-il, voici le maréchal.
Vincent leva les yeux. Un cavalier, qu’il connaissait de vue, comme le connaissaient tous les habitués du Bois, venait à eux d’un pas tranquille. Tout de suite le jeune homme fut saisi par le respect un peu ému que lui inspirait cette maigre figure, d’une crânerie si élégante à cheval malgré ses quatre-vingts ans, et qui semblait résister à l’âge avec toute la puissante inertie de sa légendaire obstination.
Cependant M. Méricourt eut, de côté, vers sa fille et M. de Villenoise, un coup d’œil rapide. Il hésita; puis, brusquement, dit à Vincent—mais d’une voix qui manquait de chaleur:
—Désirez-vous que je vous présente?
Le jeune homme comprit. Sa présence prolongée auprès de Mlle Méricourt allait devenir un sujet de remarques, non seulement pour les amis du général, mais pour tout ce monde assoiffé de cancans qui n’a pas en vain baptisé son point de ralliement dans le Bois matinal du nom de La Potinière.
Aussitôt il prit congé, s’excusant même:
—C’était si intéressant de vous écouter, mon général! Je ne voulais pas vous interrompre.
—Ah! j’en ai bien d’autres à vous dire, cria gaiement M. Méricourt. Mais je vous repincerai. Venez donc un de ces matins, vers huit heures, me demander au Champ de Mars, au grand manège de l’École. Je vous montrerai ce que j’obtiens par le dressage à pied. Vous verrez... C’est très curieux.
Après avoir, en la saluant, rencontré de nouveau le regard de Gilberte,—un long regard brun et doux qu’il emporta dans son cœur, comme l’autre soir il avait emporté dans sa poche, contre sa poitrine, le brin de réséda,—Vincent retourna en arrière et reprit la petite allée verte que tout à l’heure ils avaient suivie côte à côte.
Oh! la charmante petite allée, si bien enclose de feuillage, et si peu à la mode, si dédaignée des promeneurs que les pas de leurs chevaux n’y seraient peut-être pas effacés jusqu’au soir! A y attarder ainsi sa rêverie, Vincent oubliait le mouvement de la vie mondaine qui s’agitait à peu de distance. Il se croyait au fond de son parc immense à Villenoise. Et il n’y était pas seul. De nouveau Gilberte y chevauchait à côté de lui. Le général aussi était là qui développait sa théorie de la main fixe. Oui, le général en personne. Car il ne gênait en rien l’espèce de mirage en train de se fixer dans l’esprit de Vincent. Ce brave cœur de vieux militaire, que l’on sentait si paternel, si dévoué à l’adoration de ses deux fillettes, donnait au contraire comme une consistance, une solidité, à l’espèce de tableau de famille qui s’esquissait dans l’imagination de M. de Villenoise. Une famille... Une femme, un père, un foyer... Étaient-ce donc ces choses dont le confus désir tourmentait, depuis le matin de la noce, celui qui avait été—tellement contre son gré—le garçon d’honneur de Robert Dalgrand? Étaient-ce donc ces choses qui prêtaient une signification plus profonde au charme de Gilberte, à ce charme fait de grâce et de fraîcheur morales autant que de grâce et de fraîcheur physiques?
«Une famille!...» se dit Vincent, «Est-ce que j’en ai eu? Est-ce que j’en aurai jamais?»
Sa mère?... Il se la rappelait à peine. Le seul souvenir qu’il conservât d’elle était celui des pleurs qu’elle versait en cachette, disant à son petit garçon: «Ne le raconte pas à ton père, que j’ai pleuré. Mais, vois-tu, mon pauvre enfant, avec ses idées d’inventeur, il nous mettra sur la paille.»
Son père?... Eh bien, non, c’était plus fort que lui!... Quand il voulait penser au père Bertet, ce qui s’évoquait devant ses yeux c’était l’affiche énorme avec la bouteille de l’Apéritif.
Voilà pour la famille dans le passé. Puis, lorsqu’il regardait l’avenir, il y apercevait... Sabine.
Jusqu’à présent, il avait étouffé ses vagues regrets sous une ironie voulue à l’égard du mariage, de la fidélité des femmes et de la candeur des jeunes filles. En cherchant les mauvais côtés de la famille, il avait fini par ne plus voir que ceux-là. Et il triomphait de les découvrir plus nombreux que les bons, oubliant qu’il en est ainsi pour toutes les choses humaines. D’ailleurs, à force de dénigrer en face de lui-même aussi bien que devant les autres ce qu’il ne pouvait posséder, Vincent avait fini par croire, de bonne foi, qu’il conformait sa vie à ses théories, alors que c’étaient ses théories, au contraire, qu’il conformait aux nécessités et aux fatalités de son existence.
De là vint son étonnement de tout ce qui s’éveilla en lui dès qu’il eut rencontré Gilberte.
Il ne pouvait croire à ce qu’il éprouvait. Il ne se reconnaissait pas.