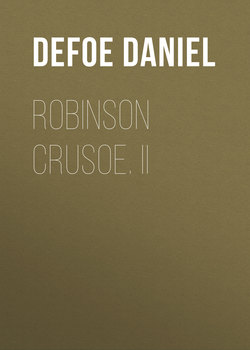Читать книгу Robinson Crusoe. II - Даниэль Дефо, Данієль Дефо, Defoe Daniel - Страница 13
BATTERIE DES INSULAIRES
ОглавлениеMes deux messagers furent en tout trois semaines absents, et dans cet intervalle, malheureusement pour eux, comme je l'ai rapporté dans la première partie, je trouvai l'occasion de me tirer de mon île, laissant derrière moi trois bandits, les plus impudents, les plus endurcis, les plus ingouvernables, les plus turbulents qu'on eût su rencontrer, au grand chagrin et au grand désappointement des pauvres Espagnols, ayez-en l'assurance.
La seule chose juste que firent ces coquins, ce fut de donner ma lettre aux Espagnols quand ils arrivèrent, et de leur offrir des provisions et des secours, comme je le leur avais recommandé. Ils leur remirent aussi de longues instructions écrites que je leur avais laissées, et qui contenaient les méthodes particulières dont j'avais fait usage dans le gouvernement de ma vie en ces lieux: la manière de faire cuire mon pain, d'élever mes chèvres apprivoisées et de semer mon blé; comment je séchais mes raisins, je faisais mes pois et en un mot tout ce que je fabriquais. Tout cela, couché par écrit, fut remis par les trois vauriens aux Espagnols, dont deux comprenaient assez bien l'anglais. Ils ne refusèrent pas, qui plus est, de s'accommoder avec eux pour toute autre chose, car ils s'accordèrent très-bien pendant quelque temps. Ils partagèrent également avec eux la maison ou la grotte, et commencèrent par vivre fort sociablement. Le principal Espagnol, qui m'avait assisté dans beaucoup de mes opérations, administrait toutes les affaires avec l'aide du père de VENDREDI. Quant aux Anglais, ils ne faisaient que rôder çà et là dans l'île, tuer des perroquets, attraper des tortues; et quand le soir ils revenaient à la maison, les Espagnols pourvoyaient à leur souper.
Les Espagnols s'en seraient arrangés si les autres les avaient seulement laissés en repos; mais leur cœur ne pouvait leur permettre de le faire long-temps; et, comme le chien dans la crèche, ils ne voulaient ni manger ni souffrir que les autres mangeassent. Leurs différends toutefois furent d'abord peu de chose et ne valent pas la peine d'être rapportés; mais à la fin une guerre ouverte éclata et commença avec toute la grossièreté et l'insolence qui se puissent imaginer, sans raison, sans provocation, contrairement à la nature et au sens commun; et, bien que le premier rapport m'en eût été fait par les Espagnols eux-mêmes, que je pourrais qualifier d'accusateur, quand je vins à questionner les vauriens, ils ne purent en démentir un mot.
Mais avant d'entrer dans les détails de cette seconde partie, il faut que je répare une omission faite dans la première. J'ai oublié d'y consigner qu'à l'instant de lever l'ancre pour mettre à la voile, il s'engagea à bord de notre navire une petite querelle, qui un instant fit craindre une seconde révolte; elle ne s'appaisa que lorsque le capitaine, s'armant de courage et réclamant notre assistance, eut séparé de vive force et fait prisonniers deux des plus séditieux, et les eut fait mettre aux fers. Comme ils s'étaient mêlés activement aux premiers désordres, et qu'en dernier lieu ils avaient laissé échapper quelques propos grossiers et dangereux, il les menaça de les transporter ainsi en Angleterre pour y être pendus comme rebelles et comme pirates.
Cette menace, quoique probablement le capitaine n'eût pas l'intention de l'exécuter, effraya les autres matelots; et quelques-uns d'entre eux mirent dans la tête de leurs camarades que le capitaine ne leur donnait pour le présent de bonnes paroles qu'afin de pouvoir gagner quelque port anglais, où ils seraient touts jetés en prison et mis en jugement.
Le second eut vent de cela et nous en donna connaissance; sur quoi il fut arrêté que moi, qui passais toujours à leurs yeux pour un personnage important, j'irais avec le second les rassurer et leur dire qu'ils pouvaient être certains, s'ils se conduisaient bien durant le reste du voyage, que tout ce qu'ils avaient fait précédemment serait oublié. J'y allai donc; ils parurent contents après que je leur eus donné ma parole d'honneur, et plus encore quand j'ordonnai que les deux hommes qui étaient aux fers fussent relâchés et pardonnés.
Cette mutinerie nous obligea à jeter l'ancre pour cette nuit, attendu d'ailleurs que le vent était tombé; le lendemain matin nous nous apperçûmes que nos deux hommes qui avaient été mis aux fers s'étaient saisis chacun d'un mousquet et de quelques autres armes, – nous ignorions combien ils avaient de poudre et de plomb, – avaient pris la pinace du bâtiment, qui n'avait pas encore été halée à bord, et étaient allés rejoindre à terre leurs compagnons de scélératesse.
Aussitôt que j'en fus instruit je fis monter dans la grande chaloupe douze hommes et le second, et les envoyai à la poursuite de ces coquins; mais ils ne purent les trouver non plus qu'aucun des autres; car dès qu'ils avaient vu la chaloupe s'approcher du rivage ils s'étaient touts enfuis dans les bois. Le second fut d'abord tenté, pour faire justice de leur coquinerie, de détruire leurs plantations, de brûler leurs ustensiles et leurs meubles, et de les laisser se tirer d'affaire comme ils pourraient; mais, n'ayant pas d'ordre, il laissa toutes choses comme il les trouva, et, ramenant la pinace, il revint à bord sans eux.
Ces deux hommes joints aux autres en élevaient le nombre à cinq; mais les trois coquins l'emportaient tellement en scélératesse sur ceux-ci qu'après qu'ils eurent passé ensemble deux ou trois jours, ils mirent à la porte les deux nouveau-venus, les abandonnant à eux-mêmes et ne voulant rien avoir de commun avec eux. Ils refusèrent même long-temps de leur donner de la nourriture. Quant aux Espagnols, ils n'étaient point encore arrivés.
Dès que ceux-ci furent venus, les affaires commencèrent à marcher; ils tâchèrent d'engager les trois scélérats d'Anglais à reprendre parmi eux leurs deux compatriotes, afin, disaient-ils, de ne faire qu'une seule famille; mais ils ne voulurent rien entendre: en sorte que les deux pauvres diables vécurent à part; et, voyant qu'il n'y avait que le travail et l'application qui pût les faire vivre confortablement, ils s'installèrent sur le rivage nord de l'île, mais un peu plus à l'ouest, pour être à l'abri des Sauvages, qui débarquaient toujours dans la partie orientale.
Là ils battirent deux huttes, l'une pour se loger et l'autre pour servir de magasin. Les Espagnols leur ayant remis quelque peu de blé pour semer et une partie des pois que je leur avais laissés, ils bêchèrent, plantèrent, firent des clôtures, d'après l'exemple que je leur avais donné à touts, et commencèrent à se tirer assez bien d'affaire.
Leur première récolte de blé était venue à bien; et, quoiqu'ils n'eussent d'abord cultivé qu'un petit espace de terrain, vu le peu de temps qu'ils avaient eu, néanmoins c'en fut assez pour les soulager et les fournir de pain et d'autres aliments; l'un d'eux, qui avait rempli à bord les fonctions d'aide de cuisine, s'entendait fort bien à faire des soupes, des puddings, et quelques autres mets que le riz, le lait, et le peu de viande qu'ils avaient permettaient d'apprêter.
C'est ainsi que leur position commençait à s'améliorer, quand les trois dénaturés coquins leurs compatriotes se mirent en tête de venir les insulter et leur chercher noise. Ils leur dirent que l'île était à eux; que le gouverneur, – c'était moi qu'ils désignaient ainsi, – leur en avait donné la possession, que personne qu'eux n'y avait droit; et que, de par touts les diables, ils ne leur permettraient point de faire des constructions sur leur terrain, à moins d'en payer le loyer.
Les deux hommes crurent d'abord qu'ils voulaient rire; ils les prièrent de venir s'asseoir auprès d'eux, d'examiner les magnifiques maisons qu'ils avaient construites et d'en fixer eux-mêmes le loyer; l'un d'eux ajouta en plaisantant que s'ils étaient effectivement les propriétaires du sol il espérait que, bâtissant sur ce terrain et y faisant des améliorations, on devait, selon la coutume de touts les propriétaires, leur accorder un long bail, et il les engagea à amener un notaire pour rédiger l'acte. Un des trois scélérats se mit à jurer, et, entrant en fureur, leur dit qu'il allait leur faire voir qu'ils ne riaient pas; en même temps il s'approche de l'endroit où ces honnêtes gens avaient allumé du feu pour cuire leurs aliments, prend un tison, l'applique sur la partie extérieure de leur hutte et y met le feu: elle aurait brûlé tout entière en quelques minutes si l'un des deux, courant à ce coquin, ne l'eût chassé et n'eût éteint le feu avec ses pieds, sans de grandes difficultés.
Le vaurien furieux d'être ainsi repoussé par cet honnête homme, s'avança sur lui avec un gros bâton qu'il tenait à la main; et si l'autre n'eût évité adroitement le coup et ne se fût enfui dans la hutte, c'en était fait de sa vie. Son camarade voyant le danger où ils étaient touts deux, courut le rejoindre, et bientôt ils ressortirent ensemble, avec leurs mousquets; celui qui avait été frappé étendit à terre d'un coup de crosse le coquin qui avait commencé la querelle avant que les deux autres pussent arriver à son aide; puis, les voyant venir à eux, ils leur présentèrent le canon de leurs mousquets et leur ordonnèrent de se tenir à distance.
Les drôles avaient aussi des armes à feu; mais l'un des deux honnêtes gens, plus décidé que son camarade et enhardi par le danger qu'ils couraient, leur dit que s'ils remuaient pied ou main ils étaient touts morts, et leur commanda résolument de mettre bas les armes. Ils ne mirent pas bas les armes, il est vrai; mais, les voyant déterminés, ils parlementèrent et consentirent à s'éloigner en emportant leur camarade, que le coup de crosse qu'il avait reçu paraissait avoir grièvement blessé. Toutefois les deux honnêtes Anglais eurent grand tort: ils auraient dû profiter de leurs avantages pour désarmer entièrement leurs adversaires comme ils le pouvaient, aller immédiatement trouver les Espagnols et leur raconter comment ces scélérats les avaient traités; car ces trois misérables ne s'occupèrent plus que des moyens de se venger, et chaque jour en fournissait quelque nouvelle preuve.
Mais je ne crois pas devoir changer cette partie de mon histoire du récit des manifestations les moins importantes de leur coquinerie, telles que fouler aux pieds leurs blés, tuer à coups de fusil trois jeunes chevreaux et une chèvre que les pauvres gens avaient apprivoisée pour en avoir des petits. En un mot, ils les tourmentèrent tellement nuit et jour, que les deux infortunés, poussés à bout, résolurent de leur livrer bataille à touts trois à la première occasion. À cet effet ils se décidèrent à aller au château, – c'est ainsi qu'ils appelaient ma vieille habitation, – où vivaient à cette époque les trois coquins et les Espagnols. Là leur intention était de livrer un combat dans les règles, en prenant les Espagnols pour témoins. Ils se levèrent donc le lendemain matin avant l'aube, vinrent au château et appelèrent les Anglais par leurs noms, disant à l'Espagnol, qui leur demanda ce qu'ils voulaient, qu'ils avaient à parler à leurs compatriotes.
Il était arrivé que la veille deux des Espagnols, s'étant rendus dans les bois, avaient rencontré l'un des deux Anglais que, pour les distinguer, j'appelle honnêtes gens; il s'était plaint amèrement aux Espagnols des traitements barbares qu'ils avaient eu à souffrir de leurs trois compatriotes, qui avaient détruit leur plantation, dévasté leur récolte, qu'ils avaient eu tant de peine à faire venir; tué la chèvre et les trois chevreaux qui formaient toute leur subsistance. Il avait ajouté que si lui et ses amis, à savoir les Espagnols, ne venaient de nouveau à leur aide, il ne leur resterait d'autre perspective que de mourir de faim. Quand les Espagnols revinrent le soir au logis, et que tout le monde fut à souper, un d'entre eux prit la liberté de blâmer les trois Anglais, bien qu'avec douceur et politesse, et leur demanda comment ils pouvaient être aussi cruels envers des gens qui ne faisaient de mal à personne, qui tâchaient de subsister par leur travail, et qui avaient dû se donner bien des peines pour amener les choses à l'état de perfection où elles étaient arrivées.