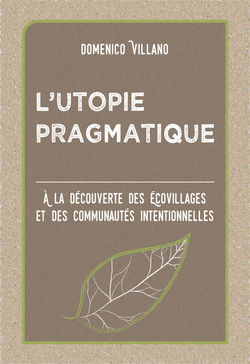Читать книгу L’utopie Pragmatique - Domenico Villano - Страница 4
Prologue
ОглавлениеProcolo nâétait pas un homme primitif, ni un aborigène australien, ni même quelquâun qui venait dâune terre lointaine. Sur la ligne 1 du métro de Naples, en direction de la Station Centrale, tous les visages lui étaient familiers. Pas vraiment tous, en réalité. Il avait remarqué des étrangers à la peau noire, dâautres aux yeux en amande, ou encore des petites familles attendrissantes, couleur café au lait. Chacun dâeux parlait une langue inconnue mais cela nâavait aucune importance à ses yeux. Quand il était encore jeune, il était allé deux ou trois fois au port de Pozzuoli pour vendre le vin dâune année exceptionnelle, et là , il avait vu des étrangers, venant des quatre coins de la planète. Mais ce qui lâintriguait, câétait plutôt tous les autres: ils lui ressemblaient tellement, avec leurs yeux noirs, leurs cheveux châtains et leur visage familier, mais ils avaient quelque chose dâétrange. Ils étaient tous très grands et habillés comme des princes. Ils arboraient des chemises impeccables, des chaussures toute neuves et des cheveux soigneusement peignés. Il devait sans doute se trouver dans une ville de rois. Il avait entendu parler des villes, de leur saleté, de la misère du peuple et de la grande richesse des seigneurs, enfermés dans leur palais et défendus par leur cour. Mais qui étaient tous ces messieurs dans ce wagon souterrain? Aucun nâavait le visage brûlé par le soleil. Il y avait bien quelques jeunes garçons à la peau rougeâtre, mais il sâagissait dâune couleur étrange, comme sâils sâétaient dépêchés de sâimmerger dans une baignoire pleine de rayons de soleil. Procolo regardait les mains de ceux qui sâagrippaient aux montants tubulaires du wagon pour ne pas perdre lâéquilibre. Elles ne ressemblaient en rien aux siennes. Aucune callosité, aucune cicatrice. Elles étaient fines et propres; les ongles bien soignés et longs, plus longs encore que ceux du marquis de De Suricis, lâhomme le plus cultivé et le plus riche de Roccafiniterre, son village bien-aimé, où il avait passé presque toute sa vie. Et maintenant, Dieu sait où il se trouvait. à vrai dire, il ne se souvenait pas comment il était arrivé dans ce curieux engin souterrain, mais il était prêt à tout pour retrouver le chemin de la maison. Il tenta de demander des informations à un des passagers, mais, malheureusement, celui-ci arrivait à peine à comprendre ce que Procolo lui disait. Il avait des dents bien droites, comme il nâen avait jamais encore vu, et il parlait une langue quâil avait déjà entendue une fois, lorsquâil avait dû aller devant le juge, dans un immense bâtiment de Benevento, pour ce problème de poulets quâil avait empruntés au poulailler de Mariuccia, sans en demander la permission. Heureusement, cette fois-là , il sâen était bien sorti, avec seulement quelques nuits passées en cellule.
Mais comme il était curieux, ce monsieur aux dents toutes droites, il parlait à Procolo comme sâil était un accusé. Et quelles manières il avait ! Il avait perdu patience après deux tentatives infructueuses et sâétait plongé dans la lecture dâun gros livre, lui qui nâétait même pas curé! Dans ce wagon, câétait chacun pour soi; personne ne se parlait. Certains passagers lisaient un livre ou un journal, dâautres fixaient le vide, hébétés. Il y en avait bien deux ou trois qui bavardaient dans le jargon des juges, cette fois peut-être un peu plus compréhensible, mais la plupart dâentre eux étaient aux prises avec de drôles dâengins lumineux en métal, parfois pourvus de longues protubérances caoutchouteuses allant jusquâaux oreilles, et qui ressemblaient à celui du docteur pour mesurer la tension ou qui sait quoi. Procolo était encore tout absorbé par ses observations quand le métro arriva à la Station Centrale et, aussitôt, la foule se précipita convulsivement vers les escaliers mécaniques. Des escaliers mécaniques â en voilà une sorcellerie ! â pensa notre personnage, tandis quâentraîné par le flot de bras, de jambes et de sacs, il gravissait les escaliers de marbre, serré entre ces deux serpents métalliques, montant et descendant, qui étaient surchargés de personnes. à peine sorti des profondeurs, il fut happé par un tourbillon de lumières, de bruits et de gens et perdit tout sens dâorientation. Il sentit alors ses jambes se dérober, la sueur froide couler sur son front et il sâeffondra sur le sol, sans connaissance. Ce ne fut quâaprès quelques heures quâil fut réveillé par un jeune garçon qui, heureusement, prononçait des mots qui ressemblaient à ceux de sa langue. Il parvenait enfin à comprendre quelquâun. Il sâappelait Mike, il avait seize ans et venait dâAmérique. â De lâAmérique? â demanda Procolo surpris â Et quâest-ce que tu fais ici? Et pourquoi tu parles comme les gens de la Rocca?
Le jeune garçon proposa au vieux paysan de lâaccompagner chez sa tante Pina, qui habitait dans le quartier de la Forcella, tout près dâici. Chez elle, il pourrait manger quelque chose et reprendre des forces et, chemin faisant, il aurait la réponse à toutes ses questions. Procolo accepta son invitation et se remit péniblement debout. Alors quâils marchaient le long du Corso Umberto, Mike expliqua au vieil homme que son arrière-grand-père avait immigré en Amérique, où il avait finalement trouvé un travail de marchand de fleurs en Pennsylvanie. Lui, il avait appris le dialecte grâce à sa grand-mère, la mémoire vivante des origines italiennes de sa famille. Ce jour-là , Mike revenait de la Rocca et il se trouvait, lui aussi, à la station de métro. Cependant, il eut aussi beaucoup de mal à sâorienter dans cette station bondée, car il ne parlait que lâanglais et le dialecte de la Rocca, et il ne comprenait pratiquement pas lâitalien. à sa grande déception, même les quelques jeunes de son âge de la Rocca ne comprenaient pas le dialecte de sa grand-mère; il avait juste réussi à échanger deux mots avec des vieillards, âgés de plus de quatre-vingts ans, assis au bar du village.
Les voitures passaient à toute allure sur lâavenue et le jeune garçon manipulait sans arrêt cet engin lumineux. Les filles déambulaient sans une once de pudeur, vêtues de pantalons ou de shorts et, parfois même, en montrant leur ventre! Procolo finit par avoir la conviction que, par quelque étrange sortilège, il avait été propulsé une centaine dâannées au moins dans le futur. Le calendrier lumineux dâune pharmacie affichait le 11/08/2016. Il nâétait pas allé à lâécole mais, heureusement, il avait appris à calculer pour ne pas se faire arnaquer au marché. Les jours suivants, Procolo se délecta des commodités offertes par la modernité. Il mangea de la viande à satiété, comme si câétait Pâques tous les jours. La nourriture était tellement exquise et raffinée dans le futur et cette armoire froide était un don du ciel! Sans parler de tous les appareils qui envahissaient la maison et, surtout, cette boîte, appelée «Télévision», qui racontait les nouvelles du journal, même à lui, qui ne savait pas lire. Avec Mike, il alla acheter des habits neufs, comme personne du village nâen avait jamais eus, et qui devaient coûter autant quâun sac de pommes de terre. Grâce aux appareils lumineux, les fameux téléphones portables, on pouvait parler et même voir les personnes de lâAmérique et faire des tas dâautres choses encore. Les jeux vidéo restaient définitivement un mystère pour lui mais, en revanche, la calculatrice et lâappareil photographique, minuscule et tellement sophistiqué, lâemballaient. Mike et sa tante lâemmenèrent faire un tour avec l'Automobile et lui firent voir, en une seule journée, des endroits merveilleux, distants de plusieurs dizaines de kilomètres les uns des autres; lui, il aurait mis des mois à les atteindre avec sa mule. Un jour, ils allèrent même à Rome avec un vaisseau volant, appelé «avion». Procolo était terrorisé, mais il fut un peu rassuré en voyant quâil nâétait pas le seul, car, autour de lui, des personnes âgées avaient la sueur au front et les yeux écarquillés exactement comme lui. Après le décollage, son émerveillement dissipa toutes ses craintes; la vue du ciel était encore plus belle que celle du massif du Matese, quâil avait gravi une fois. Il y avait tellement de maisons quâil nâarrivait pas à les compter, ni même à imaginer combien de personnes habitaient dans cette ville. Il avait toujours rêvé de venir à Rome, de franchir les portes du Vatican et dâécouter le Pape. Sa sainteté venait aussi de lâAmérique et parlait comme un magistrat. Mais au fond, lui aussi, il commençait à parler «Litaiano» et à caresser lâidée que, peut-être, un jour, il pourrait être juge. Un matin, il était seul dans la maison de la Forcella. Assis sur le balcon, il regardait les étrangers qui, en contrebas, marchandaient des objets faits dans ce caoutchouc plastique. Il en avait vu des tas dans les magasins et autant dans les poubelles. Aux dires de Mike, chacun de ces engins avait une fonction spécifique et indispensable, mais lui, il ne parvenait pas comprendre, il ne voyait tout simplement pas leur utilité. Il songea à sa maison qui commençait à lui manquer et à la Rocca. Ils y étaient tous allés une fois, mais ce nâétait plus comme dans ses souvenirs. Là aussi des voitures, des télévisions, des aliments en boîte et le silence; désormais, seules quelques personnes y habitaient encore et restaient enfermées chez elles. Dans ce monde «moderne», comme disaient les gens, ils vivaient tous comme des princes. Bien sûr, ici aussi, il y avait de très grandes différences entre les individus, mais plus personne, sauf peut-être les étrangers, ne sâexténuait plus dans les champs comme les habitants de son village. Beaucoup de maladies redoutées avaient disparu complètement et tout le monde était extrêmement propre. Mais il y avait quelque chose qui nâallait pas ; ce quâils avaient acquis en bien-être, ils lâavaient perdu en bonheur, en foi et en sociabilité. Personne ne voulait plus lâaccompagner à lâéglise le dimanche. La ville regorgeait pourtant dâéglises, mais elles étaient presque toutes vides, encore fréquentées par quelque vieillard. Quand on devait aller quelque part ou rencontrer quelquâun, on restait des heures dans la voiture, coincé dans le trafic, ou il fallait prendre les «transports en commun ». Tout le monde était pressé et un peu éteint. Et pourtant, il avait appris que Naples était une des villes les plus vivantes et joyeuses du monde ⦠alors, il nâosait pas imaginer pas les autres! La famille, telle quâil lâavait connue, nâexistait plus. Les oncles, les tantes, les cousins étaient dispersés aux quatre coins du monde, les membres de la famille ⦠oubliés. Seul le noyau papa-maman-enfants résistait encore malgré les divorces fréquents. Et puis, les enfants, on nâen faisait plus beaucoup, un ou deux maximum â on ne peut pas se le permettre â on lui disait. Mais avec toute cette nourriture sur la table, il avait du mal à y croire!
La campagne, lâodeur de la terre et ses bruits lui manquait ; ici, il nây avait que lâasphalte et la brique, comme une immense forêt de béton. Mais le pire était tous ces écrans lumineux, les télés, les ordinateurs, les téléphones portables, le cinéma. Tout le monde passait son temps devant ces appareils, pour le travail ou pour se divertir et il nây avait plus personne avec qui parler. Tout compte fait, câest vrai que ce monde moderne avait de nombreux avantages, car on y vivait incroyablement bien et longtemps. Câétait facile de fonder une famille et dâélever ses enfants, sans devoir sâépuiser à la tâche, risquer de mourir dâun refroidissement ou tomber dans une embuscade tendue par des canailles meurtrières. Mais quelque chose avait dérapé dans ce monde où les machines fabriquaient du bonheur, car la plupart des gens vivaient dans la tristesse et dans la solitude. Il y avait seulement une poignée dâhommes qui possédaient des richesses inimaginables, sans même lever le petit doigt, tandis que la majorité devait se battre pour sâen sortir. Tout ce bien-être visible nâétait rien face à la richesse des puissants, peut-être parce que dans son monde à lui, il nây avait pas non plus tellement de différences avec la modernité. On disait quâil fallait continuer à travailler tous les jours du matin au soir. Et pourquoi ? Pour produire et acheter plus de caoutchouc plastique ? Ce système, Procolo ne le comprenait vraiment pas!
Il se réveilla brusquement. Sa femme Nunzia, cachée derrière le lit de paille, était en proie à la panique : la mule avait défoncé la porte de bois et sâétait enfuie. Il sentit dâabord des démangeaisons à la tête, puis la chaleur de la laine de sa veste crasseuse et les odeurs de la terre, et enfin, lâagitation des ruelles animées de son village. Il était finalement de retour chez lui, dans sa maison, après toutes ces aventures! Il avait désormais lâenvie de conquérir lâavenir, mais sans commettre les erreurs de ses arrière-petits-enfants. Lâavenir, ils allaient sâen emparer tous ensemble : Procolo et ses concitoyens, en harmonie avec la Nature et lâAu-delà .
Le lecteur va sans doute penser sâêtre trompé de livre, en lisant ces premières pages. Il sâattendait à ce que le livre lui parle de communautés et dâécovillages, de développement durable et de vie conviviale, mais le voilà plongé dans les rêves dâun paysan méridional du dix-neuvième siècle. Et bien, je voudrais dire au lecteur que les expériences communautaires, quâil découvrira dans les prochaines pages, fournissent des réponses aux questions du vieux Procolo: comment redonner la chaleur de la vie en communauté à la modernité? Comment concilier la rationalité du progrès avec nos aspirations spirituelles, la force de la technique avec lâharmonie de la nature, le bien-être avec lâégalité sociale? Les communautés apportent des réponses utopiques, qui sont les avant-gardes de la pensée et qui se font pratiques, en se heurtant aux difficultés de la réalité.
Bonne Lecture !