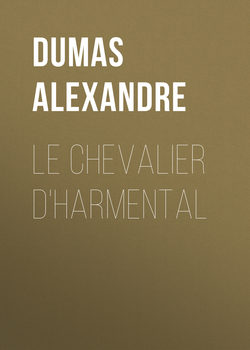Читать книгу Le chevalier d'Harmental - Александр Дюма, Dumas Alexandre - Страница 3
Chapitre 3
ОглавлениеLe chevalier Raoul d'Harmental, avec qui, avant de passer outre, il est nécessaire que nos lecteurs fassent plus ample connaissance, était l'unique rejeton d'une des meilleures familles du Nivernais. Quoique cette famille n'eût jamais joué un rôle important dans l'histoire, elle ne manquait pas cependant d'une certaine illustration, qu'elle avait acquise, soit par elle-même, soit par ses alliances. Ainsi, le père du chevalier, le sire Gaston d'Harmental, étant venu en 1682 à Paris, et ayant eu la fantaisie de monter dans les carrosses du roi, avait fait, haut la main, ses preuves de 1399, opération héraldique qui, s'il faut en croire un mémoire du parlement, aurait fort embarrassé plus d'un duc et pair. D'un autre côté, son oncle maternel, monsieur de Torigny, ayant été nommé chevalier de l'Ordre, à la promotion de 1694, avait avoué, en faisant reconnaître ses seize quartiers que le plus beau de son visage, comme on le disait alors, était fait des d'Harmental, avec qui ses ancêtres étaient en alliance depuis trois cents ans. En voilà donc assez pour satisfaire aux exigences aristocratiques de l'époque sur laquelle nous écrivons.
Le chevalier n'était ni pauvre ni riche, c'est-à-dire que son père en mourant lui avait laissé une terre située dans les environs de Nevers, laquelle lui rapportait quelque chose comme vingt-cinq ou trente mille livres de rente.
C'était de quoi vivre fort grandement dans sa province; mais le chevalier avait reçu une excellente éducation, et il se sentait une grande ambition dans le cœur; il avait donc, à sa majorité, c'est-à-dire vers 1711, quitté sa province, et était accouru à Paris.
Sa première visite avait été pour le comte de Torigny, sur lequel il comptait fort pour le mettre en cour. Malheureusement, à cette époque, le comte de Torigny n'y était pas lui-même. Mais comme il se souvenait toujours avec grand plaisir, ainsi que nous l'avons dit, de la famille d'Harmental, il recommanda son neveu au chevalier de Villarceaux, et le chevalier de Villarceaux qui n'avait rien à refuser à son ami le comte de Torigny, conduisit le jeune homme chez madame de Maintenon.
Madame de Maintenon avait une qualité: c'était d'être restée l'amie de ses anciens amants. Elle reçut parfaitement le chevalier d'Harmental, grâce aux vieux souvenirs qui le recommandaient auprès d'elle, et quelques jours après le maréchal de Villars étant venu lui faire sa cour, elle lui dit quelques mots si pressants en faveur de son jeune protégé, que le maréchal, enchanté de trouver une occasion d'être agréable à cette reine in partibus, répondit qu'à compter de cette heure il attachait le chevalier d'Harmental à sa maison militaire, et s'empresserait de lui offrir toutes les occasions de justifier la bonne opinion que son auguste protectrice voulait bien avoir de lui.
Ce fut une grande joie pour le chevalier que de se voir ouvrir une pareille porte. La campagne qui allait avoir lieu était définitive.
Louis XIV en était arrivé à la dernière période de son règne, à l'époque des revers. Tallard et Marsin avaient été battus à Hochstett, Villeroy à Ramillies, et Villars lui-même, le héros de Friedlingen, venait de perdre la fameuse bataille de Malplaquet contre Marlborough et Eugène. L'Europe, un instant étouffée sous la main de Colbert et de Louvois, réagissait tout entière contre la France. La situation des affaires était extrême; le roi, comme un malade désespéré qui change à chaque heure de médecin, changeait chaque jour de ministres. Mais chaque essai nouveau révélait une impuissance nouvelle. La France ne pouvait plus soutenir la guerre et ne pouvait pas parvenir à faire la paix. Vainement elle offrait d'abandonner l'Espagne et de restreindre ses frontières: ce n'était point assez d'humiliation. On exigeait que le roi donnât passage aux armées ennemies à travers la France pour aller chasser son petit-fils du trône de Charles II, et qu'il livrât comme places de sûreté Cambrai, Metz, La Rochelle et Bayonne, à moins qu'il n'aimât mieux, dans un an pour tout délai, le détrôner lui-même à force ouverte. Voilà à quelles conditions une trêve était accordée au vainqueur des Dunes, de Senef, de Fleurus, de Steinkerque et de la Marsaille; à celui qui, jusque-là, avait tenu dans le pan de son manteau royal la paix et la guerre; à celui qui s'intitulait le distributeur des couronnes, le châtieur des nations, le grand, l'immortel; à celui enfin pour lequel, depuis un demi-siècle, on taillait le marbre, on fondait le bronze, on mesurait l'alexandrin, on épuisait l'encens.
Louis XIV avait pleuré en plein conseil.
Ces larmes avaient produit une armée, et cette armée avait été donnée à Villars.
Villars marcha droit à l'ennemi, dont le camp était à Denain, et qui, les yeux fixés sur l'agonie de la France, s'endormait dans sa sécurité. Jamais responsabilité plus grande n'avait chargé une tête. Sur un coup de dé, Villars allait jouer le salut de la France.
Les alliés avaient établi, entre Denain et Marchiennes, une ligne de fortifications que, dans leur orgueil anticipé, Albemarle et Eugène appelaient la grande route de Paris. Villars résolut d'enlever Denain par surprise, et, Albemarle battu, de battre Eugène.
Il fallait, pour réussir dans une si audacieuse entreprise, tromper non seulement l'armée ennemie, mais l'armée française, le succès de ce coup de main étant dans son impossibilité même.
Villars proclama bien haut son intention de forcer les lignes de Landrecies. Une nuit, à une heure convenue toute son armée s'ébranle et marche dans la direction de cette ville. Tout à coup l'ordre est donné d'obliquer à gauche; le génie jette trois ponts sur l'Escaut. Villars franchit le fleuve sans obstacle, se jette dans les marais que l'on croyait impraticables, et où le soldat s'avance ayant de l'eau jusqu'à la ceinture; il marche droit aux premières redoutes, et les emporte presque sans coup férir, s'empare successivement d'une lieue de fortifications, atteint Denain, franchit le fossé qui l'entoure, pénètre dans la ville, et, en arrivant sur la place, trouve son jeune protégé, le chevalier d'Harmental, qui lui présente l'épée d'Albemarle, qu'il venait de faire prisonnier.
En ce moment, on annonce l'arrivée d'Eugène. Villars se retourne, atteint avant lui le pont sur lequel ce dernier doit passer, s'en empare et attend. Là, le véritable combat s'engage, car la prise de Denain n'a été qu'une escarmouche. Eugène pousse attaque sur attaque, revient sept fois à la tête de ce pont briser ses meilleures troupes contre l'artillerie qui le protège et contre les baïonnettes qui le défendent; enfin ayant ses habits criblés de balles, tout sanglant de deux blessures, monte sur son troisième cheval, et le vainqueur de Hochstett et de Malplaquet se retire en pleurant de rage et en mordant ses gants de colère. En six heures tout a changé de face: la France est sauvée, et Louis XIV est toujours le grand roi.
D'Harmental s'était conduit en homme qui d'un seul coup veut gagner ses éperons. Villars, en le voyant tout couvert de sang et de poussière, se rappela par qui il avait été recommandé, et le fit approcher de lui, pendant qu'au milieu du champ de bataille même il écrivait sur un tambour le résultat de la journée. En voyant d'Harmental, Villars interrompit sa lettre.
– Êtes-vous blessé? lui demanda-t-il.
– Oui, monsieur le maréchal, mais si légèrement que cela ne vaut pas la peine d'en parler.
– Vous sentez-vous la force de faire soixante lieues à cheval à franc étrier sans vous reposer une heure, une minute, une seconde?
– Je me sens capable de tout, monsieur le maréchal, pour le service du roi et le vôtre.
– Alors, partez à l'instant même, descendez chez madame de Maintenon, dites-lui de ma part ce que vous venez de voir, et annoncez-lui le courrier qui en apportera la relation officielle. Si elle veut vous conduire chez le roi, laissez-vous faire.
D'Harmental comprit l'importance de la mission dont on le chargeait, et, tout poudreux, tout sanglant, sans débotter, il sauta sur un cheval frais et gagna la première poste; douze heures après, il était à Versailles.
Villars avait prévu ce qui devait arriver. Aux premiers mots qui sortirent de la bouche du chevalier, madame de Maintenon le prit par la main et le conduisit chez le roi. Le roi travaillait avec Voisin dans sa chambre, contre l'habitude, car il était un peu malade. Madame de Maintenon ouvrit la porte, poussa le chevalier d'Harmental aux pieds du roi, et levant les deux mains au ciel:
– Sire, dit-elle, remerciez Dieu; car, Votre Majesté le sait, nous ne sommes rien par nous-mêmes, et c'est de Dieu que nous vient toute grâce.
– Qu'y a-t-il, monsieur? parlez! dit vivement Louis XIV, étonné de voir à ses pieds ce jeune homme qu'il ne connaissait pas.
– Sire, répondit le chevalier, le camp de Denain est pris; le comte d'Albemarle est prisonnier, le prince Eugène est en fuite; le maréchal de Villars met sa victoire aux pieds de Votre Majesté.
Malgré la puissance qu'il avait sur lui-même, Louis XIV pâlit; il sentit que les jambes lui manquaient, et il s'appuya à la table pour ne pas tomber sur son fauteuil.
– Qu'avez-vous, sire? s'écria madame de Maintenon en allant à lui.
– J'ai, madame, que je vous dois tout, dit Louis XIV: vous sauvez le roi, et vos amis sauvent le royaume.
Madame de Maintenon s'inclina et baisa respectueusement la main du roi.
Alors Louis XIV, encore tout pâle et tout ému, passa derrière le grand rideau qui fermait le salon où était son lit, et l'on entendit la prière d'actions de grâces qu'il adressait à demi-voix au Seigneur; puis, au bout d'un instant, il reparut calme et grave, comme si rien n'était arrivé.
– Et maintenant, monsieur, racontez-moi la chose dans tous ses détails.
Alors d'Harmental fit le récit de cette merveilleuse bataille, qui venait, comme par miracle, de sauver la monarchie. Puis, lorsqu'il eut fini:
– Et de vous, monsieur, dit Louis XIV, vous ne m'en dites rien? Cependant, si j'en juge par le sang et la boue qui couvrent encore vos habits, vous n'êtes point resté en arrière.
– Sire, j'ai fait de mon mieux, dit d'Harmental en s'inclinant; mais s'il y a réellement quelque chose à dire de moi, je laisse, avec la permission de Votre Majesté, ce soin à monsieur le maréchal de Villars.
– C'est bien, jeune homme, et s'il vous oublie, par hasard, nous nous souviendrons, nous. Vous devez être fatigué, allez vous reposer; je suis content de vous.
D'Harmental se retira tout joyeux. Madame de Maintenon le reconduisit jusqu'à la porte. D'Harmental lui baisa la main encore une fois, et se hâta de profiter de la permission royale qui lui était donnée, il y avait vingt-quatre heures qu'il n'avait ni bu, ni mangé, ni dormi.
À son réveil, on lui remit un paquet que l'on avait apporté pour lui du ministère de la guerre. C'était son brevet de colonel.
Deux mois après, la paix fut faite. L'Espagne y laissa la moitié de sa monarchie, mais la France resta intacte.
Trois ans après, Louis XIV mourut.
Deux partis bien distincts, bien irréconciliables surtout, étaient en présence au moment de cette mort: celui des bâtards, incarné dans monsieur le duc du Maine, et celui des princes légitimes, représenté par monsieur le duc d'Orléans.
Si monsieur le duc du Maine avait eu la persistance, la volonté, le courage de sa femme, Louise-Bénédicte de Condé, peut-être, appuyé comme il l'était par le testament royal, eût-il triomphé; mais il eût fallu se défendre au grand jour, comme on était attaqué, et le duc du Maine, faible de cœur et d'esprit, dangereux à force d'être lâche, n'était bon qu'aux choses qui se passaient par-dessous terre. Il fut menacé de face, et dès lors ses artifices sans nombre, ses faussetés exquises, ses marches ténébreuses et profondes lui devinrent inutiles. En un jour, et presque sans combat, il fut précipité de ce faîte où l'avait porté l'aveugle amour du vieux roi. La chute fut lourde et surtout honteuse; il se retira mutilé, abandonnant la régence à son rival, et ne conservant de toutes les faveurs accumulées sur lui que la surintendance de l'éducation royale, la maîtrise de l'artillerie et le pas sur les ducs et pairs.
L'arrêt que venait de rendre le parlement frappait la vieille cour et tout ce qui lui était attaché. Le père Letellier alla au-devant de son exil, madame de Maintenon se réfugia à Saint-Cyr, et monsieur le duc du Maine s'enferma dans la belle villa de Sceaux pour continuer sa traduction de Lucrèce.
Le chevalier d'Harmental avait assisté en spectateur intéressé, il est vrai, mais en spectateur passif, à toutes ces intrigues, attendant toujours qu'elles revêtissent un caractère qui lui permît d'y prendre part. S'il y avait eu lutte franche et armée, il se fût rangé du côté où la reconnaissance l'appelait. Trop jeune et trop chaste encore, si on peut le dire en matière politique, pour tourner avec le vent de la fortune, il resta respectueux à la mémoire de l'ancien roi et aux ruines de la vieille cour. Son absence du Palais-Royal, autour duquel gravitait à cette heure tout ce qui voulait reprendre une place dans le ciel politique, fut interprétée à opposition, et un matin, comme il avait reçu le brevet qui lui accordait un régiment, il reçut l'arrêté qui le lui enlevait.
D'Harmental avait l'ambition de son âge: la seule carrière ouverte à un gentilhomme de cette époque était la carrière des armes; son début y avait été brillant, et le coup qui brisait à vingt-cinq ans toutes ses espérances d'avenir lui fut profondément douloureux. Il courut chez monsieur de Villars, dans lequel il avait trouvé autrefois un protecteur si ardent. Le maréchal le reçut avec la froideur d'un homme qui ne serait pas fâché, non seulement d'oublier le passé, mais de voir le passé oublié. Aussi, d'Harmental comprit que le vieux courtisan était en train de changer de peau, et il se retira discrètement.
Quoique cet âge fût essentiellement celui de l'égoïsme, la première épreuve qu'en faisait le chevalier lui fut amère; mais il était dans cette heureuse période de la vie où il est rare que les douleurs de l'ambition trompée soient profondes et durables; l'ambition est la passion de ceux qui n'en ont pas d'autres, et le chevalier avait encore toutes celles que l'on a à vingt-cinq ans.
D'ailleurs, l'esprit du temps n'était point tourné encore à la mélancolie. C'est un sentiment tout moderne, né du bouleversement des fortunes et de l'impuissance des hommes. Au dix-huitième siècle, il était rare que l'on rêvât aux choses abstraites, et que l'on aspirât à l'inconnu; on allait droit aux plaisirs, à la gloire ou à la fortune, et pourvu qu'on fût beau, brave ou intrigant, tout le monde pouvait arriver là. C'était encore l'époque où l'on n'était pas humilié de son bonheur. Aujourd'hui, l'esprit domine de trop haut la matière pour que l'on ose avouer que l'on est heureux.
Au reste, il faut l'avouer, le vent soufflait à la joie, et la France semblait voguer, toutes voiles dehors, à la recherche de quelqu'une de ces îles enchantées comme on en trouve sur la carte dorée des Mille et une Nuits. Après ce long et triste hiver de la vieillesse de Louis XIV, apparaissait tout à coup le printemps joyeux et brillant d'une jeune royauté: chacun s'épanouissait à ce nouveau soleil, radieux et bienfaisant, et s'en allait bourdonnant et insoucieux, comme font les papillons et les abeilles aux premiers jours de la belle saison. Le plaisir, absent et proscrit pendant plus de trente ans, était de retour; on l'accueillait comme un ami qu'on n'espérait plus revoir; on courait à lui de tous côtés, franchement, les bras et le cœur ouverts, et, de peur sans doute qu'il ne s'échappât de nouveau, on mettait à profit tous les instants. Le chevalier d'Harmental avait gardé sa tristesse huit jours; puis il s'était mêlé à la foule, puis il avait été entraîné par le tourbillon, et ce tourbillon l'avait jeté aux pieds d'une jolie femme.
Trois mois il avait été l'homme le plus heureux du monde; pendant trois mois il avait oublié Saint-Cyr, les Tuileries, le Palais-Royal; il ne savait plus s'il y avait une madame de Maintenon, un roi, un régent; il savait qu'il fait bon vivre quand on est aimé, et il ne voyait pas pourquoi il ne vivrait pas et il n'aimerait pas toujours.
Il en était là de son rêve lorsque, ainsi que nous l'avons dit, soupant avec son ami le baron de Valef dans une honorable maison de la rue Saint-Honoré, il avait été tout à coup brutalement réveillé par Lafare. Les amoureux ont, en général, le réveil mauvais, et l'on a vu que, sous ce rapport, d'Harmental n'était pas plus endurant que les autres. C'était, au reste, d'autant plus pardonnable au chevalier qu'il croyait aimer véritablement, et que, dans sa bonne foi toute juvénile, il pensait que rien ne pourrait reprendre dans son cœur la place de cet amour; c'était un reste de préjugé provincial qu'il avait apporté des environs de Nevers. Aussi, comme nous l'avons vu, la lettre si étrange, mais du moins si franche, de madame d'Averne, au lieu de lui inspirer l'admiration qu'elle méritait à cette folle époque, l'avait tout d'abord accablé. C'est le propre de chaque douleur qui nous arrive de réveiller toutes les douleurs passées, que l'on croyait disparues et qui n'étaient qu'endormies. L'âme a ses cicatrices comme le corps, et elles ne se ferment jamais si bien qu'une blessure nouvelle ne les puisse rouvrir. D'Harmental se retrouva ambitieux; la perte de sa maîtresse lui avait rappelé la perte de son régiment.
Aussi ne fallait-il rien moins que la seconde lettre si inattendue et si mystérieuse, pour faire quelque diversion à la douleur du chevalier. Un amoureux de nos jours l'eût jetée avec dédain loin de lui, et se serait méprisé lui-même, s'il n'avait pas creusé sa douleur de manière à s'en faire, pour huit jours au moins, une pâle et poétique mélancolie; mais un amoureux de la régence était bien autrement accommodant. Le suicide n'était pas encore découvert, et l'on ne se noyait alors, quand d'aventure on tombait à l'eau, que si l'on ne trouvait pas sous sa main la moindre petite paille où se retenir.
D'Harmental n'affecta donc pas la fatuité de la tristesse. Il décida, en soupirant, il est vrai, qu'il irait au bal de l'opéra, et, pour un amant trahi d'une manière si imprévue et si cruelle, c'était déjà beaucoup.
Mais, il faut le dire à la honte de notre pauvre espèce, ce qui le porta surtout à cette philosophique détermination, c'est que la seconde lettre, celle où on lui promettait de si grandes merveilles, était d'une écriture de femme