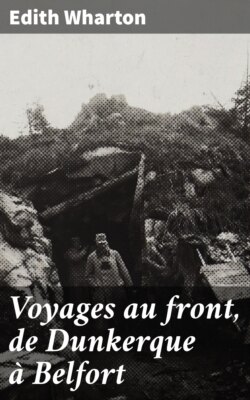Читать книгу Voyages au front, de Dunkerque à Belfort - Edith Wharton - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
Mars 1915.
Grâce à une permission de visiter quelques ambulances et hôpitaux d’évacuation derrière les lignes, j’eus, à la fin de février 1915, ma première impression de guerre.
A ce moment-là, Paris n’était déjà plus compris dans la zone militaire, ni en réalité ni en apparence. Certes, le nuage de guerre pesait encore sur la ville, mais elle était animée d’une telle activité, d’une confiance si réconfortante, que la menace cachée derrière ce sombre nuage semblait bien lointaine—lointaine par la distance autant que par le temps.
Paris, si conscient quelques mois auparavant du proche voisinage de l’ennemi, paraissait en avoir perdu la mémoire; maintenant encore, à quelques kilomètres des portes, on est frappé de passer brusquement de cette atmosphère de sécurité et de travail paisible dans une région où la guerre apparaît dans toute sa réalité.
En allant vers l’Est, on commence à s’apercevoir de ce changement, tout de suite après Meaux: entre cette tranquille cité épiscopale et la colline où s’élève Montmirail, la grande lutte du mois de septembre 1914 n’a guère laissé de traces, sauf, de temps en temps, au milieu des champs abandonnés ou fraîchement labourés, un petit monticule surmonté d’une croix avec une couronne desséchée. Pourtant, on a déjà le sentiment qu’on est dans un autre monde. En ce jour glacé de février, quand nous quittâmes Meaux pour prendre la route de l’Argonne, cette impression nous vint surtout de l’étrange absence de vie dans les villages que nous traversions. Parfois, sur le ciel d’hiver, on voyait la silhouette d’un laboureur avec sa charrue, ou bien une vieille femme ou un enfant debout sur une porte; mais la plupart des champs étaient déserts et presque toutes les portes étaient vides. Nous dépassions quelques charrettes conduites par des paysans, un vieillard qui coupait du bois dans un taillis, un cantonnier sur la route; mais plus d’automobiles civiles. Toutes celles que nous pouvions voir étaient d’un gris poussière uniforme; elles passaient comme des tourbillons, et nous y distinguions la croix rouge ou le numéro d’un corps d’armée.
A chaque pont, à chaque passage à niveau, une sentinelle barrait la route en élevant son fusil au-dessus de sa tête. Il fallait s’arrêter et montrer ses papiers.
C’était, jusque-là, à peu près la seule manifestation visible du régime militaire, manifestation presque négative; mais en descendant la première côte après Montmirail on avait subitement l’impression de tomber en pleine guerre.
Le long de la route blanche on voyait l’interminable file des automobiles militaires serpenter à perte de vue, se dirigeant vers l’Est à travers le pays accidenté, interrompue de temps en temps par la sombre masse d’un régiment en marche, ou par un train d’artillerie dont on entendait de loin les caissons résonner sur la route.
Dans les intervalles, après chaque passage de ces masses militaires, nous avions la route pour nous, quittes à nous garer parfois pour laisser passer, comme un éclair, quelque motocyclette montée par une estafette, ou une petite automobile glapissante surchargée d’officiers: apparitions bizarres avec leurs lunettes, leurs peaux de biques et leurs passe-montagnes.
Tous les villages semblaient vides—non pas au figuré mais à la lettre. Aucun d’eux n’avait réellement souffert de l’invasion allemande; à peine, par-ci par-là, une maison en ruines sur laquelle quelque vengeance accidentelle s’était exercée. Mais depuis la fuite générale en septembre 1914 ces villages avaient été abandonnés, et n’étaient plus occupés que par les troupes. De Montmirail à Châlons, tout ce riche pays n’était plus qu’un désert.
Dès l’arrivée, on se sentait électrisé par l’aspect de Châlons. La vieille ville resserrée entre le canal et la rivière servait de quartier général à une armée... non pas à un corps d’armée ou à une division, mais à une armée complète; et les vieilles rues grises qui se croisent au pied des tours romanes de Notre-Dame étaient toutes vibrantes d’activité guerrière. La place où s’élève l’hôtel au nom mirifique de «Haute-Mère-Dieu» présentait le tableau le plus complet et le plus vivant qu’il fût possible d’imaginer de la guerre moderne: les canons et les omnibus automobiles en longues files ne forment pas de groupes pittoresques comme les cavaliers d’un régiment; le bruit des motocyclettes crachant la fumée est moins romantique que le hennissement impatient des chevaux, et le métal des torpédos de course ne brille pas comme l’acier des casques et des cuirasses. Pourtant, une fois qu’on a l’œil habitué à la laideur des lignes et à l’uniformité des couleurs du nouvel appareil guerrier, on découvre tout ce qu’il y a de brillant dans une pareille scène. C’est le spectacle magnifique de tout ce qui peut se concentrer d’énergie dans un grand centre guerrier, sans que ce spectacle évoque encore la douloureuse vision où aboutira, hélas! un peu plus loin, l’élan de cette superbe énergie.
Et encore, même ici, cette vision ne nous est-elle pas pour longtemps épargnée; car on ne peut pas traverser Châlons sans rencontrer la longue procession des éclopés, sinistres épaves revenant du champ de bataille, sourds, brisés, anéantis, à moitié gelés et paralysés. C’est par milliers que ces malheureux sont renvoyés du front pour aller se soigner et se reposer, et on se sent pénétré de tristesse en les voyant se traîner misérablement, et en rencontrant les regards hébétés de ces yeux qui ont vu tant de choses que l’on n’ose pas décrire.
Si l’on pouvait ne pas voir les éclopés dans les rues, et les blessés dans les hôpitaux, Châlons offrirait un spectacle réconfortant. A notre retour à l’hôtel, l’harmonie grise des automobiles et des uniformes semblait presque étincelante sous le ciel froid d’hiver. Le va-et-vient des estafettes affairées, les ordonnances tenant en main les chevaux des officiers qui se mettaient en selle (car il y a encore des officiers à cheval), l’arrivée d’élégantes autos remplies de personnages en uniformes chamarrés de décorations, les innombrables camions gris s’en allant pour être immédiatement remplacés par d’autres, le passage des ambulances de la Croix-Rouge, ou des détachements se dirigeant vers le front—tout cela formait une vision de guerre que l’étranger civil ne pouvait se lasser de regarder.
Et à l’hôtel, quel encombrement de manteaux de fourrures et de havresacs! Dans le restaurant, autour des tables, quels groupes pittoresques et serrés de figures énergiques et bronzées!
Peu de civils peuvent arriver jusqu’à Châlons, et presque toutes les tables sont occupées par des officiers et des soldats—car, en dehors du service, il ne semble pas y avoir de distinction de rang dans cette belle armée démocratique, et un simple pioupiou a le droit de s’offrir l’ordinaire excellent de la Haute-Mère-Dieu tout comme son colonel.
Le coup d’œil est d’un intérêt sans égal. C’est un travail que d’essayer de s’y reconnaître dans les uniformes si variés. Après une semaine dans le voisinage du front on peut constater qu’il n’y a pas deux uniformes pareils dans l’armée française. Tout diffère: la coupe et la couleur. Cette question de la couleur a été un sujet de constante discussion pour les autorités militaires dans les deux dernières années: on voulait trouver un bleu invisible à distance. Pour s’assurer qu’il n’est pas un ton qui n’ait été essayé, il suffit de regarder les uniformes que les soldats portent à présent, variant du gris bleu le plus pâle au bleu marin le plus sombre. On a l’impression, il faut l’avouer, qu’il n’existe pas de bleu vraiment invisible, et que les nouvelles teintes ardoisées tirent l’œil tout autant que le bleu plus franc auquel elles ont succédé. D’autres couleurs s’ajoutent aussi à la gamme de ces bleus sans nombre: le rouge coquelicot des tuniques des spahis, et des nuances moins accusées, tel un certain drap verdâtre qu’on a peut-être fini par employer parce que les ressources du matériel d’étoffes ont été temporairement épuisées.
La coupe aussi varie: on voit des tuniques ajustées de l’ancien modèle, d’autres, copiées sur celles des Anglais, à godets et à ceintures. Et comment déchiffrer, quand on n’en a pas la grande expérience, les emblèmes désignant les grades et les différentes armes qui sont brodés sur ces uniformes? On peut, à la rigueur, reconnaître les ailes des aviateurs, la roue des automobilistes, et quelques autres symboles; mais il y en a tant: les majors, les pharmaciens, les brancardiers, les sapeurs, les mineurs, et Dieu sait combien d’éléments de cette multitude qui est en réalité la nation tout entière! Ce tableau offre autant de variétés dans les physionomies que dans les uniformes; et tous ont également leur caractère. On s’explique, à les considérer, pourquoi les Français disent en parlant d’eux-mêmes: «La France est une nation guerrière.» La guerre est le plus grand des paradoxes: elle est la plus brutale régression de l’humanité, et pourtant elle éveille dans chaque race des qualités morales qu’elle seule, semble-t-il, a le don de ressusciter. Tout dépend du genre d’émotion que la guerre réveille chez un peuple. Il suffit de jeter un regard sur les figures entrevues à Châlons pour comprendre dans quel sens la France est une nation guerrière.
Ce n’est pas trop dire que d’affirmer que la guerre a revêtu de beauté ces figures françaises, souvent spirituelles, fines, malicieuses, expressives, mais rarement douées de traits réguliers. Presque tous ces visages de soldats qui se pressent autour des tables, jeunes ou vieux, beaux ou laids, distingués ou vulgaires, ont le même caractère d’autorité et de confiance: il semble que toutes les nervosités, les agitations, les petits égoïsmes et les mesquineries personnelles aient disparu au contact d’une grande flamme de patriotisme. C’est un merveilleux exemple de la rapidité avec laquelle l’apparence même des hommes peut être transformée par la noblesse de leur idéal.
Sans doute, la déclaration de guerre avait-elle trouvé beaucoup de ces hommes attelés à des besognes médiocres, vaines ou frivoles. Aujourd’hui, chacun d’eux, pour modeste que puisse être sa tâche, prend sa part d’une œuvre immense: il en a conscience, et par là même se sent grandi.
La route, en quittant Châlons, continue au nord à travers les collines de l’Argonne. Encore des pays déserts: des soldats musent sur les portes où jadis des vieilles filaient leurs quenouilles, d’autres soldats baignent leurs chevaux dans la mare du village, ou font la soupe dans les cours des fermes. Encore des soldats dans les boqueteaux sur le bord de la route; ceux-ci abattent de jeunes sapins, les coupent à des longueurs égales, et empilent les troncs sur des charrettes en les recouvrant de leurs branches vertes. Nous ne tardâmes pas à voir à quel usage ces sapins étaient destinés. A chaque carrefour, à chaque pont de chemin de fer, une guérite faite de boue, de paille et de branches de sapin enchevêtrées était collée au talus, ou soudée comme un nid d’hirondelles dans un coin abrité.
Un peu plus loin nous commençâmes à rencontrer de grands parcs d’artillerie de plus en plus rapprochés. C’étaient des groupes de 75, nez à nez, généralement dans un champ abrité par un bois, à quelque distance de la route, et toujours accolés à une rangée de lourds camions automobiles. Les 75 ressemblaient à des gazelles géantes paissant au milieu d’un troupeau d’éléphants, et les écuries, construites à côté avec des branches de sapin tressées, eussent pu passer pour les abris de leurs gigantesques gardiens.
Le pays, entre Marne et Meuse, est l’un de ceux où la fureur des Allemands s’est exercée avec le plus de sauvagerie pendant ces sinistres journées de septembre 1914. A mi-route, entre Châlons et Sainte-Menehould, nous vîmes les premiers témoignages de l’invasion: c’étaient les pitoyables ruines du village d’Auve.
Ces souriants villages de l’Aisne se ressemblent tous, avec leur grand’rue bordée de maisons aux bois apparents, avec les hauts toits de leurs granges et leurs pignons tapissés d’espaliers. On s’imagine donc facilement ce que pouvait être Auve, sous la lumière bleue de septembre, au milieu de ses vergers mûrissants et de ses récoltes blondes se déroulant jusqu’à un horizon de collines boisées. Aujourd’hui ce n’est plus qu’un chaos de gravats et de scories. A peine peut-on distinguer la place qu’occupait chaque maison. Nous avons vu, par la suite, bien d’autres villages ravagés; mais Auve était le premier. Peut-être est-ce pour cela que nous y fûmes, plus qu’ailleurs, hantés par la vision de toutes les angoisses, de toute la terreur et de tous les déchirements que représentent les ruines de la plus chétive bourgade. De tous les mille et un petits souvenirs qui rattachent le passé au présent—photographies accrochées aux murs, buis bénits pendus au crucifix, lettres écrites d’une main malhabile et lues avec effort, robes de mariées pieusement gardées au fond de vieilles malles—de tout cela il ne reste qu’un tas de briques calcinées et quelques bouts de tuyaux tordus par l’incendie...
En consultant notre carte, aux environs de Sainte-Menehould, nous constatâmes que derrière la ligne des collines parallèle à la route, à 12 ou 15 kilomètres au nord, les deux armées étaient aux prises. Mais nous n’entendions pas encore le canon, et rien ne nous révélait le voisinage très proche de la lutte, quand, à un détour de la route, nous nous trouvâmes en face d’une longue colonne de soldats vêtus de gris. C’étaient des prisonniers qui s’avançaient vers nous entre deux rangs de baïonnettes. Ils venaient d’être pris: jeunes gars vigoureux, bâtis pour le combat, ne paraissant, hélas! ni affamés ni exténués. Leurs larges visages blonds étaient sans expression: visages clos, ne témoignant ni arrogance ni abattement. Ces vaincus ne semblaient nullement affligés de leur sort.
Notre laissez-passer du grand quartier général nous mena jusqu’à Sainte-Menehould, aux confins de l’Argonne, où il fallut nous arrêter au quartier général de la division pour obtenir la permission d’aller plus loin.
L’état-major était logé dans une maison qui avait eu beaucoup à souffrir de l’occupation allemande et on y avait improvisé des bureaux à grand renfort de cloisons. On nous fit asseoir dans un de ces bureaux de fortune, sur un vieux canapé de damas éraillé. Au mur, des affiches de théâtres, et en face, un lit avec une courtepointe de soie prune. Tout en attendant, nous entendions la sonnerie du téléphone, le bruit sec d’une machine à écrire, le ton d’une voix dictant des lettres, au milieu d’un va-et-vient continuel d’estafettes et d’ordonnances.
La prolongation nous fut enfin accordée, mais on nous pria de gagner au plus tôt Verdun, la route, ce jour-là, n’étant pas ouverte aux automobiles particulières. Cet avis, aussi bien que l’activité prévalente au quartier général, nous donna à penser qu’il devait se passer quelque affaire d’importance derrière la ligne des collines bordant la route au nord. Nous devions bientôt savoir de quoi il s’agissait.
Nous quittâmes Sainte-Menehould vers onze heures, pour arriver avant midi à un village situé sur une hauteur qui dominait tout le pays d’alentour. L’aspect des premières maisons n’avait rien d’anormal: mais la grande rue, après une descente et un tournant, déboucha sur une longue perspective de ruines désolées, restes calcinés de ce qui fut le riant village de Clermont-en-Argonne, mis à mal par les Allemands au début de la guerre. La situation pittoresque de ce petit bourg, au sommet d’une colline, fait paraître plus lamentable encore l’aspect de ses ruines. Il domine tout le pays; et, à travers les frêles arceaux de son église saccagée, on découvre un si radieux paysage! Le charme paisible du lieu a dû ajouter un attrait de plus à la frénésie de destruction des envahisseurs.
A l’autre extrémité de ce qui fut la grande rue s’élève encore un petit groupe de maisons dominé par l’hospice des vieillards. Sœur Gabrielle, qui le dirige, n’a pas quitté ses pensionnaires au moment de la grande panique qui a mis en fuite tous les habitants de Clermont: depuis lors, elle y a recueilli et soigné les blessés qui ne cessent de lui arriver du front voisin. Nous trouvâmes sœur Gabrielle en train de préparer, avec ses religieuses, le déjeuner des malades dans la petite cuisine de l’hospice—cuisine qui lui sert en même temps de salle à manger et de cabinet de travail. Elle insista pour nous offrir une part du repas préparé pour ses vieux, et nous raconta, pendant que nous déjeunions, l’histoire de l’invasion: les soldats allemands enfonçant les portes à coups de crosse, les officiers faisant irruption revolver au poing dans le grand vestibule voûté où elle se tenait parmi ses vieux et ses religieuses.
Sœur Gabrielle est petite, plutôt forte, et pleine d’activité. Sa figure rappelle ces visages vermeils et malins qui se détachent sur les fonds sombres de certains tableaux flamands. Ses yeux sont pleins d’une ardente vivacité, et il y a dans son récit autant de gaieté que de colère. Elle n’épargne pas les épithètes quand elle parle de ces «satanés Allemands»: les religieuses et les infirmières du front ont vu trop de choses pour ménager leurs termes. Malgré toute l’horreur des sinistres journées de septembre, alors que Clermont n’était qu’un vaste brasier, et que ceux des habitants qui n’avaient pas fui étaient à tout instant menacés de mort, aucun des petits détails de la vie quotidienne n’avait échappé à la sœur Gabrielle. Elle nous racontait, par exemple, son embarras pour s’adresser au commandant, «si grand», disait-elle, qu’elle ne pouvait pas voir ses pattes d’épaules. «Et ils étaient tous comme ça», ajoutait-elle avec une petite lueur de gaieté dans les yeux.
Une sœur venait de desservir et nous versait le café, quand une femme entra et nous dit, comme la chose la plus simple du monde, qu’on se battait ferme de l’autre côté de la vallée. Elle ajouta tranquillement, en commençant à laver la vaisselle, qu’un obus venait de tomber tout près de là, et que, si nous voulions traverser la rue, nous pourrions voir la bataille du jardin en face. Nous ne fûmes pas longs à nous y rendre. Sœur Gabrielle nous montra le chemin, montant quatre à quatre les marches de la maison d’en face, et nous rejoignîmes, haletants, un groupe de soldats sur une terrasse gazonnée.
Le canon tonnait sans répit, et nous semblait si proche que nous ne pouvions comprendre comment la colline que nous avions sous les yeux pouvait avoir conservé son paisible aspect de tous les jours. Mais quelqu’un nous prêta une longue-vue, et subitement il nous fut donné de voir nettement tout un coin de la bataille de Vauquois. C’était l’assaut des pentes par l’infanterie française: en bas les traînées de fumée flottant au-dessus des batteries françaises, et au fond, sur les crêtes boisées se profilant sur le ciel pâle, les éclairs rouges et les panaches blancs des pièces allemandes.—Pan! pan! Les canons se répondaient, tandis que l’infanterie, escaladant la côte, s’engouffrait dans le taillis strié de la lueur des coups. Et nous restions là, muets de saisissement de nous trouver, par le plus imprévu des hasards, témoins de l’une des rares luttes visibles de cette guerre souterraine.
Sœur Gabrielle, pour habituée qu’elle fût à de pareils spectacles, suivait avec le plus vif intérêt les péripéties de la lutte. Debout à nos côtés, bien d’aplomb dans la boue gluante, elle tenait la jumelle aux yeux, ou la faisait passer en souriant aux soldats qui l’entouraient. Mais lorsque nous prîmes congé d’elle, son beau sourire s’était éteint, et elle nous dit tristement: «Nous venons de recevoir l’ordre de tenir quatre cents lits prêts pour ce soir...»
La sinistre réalité devait singulièrement dépasser le chiffre annoncé; car, nous l’apprîmes quinze jours plus tard par un communiqué de trois colonnes, la scène à laquelle nous venions d’assister n’était rien moins que le premier acte de la brillante attaque de Vauquois. Ce village haut perché constituait, en effet, une position à laquelle les Allemands attribuaient une extrême importance, en raison de l’abri qu’elle assurait à leurs mouvements au nord de Varennes, et du fait qu’elle commandait la voie ferrée qui, depuis septembre 1914, apportait à leurs armées en Argonne munitions et ravitaillements.
Ils avaient pris Vauquois à la fin de septembre, et, tirant parti de la crête rocheuse où le village est construit, en avaient fait une place presque imprenable. Pourtant les Français, le 28 février, avaient réussi à atteindre le point culminant, et s’étaient emparés d’une partie du village. C’est cette attaque que nous avions pu voir du haut du jardin de Clermont.
Chassées ce même soir par une contre-attaque des positions conquises, les troupes françaises devaient les reprendre de haute lutte après cinq jours de combats. Depuis lors, elles s’y sont maintenues dans une position que l’état-major a définie comme étant de première importance pour les opérations à venir. «Mais à quel prix!» nous disait sœur Gabrielle quand nous la revîmes dix jours plus tard...