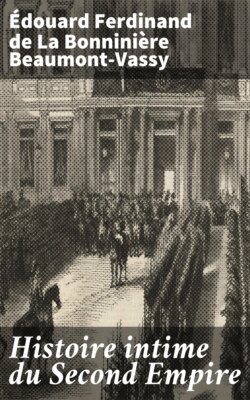Читать книгу Histoire intime du Second Empire - Edouard Ferdinand de la Bonninière Beaumont-Vassy - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеTable des matières
Première réunion à Compiègne après la proclamation de l’Empire. — C’est encore un ménage de garçon. — Aspirations de l’entourage à toutes les fonctions brodées de la future cour. — La marquise de Contades. — Son esprit et son influence. — Payement d’une ancienne dette. — Deux invitées à sensation. — Rumeurs et commentaires. — Inquiétudes de MM. de Morny et de Persigny. — Leur double démarche auprès de Napoléon III. — Ils échouent. — Opinion de M. Mocquard. — Décision de l’Empereur. — Le bouquet de violettes. — Annonce du mariage. — Couplets satiriques. — Soirée chez mademoiselle Constance. — Envoi d’un volume de Florian. — Préparatifs du mariage. — On veut éloigner miss Howard. — Son départ de Paris et son prompt retour. — La comtesse de Beauregard. — Dernière entrevue. — Le mariage. — Les épithalames.
La première réunion à Compiègne qui suivit la proclamation du second Empire ne fut pas réglée avec autant de minutie et d’étiquette que celles qui vinrent après. C’était tout simple; on en était encore au ménage de garçon. La maison n’était pas encore complétée et le pauvre Bacciochi avait un mal affreux à conduire sa barque au milieu des demandes, des réclamations et des exigences de toute sorte dont il était accablé.
On s’y préoccupait beaucoup, du reste, de cette formation de la maison civile du nouvel Empereur, qui très-probablement serait promptement suivie de celle d’une maison de l’Impératrice, puisque M. Troplong avait glissé dans son rapport l’expression engageante du désir «que dans un avenir peu éloigné une épouse vînt s’asseoir sur le trône qui allait s’élever et qu’elle donnât à l’Empereur des rejetons dignes de lui, dignes du pays.»
On ne rêvait donc dans l’entourage et parmi les familiers que de clefs de chambellans, de costumes d’écuyers et de préfets du palais; on allait même jusqu’à renouveler en imagination la jolie institution des pages, que Napoléon 1er n’avait pas dédaignée. J’ai connu un brave gentilhomme qui, possédant un fils dont les aptitudes en fait d’équitation donnaient déjà plus que des espérances, accourut à Compiègne pour solliciter par avance du nouveau souverain l’admission de ce jeune homme dans le corps des pages qui ne pouvait manquer d’être rétabli. «Des pages? en aurons-nous?» lui répondit Napoléon III en tournant sa moustache; et ce manque d’enthousiasme pour une institution qui lui semblait si nécessaire mécontenta fort son interlocuteur.
La marquise de Contades, fille du vieux général de Castellane, lequel allait dans un avenir très-rapproché recevoir le bâton de maréchal de France, animait de son esprit et de sa verve cette cour naissante où l’imagination marchait si vite et où l’on faisait tant de projets. Elle y exerçait une véritable influence et y recommanda au choix de l’Empereur plusieurs des futurs titulaires de sa maison civile, tels que chambellans et écuyers. Les premières journées de ce séjour à Compiègne, dont la fin devait être si curieusement marquée par la décision matrimoniale de l’Empereur, avaient vu la solution définitive d’une affaire d’argent assez singulière elle-même:
Louis-Napoléon avait en 1848, pour les frais de son élection et probablement avec la pensée que l’emploi de cet argent serait fructueux, emprunté une somme considérable, soixante mille écus romains, c’est-à-dire, trois cent vingt-quatre mille francs, au marquis Pallavicini, lequel avait pris hypothèque sur les domaines du prince situés dans les États pontificaux, près de Civita-Nova. Il avait été convenu que le remboursement de la somme totale n’aurait pas lieu avant le 15 janvier 1851, afin que le marquis Pallavicini pût, durant cet espace de temps, trouver pour ses fonds un placement convenable.
Mais le 15 janvier 1851, Louis-Napoléon n’était pas en mesure de rembourser son créancier. Il demanda plusieurs fois des délais, et le marquis Pallavicini finit par nommer le duc de Galliera son mandataire spécial pour toucher, en son nom, des mains du prince, les trois cent vingt-quatre mille francs, qui ne purent être intégralement rendus qu’en 1852.
On prétend qu’avant le coup d’État, le prince; causant avec M. Mocquard et quelques familiers, aurait dit qu’il ne serait pas impossible qu’il quittât l’Élysée pour la prison de Clichy, alors existante; ajoutant en riant: «J’ai toujours été habitué à avoir un factionnaire à ma porte.» Était-ce aux trois cent vingt-quatre mille francs du marquis Pallavicini qu’il faisait allusion alors? il avait d’ailleurs d’autres dettes que celle-là et plus urgentes encore, peut-être.
Mais bientôt, à Compiègne, tous les esprits, toutes les imaginations, absorbés jusque-là par des questions de détail souvent puériles, se concentrèrent fiévreusement sur un fait d’une importance capitale, et digne assurément d’inspirer l’émotion générale qu’il produisait.
Deux étrangères avaient été invitées à Compiègne et pour un certain nombre des personnes présentes c’étaient des inconnues. Il fallait, en effet, avoir fréquenté les salons du dernier règne, surtout les salons des grandes ambassades, pour se rappeler ces nouvelles venues à la cour de Napoléon III, qui lui-même, alors que toute la haute société les connaissait si bien, n’avait fait que les entrevoir une fois avant le voyage de Compiègne.
Ces deux invitées à sensation n’étaient autres que madame de Montijo et sa fille Eugénie, jeune Espagnole exceptionnellement douée au point de vue de la beauté et de la grâce, d’abord entrevue dans le grand monde diplomatique, plus répandue ensuite et ayant même, par l’effet naturel du charme de ses relations, su se créer à Paris quelques solides et sincères amitiés.
La comtesse de Montijo était la fille de M. Kirkpatrick, autrefois consul d’Angleterre dans un port d’Espagne; fort jolie dans sa jeunesse, elle avait épousé, un peu par hasard, le comte de Téba, cadet d’une grande famille espagnole, devenu comte de Montijo à la mort de son frère aîné, et elle en avait eu deux filles. L’une était devenue duchesse d’Albe et de Berwick en s’alliant au rejeton d’une des vieilles et nobles maisons de la Péninsule. Elle est morte à Paris en 1860. L’autre, par un jeu singulier et frappant de la destinée, devait s’asseoir sur le trône de France et en prendre, pour ainsi dire, possession de par le droit de la beauté.
Il faut bien le dire, le cadre dans lequel se produisait tout à coup cette individualité charmante était merveilleusement propre à en faire valoir les perfections. Ce mouvement, ces chasses que mademoiselle de Montijo suivait avec tant d’ardeur et d’habileté, car, même à côté de la marquise de Contades, entreprenante amazone, elle brillait, à cheval, par sa grâce et son intrépidité ; ces spectacles, ces petits bals intimes qui terminaient des journées si remplies, tout semblait réuni pour faire ressortir sa supériorité féminine. La sympathie naissante de Napoléon III pour la belle étrangère n’échappa pas longtemps aux regards et aux commentaires des invités, parmi lesquels se trouvaient plusieurs des membres de la famille impériale, entre autres les princesses Mathilde et Murât, les princes Napoléon, Murat et Lucien Bonaparte. Chacun se montrait naturellement très-attentif à tous les développements, à toutes les péripéties de celle romanesque aventure. MM. de Morny et de Persigny commencèrent à s’en inquiéter. M. de Persigny, le premier, s’en expliqua avec Napoléon III. Il le suivit un soir dans sa chambre à coucher au moment où il se retirait et commença à faire en plaisantant une allusion directe à la passion nouvelle de son maître. La physionomie froidement sévère de Napoléon III l’arrêta sur-le-champ. Il vit que le cas était sérieux et résolut aussitôt de tenter une attaque sérieuse. M. Fialin de Persigny, le compagnon des mauvais jours, avait, dans l’intimité, l’habitude de tutoyer son impérial ami.
Ses observations, qu’il voyait mal reçues, prirent un caractère de plus en plus violent a mesure qu’il s’animait, et en dépit de la présence dans un cabinet voisin du valet de chambre de l’Empereur.
Il réunit toutes les objections qui pouvaient être présentées, même celles résultant des cancans et commérages débités si légèrement sur le compte de mademoiselle de Montijo dans toutes les ruelles et dans tous les cercles, commérages basés sur le laisser aller de son éducation première, suivie de l’existence nomade, aux eaux, dans les hôtels, dans les lieux publics, à travers laquelle madame de Montijo avait promené la jeunesse de sa fille.
Voyant que ce genre d’arguments échouait complétement, M. de Persigny, saisissant son interlocuteur par le boulon de son. habit, alla jusqu’à lui dire; «Ce n’était ma foi pas la peine que tu fisses le coup d’État pour finir d’une telle façon.»
Cette scène avait été très-vive, et les éclats de la voix de M. de Persigny s’étaient même fait entendre au dehors, dans les couloirs du palais. M. de Morny reprit la même thèse le lendemain matin, mais avec le calme, la mesure d’un homme d’État doublé d’un homme de cour. Ses arguments furent surtout politiques, et il a dit depuis qu’une des meilleures raisons qu’il eût trouvées était de dire à l’Empereur que, puisqu’il n’attachait pas d’importance à ce que sa future épouse sortît d’une famille plus ou moins souveraine, mieux valait cent fois la prendre dans les rangs de la noblesse française que dans ceux de la noblesse étrangère. Inspirées par un zèle éclairé, présentées avec la modération qui lui était ordinaire, ces objections de M. de Morny ne produisirent aucun effet sur l’esprit de Napoléon III. Ce dernier parla un instant de l’impératrice Joséphine, puis ne répondit plus. Ce qu’il ne disait pas et ce que son interlocuteur devinait très-bien, c’était la passion violente qui le dominait.
Si quelqu’un de son entourage avait pu, en cette circonstance grave, exercer sur son esprit une influence sérieuse, c’eût été cependant le comte, depuis duc, de Morny. Curieuse figure historique que celle de ce personnage complexe, homme d’énergie et d’action sous les agréables apparences et le vernis du mondé, nature parfaitement organisée pour les grandes affaires, et réunissant toutes les séductions, toutes les forces. du pouvoir. Jamais ministre de l’intérieur ne rédigea mieux une dépêche aux agents supérieurs de son administration; jamais, dans l’exercice de l’autorité, on ne donna des ordres plus pratiques et plus précis; vigueur, initiative, sûreté de coup d’œil, sang-froid et, encadrant tout cela, une sorte d’aisance élégante qui trahissait toujours l’homme de salon, tel était l’ensemble de ses qualités gouvernementales. Type particulier du gentilhomme financier qui n’existait pas autrefois, mais que les mœurs actuelles expliquent, M. de Morny a trouvé dans les partis de très-violents détracteurs. On lui a reproché, et souvent très-amèrement, de s’être trop complaisamment engagé dans les affaires industrielles et financières, et le fait est qu’il est allé très-loin dans cette voie et a quelquefois dépassé les limites permises à un homme politique; mais, en même temps, tous étaient forcés de confesser son énergique habileté et la dignité de sa conduite au moment où parut le déplorable décret concernant les biens de la famille d’Orléans.
Dans tous les cas, il ne réussit pas mieux auprès de Napoléon III que l’irrascible et bizarre Persigny, qui l’avait si mal remplacé au ministère de l’intérieur.
De tous ces conseillers intimes de Napoléon III, le chef de son cabinet, M. Mocquard, fut, on ne sait pourquoi, le mieux disposé, dès le principe, à admettre favorablement le choix que l’Empereur semblait faire. Peut-être, avec sa finesse ordinaire, avait-il compris tout d’abord qu’il serait au moins inutile de lutter contre une résolution déjà formée dans l’esprit de son maître, dont il connaissait le caractère autant qu’il était possible de le connaître. Je reviendrai ultérieurement sur cette figure très-intéressante du chef du cabinet de Napoléon III, pour signaler le rôle si important qu’a joué M. Mocquard et l’influence occulte, mais considérable, qu’il a exercée sur les décisions politiques et privées du règne.
La résolution de l’Empereur, en ce qui touchait ce mariage, était bien prise, en effet; il cédait à sa passion que les obstacles ne faisaient qu’irriter. L’issue de cette intrigue matrimoniale ne fut bientôt plus douteuse pour personne, et, un soir, comme on dansait, sans cérémonie, dans la galerie des Chasses, mademoiselle Eugénie de Montijo s’étant embarrassée dans les plis de sa longue robe et ayant fait une chute sans gravité, l’expression d’inquiétude qui se manifesta soudain sur le visage ordinairement impassible de Napoléon III, ne put que confirmer la nature et la vivacité de ses sentiments dans l’esprit de toutes les personnes qui assistaient à cette petite scène, au nombre desquelles je me trouvais moi-même. Un bouquet de violettes, offert par Napoléon III au moment d’un dîner, fut le signe convenu entre les deux éminents personnages de l’irrévocable décision prise par lui d’épouser la comtesse de Téba et de l’associer à ses futures destinées. Assurément, ni l’un ni l’autre ne voyait alors de nuage dans son horizon; pas même un de ces «points noirs» qui ont tant égayé l’Europe dans les dernières années de l’Empire.
De Compiègne, la grande nouvelle se répandit bien vite jusqu’à Paris, où elle fut assez diversement accueillie. La haute société, légitimiste et orléaniste, railla et fit des bons mots. La bourgeoisie étonnée échangea sourdement des objections qui n’étaient pas exemptes de malveillance: une Espagnole sur le trône! L’influence cléricale n’allait-elle pas apparaître sous peu et n’allait-on pas entrer dans la voie de tout sacrifier aux intérêts catholiques? On sait que c’est là un grand épouvantail pour la classe moyenne à Paris, et puis on faisait remarquer que la nouvelle Impératrice n’apportait avec elle ni alliances politiques ni dot princière. Sa beauté, dont on parlait beaucoup déjà, voilà tout ce qu’elle avait à échanger contre une couronne. C’était assurément quelque chose, disaient les sceptiques; on comptait aussi sur une énergie dont la jeune femme paraissait capable et qui pourrait un jour se trouver une qualité précieuse chez la compagne de Napoléon III.
Quant au peuple, auquel le romanesque n’a jamais déplu, habitué à voir dans les féeries les rois se marier selon leur cœur, sauf, au besoin, à épouser des bergères, estimant que la plus belle était la plus digne de s’asseoir sur le trône, à leur côté, il partageait assez cet avis, et voyait là un abandon des traditions qui ne lui déplaisait pas.
La famille de l’Empereur, pour laquelle il avait déjà tant fait, s’inclina d’assez bonne grâce devant sa volonté, sauf le prince Napoléon. Sa sœur, la princesse Mathilde, plus sensée et plus dévouée, dit, à propos du prochain mariage de son cousin: «Les sœurs de Napoléon Ier ont fait des difficultés pour porter la traîne de la robe de l’Impératrice lors de la cérémonie; quant à moi, je n’en ferai certainement aucune.»
Et pendant que l’on préparait les communications officielles à faire aux grands corps de l’État, la verve railleuse des adversaires se répandait dans toutes les sphères sociales en diatribes, en jeux de mots, en couplets. Le déchaînement des colères sourdes fut même plus grand, à cette époque, qu’il ne l’avait été après le coup d’État. On fit circuler ces quatrains d’origine inconnue:
Chacun son goût et sa marotte:
Les cheveux roux sont en faveur,
Rien ne peut plaire au carotteur.
Autant que la couleur carotte.
Et cet autre après la célébration du mariage:
Depuis que de César, en ses sacrés parvis,
Un archevêque a béni l’amourette,
Notre-Dame de Paris,
C’est Notre-Dame de Lorette.
Tout le monde connaît la chanson populaire qu’on répandit dans les faubourgs, qu’on osa même coller, une nuit, sur les murs des Tuileries, et qui commence par ce couplet:
Amis du pouvoir,
Voulez-vous savoir
Comment Badinguette,
D’un coup de baguette,
Devint par hasard
Madame César?
On m’a dit que l’auteur de cette chanson, fort peu littéraire d’ailleurs, et pleine de grossiers défauts de versification, était un ouvrier ou contre-maître des faubourgs. J’ai vainement cherché à approfondir ce mystère. La légende veut qu’après l’audacieuse apposition de son œuvre sur les murs des Tuileries, il ait été découvert et arrêté par la police, puis transporté à Cayenne. Rien de certain sur ce point.
Il y eut à cette époque une soirée donnée par mademoiselle Constance, l’actrice, et où se trouvaient réunies bon nombre de celles des princesses de la rampe qui avaient paru dans les parties galantes de Compiègne et de Saint-Cloud. Dans un moment d’épanchement, l’une des plus séduisantes de ces dames dit naïvement à sa voisine: «Ah! ma chère, si j’avais su! — Et moi donc! reprit son interlocutrice. — Si nous avions su! ajoutèrent en chœur un certain nombre d’entre elles. — Eh bien! si vous aviez su? demanda un auteur dramatique qui se trouvait là, que serait-il donc arrivé ? — Il serait arrivé que l’une de nous serait Impératrice. — Oui, mais vous ne saviez pas. — Hélas! mais nous pouvons nous venger. — Ah! par exemple expliquez-moi cela. — C’est bien simple: j’ouvre une souscription pour acheter le plus bel exemplaire qui existe des amours d’Estelle et de Némorin, par M. de Florian. Nous le ferons relier en superbe chagrin noir et nous marquerons à l’intérieur du volume, avec un ruban vert, comme ceux dont les bergers amoureux ornent leurs chapeaux, à la page 57, le passage suivant: «Bientôt Némorin connut toute la violence du feu qui le dévorait, mais il n’était plus temps de l’éteindre.»
«Tout dit, craignez de perdre un jour
De la belle saison d’amour;»
et nous enverrons le volume au nouvel époux.»
On m’a assuré que le livre relié en chagrin noir était parvenu à l’Empereur, mais l’envoi ne fut naturellement pas signé, et pour cause.
En présence des grands corps de l’État, Napoléon III prononça ces paroles: «Quand, en face de la vieille Europe, on est porté par la force d’un nouveau principe à la hauteur des anciennes dynasties, ce n’est pas en vieillissant son blason et en cherchant à s’introduire à tout prix dans la famille des rois qu’on se fait accepter, c’est bien plutôt en se souvenant de son origine, en conservant son caractère propre et en prenant franchement vis-à-vis de l’Europe la position de parvenu, titre glorieux lorsqu’on parvient par le libre suffrage d’un grand peuple.» Ce fier langage avait un grand défaut, celui de n’être pas conforme à la réalité des faits. L’Europe à laquelle on s’adressait se rappelait fort bien que c’était après avoir frappé à bien des portes princières qui ne s’étaient point ouvertes, quel Empereur avait songé à l’alliance matrimoniale qu’il concluait en se donnant la qualification de parvenu. Celle qualification elle-même, qui pouvait (quoique ce ne fût pas dans l’intention du nouvel Empereur des Français) paraître quelque peu provoquante aux yeux des vieilles dynasties de l’Europe, cette qualification elle-même était fort discutable; car, lorsqu’on prenait le nom de Napoléon III, lorsqu’on se posait, par conséquent, comme successeur des deux premiers Napoléons, il n’était guère possible de se vanter de n’être qu’un parvenu.
Mademoiselle de Montijo et sa mère avaient, depuis la notification officielle du mariage, été installées au palais de l’Elysée. Là, elles ne recevaient plus qu’un nombre assez restreint de leurs anciennes connaissances, qui toutes, naturellement, saluant le soleil levant, seraient aisément devenues ambitieuses et gênantes. Parmi les exceptions se trouvait madame Gould, femme d’un négociant anglais qui avait fait fortune en Portugal et s’était retiré des affaires en venant habiter Paris. C’était une amie d’assez vieille date, à laquelle la comtesse de Téba, devenue Impératrice, fit don, ne pouvant pas la nommer dame du palais, comme madame Gould l’aurait désiré, disait-on, d’un superbe médaillon orné de son portrait, preuve ostensible de son amitié, que madame Gould paraissait très-fière de porter.
Les Rothschild, les Aguado faisaient partie des élus, ainsi que cet affreux Mérimée, affreux, non pas au physique, car c’était au contraire un fort bel homme, mais au moral, à cause de ce scepticisme égoïste qu’il ne prenait même pas la peine de dissimuler et qui faisait le fond de son caractère. Quoiqu’il fût dès cette époque extrêmement intime et assidu, on ne disait pas encore, cependant, qu’il eût épousé secrètement madame de Montijo. Si ce bruit fût alors parvenu aux oreilles de l’Empereur, cela l’aurait-il arrêté dans l’exécution de son dessein? On peut dire qu’avec son caractère il eût peut-être été ébranlé par cette considération plus que par toutes les raisons politiques si chaleureusement développées devant lui. Mais de là à dominer entièrement sa passion il y avait encore bien loin.
La maison de l’Empereur et celle de la future souveraine devaient être bientôt composées et formées selon les traditions du premier Empire. Par un décret en date du 51 décembre 1852, furent nommés dans la maison de l’Empereur: premier aumônier, l’évêque de Nancy, monseigneur Darboy, la future victime des fureurs de la Commune de Paris en 1871, singulier et triste rapprochement! grand maréchal du palais, le maréchal Vaillant; premier préfet du palais, le colonel, depuis général de Béville, tout naturellement désigné à la faveur de Napoléon III par l’habileté et la discrétion avec lesquelles il avait, au 2 décembre, accompli la délicate mission de porter les décrets à l’imprimerie nationale et de les faire imprimer sous ses yeux; grand chambellan, le duc de Bassano, qui, pour cette haute position de cour, abandonnait le poste de ministre de France à Bruxelles; choix heureux sous tous les rapports, car le duc et la duchesse de Bassano, née d’Hoogworst, et morte aujourd’hui, ont rendu par leurs formes pleines d’aménité et de courtoisie de véritables services au gouvernement impérial; premier chambellan, le comte Bacciochi; grand écuyer, le maréchal de Saint-Arnaud; imitation du premier Empire, où plusieurs des grandes charges de cour étaient remplies par des maréchaux dont ces sinécures dorées doublaient presque les appointements; premier écuyer, le colonel, depuis général Fleury; souvenir naturel d’un dévouement qui en a fait le Junot du second Empire; grand veneur, le maréchal Magnan; premier veneur, le colonel, depuis général Edgard Ney; grand maître des cérémonies, le duc de Cambacérès, l’aîné des neveux de l’archi-chancelier, ancien pair de France sous Louis-Philippe, nom qu’il était tout simple, d’ailleurs, de retrouver parmi ceux des dignitaires du nouvel Empire. Des chambellans, des préfets du palais, des maîtres et aides des cérémonies, des aides de camp, officiers d’ordonnance et écuyers complétaient la maison civile et la maison militaire de l’Empereur.
Au milieu des préoccupations que lui causaient tous les arrangements intérieurs et les préparatifs que nécessitait la réalisation du grand acte qu’il allait accomplir, une idée dominait la pensée de Napoléon III; c’était celle d’éloigner miss Howard qui, grâce à la discrétion du petit cercle dont elle était entourée, en était encore à ignorer tout. Il chargea le fidèle M. Mocquard d’aller trouver son ancienne maîtresse et de lui persuader de faire un voyage à Londres pour s’y aboucher avec un certain Jack-Young-Fitzroi, qui tenait une sorte de cercle que Louis-Napoléon avait fréquenté durant son séjour en Angleterre, et qui prétendait avoir des lettres de lui qu’il saurait publier au besoin. M. Mocquard devait offrir à miss Howard de l’accompagner dans ce voyage. Ils partirent ensemble, en effet; mais, arrivée à Boulogne, miss Howard ayant lu dans un numéro du Moniteur qui venait de paraître un article relatif au mariage de l’Empereur avec la comtesse de Téba, elle comprit qu’on voulait l’éloigner et qu’elle était dupe d’une mystification; il y eut là une scène violente; en dépit des prières et même des menaces de Mocquard, qui voulait absolument l’embarquer pour l’Angleterre, miss Howard reprit le chemin de Paris, où elle rentra dans son hôtel de la rue du Cirque. Là, une nouvelle surprise l’attendait: elle trouva deux de ses meubles forcés. Ces meubles renfermaient des papiers secrets d’une grande importance pour elle, notamment sa correspondance avec Louis-Napoléon; ce dernier, redoutant la colère de son ancienne maîtresse en apprenant son mariage, avait prudemment fait enlever par la police des documents qui auraient pu devenir compromettants pour lui.
Miss Howard épuisa sa colère en vaines déclamations. «Si l’Empereur, disait-elle, s’alliait à quelque maison souveraine, s’il épousait une princesse de sang royal, je ne me plaindrais pas.» Plaintes inutiles et regrets superflus; l’Empereur, qui avait été instruit de suite de son retour à Paris, crut cependant devoir faire quelque chose pour la calmer; il lui envoya dire qu’il la faisait comtesse de Beauregard et lui donnait la terre et le château de ce nom. Il ne s’en tint pas là, d’ailleurs, pour acquitter sa dette de reconnaissance envers une femme qui avait engagé sa fortune pour la réussite du coup d’État, et avait plusieurs fois tiré Napoléon III d’une situation difficile, notamment en 1851, en acquittant des billets protestés chez Montaut, changeur au Palais-Royal. Voici, du reste, la note manuscrite trouvée aux Tuileries après le 4 septembre 1870:
«J’avais promis 3 millions, plus les frais d’arrangement de Beauregard, que j’évaluais tout au plus à 500,000 francs.
Cette note, écrite de la main de l’Empereur, fixe absolument l’opinion sur la quotité des sommes reçues par miss Howard, à laquelle son titre et sa fortune ne profitèrent guère, par parenthèse, car après avoir épousé à Florence un homme qui la rendit très-malheureuse, elle voulut revoir Paris en 1865, et y mourut subitement celte même année.
Peu de temps après le mariage de l’Empereur, et après en avoir reçu le titre de comtesse; elle s’était décidée à se rendre en Angleterre afin de disparaître un moment aux regards curieux et railleurs des adversaires de l’Empire. Elle écrivit alors à Napoléon III la lettre suivante: «Sire, je vais partir. Je me serais aisément sacrifiée à une nécessité politique, mais je ne puis vraiment vous pardonner de m’immoler à un caprice. J’emmène avec moi vos enfants (c’étaient ceux de la blanchisseuse de Ham qu’elle élevait) et, nouvelle Joséphine, j’emporte votre étoile; je sollicite seulement une dernière entrevue pour vous faire un adieu éternel. J’espère que vous voudrez bien ne pas me la refuser.»
Cette lettre lui avait été très-probablement dictée. Dans tous les cas, sa demande fut exaucée: l’Empereur se rendit incognito rue du Cirque et eut un dernier entretien avec celle qui si longtemps avait été pour lui une providence.
Revenons au mariage.
Après avoir constitué une maison civile de l’Empereur, on s’occupa de celle de l’Impératrice. Elle fut d’abord composée: d’une grande maitresse, la princesse d’Essling; d’une dame d’honneur, la duchesse de Bassano; de six dames du palais, mesdames Gustave de Montebello, Feray, de Pierres, Lezay-Marnesia, de Malaret et de Las Marismas; d’un grand maître, le comte ensuite duc Tascher de la Pagerie; d’un premier chambellan, Charles Tascher de la Pagerie, d’un chambellan, le vicomte Lezay-Marnesia, et d’un écuyer, le baron de Pierres. Depuis lors, la maison de l’Impératrice s’accrut de dames du palais, de chambellans, d’écuyers et même de demoiselles d’honneur. L’impératrice désigna pour sa lectrice une ancienne amie, une seconde madame Gould, nommée madame de Vagner.
La date du mariage religieux fut fixée au 50 janvier. La malignité publique s’était emparée du mot parvenu, prononcé par l’Empereur dans son discours aux grands corps de l’État, et on lança encore le quatrain suivant:
Parvenu se pose en Titus,
Mais il agit en sens contraire,
Car il compte pour jours perdus
Tous ceux qu’il passe sans mal faire.
Il y eut un assez grand nombre d’arrestations de gens qui, soit au quartier Latin, soit dans les cafés des boulevards, s’étaient permis des plaisanteries sur la fiancée de l’Empereur: un commis de M. Ritter, coulissier, rue de Hanovre, fut jeté en prison pour des paroles inconvenantes relatives au mariage; deux ouvriers du boulevard Beaumarchais qui, sur le même sujet, échangeaient entre eux des propos malsonnants, furent également saisis par la police. Dans un café de la place des Victoires, un jeune homme eut l’imprudence de raconter à des amis qu’à Spa il avait dansé plusieurs contredanses avec mademoiselle Eugénie de Montijo, qui lui avait semblé avoir autant d’entrain que de charmes; il fut arrêté en sortant du café. Un auteur dramatique qui, lors de l’arrivée à Paris de madame de Montijo et de sa fille, se disait épris de celte dernière, eut le même sort ainsi que bon nombre de correspondants de journaux étrangers qui, en Belgique surtout, publiaient les informations de Paris les plus hostiles et les plus outrageantes.
Celles de ces mesures qui furent connues firent beaucoup crier le public, et cependant il était fort naturel, comme M. de Morny le reconnut lui-même, que l’Empereur ayant fait un choix matrimonial, il en défendît et en fît respecter l’objet.
Le 29 janvier 1853, à huit heures du soir, le duc de Cambacérès, grand maître des cérémonies, se rendit au palais de l’Élysée avec deux voitures de la cour entourées d’une nombreuse escorte. Il allait chercher mademoiselle de Montijo ainsi que sa mère, pour les conduire aux Tuileries, où devait avoir lieu la cérémonie du mariage civil; les voitures s’arrêtèrent, en revenant, au pavillon de Flore, où le duc de Bassano; grand chambellan, le maréchal Saint-Arnaud, grand écuyer, le colonel Fleury, premier écuyer, des chambellans et des officiers d’ordonnancé attendaient l’arrivée de la future souveraine.
On se dirigea vers l’appartement dit salon de Famille; à l’entrée du premier salon du palais, le prince Napoléon et la princesse Mathilde, sa sœur, attendaient la fiancée impériale, qu’ils conduisirent à l’Empereur; celui-ci, entouré du prince Jérôme, son oncle, des ministres, cardinaux, maréchaux et amiraux, la reçut solennellement, et la cour se rendit alors en cortège dans la salle des Maréchaux, où devait avoir lieu la cérémonie. Le ministre d’État, M. Fould, auquel incombait, en cette circonstance, la charge d’officier de l’État civil, était entouré des témoins de la future Impératrice. C’étaient MM. le marquis de Valdegamas, ministre d’Espagne à Paris, le duc d’Ossuna, le marquis de Bedmar, grands d’Espagne de première classe, le général Alvarez de Toledo et le comte de Galve, parent de mademoiselle de Montijo; les témoins de l’Empereur étaient le prince Jérôme, son oncle, et le prince Napoléon, son cousin.
L’ancien registre de l’État civil de la famille impériale avait, particularité assez curieuse, été conservé par des dévouements subalternes; il reparut dans cette circonstance solennelle, et ce fut sur ses pages, après l’acte d’adoption par Napoléon Ier d’Eugène, fils de Joséphine, et celui mentionnant la naissance du roi de Rome le 20 mars 1811, que fut inscrit l’acte qui sanctionnait l’union de Napoléon III et de la comtesse de Téba.
Le lendemain, le cortège nuptial se dirigeait vers Notre-Dame, splendidement préparée à le recevoir avec ses quinze mille bougies éclairant les riches tentures dont on avait paré les vieux arceaux gothiques. Comme la veille, le grand maître des cérémonies était allé chercher à l’Élysée la fiancée impériale, ainsi que sa mère; l’Empereur, avant de monter dans le carrosse d’apparat qui devait le conduire à la vieille basilique, parut avec sa future épouse au balcon des Tuileries et la présenta aux troupes qui étaient massées dans la cour et sur la place du Carrousel, puis le cortège se mit en marche. On avait sur le conseil de M. de Persigny, qui aimait à entrer dans ces sortes de détails, cherché autant que possible à imiter celui du mariage de Napoléon Ier. Le nombre des voitures était le même: trois carrosses à six chevaux étaient occupés par les titulaires des grandes charges de la cour, la princesse Mathilde, la comtesse de Montijo, le prince Jérôme et son fils. Un intervalle de trente pas les séparait du carrosse impérial, le même qui avait servi au sacre de Napoléon Ier, voiture splendide de dorures et d’ornements, traînée par huit chevaux de robé pareille, escortée aux portières de gauche et de droite par le grand écuyer, le grand veneur, le général commandant la garde nationale de Paris et le premier écuyer. Ce magnifique cortège était précédé d’un escadron des Guides, corps nouvellement formé et suivi d’une division de grosse cavalerie. La foule se pressait sur son passage et n’était que difficilement contenue par la double haie formée par la garde nationale et l’armée qui tenaient chacune un des côtés de la chaussée. Tous les yeux étaient tournés vers la voiture impériale, car la plus vive curiosité régnait dans les masses populaires, avides surtout de contempler les traits de la belle étrangère qui avait su inspirer au nouvel Empereur une résolution de cette nature. Le. peuple de Paris, je l’ai déjà dit, aime beaucoup le romanesque et l’imprévu; son imagination naturelle et le goût du théâtre ont développé en lui des instincts particuliers qui, en cet instant, trouvaient un aliment naturel dans le spectacle qui se déroulait devant lui.
En de telles circonstances, il est difficile de ne pas trouver des poëtes plus ou moins bien inspirés, plus ou moins bons courtisans, qui s’empressent d’accorder leur lyre et d’invoquer le dieu Hymen. Cette fois, ce furent MM. Arsène Houssaye, Méry, Philoxène Boyer, Belmontet, qui se chargèrent de ce soin. On remarqua surtout dans ce débordement de poésie ces quatre vers délicats et galants, qui sentaient d’une lieue la poudre à la maréchale:
D’un bonheur qui nous fuit, ah! bénissons les causes.
Fêtons d’un même accord Eugénie et les roses.
Hymen, tourne longtemps le fuseau de l’amour,
Et prolonge la nuit jusqu’à la fin du jour.