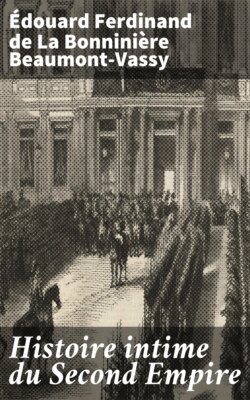Читать книгу Histoire intime du Second Empire - Edouard Ferdinand de la Bonninière Beaumont-Vassy - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
Une dépêche confidentielle du duc de Bassano. — Journal d’un travail secret de gravure. — Mademoiselle de Montaut, héritière du sieur Laie. — Un secret d’État. — Détails. — Histoire du comte Camerata. — Sa mort. — Faits étranges. — Mademoiselle Marthe. — Ministère de la police générale. — Inspecteurs généraux et spéciaux de la police. — Mot du chancelier Pasquier. — La police un peu dans tout.
J’ai dit que le duc de Bassano avait échangé contre la dignité de grand chambellan la haute position diplomatique qu’il occupait à Bruxelles. Avant de quitter ce poste, il eut l’occasion de rendre à la famille Bonaparte un singulier, mais très-réel service, que les découvertes et indiscrétions postérieures ont, du reste, rendu inutile. M. de Bassano n’en avait pas moins agi en fonctionnaire éclairé et en fidèle serviteur.
Voici ce qu’il écrivait, à la date du 20 mars 1852, avant le mariage de l’Empereur, à une personne qui fut sans doute M. Mocquard:
«Monsieur, j’ai à vous faire une communication d’une nature assez étrange. Vous jugerez si elle mérite d’être portée à la connaissance du prince-président. Voici ce dont il s’agit:
«Il parait qu’en 1810 et, plus tard, en 1812, avant la campagne de Russie, S. M. l’Empereur ordonna de fabriquer une quantité considérable de faux billets de la banque d’Angleterre et de celle de Russie. Cette fabrication, dirigée par le ministère de la police, fut entourée du plus grand mystère, et la gravure des planches fut confiée à un sieur Lale, graveur habile du Dépôt général de la guerre. A une époque qui n’est pas précisée, le sieur Lale adressa à un des frères de Sa Majesté un récit circonstancié de la part qu’il avait prise à cette opération; il l’intitula: «Extrait du
«journal du travail de gravure qui m’a été confié
«pour le service particulier du cabinet secret
«de S. M. l’Empereur.» A sa mort, le manuscrit original de cette relation était parmi ses papiers, ainsi qu’une lettre du duc de Rovigo et une autre du sous-directeur du Dépôt de la guerre, se rattachant toutes deux aux circonstances que je viens de mentionner. Une des héritières du sieur Laie, mademoiselle de Montaut, sa nièce, se trouva en possession de ces trois pièces. Malgré le secret qu’elle garda scrupuleusement à leur sujet, leur existence ne resta pas ignorée. Des personnes hostiles aux gloires de l’Empire lui firent, à plusieurs reprises, l’offre de sommes importantes si elle voulait consentir à leur laisser ces pièces auxquelles on se proposait de donner de la publicité. Mademoiselle de Montaut ne voulut pas, par un sentiment de probité et de loyauté qui lui fait honneur, se prêter à ces perfides desseins. Elle refusa donc constamment, malgré l’état de gêne où elle vivait, les offres avantageuses qui lui étaient faites. Elle résolut de ne jamais se dessaisir des documents que le hasard avait placés entre ses mains, si ce n’était pour les remettre fidèlement un jour à l’héritier de l’Empereur. Elle désire maintenant accomplir le devoir qu’elle s’est imposé, et elle m’a prié de faire parvenir ces papiers au prince.
«Je m’acquitte de la mission qu’elle m’a confiée, et je vous envoie ci-joint, monsieur, les trois pièces dont il s’agit. Si vous avez le temps d’y jeter les yeux, vous vous convaincrez qu’il convenait que les révélations qu’elles contiennent ne fussent pas livrées aux ennemis du prince et de S. M. l’Empereur.
«Mademoiselle de Montaut n’a pas la pensée de vouloir mettre un prix à la remise de ces papiers; elle n’a pas fait la moindre mention à cet égard; mais je crois devoir vous faire connaître sa position. Elle est absolument dénuée de fortune; elle n’a d’autres ressources que son travail. Elle est en ce moment institutrice des enfants du prince de Chimay. C’est une personne très-distinguée et très-méritante sous tous les rapports.»
A cette lettre étaient jointes les trois pièces en question. Dans la première, datée du 12 août 1812, le colonel Muriel, sous-directeur du dépôt général de la guerre, se plaint au sieur Lale de son éloignement momentané du Dépôt. Il lui demande la preuve que c’est par suite d’un ordre du gouvernement qu’il manque aux engagements qu’il a pris. La seconde renferme une attestation du duc de Rovigo, ministre de la police, que le sieur Laie est chargé de dresser des cartes très-secrètes pour le cabinet de l’Empereur, et a reçu l’ordre de ne communiquer absolument avec qui que ce soit, excepté avec les artistes nécessaires à la confection de l’ouvrage.
La troisième renferme la relation, sous forme de journal, des faits qui se sont produits à propos du travail qui lui a été confié pour le service particulier du cabinet secret de l’Empereur. Cette relation, adressée à un des frères de Napoléon Ier, le roi Joseph très-probablement, débute ainsi:
«Il ne m’appartient pas d’approfondir les vues du gouvernement de cette époque, ni les motifs qui le forcèrent à adopter un pareil parti, pour porter à ses nombreux ennemis un coup qui devait amener la ruine complète de leurs ressources financières, ce qui devait paralyser avec le temps le nerf des opérations militaires de leurs armées, et les forcer à respecter l’indépendance de la France, à lui procurer une paix durable qu’elle avait acquise au prix de la valeur de ses nombreux guerriers, commandés alors par le plus grand capitaine de l’Europe, l’Empereur, votre auguste frère. Ma position, à cette époque, était de me soumettre aux ordres du gouvernement et de repousser avec indignation toutes propositions qui auraient eu pour but de prévenir les ennemis de la France des moyens que l’on employait contre eux.»
Après ce préambule, Lale commençait sa relation. Au début de l’année 1810, il se trouvait employé en qualité de premier graveur d’écriture au Dépôt général de la guerre. Il avait alors dix ans d’exercice et, comme tous les graveurs employés dans cet établissement, il gravait pour la ville, le matin et le soir, après les travaux du Dépôt.
Il reçut un jour la visite d’un personnage qui lui était inconnu. Celui-ci lui proposa la gravure d’une planche, qui offrait dans son exécution de très-grandes difficultés, l’original parfaitement exécuté à Londres, faisant partie d’un texte gravé en taille douce avec le plus grand soin. L’ouvrage, disait-il, était venu entre les mains d’un libraire de Paris qui désirait le compléter, et plusieurs cuivres se trouvant égarés, il s’agissait d’imiter servilement l’original. Laie se chargea de ce travail et, quinze jours après, il fit tirer des épreuves de sa planche, qu’il remit au personnage en question. Ce dernier parut émerveillé du travail, paya et disparut.
Quinze jours plus fard, il se présentait de nouveau et engageait Lale à l’accompagner chez le libraire, propriétaire de l’ouvrage. Lale l’accompagna, en effet, et sa surprise ne fut pas médiocre lorsque, arrivé devant l’hôtel du Ministère de la police générale, son compagnon l’invita à y entrer avec lui.
Introduit dans un petit salon et abandonné par son introducteur, il resta pendant près d’une heure à réfléchir sur son aventure. Enfin, un coup de sonnette vint lui annoncer qu’il allait être introduit. Il s’entendit appeler, traversa plusieurs pièces et se trouva dans le cabinet du premier chef de division de la police secrète, qu’il salua profondément et prit pour le ministre Fouché lui-même. «Je suis aux ordres de Votre Excellence, dit-il; veut-elle bien me donner connaissance du motif qui m’amène devant elle? — Je ne suis pas le ministre, répondit en souriant le chef de division, mais je suis chargé par lui de vous entretenir d’un travail qui va vous être confié et qui demande de votre part la plus grande discrétion. Vous en serez chargé seul, et vous répondrez de la régularité de son exécution. J’ai fait prendre des renseignements sur votre moralité ; je n’ai rien oublié de ce qui pouvait nous donner la certitude que vous réunissez les capacités nécessaires pour entreprendre le travail que le gouvernement va vous confier. C’est à vous, monsieur, de répondre à ce que nous avons droit d’attendre de vous: zèle et discrétion, voilà quelle doit être la règle de votre conduite. Vous allez être dépositaire d’un grand secret d’État; c’est à vous à vous tenir en garde contre tout interlocuteur qui voudrait le connaître et à nous prévenir de suite. Il faut dans cette affaire beaucoup de désintéressement et ne point sacrifier l’intérêt du gouvernement au profit de ses ennemis, qui ne manqueraient point de vous abuser par de séduisantes promesses, mais qui vous abandonneraient lorsqu’il s’agirait de nous rendre compte de voire trahison. — Je vous remercie, monsieur, de vos bons avis, reprit Laie; et je vous prie de me faire connaître le travail dont il est question. »
M. Desmaret (c’était le premier chef de division de la police secrète) sortit alors de son bureau une liasse énorme de billets de la banque d’Angleterre. Il plaça sur la table l’épreuve de la planche que Lale avait gravée et dit à celui-ci que cette gravure avait été vue par le ministre, qu’elle avait été comparée avec l’original et qu’elle s’était trouvée dans toutes ses parties d’une parfaite ressemblance. «Il nous est donc démontré, ajouta M. Desmaret, que vous pouvez imiter ces billets; ils sont gravés en taille-douce et paraissent offrir à l’œil moins de difficulté dans leur exécution que la page que vous avez gravée. Ce travail sera de longue durée; ce n’est qu’un commencement d’opération qui, par la suite, doit en amener d’autres; vous seul serez chargé de l’exécution de toute la gravure du cabinet secret de l’Empereur, et pour vous prouver combien est grande la confiance que nous mettons en vous, vous êtes chargé de nous faire connaître un imprimeur en taille-douce qui réunisse, sous le rapport de l’habileté et de la moralité, toutes les qualités nécessaires à une pareille opération. »
Laie fit choix d’un imprimeur en taille-douce qui travaillait pour son compte, jouissait d’une excellente réputation et était d’un caractère peu communicatif. Il l’introduisit auprès de M. Desmaret et se retira à l’écart pour ne point assister à leur conférence. Trois jours après, à huit heures du soir, l’imprimeur, qui se nommait Malo, arrivait chez lui accompagné d’un M. Terrasson, commissaire du gouvernement, chargé spécialement de la surveillance du travail. Il fit choix d’un cabinet à côté de la pièce où Lale s’était installé pour travailler à sa gravure et, le lendemain, il apporta une presse. Cette presse était destinée à l’impression des épreuves des planches gravées par Lale, afin d’éviter des démarches multipliées qui auraient entraîné une grande perte de temps pour arriver aux corrections desdites planches. Seulement on adapta une chaîne aux croisettes de la presse et on y plaça un fort cadenas dont la clef fut remise au sieur Malo.
Lale occupait, dans le faubourg Saint-Jacques, une petite maison composée de deux étages et d’un jardin, dont il était le seul locataire. Le premier étage avait trois croisées en face de la rue des Ursulines et n’était accessible à aucun voisin. La chambre d’entrée et la chambre à coucher de Lale avaient vue sur le jardin, qui était contigu à celui des Sourds-Muets. Le second étage était disposé de la même façon; même vue, même isolement. Ce logement était admirablement choisi pour la besogne qu’on y voulait faire.
Elle marcha vite cette besogne. Lale l’activa autant qu’il était en son pouvoir, sur les instances du gouvernement. Dans le commencement, il ne gravait pas ses planches avec beaucoup de sécurité, parce qu’il n’avait pas encore reçu l’autorisation du ministre, quoiqu’il la lui eût fait demander plusieurs fois. Enfin, le duc de Rovigo, qui venait de remplacer Fouché, ayant pris connaissance du travail, accorda cette autorisation. si impatiemment attendue.
Lale en était à sa sixième planche gravée, ce qui, par le fait du tirage, devait déjà donner une très-grande quantité de. billets faux, lorsque l’agent Terrasson se présenta chez lui à neuf heures du soir. Il lui donna l’ordre de placer dans son portefeuille les six cuivres dont la gravure était terminée et de l’accompagner. Tous deux furent bientôt en train de s’acheminer vers le boulevard Montparnasse, par une nuit si obscure que Lale ne put s’empêcher de faire observer à son compagnon que le boulevard était bien peu fréquenté à cette heure. «Si des malveillants venaient nous attaquer, ajouta-t-il, et m’enlever mon portefeuille? — Rassurez-vous, dit Terrasson, nous avons derrière nous trois gaillards qui ne tarderaient pas à nous secourir: pensez-vous que je m’aventurerais à cette heure si je n’étais point surveillé ?»
Ils arrivèrent ainsi au numéro 25 du boulevard; c’était près la rue de Vaugirard. «Remarquez bien, dit Terrasson, la manière de sonner à la porte de cette maison.» Il sonna deux fois à intervalles égaux, puis mit la cloche en branle pendant dix minutes environ. Alors, un homme de forte taille vint ouvrir et refermer de suite la porte; parvenu à l’extrémité d’un long couloir, l’agent prit les mêmes précautions; la seconde porte s’ouvrit, ils traversèrent un petit jardin et pénétrèrent dans une grande pièce au rez-de-chaussée où se trouvait un cabinet particulier pour M. le directeur Fain, frère du secrétaire de l’Empereur. Lale fut présenté au directeur, qui l’accueillit bien et l’invita à l’accompagner à l’imprimerie; elle servait de dortoir aux imprimeurs ainsi qu’aux employés de la maison; les lits étaient à bascule et paraissaient être renfermés dans des armoires; on passa dans une seconde pièce, et Lale fut bien surpris d’y trouver Malo qui achevait de monter les presses qui devaient fonctionner le lendemain matin. C’était, en effet, un homme d’une discrétion à toute épreuve, qui avait gardé le silence même vis-à-vis de son camarade. Le directeur fit connaître Lale aux portiers de la maison, il leur donna l’ordre de le laisser entrer à toute heure de la nuit, et lui recommanda à lui-même d’observer exactement la consigne, sous peine de rester à la porte. Le plus grand silence régnait dans cette maison et la discrétion des employés était absolue. Le traitement des ouvriers imprimeurs était de neuf francs par jour, plus la nourriture. C’étaient des hommes mariés et d’une bonne conduite, pour la plupart d’un âge avancé. Lale s’était contenté du traitement qui lui avait été alloué par le ministre et qui s’élevait au double des appointements qu’il recevait comme premier graveur au département de la guerre, avec promesse d’une gratification que les événements ultérieurs l’empêchèrent de toucher. Dès qu’il fut parfaitement au courant des habitudes et des détails de la maison, il prit congé et retourna chez lui, toujours accompagné de Terrasson et de ses agents.
Assurément, cette imprimerie clandestine était admirablement organisée et dissimulée, et le gouvernement aurait pu la croire à l’abri des investigations extérieures; mais il avait compté sans ses propres agents, et c’est un côté assez comique de cette mystérieuse aventure: il existait alors un certain commissaire de police nommé Maçon, qui passait pour l’homme le plus habile du monde, et qui, chargé spécialement de la police des Halles, étendait plus loin sa surveillance officieuse par suite d’une exubérance de ce zèle contre lequel M. de Talleyrand avait le soin de prémunir ses employés; or, le commissaire Maçon avait été prévenu par ses agents qu’il existait sur le boulevard Montparnasse, au numéro 25, une imprimerie suspecte; que l’on y voyait souvent entrer des gens qui, par leur mise, annonçaient de l’aisance; que d’autres y étaient admis portant sous leurs bras des portefeuilles de ministres; qu’on y introduisait plusieurs fois dans la journée des provisions de bouche considérables en raison du petit nombre de personnes qui entraient et sortaient de cette maison. Le commissaire prit donc la résolution de la faire investir et de saisir tout ce qu’elle contenait.
De son côté, le gouvernement était informé que, depuis quelques jours, plusieurs individus rôdaient autour du jardin de l’imprimerie du boulevard; le rapport en avait été fait au ministère, et des mesures de précaution avaient été prises à l’effet de déjouer toute entreprise dirigée contre la sûreté de la maison.
Cependant, grâce aux profondes combinaisons du commissaire Maçon, un mardi, à deux heures du soir, le coup de sonnette se faisait entendre. Conformément à la consigne, le premier portier ouvrit à l’instant; il se vil aussitôt prendre à la gorge, se défendit avec courage et cria: «Au secours!» L’alarme se répandit bien vite dans la maison; les ouvriers se saisirent à l’instant de tout ce qui se trouvait sous leur main.
A la seconde porte d’entrée, ils s’aperçurent que deux agents s’étaient glissés furtivement par une petite fenêtre qui donnait sur le couloir. Ces deux hommes avaient pénétré en enfonçant avec leurs pieds cette petite croisée, dans la cuisine qui communiquait à un escalier dérobé, celui de l’imprimerie. Ils furent à l’instant saisis et terrassés par les ouvriers. Pendant ce temps, M. Fain, qui entendait frapper à coups redoublés à la seconde porte d’entrée, la faisait ouvrir, et était saisi à l’instant par le commissaire Maçon qui le tenait serré à la gorge. A peine l’infortuné directeur pouvait-il parler. Il conjura le commissaire de lire la pièce qu’il tenait à la main; mais le farouche fonctionnaire ne voulait rien entendre et criait à ses nombreux agents d’appeler la force armée qui cernait le jardin et la maison.
Le parti assiégé tint bon et disputa le terrain pied à pied; les coups de canne roulaient de la part des agents de police; les employés de la maison ripostaient avec des instruments de cuisine dont ils s’étaient emparés au moment du combat; il y eut des blessés de part et d’autre et le plancher était couvert de sang. Enfin, le commissaire Maçon, ayant pris connaissance du sauf-conduit et reconnu les signatures de l’Empereur et du ministre de la police, se rendit à discrétion; pâle et tremblant, il devint à l’instant l’homme le plus pacifique du monde. Présentant à M. Fain les plus humbles excuses, il ordonna à ses agents de se rallier et renvoya la force armée qui lui servait d’escorte; puis, honteux et confus, il se replia lui-même sur la préfecture de police, dont il n’aurait jamais dû sortir sans ordre. Mandé auprès du ministre le lendemain de cette affaire, il s’en fallut de très-peu qu’il ne fût révoqué de ses fonctions.
Étrange et amusante aventure que celle de ce gouvernement pris en flagrant délit par ses propres agents, trop bien dressés!
Bientôt on ne s’en tint plus à la fabrication des faux billets de la banque d’Angleterre. Lale raconte qu’après l’interruption de ce premier travail il fut appelé de nouveau au ministère de la police générale et que, là, M. Desmaret lui annonça qu’il allait être chargé d’un travail important qui exigeait de sa part autant de discrétion que le premier et serait plus compliqué, mais qui offrait cet avantage qu’il pourrait être morcelé, divisé, de façon à ne point être deviné par ceux qui y seraient employés secondairement. Cette fois il s’agissait d’imiter les assignats et le papier de banque de la Russie. Ces billets, sur papier de couleur, étaient mal gravés, les caractères typographiques en étalent mauvais, mais les signatures s’en trouvaient très-compliquées; seulement, elles pouvaient se graver à l’eau forte et même assez promptement.
On se mit à l’œuvre. Dix planches gravées sortaient de chez Laie; elles étaient portées à l’imprimerie du sieur Malo, rue de Vaugirard, n° 26, près du magasin d’équipements militaires, vaste hôtel que le ministère avait fait louer et où étaient installées vingt-trois presses en taille-douce qui fonctionnaient tous les jours jusqu’à onze heures du soir. L’imprimerie typographique, dirigée par M. Fain, était toujours dans le local du boulevard Montparnasse, jadis assiégé par la police, à portée de celle de Malo.
Plus de sept cents planches furent gravées en moins de trois mois; le tirage que l’on fit, dit Lale, a dû être considérable, puisqu’il a duré jusqu’à l’époque des revers de l’armée française en Russie; les billets étaient jetés sur le carreau d’une chambre remplie de poussière et retournés dans tous les sens avec un balai de cuir; ils s’amollissaient ainsi, prenaient une teinte cendrée et paraissaient à l’œil avoir passé par beaucoup de mains; on les groupait en liasses et on les expédiait de suite au ministère.
Lorsque arriva la campagne de France, l’anxiété de Laie augmentait à chaque nouveau succès des Alliés. «L’invasion de la capitale arrivée, dit-il, quelle dut être ma position! Ceux qui avaient le plus gagné dans cette affaire s’expatrièrent, et moi, qui avais eu la direction des deux opérations, je restai au milieu des étrangers, ennemis de mon pays, qui pouvaient d’un moment à l’autre se saisir de ma personne et m’envoyer graver en Sibérie. Grâce à Dieu, il n’en fut rien.»
La relation du sieur Lale ne renferme pas moins de vingt-huit ou trente pages. J’en ai extrait ce qu’elle présente de plus curieux: on ne peut, après en avoir pris connaissance, que reconnaître le zèle intelligent de M. le duc de Bassano et le service qu’il rendait à la famille Bonaparte en transmettant à Napoléon III les papiers conservés par mademoiselle de Montaut.
Peu de temps après le mariage de l’Impératrice, il se passa un fait fort étrange et qui jusqu’ici n’a pas été suffisamment éclairci.
Le comte Camerata, parent de l’Empereur comme petit-fils de la princesse Élisa Bacciochi, était un jeune homme charmant et distingué sous tous les rapports. Lors de la récente formation du conseil d’État, il y avait été compris en qualité de maître des requêtes et avait déjà donné la mesure de son intelligence et de sa capacité.
Il paraît que ce jeune homme, intéressant à tous les points de vue; avait ressenti pour la comtesse de Téba et avant le mariage de cette dernière, une passion ardente, insensée, que la brusque détermination de Napoléon III et l’événement qui s’en était suivi n’avaient pu que comprimer sans l’étouffer. Reçu aux Tuileries avec toute la distinction et l’empressement que motivaient si bien ses qualités aimables, il n’avait eu que trop d’occasions de revoir l’objet de ses pensées constantes et de son culte secret. Quelle imprudence commit-il au milieu des bruyants ébats d’une fête à la cour? Risqua-t-il une déclaration à son impériale danseuse et celle-ci s’en plaignit-elle à Napoléon III? Une lettre fut-elle glissée par lui et tomba-t-elle entre les mains de quelque dame du palais? Toujours est-il qu’il fut prié de se retirer et qu’un agent de la police secrète fut chargé de l’accompagner chez lui. On ne sait ce qui se passa alors. Cet agent secret était un Corse du nom de Zambo; y eut-il une discussion violente entre lui et le jeune homme qu’il était chargé de garder à vue, sans doute, jusqu’à ce qu’une décision souveraine intervînt pour prescrire au jeune audacieux de quitter la France? Zambo obéit-il simplement à un mouvement personnel de fureur sauvage en pensant à l’injure que son souverain aurait reçue? Ce qu’il y a de certain, c’est que l’infortuné Camerata reçut derrière la nuque un coup de pistolet qui lui fit sauter la cervelle.
Maintenant, voici où l’histoire devient plus singulière encore: l’agent secret Griscelli, qui a publié des mémoires où percent à chaque instant la vanité et l’outrecuidance, mais qui renferment beaucoup de choses vraies, lesquelles perdent à être racontées dans un style fanfaron, l’agent Griscelli, Corse de naissance, après avoir présenté l’affaire Camerata à peu près comme je viens de le faire, ajoute ceci:
«M. Piétri et moi, instruits de ce qui venait d’arriver, courûmes chez le prince (Griscelli veut absolument faire un prince du comte Camerata); mais, quand nous arrivâmes, il était mort. Le préfet de police se jeta sur le corps de son ami en pleurant comme un enfant. Quelques minutes après, il se leva. Je n’avais pas versé une larme. Nous fermâmes la porte et nous passâmes par les Tuileries, où l’on dansait encore. En entrant chez le concierge, j’appris que Zambo était rentré, puis ressorti quelques instants auparavant. M. Piétri et moi nous rentrâmes à la préfecture.....
«Le matin, en me levant, j’eus comme un éblouissement sanguin. Une heure après, sans autre idée que celle de venger l’ami de mon bienfaiteur, je me présentai chez M. Piétri et lui demandai un passe-port pour Londres. Il me regarda en face, puis me dit ces mots: «Nous sommes Corses, va, je t’ai compris; que la vengeance ne se fasse pas attendre! — Comptez sur moi; dans quarante-huit heures au plus, tout sera fini. Pendant ce temps, si l’on me demande au Château, vous direz que je suis malade.» Il m’embrassa et me donna mille francs. Trente-sept heures après, j’étais de retour, après avoir couché sous le pont de Londres, complètement défiguré et poignardé, Zambo, l’assassin du prince Camerata. La police de Londres, malgré toute son intelligence, ne put jamais reconnaître le cadavre (une bouteille de corrosif lui avait brûlé la figure), ni découvrir le coupable.
«Environ quinze jours après le bal des Tuileries, j’avais accompagné Leurs Majestés impériales à Saint-Cloud, et je me promenais dans la cour, quand Napoléon m’ordonna par une fenêtre de monter au salon. Dès que je fus en sa présence, Sa Majesté impériale, devant l’Impératrice, me demanda: «Connaissez-vous Londres? — Oui, sire. — Quand y avez-vous été ? — Lorsque Sa Majesté impériale m’y a envoyé porter une lettre à M. de Persigny. — Mais vous y avez été depuis? (Il me disait cela en me regardant en face.) — Oui, sire, répondis-je en le regardant également en face, le jour où M. Piétri m’a donné un passe-port. — Sempre la vendetta! dit Napoléon. — Sono Corso! répondis-je.»
Il doit y avoir du vrai dans ce récit si net, si précis, d’un homme qui n’hésite pas à s’accuser lui-même d’un meurtre; dans tous les cas, au lieu de faire la lumière, il apporte, avec ses réticences calculées, plus d’obscurité encore dans cette sombre affaire Camerata, qu’on étouffa alors autant qu’on le put et qui eut un touchant épilogue.
On avait répandu le bruit que le jeune comte, à la suite de pertes considérables à la Bourse, s’était brûlé la cervelle dans un accès de désespoir, et le monde parisien, préoccupé, en ce moment, de tant d’autres choses, accepta facilement, sans la contrôler, l’explication qu’on lui donnait de cette fin tragique; mais il se montra ému et touché de la mort d’une jeune femme qui en fut la conséquence. Une actrice des Variétés, mademoiselle Marthe, s’était sérieusement éprise du comte Camerata, qui, pour écarter l’attention et les soupçons peut-être, avait noué quelques relations avec elle et lui avait accordé une certaine confiance bien justifiée, d’ailleurs, car Marthe, douée du plus heureux naturel, avait un cœur généreux, aimant et désintéressé.
La police fut mise au courant de ces détails et du degré de confiance que le comte accordait à la jolie actrice, par une camarade jalouse de cette dernière. On fit une perquisition chez Marthe, et on saisit tous les papiers et correspondances qu’on trouva chez elle. Elle ne savait pas encore la mort du comte Camerata, et, de crainte de le compromettre, elle s’obstina à se taire quand on voulut l’interroger. Lorsqu’elle sut toute la vérité, Marthe s’asphyxia, triste et touchante victime d’une fatalité singulière.
La police joua, du reste, un fort grand rôle aux débuts du régime nouveau. On l’employait à tous les degrés de l’échelle sociale, quoiqu’on n’eût pas encore (perfectionnement qui ne vint que plus tard) rétabli le Cabinet noir, c’est-à-dire le décachetage des lettres par ordre, fait souvent contesté, mais désormais acquis par des preuves formelles.
La création d’un ministère de la police générale, mesure grave et digne d’attention dans les circonstances données, avait été accompagnée de l’institution d’inspecteurs généraux et d’inspecteurs spéciaux de la police dont les attributions étaient plus vaguement définies que celles du ministre lui-même. Le département de la police n’était pas, d’ailleurs, une création nouvelle; c’était une résurrection. Le Directoire l’avait fondé ; le Consulat l’avait supprimé ; l’Empire l’avait rétabli, et la Restauration l’avait conservé jusqu’au 21 février 1820.
Mais les inspecteurs généraux et spéciaux, agents ostensibles et haut placés de ce département ministériel, avaient des attributions trop. étendues, et pas assez définies, pour que, dans la pratique, elles ne créassent pas de conflits. Ils devaient, suivant les termes du décret, surveiller particulièrement tout ce qui pouvait influer sur l’esprit public ou donner lieu à des plaintes: la presse, la librairie, les publications de toute nature, les théâtres, lés prisons, l’instruction publique, les associations politiques et industrielles, et, en général, fixer leur attention sur toutes les parties d’administration et de service public en se conformant aux instructions du ministre. Qui ne comprend que pour remplir cette lâche difficile et multiple, ils étaient ou trop petits ou trop grands? Trop petits si leur influence et leur action étaient subordonnées à celles des fonctionnaires, chefs naturels de tous ces services qu’ils avaient à surveiller; trop grands si, dans cette surveillance si étendue et à laquelle le public donnait un autre nom, leur influence primait celle des fonctionnaires placés à la tête des administrations diverses.
On avait créé ainsi neuf inspecteurs généraux dont les résidences étaient fixées à Paris, Lille, Metz, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Bourges. Chacun d’eux avait dans ses attributions deux divisions militaires. Douze inspecteurs spéciaux devaient résider dans les chefs-lieux de divisions militaires autres que les villes en possession d’un inspecteur général.
Cette institution n’eut, d’ailleurs, qu’une existence éphémère. Entravée dès le début par les difficultés inhérentes à leur origine et par les conflits que devaient faire naître l’étendue et la multiplicité de leur action, ces fonctionnaires, assez bien choisis, du reste, et généralement modérés, devaient bientôt disparaître de la scène politique. Quelques-uns entrèrent au Corps législatif, d’autres dans l’administration. Mais plusieurs, dont on avait ainsi récompensé le zèle au moment du coup d’État (ces fonctions étaient très-largement rétribuées), ne purent parvenir à des positions nouvelles.
Cette création avait donné lieu à un joli mot du vieux chancelier Pasquier, qui, lisant le décret et le jugeant avec son expérience de longue date, dit: «Voilà un enfant qui n’est pas né viable, mais qui, avant son décès, peut causer beaucoup d’ennui à ses parents.»
L’autorité semblait, du reste, vouloir surveiller sévèrement alors les petites comme les grandes choses et mettre un peu la main partout. Ainsi le docteur Véron, qui venait de publier ses Mémoires d’un bourgeois de Paris, assez désagréables par parenthèse pour M. de Maupas, ayant voulu faire illustrer une nouvelle édition de son livre d’une gravure qui aurait représenté le docteur tirant un rideau et laissant voir M. Thiers, M. de Lamartine, mademoiselle Rachel, en un mot tous les personnages passés par lui en revue, au nombre desquels se seraient trouvées reproduites par un hardi burin des silhouettes très-compromettantes, ce luxe aristophanesque ne fut pas autorisé par la police, et le «bourgeois de Paris», repoussé avec perte, dut opérer prudemment sa retraite tout en invoquant les services que son journal avait rendus.