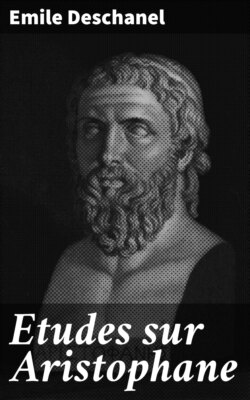Читать книгу Etudes sur Aristophane - Emile Deschanel - Страница 103
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PEUPLE.
ОглавлениеOui, voilà comme j'attrape ceux qui se croient bien fins et pensent me tromper! je les suis de l'œil, sans en avoir l'air, pendant qu'ils me volent; ensuite je leur fourre un jugement dans la gorge, et ils rendent tout ce qu'ils ont pris.
* * * * *
Enfin Cléon, vaincu encore une fois, devant le Peuple comme devant le
Sénat, est livré au charcutier son vainqueur.
Puis on voit reparaître Peuple, régénéré et rajeuni par les soins du charcutier, qui l'a fait bouillir dans sa marmite, comme Médée le vieil Éson. Il est paré élégamment, quoiqu'à la vieille mode. Il est brillant de paix, de bien-être et d'honneur. Il a recouvré la vigueur de son esprit comme de son corps, et rougit de son imbécillité passée,—qui était donc plus réelle qu'il ne l'avouait.—Agoracrite, de son côté, n'est plus dès-lors, évidemment, le charcutier impudent et fripon, mais Aristophane lui-même. Aristophane se sert de sa fiction comme d'un masque qu'il ôte ou reprend à son gré (Rabelais fera de même). Selon le moment, dans la même pièce, Aristophane appelle la ville d'Athènes «la République des Gobe-mouches,» τήν κεχηναίων πόλιν, ou bien c'est ensuite, «l'antique Athènes, couronnée de violettes, la belle et brillante Ville, qui porte sur sa chevelure la cigale d'or!»
Il sait que ses concitoyens riront volontiers de ses railleries sur leur légèreté et leur mobilité, s'il caresse leur patriotisme.
Telle est cette comédie pleine de verve, si mal appréciée par La Harpe, et beaucoup mieux par M. Grote: «C'est, dit-il, le chef-d'œuvre de la comédie, diffamatoire. L'effet produit sur l'auditoire athénien quand cette pièce fut jouée à la fête Lénéenne (janvier 424 av. J.-C., six mois environ après la prise de Sphactérie), en présence de Cléon lui-même et de la plupart des chevaliers réels, a dû être puissant au delà de ce que nous pouvons facilement nous imaginer aujourd'hui. Que Cléon ait pu se maintenir après cet humiliant éclat, ce n'est pas une faible preuve de sa vigueur et de sa capacité intellectuelles. Son influence ne semble pas en avoir été diminuée.—Non pas, du moins, d'une manière permanente. Car non-seulement nous le voyons le plus fort adversaire de la paix pendant les deux années suivantes, mais il y a lieu de croire que le poëte jugea à propos de baisser le ton à l'égard de ce puissant ennemi.—La plupart des écrivains sont tellement disposés à trouver Cléon coupable, qu'ils se contentent d'Aristophane comme témoin contre lui, bien que nul autre homme public, d'aucune époque ni d'aucune nation, n'ait jamais été condamné sur une telle preuve. Personne ne songe à juger sir Robert Walpole, ni M. Fox, ni Mirabeau, d'après les nombreux pamphlets mis en circulation contre eux. Personne ne prendra Punch comme mesure d'un homme d'État anglais, ni le Charivari, d'un homme d'État français. L'incomparable mérite comique des Chevaliers d'Aristophane n'est qu'une raison de plus de se défier de la ressemblance de son portrait avec le vrai Cléon[17].»
* * * * *
En résumé, l'exposition vive et amusante faite par les deux esclaves qui entrent en poussant des mugissements fantastiques; le portrait si fin du bonhomme Peuple, qui rappelle les têtes de vieillards d'Holbein; les scènes si hardies où le poëte se sert des libertés de la démocratie pour en attaquer les excès; les luttes prolongées, et pourtant variées, du charcutier avec le corroyeur; leurs assauts d'impudence, d'effronterie, de coups de poings et de coups de tripes, leurs plaisanteries, grossières et jolies tour à tour, mais abondantes comme les eaux dans les montagnes; enfin la métamorphose joyeuse et touchante de Peuple, rajeuni et régénéré, entouré de trêves de trente ans, personnifiées en de belles jeunes femmes, et cette marche triomphale accompagnée de fanfares; tout cela valut au poëte une nouvelle victoire, dans un sujet si délicat, si hasardeux! Par sa gaieté et son adresse il fit applaudir son audace. Il obtint encore cette fois le premier prix, par-dessus Aristomène et Cratinos.
Aristophane aimait à rappeler cette victoire et n'en parlait qu'avec orgueil. Il se vante, en plusieurs endroits, du courage herculéen qu'il a déployé, au début de sa carrière, en attaquant un monstre affreux.
* * * * *
En effet, ne l'oublions pas, la hardiesse du poëte comique, en cette circonstance, était moins de faire la caricature du peuple et de la démocratie elle-même que d'attaquer son meneur redouté. Car, selon la remarque de Macchiavel, «du peuple on peut médire sans danger, même là où il règne; mais, des princes, c'est autre chose.» Or Cléon, à ce moment-là, ayant remplacé Périclès, était en quelque sorte le prince de cette mobile démocratie.
On voit par cet exemple comment la liberté de la comédie ancienne n'était limitée que par la faveur ou la défaveur du public. Cette sorte de journalisme oral pouvait aller aussi loin qu'il voulait, à la seule condition de se faire applaudir.
Imaginez-vous la représentation d'une pareille pièce. Quelle journée! et que d'émotions! N'est-ce pas bien là cette Athènes que Bossuet définit ainsi: «Une ville où l'esprit, où la liberté et les passions donnaient tous les jours de nouveaux spectacles?»
Shakespeare, dans ses drames de Coriolan, de Jules César et de Richard III, a fait aussi d'admirables peintures du peuple, de sa crédulité, de sa mobilité, qui sont les mêmes dans tous les temps; il n'a pas effacé Aristophane. L'un et l'autre sont également vrais, par des procédés différents: Shakespeare, Anglais et réaliste, nous fait mieux voir la bête à mille têtes; Aristophane, Grec et idéaliste, les réunit en une seule et fait du peuple une personne. L'un met en mouvement la foule, comme les flots de l'Océan; l'autre la résume en un type et anime une abstraction, qui semble une réalité. Shakespeare n'a aucun parti pris, que de peindre la nature humaine; Aristophane en a un autre, et très-arrêté: c'est de combattre la démagogie, et même quelquefois la démocratie.
Mais ce que l'on nommait alors démocratie, n'était pas encore, tant s'en faut, la démocratie véritable. «Le vrai malheur d'Athènes, non plus que d'aucune cité antique, dit M. Havet, n'a pas été d'aller jusqu'à la démocratie, mais plutôt de n'y pas atteindre. On ne voit nulle part, dans le monde grec, un peuple qui ne dépende que de lui-même, mais des villes sujettes d'une autre ville, et, dans la ville maîtresse, une population d'esclaves sous une plèbe privilégiée. Pour qui n'était pas citoyen, il n'y avait pas de droit proprement dit. Si c'était une grande nouveauté dans la physique que de briser la voûte de cette sphère, d'un si court rayon, où on enfermait l'univers, comme l'osèrent Démocrite et Épicure, ce ne fut pas une tentative moins hardie, dans la philosophie morale, que de franchir les bornes de la cité, comme le firent les stoïciens. Les socratiques ne s'occupaient encore que de la cité, et là point d'inégalité, point de maître; on buvait, comme dit Platon, le vin pur de la liberté, on s'en enivrait jusqu'au délire, et la raison des sages se heurtait avec colère aux folies démagogiques qui s'étalaient de toutes parts. Il nous est facile aujourd'hui de reconnaître que le véritable principe de ces excès n'était pas l'égalité établie entre les citoyens, mais, au contraire, l'inégalité sur laquelle la cité était fondée. Et d'abord les délibérations de la multitude, amassée sur la place publique, seraient devenues chose impossible si dans le peuple eussent été compris les esclaves, et plus impossible encore si ces sujets d'Athènes, qu'on appelait ses alliés, eussent été tenus pour Athéniens, et n'avaient fait qu'un avec les habitants de l'Attique. Ainsi disparaissaient d'un seul coup l'extrême mobilité d'un gouvernement à vingt mille têtes, absolument incapable d'aucune suite; l'influence des démagogues tournant au vent de leur parole une foule assemblée deux ou trois fois par mois comme pour un spectacle; le scandale de la souveraineté exercée pour un salaire[18] par une population besogneuse, qui subsistait des oboles de l'agora ou des tribunaux; les fonctions publiques tirées au sort, non comme un service, mais comme un profit, tandis que les sages demandaient si ceux qui montent un navire ont coutume de tirer au sort celui qui gouvernera le vaisseau; une justice capricieuse comme une loterie, faite non pour les jugés, mais pour les juges, car il fallait leur fournir des procès pour les faire vivre, et ils recevaient, pour ainsi dire, des bons pour juger comme ils auraient reçu des bons de pain; enfin les malheureux alliés faisant principalement les frais de cette justice, comme l'atteste Xénophon, et forcés, pour l'alimenter, de s'en venir plaider dans Athènes. Toutes ces misères ne résultaient pas de ce que la république athénienne était une démocratie, mais bien de ce qu'elle était la démocratie de quelques-uns, et non pas de tous. Cette multitude exerçait en réalité une tyrannie, et, comme les tyrans, elle usait de sa puissance pour satisfaire ses envies et pour se dispenser de ses devoirs. Elle voulait régner par la guerre et elle ne voulait pas faire la guerre: elle payait donc des mercenaires, et c'est la plainte perpétuelle des bons citoyens; mais avec quoi les payait-elle? Avec l'argent des sujets. Sans les sujets, il n'y aurait pas eu de mercenaires, car qui les aurait payés? Et, sans les esclaves, il n'y aurait pas eu non plus de mercenaires: car, si tous les habitants avaient été des citoyens, Athènes n'aurait pas eu besoin d'étrangers pour se défendre. La multitude voulait encore avoir des fêtes, des spectacles, des distributions; elle payait tout cela, avec quoi encore? Toujours avec l'argent des sujets. Et, comme ce n'étaient pas ses propres deniers qu'elle administrait, ni les fruits de son travail, mais ceux du travail d'autrui, elle les administrait mal, et perdait en dépenses folles les ressources des services publics. Enfin toutes les misères privées ou publiques, toutes les espèces d'infériorité que l'esclavage entraîne avec soi, Athènes y était condamnée, ainsi que le monde ancien tout entier. Il ne s'agissait donc pas, pour la délivrer des maux qu'elle souffrait ou la mettre à couvert des périls dont elle était menacée, de restreindre chez elle la démocratie; tout au contraire il aurait fallu l'élargir, là comme dans toutes les cités du monde antique, l'étendre jusqu'où la démocratie moderne s'est étendue, et faire de l'empire d'Athènes, ou plutôt de la Grèce elle-même, ce que nous appelons une nation, dont tous les membres, égaux et libres, servent au même titre la patrie, et ne sont sujets que de la loi[19].»
* * * * *
Ne laissons pas cependant d'admirer la noble race athénienne. Quelle autre a plus fait pour la gloire et pour les progrès de l'humanité? Dans son amour de l'idéal, elle aurait voulu devancer les siècles; mais à toute chose il faut le temps pour se développer et pour mûrir. C'est donc l'honneur d'Athènes, et non pas son erreur, quoi qu'en aient dit Aristophane, et avant lui les pythagoriciens, et après lui les socratiques, d'avoir conçu et essayé la démocratie avant le temps. «Elle a aimé, du moins pour ses citoyens, l'égalité, le droit, la seule souveraineté de la loi et de l'opinion; elle a fait voir dans l'antiquité l'effort le plus indépendant et le plus hardi que la liberté humaine, eût fait jusqu'alors vers l'idéal politique: la république de l'avenir a donné là ses prémices, bien imparfaites et cependant déjà grandes[20].»
* * * * *
Le patriotisme d'Aristophane l'empêchait d'étendre ses regards vers l'avenir: il ne s'attachait qu'au présent, et même il eût voulu ramener le passé.
Dès cette époque, cinq siècles avant notre ère, la religion et la philosophie, par suite, la littérature et l'art, commençaient à être travaillés d'une crise de rénovation et de révolution qui ne devait aboutir que longtemps après, sous le nom de christianisme. Aristophane, dont l'imagination était si hardie, était d'une raison prudente à l'excès. Effrayé de l'ébranlement général des esprits, inquiet aussi et irrité des excès démocratiques, il se déclare à la fois l'adversaire de la démagogie, ennemie de l'ordre, de la sophistique, qui renverse les croyances, de la nouvelle tragédie, qui prêche une morale téméraire et qui abuse du pathétique en l'excitant par de mauvais moyens. Il personnifie la première dans Cléon, la seconde dans Socrate, la troisième dans Euripide. En toute chose, il déteste l'excès et craint la nouveauté; il prêche les anciennes mœurs, l'ancienne religion, l'ancienne politique, l'ancienne tragédie, les anciennes formes et les anciennes idées.
* * * * *
Pour nous modernes, qui sommes instruits par la longue suite des événements historiques accumulés pendant vingt-deux siècles depuis lors, une vérité est évidente:
Il y a tel progrès qui ne peut s'accomplir pour l'humanité tout entière qu'en brisant le peuple qui l'accomplit. Telle nation enfante une grande révolution dont profiteront tous les autres peuples, et est destinée elle-même à périr dans l'enfantement. Aristophane avait-il le vague pressentiment de cette vérité, que les destins de la Grèce et de Rome devaient manifester plus tard? et était-il moins soucieux du progrès de l'humanité que du danger de sa patrie? On pourrait le lui pardonner.