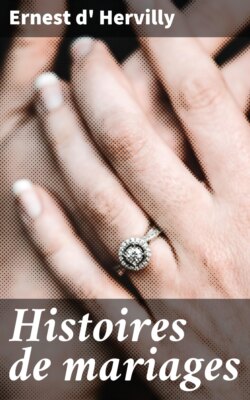Читать книгу Histoires de mariages - Ernest d' Hervilly - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
UN CANCRE FIEFFÉ
ОглавлениеTable des matières
HISTOIRE RACONTÉE PAR M. E…
Le Doigt de la Providence se manifeste visiblement, à plusieurs reprises, dans le courant de ce récit, seulement,–il est noir.
Je m’explique:
Le roi nègre Rana-wah-go, plus connu sous le nom sans prétention de Boule-de-Suie, que lui ont décerné les équipages des navires qui viennent à la Côte des Dents (Guinée supérieure) faire un commerce d’échanges avec les souverains des pays de l’intérieur, a joué un rôle considérable et providentiel dans mon existence.
C’est lui qui a fait tourner bride à ma destinée.
Sans cet excellent Boule-de-Suie, pardon, sans l’intervention de S.M. Rana-wah-go, la douce et charmante créature que j’ai l’honneur d’avoir pour femme aurait été emmenée en esclavage conjugal par un certain capitaine Saint-Ideuc, et le reste de ma vie se serait passé dans les larmes et à jouer de la flûte, sans recevoir les compliments d’une épouse dilettante.
Car je suis musicien, vous le savez, et cela depuis mes plus tendres ans. C’est même ce tempérament musical, dont j’ai donné des preuves dès le berceau (elles étaient alors sans harmonie, je l’avoue) qui ameuta contre moi, au collège, les professeurs de toute espèce qu’il contenait et me fit acquérir la réputation d’un cancre fieffé.
Cancre fieffé je fus au collège–pour mes pions, et cancre fieffé je suis resté dans la vie,– pour ceux-là du moins à qui il me déplaît de montrer que je connais encore pas mal de petites choses apprises tout seul.
Je n’eus donc aucun prix au collège. Jamais, je le jure, jamais un accessit de n’importe quoi ne me tomba sur la tête! Seulement, en sortant du Mazas universitaire où, quoique innocent, j’avais été incarcéré pendant dix ans par la volonté de mon parrain et tuteur, M. Seuleunéer, marchand de grains à Cambrai, je savais tout ce qu’on n’apprend pas dans les salles d’études, depuis l’art de faire cuire une volaille à point jusqu’à la science des fonctions d’un garçon d’ honneur.
En outre je savais par cœur et récitais avec goût les plus beaux morceaux, prose ou vers, des poètes et des littérateurs qui sont l’honneur de la France contemporaine, et dont personne, dans les lycées, ne vous dit même le nom.
J’étais un cancre fieffé!
Si bien que le jour de ma libération, lorsque j’eus fini mon temps de bahut, qu’on me passe le mot, je faisais un cavalier modeste, point pédant, réservé, utile dans le monde, sachant donner le bras à une dame, lui glisser un coussin sous ses jolies bottines, ou reporter avec grâce sa tasse de thé vide sur une table; mais je n’étais pas bachelier!
Je ne dédaignais pas non plus d’écouter parler les vieillards. En une heure de temps, dans leur conversation, et malgré d’inévitables radotages, j’apprenais plus de choses sur les hommes et la vie, l’histoire sociale et naturelle, les usages, les mœurs, etc., que les livres classiques n’avaient pu m’en mettre dans la tête en dix ans.
En ma qualité de cancre fieffé et de musicien, je demandai à mon parrain Seuleunéer, marchand de grains à Cambrai, place du Saint-Sépulcre, la permission d’entrer au Conservatoire.
J’avais alors vingt ans.
Mon parrain Seuleunéer éclata comme un volcan qui aurait eu une éruption de colère. Quand il eut retrouvé son calme habituel, il me dit, très froidement, que si je voulais prendre la peine d’examiner ses comptes de tutelle, je verrais clairement que les frais de mon éducation et de mon entretien avaient absorbé, sauf une petite somme, l’argent que m’avait laissé mes parents.
Il était tout disposé, me dit-il encore, à pourvoir, de sa propre bourse, à tous mes besoins jusqu’au jour où j’aurais un établissement sérieux, mais à condition que je renoncerais à mes bêtises musicales.
Il dit «bêtises», oui, messieurs, et Apollon ne descendit pas pour l’écorcher vif.
A ce discours, je répondis:
–Mon cher parrain, je serais désolé de vous priver et de priver ma chère Henriette,–c’était le nom de la fille de M. Seuleunéer, et je l’adorais –d’une parcelle, même infinitésimale, de votre fortune. Ayez seulement l’obligeance de continuer à faire valoir le petit capital qui est mon bien particulier, et tout ce que je vous demande, c’est de m’en faire parvenir mensuellement la rente à Paris, où je serai demain, avant le coucher du soleil, si la vapeur n’est pas un vain mot.
–Tu pars, s’écria Henriette qui avait écouté cet entretien suprême avec effroi.
–Oui, ma mignonne. Je suis un cancre fieffé. Je sens bien que je ne pourrai jamais devenir ce que mon parrain, non sans raison (car l’art est long et la vie est brève), voudrait que je devinsse: un commerçant, un notaire, ou tout autre espèce d’homme considérable et posé. Je serai musicien. Cultivons notre jardin, a dit Candide…
–Tu mourras sur la paille, voilà tout.
–Peut-être, mon parrain, mais soyez sûr du moins que j’y mourrai honnêtement, et en gardant jusqu’au dernier moment le souvenir reconnaissant de ceux qui ont remplacé, auprès de moi, pauvre petit orphelin, les parents que la tombe m’a pris.
–Va donc à Paris! murmura M. Seuleunéer, et… et… quittons-nous bons amis. Si plus tard tu te ranges, si tu trouves que la vache enragée est indigeste, si tu prends enfin un métier, fut-il le plus humble, je serai là pour t’aider.
–Encore un mot, mon cher parrain, un seul:–J’aime Henriette et j’espère bien que vous attendrez, pour la marier, que je sois.
–Il est trop tard, trop tard!–Jamais Henriette ne sera la femme d’un entêté joueur de lyre!
Il dit «joueur de lyre», avec un mépris extrême, et Apollon, provoqué pour la seconde fois, ne descendit pas de l’Olympe pour l’écorcher avec délices.
Pendant que nous nous livrions à cette joûte oratoire, la pauvre Henriette fondait littéralement en larmes.
Je me hâtai de prendre congé d’elle et de mon parrain, car mon cœur se brisait à la vue de la chère enfant.
Mais je n’eus pas le temps de leur dire adieu d’un air indifférent. Des pleurs jaillirent de mes yeux soudainement, comme je tenais le bouton de la porte.
Mon parrain s’attendrit à son tour. Ce fut une averse générale. Au bout d’un instant, nul n’aurait pu traverser la chambre à pied sec.
Je me précipitai donc dehors, tout ruisselant.
Il était temps!
Une minute de plus, en effet, et je jurais à mon parrain que je renonçais à la flûte, à ses pompes et à ses œuvres.
Le lendemain, j’étais à Paris. C’était l’époque de la rentrée au Conservatoire. Je m’y présentai, un professeur désagréable m’écouta, et je fus admis dans sa classe en qualité d’auditeur.
Mais nous voilà bien loin de l’excellent roi nègre Rana-wah-go. Revenons donc à ce souverain d’un brun foncé.
Le capitaine Saint-Ideuc, que j’ai à vous présenter, ramène tout naturellement Boule-de-Suie en scène. Boule-de-Suie était un des clients les plus remarquables du capitaine Saint-Ideuc. Celui-ci faisait, entre la Guinée et Anvers, avec escale principale à Dunkerque, un commerce lucratif de bêtes curieuses et même féroces.
En échange des animaux que lui livrait Boule-de-Suie, le capitaine Saint-Ideuc amenait à la côte des Dents des liqueurs d’une force extraordinaire, des Bibles de la société anglaise et des catéchismes catholiques, le tout pêle-mêle. Le capitaine Saint-Ideuc était très éclectique en matière de cultes. L’or était son dieu principal, il le célébrait seul avec une grande dévotion. Ce qui ne l’empêchait pas, en Europe, de se montrer parfait protestant quand il allait chercher une cargaison de Bibles à Londres, ou parfait catholique quand il obtenait à Cambrai un fort chargement de catéchismes et de «journées du Chrétien» destinés à la nourriture spirituelle des noirs plongés jusqu’au cou dans les ténèbres de l’ignorance.
Donc Boule-de-Suie était une mine d’or pour le capitaine Saint-Ideuc. Boule-de-Suie préférait, il faut l’avouer, le contenu des barils de faux rhum du capitaine au contenu de ses livres saints. Il se faisait néanmoins, là-bas, une grande consommation de ces bouquins, car les naturels impies avaient à la longue trouvé le moyen d’accommoder et de manger les peaux de leur reliure. Un ragoût de peaux de reliure était devenu, parmi les sujets de Boule-de-Suie, une friandise de high life, depuis que les délices de l’anthropophagie avaient été interdites, dans l’intérieur du pays, en exécution des ordres de la France et de l’Angleterre.
Après avoir mangé les reliures, les noirs, tout en fumant leur pipe, faisaient leur profit (quand ils savaient lire) des hauts enseignements renfermés dans les pages des livres sacrés.
Les bibles et les catéchismes servaient donc à la fois de nourriture spirituelle et matérielle aux noirs plongés jusqu’au cou, et même au delà, dans les ténèbres de l’ignorance.
Rana-wah-go, lui, n’avait aucun goût pour les fricassées de reliures, et c’était au rhum de la Jamaïque, fabriqué à Dunkerque, qu’il demandait de le consoler des déceptions du pouvoir unies aux tracasseries de ses innombrables épouses.
Le caractère trop agréable des principales épouses de Boule-de-Suie avait même réduit ce monarque, qu’elles tuaient à grand feu, à user fréquemment de ce reconstituant connu sous le nom d’huile de foie de morue.
C’était Saint-Ideuc qui avait conseillé au roi nègre de réparer ses forces en absorbant, matin et soir, de nombreuses coupes d’huile de foie de morue. Boule-de-Suie ne détestait pas l’huile de foie de morue, au contraire. Il trouvait seulement le breuvage un peu fade, et pour lui donner du ton, il avait inventé d’y ajouter du rhum et beaucoup de malaguette, le poivre du pays.
A l’aide de cet excellent régime, le potentat couleur de cirage s’inclinait chaque jour un peu plus vers la tombe.
Pourtant, il avait encore un espoir. La dernière fois que Saint-Ideuc était venu à la côte des Dents, il avait promis à Rana-wah-go de lui rapporter, à son prochain voyage, mais en échange d’animaux carnassiers de grande taille, un remède infaillible, un élixir d’une vertu formidable.
Confiant dans cette promesse, ayant rempli ses parcs de fauves terribles, Boule-de-Suie attendait impatiemment le retour de son étrange médecin blanc.
Ce que faisait celui-ci, pendant que les populations de la côte des Dents interrogeaient chaque jour l’horizon et demandaient au ciel de ramener bientôt l’ami du roi et le grand fournisseur de rhum du pays, je vais vous le dire.
Il était assis–et ceci se passait le lendemain du jour où je partis pour Paris–dans un petit estaminet de Cambrai, l’estaminet de La barque légère, en face de mon parrain Seuleunéer.
A côté d’eux, sur la table, se dressaient deux chopes à demi vidées, mais soigneusement recouvertes, comme c’est l’habitude, par un couvercle mobile en étain.
Ils causaient d’affaires de cœur et d’affaire d’argent.
Mon parain Seuleunéer, vivement poussé par le capitaine, lequel était de passage à Cambrai pour l’acquisition d’un solde d’ouvrages pieux de M. de Ségur,–reliés en veau, bien entendu, et qui sont fort goûtés en Guinée,– mon parrain Seuleunéer réfléchissait à la demande brusque que venait de lui faire, carrément, le capitaine.
Le capitaine lui avait demandé la main de sa fille Henriette.
–Je serai de retour dans six mois, mon vieux camarade, disait Saint-Ideuc, avec une cargaison d’animaux magnifiques dont je me déferai avantageusement sur le marché d’Anvers.
–Oui, vraiment! disait mon parrain.
–Oui, mon cher. On manque d’animaux féroces dans les ménageries d’Allemagne. J’ai reçu des commandes des muséums. Mon chargement réalisé, je me trouverai à la tête d’une fortune, qui grossit depuis longtemps, et je renonce à la mer.
–Oui, vraiment!
–Je viens prendre mes invalides à Cambrai. Votre fille et moi nous soignons vos vieux jours. Je vous raconte mes aventures. Nous sommes tous très heureux, et nous avons des bottes d’enfants.
–Mais, Henriette?… elle aime un petit jeune homme. mon filleul.
–Elle l’oubliera, son petit jeune homme, votre filleul! parbleu!
–Vous croyez?
–J’en suis certain.
–Alors, nous verrons… dans six mois.
Ce fut sur ce mot terrible–que j’appris par une lettre d’Henriette, car la chère enfant m’instruisait de tout ce qui se passait à Cambrai–que se séparèrent mon parrain et le misérable capitaine.
L’air de flûte que je jouai ce jour-là, en apprenant cette horrible nouvelle, fut lugubre. Je me crus perdu à tout jamais. Je composai même un morceau de circonstance que j’intitulai: Sombres regrets!
Le lendemain, je reçus une nouvelle lettre plus navrante encore que celle de la veille. Henriette m’avouait que son père avait donné sa parole au capitaine et qu’elle serait la femme de ce long-courrier, dès son retour. Larmes, crises de nerfs, annonce de mort prochaine, rien n’avait pu fléchir le vieux grainetier. Il avait juré! Le capitaine était parti radieux.
Mais, ajoutait la brave fille, en post-scriptum: –«Cet horrible mariage n’aura pas lieu. Je te le promets à mon tour, et je te le jure. Laissons passer le temps. Soyons patients. Travaille. Deviens un grand musicien.»
Cet encouragement qui n’avait pourtant que deux lignes, me remit un peu de baume au cœur J’entrevis des jours meilleurs. Il m’est impossible, en six mois, pensai-je, de devenir l’égal de Meyerbeer, mais je ferai tant des lèvres et des mains,–avec ma flûte–que je réussirai certainement d’ici là à me créer une position solide en donnant des leçons. Alors, fier, de l’argent plein les poches, j’irai à Cambrai et je dirai à mon parrain:–Je suis établi, donnez-moi Henriette, et au diable le capitaine!
Consolé par cette perspective riante, je fis à l’instant un nouveau morceau musical de circonstance, d’une gaieté tendre, d’un ton. bleuâtre, si j’ose m’exprimer ainsi, et que j’intitulai: Espoir fleuri!
Les mois se passèrent, j’étais toujours auditeur. L’époque du retour de l’infâme Saint-Ideuc approchait avec une rapidité extraordinaire. Bientôt ce ne furent plus des mois, mais des semaines, des jours, que je vis s’enfuir sans m’apporter la position sociale rêvée par mon parrain pour le mari de sa fille.
Enfin un matin, quelques jours avant la date fatale, les démarches que je faisais en vain depuis quelque temps,–flûte à part, hélas!–dans les corridors d’un ministère, furent couronnées d’un plein succès. On me proposa de concourir pour une place d’aspirant surnuméraire. J’acceptai avec reconnaissance! J’eus à subir un petit examen, et comme j’étais un cancre fieffé, je le passai brillamment. J’avais d’ailleurs pour moi les recommandations des dames auxquelles, dans les salons, j’avais donné le bras, glissé un coussin sous les pieds, ou pris leur tasse de thé vide. Les vieillards que j’écoutais complaisamment me furent aussi fort utiles. Ils patronnèrent chaudement un jeune homme qui, disaient-ils, étaient réellement digne d’intérêt..
Mon brevet d’aspirant surnuméraire en poche, je me rendis à Cambrai plein d’une noble fierté, et je l’exhibai aux yeux de mon parrain, d’un air de triomphe.
–Hélas, mon pauvre ami, me dit ce bon vieillard, il est trop tard. Je suis touché de ton sacrifice; mais il est trop tard. Henriette épousera le capitaine Saint-Ideuc. J’ai donné ma parole.
–Je le sais, mon cher parrain, mais j’ai votre parole aussi et je suis le premier en date. J’ai fait selon votre désir. Je ne suis plus musicien militant. Accordez-moi la chère petite.
–Impossible, j’ai juré.–Je le regrette, mais j’ai juré. Un grainetier sexagénaire ne connaît que son serment.
Je renonce à peindre ma douleur et celle d’Henriette.
Nous obtînmes cependant de mon parrain, visiblement ému par notre détresse, la promesse que si le capitaine n’était pas revenu à Cambrai quinze jours, ou même un mois, après l’expiration de la date fixée pour son retour, il se considèrerait comme libéré de tout engagement.
Le mois de délai s’écoula. Saint-Ideuc ne parut point sur l’horizon, et pour cause.
Et cette cause, nous l’apprîmes par la lettre suivante que publia un journal de Dunkerque:
–«Le10du mois dernier, à cinq heures du matin, l’homme de vigie du navire de l’État le Souffleur, qui se trouvait alors à400milles au large de la côte des Dents (Guinée supérieure), aperçut à l’horizon un bâtiment dont les allures étaient étranges et les manœuvres incompréhensibles. Il virait de bord à chaque instant, comme s’il eût été manœuvré par des fous. Le commandant du Souffleur fit exécuter des signaux auxquels il ne fut pas répondu. Alors, soupçonnant qu’il avait en vue un bâtiment négrier dont l’équipage était en révolte, il fit armer un canot, en confia le commandement à un enfant de notre ville, le jeune Pluvinage, aspirant de 2e classe, et lui donna l’ordre d’aller visiter le mystérieux navire inconnu. Le jeune Pluvinage atteignit bientôt les flancs du bâtiment suspect, et, le revolver au poing, monta à l’abordage suivi de ses hommes. Quelle ne fut pas leur surprise en se voyant reçus sur le pont par un lion exténué, mourant de faim. Ils tuèrent le lion, et passèrent outre. En arrivant sur le gaillard d’arrière, leur étonnement prit des proportions colossales en constatant qu’une foule de singes avaient pris en main la roue du gouvernail, qu’ils faisaient tourner dans tous les sens, au gré de leurs caprices, ce qui amenait les changements inouïs remarqués dans la marche du vaisseau. Ils s’aperçurent aussi, non sans horreur, que la mâture et les vergues étaient remplies d’énormes serpents. Dans les entreponts, qu’ils visitaient avec effroi, ils virent çà et là des squelettes humains complètement rongés. A côté d’eux se trouvaient les cadavres de panthères et d’hyènes.
«La lecture des papiers du bord leur révéla le mot de l’énigme. Le navire en question,–le Miroir de justice, capitaine Saint-Ideuc,– transportait en Europe une formidable cargaison d’animaux féroces.
«Ces terribles passagers trouvèrent un jour, on ne sait comment, le moyen de s’échapper de leurs cages, se rendirent dans les entreponts où ils attaquèrent les matelots et leurs chefs, qui se défendirent longtemps et finirent par succomber.
«Du reste, les regrets et la compassion que pourrait faire naître leur fin déplorable, seront absolument effacés dans tous les cœurs, quand on apprendra que le capitaine Saint-Ideuc faisait la traite des noirs en même temps que le commerce des bêtes fauves. Ce misérable marin a reçu le juste châtiment de ses derniers crimes envers l’humanité.»
Mon parrain Seuleunéer retrouva le premier la parole après cette nouvelle stupéfiante. Il la retrouva pour s’écrier:
–Un négrier!–J’aurais donné ma fille à un négrier!
–Il est de fait qu’un musicien vaut encore mieux, peut-être, fis-je doucement.
Mon parrain ne dit pas oui, positivement, mais il me tendit les bras.
Nous nous y jetâmes Henriette et moi, et toutes nos peines furent oubliées. Que Boule-de-Suie soit béni!
Et le lendemain, sans que mon oncle s’y opposât, installé, ma flûte à la main, sur les sacs de graines de sa boutique, je me mis à composer une marche nuptiale destinée à être jouée le jour de notre mariage. On l’intitula: Félicité!
Le morceau fini, je l’exécutai et mon parrain le trouva superbe.