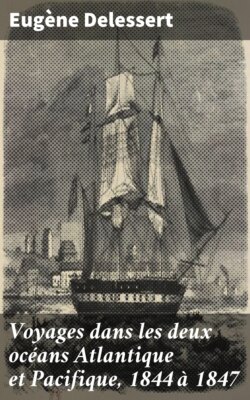Читать книгу Voyages dans les deux océans Atlantique et Pacifique, 1844 à 1847 - Eugène Delessert - Страница 7
A JEAN DE LÉRY.
Оглавлениеa Tu fus par ci la fidèle trompette
» Qui ce monde antartiq’ sommas à nostre foy,
» Et, n’eust esté ce traistre à son Dieu, à son roy,
» La conqueste sans glaive en estoit toute faicte
» Si ce peu de bon sang que la France rejette
» (France barbare aux siens) avoit tel cœur que moi,
» Nous te prendrions pour chef et irions avec toi
» Chercher là quelque part de paisibles retraites;
» Mais ains que s’embarquer, je voudrois tous jurer
» A peine du boucan de ne point déclarer
» A nos hostes nouveaux la cause du voyage;
» Car s’ils savoyent, Lery, comme sans nul merci
» Nous nous entre mangeons, ils craindroient que d’ici
» Leur vinssions quereller le titre de sauvage.»
Dans l’année 1558, le roi de Portugal, don Sébastien, meurt en Afrique avec l’élite de sa noblesse. Le sombre héritier de Charles-Quint, Philippe II, s’empare du Portugal et de ses colonies, et ce ne fut qu’en 1640 que le Brésil revint de nouveau à ses premiers maîtres. Mais, pendant la domination espagnole, les Hollandais s’emparèrent de la partie du Brésil comprise entre l’embouchure du Rio-San-Francisco et du Maragnan, où ils fondèrent divers établissements.
C’est l’époque à laquelle des guerres sanglantes et de cruelles exterminations vinrent apprendre aux naturels du pays ce qu’ils devaient attendre de leurs maîtres européens. Sans cesse attaquée par les Anglais ou les Hollandais, qui, toujours repoussés, reparaissaient encore, la colonie, mal défendue et plus mal gouvernée, périssait d’une double plaie. Cette guerre d’insurrection et d’usurpation finit enfin en 1654. Dès lors le Brésil hollandais fut perdu pour la métropole; mais aussi, à partir de cette époque, la maison de Bragance étendit sa sollicitude sur ce riche pays, qui, n’étant plus disputé, ne tarda pas à gagner en étendue et en importance. C’est à ce moment qu’on découvre les mines d’or de la province de Minas-Geraes, et quelques années plus tard les mines de diamants.
Jusque-là l’Amérique portugaise n’avait été qu’un immense littoral parsemé de rares habitations, de faibles villes maritimes; mais la voici qui s’enrichit de nouvelles provinces: l’appât de l’or fraie un passage dans l’intérieur et y crée des villes. Pernambuco et Bahia se relèvent des désastres de la guerre, et Rio-Janeiro, qui avait supporté une désolation de. trente ans sans trop souffrir, prend un rapide développement et devient en 1773 la capitale du Brésil.
Depuis le commencement du dix-neuvième siècle Napoléon ébranlait les trônes de l’Europe; les héritiers des Césars sentaient leur couronne vaciller sur leur tête. En 1808, un capitaine du grand empereur poussa violemment la famille de Bragance sur les côtes brésiliennes, où elle vint se consoler de son royaume perdu; mais là encore la tranquillité fuyait le roi Jean, la mode des constitutions était dans l’air et les flots l’avaient portée par delà l’Atlantique. Don Pedro devient empereur du Brésil pour laisser à sa fille dona Maria le turbulent Portugal. En 1831, il est lui-même forcé d’abdiquer en faveur de son fils don Pedro II, âgé de sept ans, qui fut à son tour proclamé empereur.
Si j’avais sous les yeux le naïf conteur Jean de Léry, je pourrais longuement parler de ces infortunés Peaux-rouges, basanés, tatoués, que je plains de tout mon cœur. Le lecteur qui consultera cet auteur s’initiera parfaitement aux mœurs de ces hommes sauvages; il assistera à leurs festins de cannibales sans éprouver le moindre désir de les partager, nous assure notre voyageur. Il les verra dormir du sommeil du juste après avoir dépecé un de leurs semblables, et ne pas se montrer après trop mauvais pères ou intraitables époux.
Je dois à la vérité de mon récit de déclarer que je n’ai pas eu le plaisir de rencontrer dans mon voyage un seul de ces habitants primitifs. A mesure que la civilisation avance, ils reculent, laissant à leurs frères blancs les cendres chaudes de leur foyer, et ne s’inquiétant pas de l’empereur qui trône à Rio. On n’en voit guère sans doute venir grossir les rangs de la milice citoyenne ou les bataillons des régiments; ils sont probablement tout aussi indociles à payer les impôts ou à satisfaire aux autres exigences du régime constitutionnel. Je sais pourtant que quelques tribus ont embrassé le christianisme et adopté certaines habitudes de la civilisation; le reste vit dans l’état sauvage au milieu des forêts.
Je pourrais, tout comme un autre, me livrer à des discussions plus ou moins profondes au sujet de ces peuples autochthones, que les premiers navigateurs découvrirent dans l’Amérique sans avoir obtenu le secret de la route qui les y avait amenés. Car enfin la question, souvent débattue, n’est pas encore résolue, que je sache. D’où venaient ces peuples américains? quelle fut l’origine de ces races diverses? on s’est perdu en recherches pour le découvrir, mais leur berceau reste encore caché dans la poussière des siècles. La science en défaut, s’efforçant en vain de soulever le voile qui le couvre, est réduite à glaner dans le champ stérile des conjectures. On a bien supposé que le naufrage de quelques jonques japonaises ou chinoises avait formé les premiers éléments de cette population; mais les observations anatomiques, appliquées aux caractères nombreux que présente l’espèce humaine, ont démontré qu’il existait une différence très-grande entre les Américains et les races mongoles. Ainsi s’est écroulée la conjecture qui offrait le plus de probabilité. Résignons-nous: il y a dans le monde physique et dans le monde moral bien d’autres mystères qui confondent la raison humaine.
Tout dans l’Amérique, dit un voyageur , porte la trace d’une antique civilisation éteinte dont l’âge est inconnu. Des races civilisées, sans nom pour nous, ont disparu de la face du monde peut-être par quelque cataclysme, par quelque phénomène de la nature ou les ravages de la conquête. Qu’est devenu le peuple qui sut élever ces villes, ces canaux, ces édifices, ces camps, ces lignes immenses fortifiées et construites en maçonnerie, ces statues colossales que le voyageur rencontre au sein des solitudes les plus reculées, sur les bords du Missouri, de la Colombie, de l’Ohio, au Mexique, au Pérou, au Chili? Où sont les habitants de ces grandes cités dont on retrouve les vestiges au désert? Qui a construit ces gigantesques monuments tumulaires, érigés à la gloire de héros dont les noms ont disparu dans l’éternité ?
Dieu s’est réservé jusqu’ici la solution de ces questions et d’un grand nombre d’autres tout aussi mystérieuses; mais pourquoi ces peuples américains, qui, sur plusieurs points du vaste continent, avaient dû atteindre à une civilisation très-avancée, étaient-ils sur quelques autres dans un état de barbarie voisin de la brute? A l’époque de la découverte des Portugais, le Brésil était partagé entre plusieurs nations ou peuplades différentes: les unes cachées dans les forêts, d’autres établies dans les plaines, sur les bords des rivières ou sur les côtes de la mer; quelques-unes sédentaires et plusieurs autres nomades: celles-ci trouvant dans la chasse ou la pêche leur principale subsistance, celles-là vivant surtout des productions de la terre plus ou moins cultivée; la plupart sans communication entre elles ou divisées par des haines héréditaires et toujours armées
La race qui paraissait alors dominer au Brésil était celle des Tupis. Au rapport des voyageurs, ils étaient des hommes par la conformation physique et des brutes par les instincts. L’anthropophagie était dans leurs mœurs: «Ils dévoraient
» en cérémonie et avec une horrible joie leurs prisonniers de guerre et
» souvent leurs amis,» nous dit Jean de Léry. Tous les Brésiliens n’étaient cependant pas cannibales.
Botocoude.
Peau-rouge.
En contemplant de pareils êtres humains, le philosophe se demandera où remonte le naufrage de la civilisation américaine qui a peuplé ces solitudes de sauvages errants? quelle puissance mystérieuse a opéré cette dépression de l’intelligence, d’où est sortie l’altération de tout l’être pensant? La raison fait silence, et les sauvages ne nous apprennent rien. Je doute cependant que les terres du Brésil aient jamais été la demeure de nations civilisées comme celles du Mexique; aucun voyageur n’a signalé dans l’empire brésilien les restes de monuments antiques, de villes ruinées ou les murs croulants de hautes pyramides. Il est peut-être permis de croire que les Brésiliens, en montagnards obstinés, se seront gardés volontairement des raffinements de la civilisation du royaume des Incas; seulement, lorsque la nuit se sera faite sur cette race d’hommes, en punition, qui sait? de quelque monstrueuse transgression de la loi naturelle et divine, les ténèbres seront devenues plus épaisses chez nos sauvages, qui auront eu moins de chemin à faire pour arriver à l’état de la brute: je ne trouve pas de meilleure raison pour expliquer l’excès de barbarie stupide, immonde, dans lequel les premiers voyageurs les trouvèrent.
Négresses esclaves.
Quant à la population actuelle, elle se compose 1° des Européens; 2° des Brésiliens blancs nés au Brésil; 3° des mulâtres, c’est-à-dire de la race mêlée des blancs et des nègres; 4° des Mamalucos, ou la race mêlée des blancs et des Indiens dans toutes ses variétés; 5° des Indiens civilisés qu’on appelle Caboclos; 6° de ceux qui mènent encore une vie sauvage et qu’on appelle Tapayas; 7° des nègres nés au Brésil et d’Africains affranchis; 8” enfin des Mestizoz, ou la race mêlée des Indiens et des nègres. Les esclaves sont africains, nègres, créoles, mulâtres ou mestizoz.
On compte aujourd’hui au Brésil plus de cinq millions d’habitants, sans comprendre dans ce nombre les peuplades indiennes, qui occupent une partie considérable du pays. Les nègres esclaves composent à peu près la moitié de cette population.
Il est peu de pays hors d’Europe qui offrent autant de ressources que le Brésil, et qui soient appelés à jouer dans la politique du monde un rôle aussi brillant. Ses montagnes recèlent dans leur sein des métaux précieux, ses rivières couvrent de leurs eaux des diamants et des pierres fines; le sucre et le froment, la vigne et le café, les arbres fruitiers de l’Europe et de l’Inde sont cultivés à la fois dans ses terres fertiles; ses immenses solitudes ne demandent qu’à recevoir d’innombrables colons, et ses ports assurent de faciles débouchés aux produits du sol et de l’industrie. Le Brésil se mettra-t-il en voie de progrès, s’élèvera-t-il dans un temps donné à la hauteur des Etats-Unis? c’est ce qu’il est impossible de prévoir. Il a sur cette puissance l’avantage d’un climat plus doux, d’un sol plus fertile en productions utiles ou de grand prix; et par sa position géographique, qui domine le chemin des deux Indes et de toutes les grandes mers du globe, il forme comme le nœud des communications commerciales de toutes les parties du monde civilisé. C’est en vain que des flottes nombreuses tenteraient de l’envahir: des armées formidables ne sauraient lui inspirer de crainte; la nature a su le mettre à l’abri de l’ambition ou de la mauvaise foi étrangère.
Pendant tout le temps que le Brésil fut soumis au régime colonial, il fut fermé aux étrangers avec un si grand soin, qu’on ne connaissait rien de son intérieur et de son administration. On demandait encore, dans un livre imprimé au commencement du siècle, si la baie de Rio-Janeiro n’était pas l’embouchure d’une grande rivière. Si le pays a fait relativement peu de progrès dans les arts les plus nécessaires, il serait injuste d’en accuser exclusivement les Brésiliens. Personne n’ignore que le système colonial tendait à retarder le développement de l’instruction.
L’événement qui conduisit à Rio-Janeiro la famille de Bragance a changé la face du pays. Ce n’est plus une colonie obéissant avec répugnance à une métropole exigeante, c’est un vaste empire avec toutes les chances de parvenir au plus haut degré de prospérité.
Les institutions démocratiques qui ont fait du Brésil une monarchie fédérative avaient été regardées par beaucoup comme autant de degrés menant à une république. L’exemple des turbulents voisins de la Colombie, du Chili, de Buenos-Ayres devait être contagieux; voilà pourtant que son jeune empereur de vingt ans ne se trouve pas trop mal assis sur son trône. Grâce à la prudence de son gouvernement, grâce aux alliances contractées par ses sœurs, dont l’une a épousé un prince napolitain et l’autre un vaillant fils de Louis-Philippe, sa puissance est assez solidement assurée au milieu de ces institutions constitutionnelles.
La capitale de l’empire, Rio-Janeiro, passe à juste titre pour la plus importante ville de l’Amérique du Sud; elle est située sur une langue de terre haute et baignée par une vaste baie dont l’entrée, resserrée entre les rochers et protégée par des forts, est éloignée de trois quarts de lieue de la ville. On distingue la vieille ville et la ville nouvelle, qui ne date que de 1808. Le port, vaste et profond, est défendu par un château. La ville se prolonge sur tout un côté de la baie, abritée malheureusement des vents de terre par les montagnes; on y éprouve une chaleur étouffante; elle ne reçoit de fraîcheur que de la brise de mer, qui ne se fait sentir que dans le milieu du jour. Quelques maisons et des chantiers sont établis sur des îles voisines du port. Les rues sont bien alignées, généralement étroites, assez mal pavées, mais garnies de trottoirs: on remarque tout d’abord la rue d’Ovidor, entièrement française. De belles maisons bâties en granit, plusieurs places publiques, quelques monuments importants donnent de la physionomie à cette ville. Le palais impérial est un bâtiment fort simple, dont rien à l’extérieur ne révèle le séjour de ses hôtes illustres; les briques rouges qui ont servi à sa construction lui donnent un pauvre aspect.
Les environs de Rio sont renommés par les admirables tableaux qu’y offre la nature. «C’est la beauté de la situation, dit M. Balbi, la bonté du climat et
» les richesses végétales plus que l’œuvre des hommes qui attirent l’attention
» des voyageurs.» On ne rencontrerait nulle part au monde de plus belles promenades. Les principales, celles où si souvent j’ai porte mes pas et mes rêveries, en donnant un souvenir à la patrie absente, sont celles de Botafogo, Larangerias, le jardin public, la Gloria, l’Aqueduc, Rio Compredo, Engenho Velho, Saint-Christovâo, Corcovado, etc. Le plus brillant coloris du peintre paysagiste n’en donnerait qu’une idée incomplète: et pourtant ces lieux ravissants sont déserts. Les habitants de Rio préfèrent l’intérieur de leurs sombres demeures aux promenades merveilleuses, où l’on est si bien.
L’eau est amenée dans la ville par un aqueduc d’un bel effet, qui traverse une vallée profonde. Les églises sont en grand nombre, comme dans toutes les anciennes colonies espagnoles ou portugaises. Si elles ne se distinguent pas par une architecture bien caractérisée, l’intérieur est splendidement orné : aussi les fêtes religieuses s’y célèbrent-elles avec une pompe inusitée ailleurs. Dans les grandes solennités, on tire dans les rues et devant les portes des églises des feux d’artifice dont le bruit, ajouté au fracas de toutes les cloches en mouvement, surprend et étourdit outre mesure l’étranger.
Je croyais trouver une ville originale, ayant son caractère propre, et le génie moderne m’avait gâté Rio-Janeiro: je trouvai, comme en Europe, un amas de maisons élevées, des places et des rues: il eût mieux valu pour les Brésiliens bâtir d’une autre façon que nous: au lieu d’écraser leurs maisons sous des étages répétés, j’aurais voulu de vastes maisons à un seul étage, avec des galeries, des cours, des jardins, où l’air puisse circuler; tout comme à la Havane, qui se trouve à la même latitude nord que Rio. Si ce n’était une prodigieuse quantité de nègres, de négresses, que l’on rencontre à chaque pas dans les rues, occupés à divers travaux, et criant à vous rendre sourd, on se croirait dans une ville d’Europe. Il y a des habitudes de mauvaise tenue, de malpropreté qui choquent et incommodent l’étranger. La police des rues est mal faite, tout s’y dépose et s’y entasse. Il en résulte des exhalaisons d’autant plus nuisibles à la santé que le climat est plus chaud.
Rio a plusieurs établissements scientifiques d’instruction publique, des journaux et des revues. On trouve à Rio les partisans du gouvernement et les farrapilhas ou sans-culottes: ces républicains ne sont pas d’accord, les uns veulent la forme unitaire, et les autres la forme fédérative: en attendant, la république est ajournée, et sa théorie ne se discute point officiellement. Mais les partis juste milieu, pour parler comme en France, ou républicain, ne prouvent pas que l’éducation politique des Brésiliens soit bien avancée.
Le musée de Rio mérite d’être vu: ce qui en fait tout le prix, selon moi, c’est qu’il est exclusivement formé d’animaux et de curiosités du pays. Je conseille aux voyageurs de ne pas oublier la salle des oiseaux, où ils remarqueront une collection des plus rares, la magnificence du plumage et la grande quantité des individus. Celle des minéraux ne pouvait manquer d’être curieuse et riche, avec les nombreux produits minéralogiques du Brésil. Il y a des momies indiennes bien conservées, divers ustensiles, des armes, des vêtements de sauvages.
Le théâtre ou alcala est un des plus beaux monuments à visiter, la salle est vaste, bien éclairée et bien aérée; on la dit aussi grande que celle de l’Opéra de Paris. Il existe aussi un théâtre français à la mode et où la cour se rend tous les jours.
Le passo publico, jardin public, est remarquable par la diversité des plantes qu’on y cultive, et la belle vue dont on jouit. Combien de fois ne suis-je pas allé dans ce charmant jardin promener mes rêveries, endormir mes soucis, ou chasser les accès du spleen! La mer m’envoyait des brises rafraîchissantes; et Dieu, les pensées qui fortifient et consolent. Ce que j’éprouvais au milieu de ces ombrages, parmi tous ces parfums, en regard de magiques tableaux, je ne saurais l’exprimer. C’était le calme, une jouissance doucement pénétrante, le bonheur pour quelques heures.
Un de mes amis m’écrivait d’Europe: «Si tu te promènes, un matin ou un
» soir, sur la terrasse du jardin public, par un soleil brûlant qui ne saurait t’atteindre,
» l’immense baie de Rio devant toi, à gauche les Orgues, à droite l’entrée
» de la baie, en face Praia Grande, et si dans une religieuse admiration
» tu te demandes, si quelqu’un comme toi éprouva les émotions touchantes
» auxquelles tu te laisses aller; écoute: il y a dix ans, j’étais là, moi aussi,
» mollement bercé de rêveries, heureux de trouver tant de charmes à la vie.
» J’admirais en silence: personne ne venait troubler mes joies intimes. Mais
» je regardais la mer, et la pensée de tout ce qui m’était cher, de tout ce que
» j’avais quitté, me faisait aspirer vers les climats brumeux de la patrie.»
C’est bien ainsi que se traduisaient mes sentiments. Je jouissais avec délices de toutes les merveilleuses choses que je voyais: mais une pensée se détachait, pour aller saluer, par delà les mers, les êtres chéris qui me manquaient. Et je revenais de ma promenade un peu ému, triste souvent, mais cette tristesse était pleine de charmes.
Rio se trouve naturellement par sa position le grand marché du Brésil, et spécialement celui des provinces de Minas-Geraes, de Saint-Paul, de Goyas, etc. Les districts des mines étant les plus peuplés ont aussi le plus besoin de marchandises, et envoient en retour les objets les plus précieux du commerce.
L’Anglais Mawe dit que le port d’aucune colonie n’est aussi bien situé que celui de Rio pour le commerce de toutes les parties du monde: il semble creusé par la nature pour former le lien qui doit unir entre elles les grandes divisions du globe. Les relations de cette capitale tendent à l’agrandir tous les jours. On importe au Brésil les produits de tous les pays. Les objets d’exportation sont le coton, le sucre, le rhum, le bois de construction, de marqueterie, les cuirs et le suif; les plus précieux sont l’or, les diamants, les topazes de différentes couleurs, les améthystes, les tourmalines, les aigues-marines, etc.
Dans un temps donné, Rio deviendra un centre de relations commerciales avec l’Europe, la Chine, les Indes orientales et les îles du Grand-Océan. Il suffit que le gouvernement entende assez bien ses vrais intérêts, pour donner à cette ville tout le degré de prospérité qu’elle comporte. On évalue sa population à plus de deux cent mille habitants, dont les esclaves composent la majeure partie.
En descendant dans la partie la plus méridionale du Brésil, nous trouvons le climat tempéré. La capitainerie de Rio-Grande-do-Sul qui touche à l’Uraguay est une de celles que la nature a le plus favorisée. Son territoire produit dans la partie septentrionale du sucre, et dans la partie méridionale du froment, et tous les fruits de l’Europe. Ses habitants jouissent d’une santé robuste: ils ont le teint frais et coloré, les mouvements vifs, les manières aisées.
Sur une presqu’île formée par une colline qui s’avance dans le lac Dos Pathos s’élève la jolie petite ville de Porto-Alegre, capitale de la Province. Ses toits rouges, un peu élevés et saillants, se détachent admirablement, en couronnant des maisons blanches ou jaunes et d’une architecture simple et gracieuse. Les maisons de nouvelle construction sont élégantes, celles plus anciennes sont basses et mal disposées.
Cinq rivières, apportant le tribut de leurs eaux et se réunissant pour former le Rio-Grande-do-Sul présentent en face de la ville un vaste bassin parsemé d’îles nombreuses très-boisées et peuplées d’habitations champêtres. Cette position est charmante. «Ce n’est plus la zone torride, dit M. Saint-Hilaire, ses
» sites majestueux et encore moins la monotonie de ses déserts, c’est le midi de
» l’Europe et tout ce qu’il y a de plus enchanteur.» Ce voyageur était à Porto-Alegre au mois de juin: l’eau gela souvent.
Porto-Alegre, situé par 30° 2′ sud, doit être considéré comme la véritable limite du manioc et du sucre dans la partie est de l’Amérique méridionale.
Au delà de Rio-Grande vers le sud, l’influence du climat devient plus sensible. Ainsi à un degré au nord de Porto-Alegre, les arbres dans la saison la plus froide sont encore tout chargés de feuilles. A San-Francisco-de-Paulo, à peu près le tiers des végétaux ligneux perd les siennes; et enfin à deux degrés plus au sud, un dixième des arbres seulement conserve son feuillage, et ce ne sont guère que les espèces les moins élevées.
Si nous remontons au nord jusqu’au 27° 19′ de latitude australe, nous touchons à l’île Sainte-Catherine, séparée du continent par un détroit qui n’a pas une demi-lieue de largeur. Rien n’est plus gracieux que la ville et ses environs. Le canal est bordé de collines, de petites montagnes très-variées par la forme, et qui, disposées sur différents plans, offrent un mélange charmant de teintes brillantes et vaporeuses; l’azur du ciel n’est point aussi éclatant qu’à Rio, mais il est aussi pur et se nuance, dans le lointain, avec la couleur grisâtre des mornes qui bornent l’horizon. L’humidité naturelle du sol entretient dans l’intérieur de l’île une brillante végétation, qui ressemble en grande partie à celle de Rio. La prodigieuse quantité de fleurs, les plus belles, annonce la qualité fécondante du climat. Les roses et les jasmins y sont en fleurs toute l’année. A treize lieues plus au sud on commence à trouver des changements plus notables dans la végétation; et la différence de l’été et de l’hiver est déjà sensible.
L’entrée du port de Sainte-Catherine est commandée par deux forts. La ville, peuplée de six mille habitants, est un séjour particulièrement affectionné par les négociants et les marins retirés. Vis-à-vis de la ville, sur le continent, de hautes montagnes couvertes d’arbres forment une barrière impénétrable.
En longeant la côte vers le nord-est, nous arrivons à Santos. Cette ville, dont les environs sont souvent submergés, est un des plus anciens établissements européens du Brésil. La ville dut son origine au premier navire qui fit naufrage sur l’ile de Saint-Vincent. Santos est le magasin général de la province de Saint-Paul: le lieu où abordent beaucoup de navires qui font la navigation du Rio-de-la-Plata. On récolte dans les environs le meilleur riz du Brésil. Sa population est de huit mille habitants.
Si de Santos nous voulons aller visiter Saint-Paul, il nous faut abandonner le rivage de la mer et nous aventurer dans des montagnes d’une hauteur presque inaccessible: mais nous rencontrons là une route merveilleuse, creusée dans le roc à travers la Serra-de-Perrannagua. L’Europe ne peut pas montrer beaucoup d’ouvrages qui l’emportent sur ce chemin, nous dit le voyageur anglais Mawe. Napoléon, qui a percé le Simplon, aurait peut-être lui seul pu en concevoir l’idée et en exécuter le plan. On arrive par des pentes ménagées sur une hauteur qui s’élève à trois mille mètres au-dessus du niveau de la mer
La ville de Saint-Paul ou San-Paulo, chef-lieu de la province de ce nom, est bâtie sur une éminence, entourée de tous côtés par des prairies basses, et arrosée par plusieurs ruisseaux. Elle fut fondée par les jésuites, séduits sans doute autant par les mines d’or des environs que par la salubrité de sa position. Sous ce rapport elle ne le cède à aucun autre lieu de l’Amérique méridionale. Sa population s’élève au-dessus de quinze mille âmes.
Les Paulistes se sont constamment signalés par leur esprit entreprenant, et par cette ardeur pour les découvertes qui distingua autrefois les Portugais. Ce fut d’abord un mélange de la race brésilienne et d’aventuriers des différents pays de l’Europe. On les désignait sous le nom de Mamelucs, peut-être à cause de leur ressemblance avec ce qu’on appelait les brigands de l’Égypte. Ils s’enrichissaient par le commerce des esclaves, ils bravaient les édits de la cour, les brefs du Saint-Siège, chassaient les jésuites et s’organisaient militairement. Ils ont parcouru tout le Brésil, se sont frayé de nouvelles routes à travers des forêts impénétrables, et ont trouvé un grand nombre de mines riches, et entre autres la mine d’or de Juragua, la plus ancienne du pays.
Il y a un siècle passé, ce canton était en or. C’était comme le paradis terrestre du Brésil, dont il fut pendant deux siècles le véritable Pérou. Ce n’est qu’après avoir épuisé les mines par le lavage que les habitants se sont adonnés à l’agriculture, dont ils se trouvent mieux malgré leurs mauvais procédés dans cet art encore dans l’enfance chez eux.
Au sud de Saint-Paul on voit successivement s’arrêter la culture des diverses productions coloniales, dont les limites sont ici le résultat combiné de la nature de chaque plante, de l’élévation du sol et de l’éloignement de l’équateur. A dix lieues de Saint-Paul on trouve la ligne des cafiers; douze lieues plus loin, celle de la canne à sucre: à quinze lieues de là, plus de bananiers; enfin à quarante lieues plus avant s’arrêtent les cotonniers, ainsi que les ananas.
En se dirigeant à l’ouest, on trouve Los Campos-Geraes, qui forment un des plus beaux cantons du Brésil. Les mouvements du terrain n’y sont pas assez sensibles pour mettre des obstacles à la vue. Aussi loin qu’elle peut s’étendre, on découvre d’immenses pâturages: des bouquets de bois où domine l’utile et majestueux araucaria sont épars dans les vallées profondes. Quelquefois des rochers à fleur de terre se montrent sur le penchant des collines, et laissent échapper des masses d’eau qui se précipitent en cascades. De nombreux troupeaux de juments et de bêtes à cornes paissent dans la campagne, où les maisons sont rares mais bien entretenues.
Les habitants des Campos-Geraes tirent peu de parti de leur terrain fertile: ils se livrent généralement au commerce des mulets, qu’ils vont chercher en bravant mille dangers dans Rio-Grande. Respirant un air pur, sans cesse occupés à monter à cheval, à jeter le lazo ou à rassembler les bestiaux dans les pâturages, ils jouissent d’une santé robuste, et sont en général grands et bien faits.
Au nord des provinces de Saint-Paul et de Rio-Janeiro nous entrons dans l’El Dorado, ce pays fabuleux, on le croyait, qui produit l’or et les diamants.
Tenons-nous sur nos gardes, car on n’entre pas ici sans précaution, et on n’en sort pas surtout sans être fouillé. Des postes nombreux sont échelonnés sur divers points, surveillant les touristes savants ou curieux, les arrêtant, pour s’assurer s’ils n’ont pas glissé dans leurs poches quelques-unes de ces pierres précieuses dont la belle moitié du genre humain est si avide.
La province de Minas-Geraes est une des plus mal cultivées. Les bras qui manient l’or pourraient-ils, avons-nous déjà dit, s’abaisser à travailler la terre? Aussi les environs de Villa-Rica, la ville principale, attristent-ils les regards par leur aspect âpre et sauvage. On ne découvre de tous côtés que des gorges profondes, des montagnes arides. Partout des terrains sillonnés, déchirés, bouleversés, attestent les travaux des mineurs. Les forêts vierges qui de Rio se prolongent dans une étendue de cinquante lieues ont été incendiées dans tout le district. La verdure des gazons a fait place à des amas de cailloux, et les rivières, salies par l’opération du lavage, roulent des eaux fangeuses et rougeâtres,
Villa-Rica pourrait être plus justement appelée de nos jours la Ville-Pauvre. Rien ne répond plus à la magnificence de son nom; il n’en était pas de même vingt ans après sa fondation. Alors, elle passait pour le lieu le plus riche du globe. Vers 1713, la quantité d’or produite par le district de Villa-Rica était si considérable, que le cinquième du roi s’élevait annuellement à 12 millions.
De 1730 à 1750, les mines atteignirent à leur plus haut degré de prospérité : il y eut dans cette période des années où le cinquième du roi donna 24 millions.
Peu à peu les mines s’épuisèrent, et la ville riche devint la cité des misères. Aujourd’hui les habitants désœuvrés, rêvant peut-être un passé qui ne saurait revenir, négligent la culture de leur beau pays, qui les récompenserait pourtant amplement des richesses que leurs ancêtres arrachaient de son sein.
Villa-Rica, sous un climat qui rappelle celui de Naples, renferme vingt mille habitants. Ses rues sont irrégulières, mal pavées, mais variées par des jardins en terrasse et décorées de jolies fontaines qui conduisent l’eau dans toutes les maisons.
Saluons cette grandeur tombée, pour laquelle l’or n’est, hélas! trop réellement, plus qu’une chimère, et soyons encore davantage sur nos gardes; nous voici à Villa-do-Principe, où nous pourrions bien être emprisonnés comme suspects: c’est la frontière du district des diamants, le Cerro-do-Frio: à mesure que nous avançons dans ces lieux de trésors enfouis, la contrée, montagneuse et stérile, est peu habitée; la misère y est à son comble. Singulière destinée que celle des hommes occupés aux plus productives industries, ils enrichissent le monde et vivent de privations.
Dans le Cerro-do-Frio, l’aspect du paysage a changé : la surface du sol, recouverte de graviers et de quartz, dépourvue d’herbes et de bois, présente des couches de grès micacé. Dans plusieurs endroits, sur les bords des rivières, il y a de grandes masses de cailloux roulés, agglutinés par de l’oxyde de fer et qui enveloppent l’or et les diamants.
Nous arrivons à Tejuco, résidence de l’intendant général des mines. Les environs de cette ville ne ressemblent en rien à ceux de Villa-Rica. Ici tout est aride et âpre, mais plus qu’ailleurs la misère est générale: les habitants meurent de faim, et ils ont sous les yeux l’or et les diamants qui s’entassent chaque mois dans le trésor de l’intendance.
Ce qu’on appelle le district des diamants peut avoir seize lieues du nord au sud et huit de l’est à l’ouest sur le point le plus élevé du Cerro-do-Frio. Ce furent des mineurs entreprenants de Villa-do-Principe qui le découvrirent au commencement du dix-huitième siècle: ils cherchaient de l’or et ils trouvèrent des diamants.
Depuis 1772 les mines de diamants s’exploitent au profit du gouvernement, qui punit avec rigueur les fraudeurs maladroits. Malheur au nègre soupçonné d’avoir avalé une de ces pierres précieuses: si on ne lui ouvre pas le ventre, comme on rapporte que le faisait faire un chef d’exploitation de je ne sais quel district des Cordilieres, on prend les plus minutieuses précautions pour la retrouver; car elles ne peuvent se dissoudre et n’ont point été avalées pour donner l’exemple d’un repas plus somptueux que celui de Cléopâtre.
On rapporte que la quantité de diamants envoyés en Europe pendant les vingt premières années de la découverte est presque incroyable, elle dépassa 1,000 onces.
La principale exploitation a lieu dans le lit du Jiquitonhonha, qui coule au nord-ouest, et porte ses eaux au Rio-Grande-de-Tocayes. Les substances qui accompagnent les diamants et que l’on regarde comme de bons indicateurs de leur présence, sont un minerai de fer brillant et pisiforme, un minerai schisteux, siliceux, de l’oxyde de fer noir en grande quantité, des morceaux roulés de quartz bleu, du cristal de roche jaunâtre, et toutes sortes de matières entièrement différentes de celles qu’on sait être contenues dans les montagnes voisines. Les diamants trouvés dans ce district sont regardés comme étant de la plus belle qualité. Les connaisseurs les préfèrent à ceux de l’Inde.
Trois malfaiteurs condamnés pour crimes trouvèrent dans un ruisseau le plus gros diamant que possède le Portugal. Il pèse une once. Les heureux brigands reçurent avec leur grâce une forte récompense. Leur trouvaille en avait fait d’honnêtes gens.
L’exploitation des diamants, qui rapportait il y a quelques années 200,000 carats au gouvernement, est, comme celle de l’or, beaucoup moins abondante. La nature est lente à former l’or et le diamant. Nos Pyrénées, où les Romains trouvaient l’or à la surface de la terre, n’en produisent plus que quelques parcelles roulées par les torrents, et l’Espagne ne retire plus d’émeraudes ou d’améthystes de ses opulentes montagnes. Il arrive un temps où les frais d’exploitation dévorent les produits. Les sucs végétaux sont les seuls qui ne s’épuisent pas, et la charrue est plus précieuse que le râteau du mineur: c’est ce que devraient comprendre les habitants du district des mines au Brésil.
Nous n’avons rien de suspect; nos poches sont vides de tout diamant impérial, tant mieux: nous pouvons partir pour aller visiter d’autres lieux.
La province de Goyaz à l’ouest de Minas-Geraes donne naissance au fleuve des Tocantins et au Rio-San-Francisco. A l’ouest de Goyaz s’étend le vaste pays de Mato-Grosso, qui touche au Paraguay et à la rivière des Amazones;. c’est le boulevard du Brésil, qu’elle couvre et à qui elle donne la facilité de pénétrer au Pérou. Ces deux provinces ont également des mines d’or d’un faible produit.
Nous avons une longue route à faire, pour revenir de l’extrémité occidentale de l’empire, des frontières de la Bolivie, à la côte orientale où nous trouvons Bahia. Nous négligeons des pays qui attendent une plus grande prospérité pour intéresser le voyageur d’Europe. Sur cette côte orientale, toutes les villes jusqu’à San-Salvador sont situées à l’embouchure des fleuves. Les environs sont couverts de forêts vierges qu’on a respectées jusqu’ici. Ces asiles impénétrables expliquent pourquoi les Portugais ne se sont étendus qu’à huit ou dix lieues du rivage, sur ces côtes, tandis que du côté de Mato-Grosso la domination brésilienne touche aux anciennes provinces espagnoles.
La province de Bahia est située au nord de celle des Minas-Geraes: elle occupe une longue étendue de côtes. San-Salvador-de-Bahia-de-Todos-santos, généralement connue sous le nom de Bahia, fut pendant deux cents ans la capitale du Brésil. Cette ville a successivement été détruite, relevée, prise et reprise pendant les trente années de la guerre de l’insurrection. Elle est encore aujourd’hui, par son étendue, ses fortifications, ses édifices, sa vaste baie, l’une des villes les plus importantes du Nouveau-Monde. Des rochers dentelés, des coteaux verdoyants, des forêts épaisses, une baie profonde, mais tranquille, où peuvent s’abriter deux mille vaisseaux, tel est l’aspect quelle présente. Un Portugais, Diego-Alvarez Correa-de-Viana, allant aux Indes orientales vers 1510, fit naufrage sur cette côte, et, frappé de la beauté du site, lui donna le nom de San-Salvador, parce qu’il y avait trouvé son salut. Améric-Vespuce n’avait fait qu’y toucher.
Ici, de même qu’à Rio, la mer semble s’être enfoncée dans les terres; on peut même conjecturer qu’un grand lac, brisant sa barrière, s’y est tracé un chemin jusqu’à l’Océan. Six grandes rivières navigables s’écoulent dans ce golfe ou plutôt dans ce lac paisible et cristallin, qui se divise en plusieurs anses, pénètre ainsi dans les terres sous toutes les directions. Une centaine d’îles, vivifient cette petite Méditerranée.
La ville est encore située sur le penchant d’une colline et le long de la baie. La partie la plus considérable est sur la hauteur, c’est le séjour des riches désœuvrés. Les marchands se sont construit une ville sur les bords de la mer. Les maisons sont entremêlées de jardins plantés d’arbres toujours verts et notamment d’orangers. Les églises, plusieurs couvents et le palais du gouverneur sont d’assez beaux monuments. Il y a un collège et une belle bibliothèque publique. Le commerce très-actif sert d’entrepôt aux productions de la province On voit flotter dans le port, qui est bien défendu, le pavillon de toutes les nations. Bahia est restée la métropole ecclésiastique, puisqu’elle est la résidence de l’archevêque, de qui relèvent tous les évêques de l’empire.
De nombreuses baleines viennent annuellement avec leurs petits se réfugier dans la baie de Bahia, pour se mettre à l’abri des vents et des tempêtes; mais là elles rencontrent, dans les habitants de la ville basse qui les harponnent et en tirent un bon produit, des ennemis plus dangereux. Les nègres choisissent certaines parties de ces géants des mers pour se nourrir, quoique la chair de ces cétacés soit aussi dure que repoussante; c’est, je crois, le seul lieu du monde où l’on peut assister de sa fenêtre à une véritable pêche de la baleine.
Au nord de Bahia est la province de Pernambuco et sa capitale du même nom. Trois villes ont formé ce chef-lieu: San-Antonio-de-Recife sur le bord de la mer, Olinda sur une hauteur, et Bona-Vista. La pente de la colline d’Olinda est très-escarpée. L’aspect en est si ravissant quand on arrive par mer, qu’il a fait donner à la ville son nom: en portugais Olinda signifie 0 belle. Mais l’intérieur ne répond pas à l’extérieur: Pernambuco est sous le rapport de l’importance commerciale la troisième ville du Brésil. Seulement sa situation, à la hauteur du ras de marée, rend l’ancrage souvent dangereux.
Je termine ici cette course au clocher à travers l’empire du Brésil, et mon voyage sera clos par quelques mots sur les mœurs, l’industrie et le commerce du pays.
Pour apprécier sainement les habitudes de la vie du Brésilien, il serait mal de se placer à notre point de vue européen et d’établir une comparaison avec la France ou l’Angleterre. Au Brésil et surtout dans les grandes villes maritimes; l’affluence des étrangers de tous les pays du globe masque au premier aspect le caractère national. Voyez les principales villes maritimes du monde et vous aurez une idée de ces grands caravansérails des peuples dont la physionomie et l’originalité sont insaisissables au milieu de tant d’individualités différentes. Mais au Brésil, si vous pénétrez au cœur de la nation, si vous surprenez le Brésilien dans sa vie intime et dans son déshabillé, vous trouverez qu’en fait de manières élégantes et de civilisation, il s’est arrêté au règne du roi Jean; c’est le Portugais de 1808. Comme l’habitant de la métropole, il a de lui-même une haute opinion: il est fier et point orgueilleux. L’orgueil annonce toujours un profond égoïsme et un grand mépris pour autrui: la fierté, c’est le sentiment élevé de la dignité humaine qui inspire les actions honorables et généreuses. Combien je préfère ces grands airs qui s’allient parfaitement avec la politesse et la bienveillance à cette morgue insultante, à ce froid mépris que tant de gens de peu ne parviennent jamais à dissimuler sur leur figure pour qui n’est pas comme eux aussi richement doté par la fortune!
Un Français habitué au luxe d’une grande existence, un Anglais qui aura vécu dans le confortable que donne la richesse, prendront en pitié ce fier Brésilien qui se croit heureux dans de tristes maisons pauvrement décorées, où les meubles les plus essentiels manquent, et où rien ne cache la nudité des murs: un sourire dédaigneux arrivera sur les lèvres de nos Européens élégants, s’ils voient une famille dans sa demeure. C’est le sans-façon du chez-soi; mais un sans-façon tant soit peu décolleté. On désirerait que le déshabillé fût plus décent et plus souvent renouvelé. Chez l’homme comme chez la femme l’habillement de la maison accuserait les mains africaines d’avoir déteint sur les étoffes. Ce défaut, dont il ne faut pas exagérer l’étendue, finira aussi par disparaître: les étrangers riches dont les maisons sont bien ordonnées serviront de modèles aux Brésiliens bornes: ils donneront plus de soins aux diverses pratiques hygiéniques impérieusement réclamées par les lois de la propreté et du respect pour soi. Ils feront de leurs maisons, non plus le sanctuaire inabordable d’un intérieur repoussant, mais de gracieuses demeures en harmonie avec leur beau climat.
Si j’entrais dans des détails qu’un assez long séjour au Brésil m’a fait connaître, je manquerais au respect dû à la vie domestique du citoyen de tous les pays. La maison doit être murée et les jugements s’arrêtent au seuil. J’aime mieux vous montrer l’habitant d’une grande ville du Brésil sortant de chez lui pour assister à une fête religieuse. La transformation est complète: au lieu de l’habillement négligé, la famille que les cloches appellent est devenue merveilleusement superbe, dirait La Fontaine; les hommes élégamment habillés de noir portent à la chemise de riches diamants et souvent sur l’habit des décorations de grand prix; les dames en robes de satin noir, leurs beaux cheveux ornés de fleurs, étalent des rivières de diamants et de pierreries; les enfants sont aussi parés: jetez sur tout cet éclat, sur toute cette parure un peu roide, la gravité qui n’abandonne jamais le Brésilien en habits de fête; voyez-le marcher en avant de sa famille, la tête haute, le regard fier et la démarche assurée: pour escorte il a ses nègres et ses négresses, qui se sont, eux aussi, endimanchés; ils portent, avec toute la, dignité dont ils sont capables, les ombrelles, les parasols, les livres de prières et les coussins pour les genoux.
J’ai été frappé, comme le sont tous les étrangers, de la pompe des fêtes religieuses, de la magnificence trop fastueuse des processions. On se ferait difficilement une idée des dépenses qui s’engloutissent dans les diverses cérémonies du culte. Le philosophe se prend à regretter l’emploi de sommes énormes qui pourraient être mieux utilisées à faciliter l’industrie, à améliorer le sort des classes pauvres: mais on excusera ces populations méridionales qui ont besoin de spectacles éclatants; qui recherchent avec avidité tout ce qui charme les yeux et caresse l’imagination. Le temps et l’instruction, en conservant à la religion toute sa dignité, viendront mettre le culte en rapport avec toutes choses.
On reproche aux Brésiliens l’espèce de tyrannie qu’ils exercent sur leurs femmes. Ils les confinent en effet dans une espèce de gynécée impénétrable qui les dérobe aux yeux de tous. Ils n’admettent que rarement dans leur intérieur les personnes étrangères, encore n’est-ce qu’après avoir longuement étudié la moralité et les habitudes de leurs connaissances. Ce caractère ombrageux et jaloux explique, sans le justifier, l’isolement des Brésiliennes, qui ne fréquentent pas les maisons étrangères. Une pareille vie ne contribue pas médiocrement à les entretenir dans l’ignorance des mœurs sociales: elles ne comprennent pas la vie du monde qu’on leur interdit; voilà la cause de l’espèce de timidité, de malaise qu’on rencontre chez ces femmes et qui ferait douter de leur aptitude intellectuelle. La plupart ont de ravissantes figures, des yeux expressifs qui annoncent clairement combien elles désireraient, comme leurs heureuses sœurs d’Europe, s’essayer au doux langage. La société qu’elles embelliraient, si elles y étaient appelées, en aurait plus de charmes, et elles y acquerraient ce sentiment de noble dignité, de gracieuse aisance qui leur manque. La société dépend des femmes: tous les peuples qui ont le malheur de les enfermer sont insociables, dit Voltaire.
Avec toutes ces précautions les lois de l’hyménée sont elles plus fidèlement observées au Brésil que sur les bords de la Seine, nous demandera-t-on, et les maris dorment-ils paisibles à l’abri de toute infortune? Le respect que je porte à la femme me fait un devoir de ne pas répondre à cette question, dont l’examen, de quelque nature qu’il fût, dénoterait d’injurieux soupçons. Je me bornerai à former des vœux pour que les voyageurs qui visiteront après moi la terre du Brésil n’aperçoivent plus seulement à travers les vitrages grillés ou les tentes des balcons, ces grands yeux noirs qu’on aimerait tant à admirer sur les belles promenades, dans de gracieux salons, au milieu de réunions choisies, où le plaisir viendrait alors les animer.
Dans les colonies portugaises on ne remarque pas comme ailleurs les distinctions établies par la couleur. Il en est résulté que les castes mêlées sont devenues très-nombreuses Ce mélange des castes date de la guerre avec les Hollandais, dans laquelle les Indiens et les noirs se distinguèrent. Les mulàtres peuvent entrer dans les ordres sacrés ou dans la magistrature, si leurs papiers portent qu’ils sont blancs, quand même leur teint prouverait le contraire.
Les Mamalucos on descendants des blancs et des Indiens se rencontrent plus fréquemment dans l’intérieur que sur les côtes; ils sont en général mieux que les mulâtres, et leurs femmes sont les plus belles du pays.
Les nègres libres sont bien faits, braves, vigoureux, soumis: ils obéissent aux blancs et cherchent à leur plaire. C’est parmi eux qu’on voit le plus d’artisans.
Les mineurs, suivant M. de Saint-Hilaire, sont portés aux idées contemplatives par leur tempérament un peu hypocondriaque et leur vie inactive. Ils montrent une rare intelligence et une facilité extraordinaire.
Les hommes du Rio-Grande mènent une vie tout extérieure; leurs femmes se montrent dehors: les unions légitimes sont plus communes et les mœurs plus pures. Dans cette province, les habitants se distinguent par une grande intrépidité. Ils exercent l’hospitalité avec empressement; il en est de même chez tous les peuples de l’intérieur; mais cette vertu a disparu sur les côtes, où les habitants se sont lassés de bien recevoir tant d’hommes tarés et corrompus que l’Europe vomit sans cesse de son sein.
Les nègres esclaves, qui sont très-nombreux, sont traités avec humanité : les affranchissements y sont rendus faciles; et le Brésil, sans entrer dans le concert des grandes puissances pour interdire la traite des noirs, leur accorde peut-être de plus grandes facilités pour arriver plus promptement et plus directement à l’émancipation en se rachetant. A quelques lieues de Porto-Alegre une colonie suisse a fondé un établissement, qui prospère depuis plusieurs années: cet essai ne peut avoir qu’une heureuse influence sur les progrès agricoles et sur toute l’économie des habitudes brésiliennes.
Quant aux relations commerciales que les nations étrangères entretiennent avec cet empire, il est pénible d’avouer que le commerce français dans toute l’Amérique du Sud est infiniment inférieur à celui des autres nations. On dit que cela tient à la mauvaise foi ou à l’avidité de spéculateurs trop pressés de s’enrichir.
«On ne compte pas de maisons comparables à celles des Anglais parmi le
» commerce français dans toute l’Amérique du Sud, tandis qu’on en cite un
» grand nombre des autres pays.» C’est un Français qui parle ainsi. Tous les officiers de marine, tous les voyageurs qui étudient cette question ont signalé la déconsidération dans laquelle était tombé notre commerce maritime, et j’ai observé moi-même, la rougeur au front, la vérité de leurs paroles. Pour l’honneur de mon pays, je désire ardemment que notre commerce avec les nations lointaines soit loyal et honnête; il n’a pas d’autre moyen de se relever.
J’ai déjà dit que pendant mon séjour à Rio des affaires m’appelèrent aux États-Unis, que je visitai en courant; j’ajoute en courant, car la rapidité avec laquelle on voyage en chemin de fer ne laisse guère le temps d’examiner les contrées par lesquelles on passe. Je débarquai à Baltimore et je me rendis de là à Washington, à Philadelphie, à New-York, où je fis un séjour de plusieurs mois. New-York est absolument une ville anglaise, aussi le voyageur qui aura d’abord vu l’Angleterre reconnaîtra la même disposition des rues, la même architecture, le langage et les habitudes de la vie ordinaire. La facilité des moyens de transport me permit de faire de nombreuses excursions dans le pays et de le parcourir dans tous les sens. Je n’entrerai dans aucun détail sur les États-Unis, bien connus par des descriptions auxquelles je ne trouverais rien à ajouter. Je serais seulement tenté de parler de ce qui frappa le plus mon imagination pendant ce voyage: la chute du Niagara; mais la vue imposante de cette merveille du monde, en m’absorbant tout entier, ne m’a pas permis de trouver des mots pour rendre les sentiments divers que j’éprouvai. Maintes fois j’essayai d’en faire la description et toutes mes tentatives ne me donnèrent que des résultats si fort au-dessous de mes impressions et de mes souvenirs que j’ai dû y renoncer. Ce que j’en ai lu ne m’a pas satisfait et je demeure convaincu qu’il est impossible d’en donner une idée exacte. J’étais arrivé à Goat-Island qui sépare les chutes, déjà émerveillé à la vue des rapides qu’il fallut traverser sur un pont de bois assez solide et appuyé sur quelques arches et quelques roches. J’avais devant moi l’immense nappe du lac supérieur et j’entendais sans les voir le bruit sourd et tumultueux des eaux.
Loriot de Baltimore.
Tétras du Canada.
Faucon à tête blanche.
J’arrivai enfin à la tourelle de la grande cataracte désignée sous le nom de Fer-à-cheval. Je restai immobile et muet, les yeux fixés sur cette mer d’écume; à ma droite la limite des États-Unis et devant moi celles du Canada, séparées par les eaux du torrent qui fascine et attire toute l’attention. C’est de la galerie de cette petite tour audacieusement placée que, plongeant sur le gouffre et entouré d’un immense torrent furieux prêt à vous entraîner avec tout ce qui lui résiste, on voit, sans pouvoir les suivre des yeux et sur une surface de six cents pieds d’un bord à l’autre, les eaux du lac se précipiter écumantes d’une hauteur de plus de cent soixante pieds. Ces avalanches d’eau roulent d’immenses flots d’écume qui se brisent les uns contre les autres, tourbillonnent, mugissent et font remonter sans interruption vers le ciel d’énormes nuages qui bientôt retombent blancs et majestueux au fond de l’abîme en formant un brouillard irisé de tous les feux de l’arc-en-ciel. La forme triangulaire ou plutôt en croissant de la chute principale permet d’en voir les deux extrémités qui semblent vouloir bondir l’une contre l’autre, et laissent paraître à travers mille gerbes d’eau et un voile de pluie le vaste entonnoir où les eaux s’engloutissent avec fracas.
Perdrix de la Virginie attaquées par un oiseau de proie.
Martin-pêcheur.
Après les États-Unis, c’est le Brésil qui entre en première ligne commerciale avec la France; plus de trente navires trouvent annuellement à établir une navigation suivie. Il se présente surtout un grand nombre de passagers; ce qui a donné l’idée de former une société pour l’exploitation d’une ligne de bateaux à vapeur qui, dit-on, partiront prochainement de Nantes et multiplieront et accéléreront encore les rapports.
Dindon sauvage.