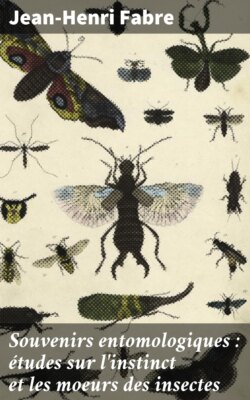Читать книгу Souvenirs entomologiques : études sur l'instinct et les moeurs des insectes - Fabre Jean-Henri - Страница 12
LES BOUSIERS DES PAMPAS
ОглавлениеCourir le monde, terres et mers, d’un pôle à l’autre; interroger la vie sous tous les climats dans l’infinie variété de ses manifestations, voilà certes, pour qui sait voir, chance superbe; voilà le magnifique rêve de mes jeunes années, alors que Robinson faisait mes délices. Aux illusions roses, si riches de voyages, ont promptement succédé les réalités maussades et casanières. Les jungles de l’Inde, les forêts vierges du Brésil, les hautes cimes des Andes, aimées du condor, se sont réduites, comme champ d’exploration, à un carré de cailloux enclos de quatre murs.
Le Ciel me garde de m’en plaindre. La moisson des idées n’impose pas expéditions lointaines. Jean-Jacques herborisait dans le bouquet de mouron servi à son serin; Bernardin de Saint-Pierre découvrait un monde sur un fraisier venu par hasard en un coin de sa fenêtre; Xavier de Maistre, usant d’un fauteuil en guise de berline, entreprenait autour de sa chambre un voyage des plus célèbres.
Cette façon de voir du pays est dans mes moyens, abstraction faite de la berline, trop difficile à conduire à travers les broussailles. Je fais et cent fois refais le périple de l’enclos, par petites étapes; je stationne chez l’un, chez l’autre; patiemment j’interroge, et de loin en loin j’obtiens quelque lambeau de réponse.
La moindre bourgade m’y est devenue familière; j’y connais toute brindille où perche la Mante religieuse; tout buisson où doucement stridule le pâle Grillon d’Italie dans le calme des nuits estivales; toute herbe vêtue d’ouate que ratisse l’Anthidie, manufacturier en sachets de coton; tout fourré de lilas exploité par la Mégachile, coupeuse de feuilles.
Anthidie diadème, grossie 1 fois 1/2.
Si le cabotage dans les coins et recoins du jardin ne suffit pas, un voyage au long cours me fournit ample tribut. Je double le cap des haies voisines, et, à quelque cent mètres, j’entre en relations avec le Scarabée sacré, le Capricorne, le Géotrupe, le Copris, le Dectique, le Grillon, la Sauterelle verte, enfin avec une foule de peuplades dont l’histoire développée épuiserait une vie humaine. Certes, j’en ai bien assez, j’en ai trop avec mes proches voisins, sans aller pérégriner en des régions lointaines.
Et puis, d’ailleurs, courir le monde, disperser son attention sur une foule de sujets, ce n’est pas observer. L’entomologiste qui voyage peut piquer dans ses boîtes de nombreuses espèces, joie du nomenclateur et du collectionneur; mais faire récolte de documents circonstanciés, c’est tout autre chose. Juif errant de la science, il n’a pas le loisir de s’arrêter. Lorsque, pour étudier tels et tels faits, un séjour prolongé serait nécessaire, l’étape suivante le presse. N’allons pas lui demander l’impossible en de telles conditions. Qu’il épingle sur des tablettes de liège, qu’il macère dans des bocaux de tafia, et qu’il laisse aux sédentaires l’observation patiente, dispendieuse en temps.
Ainsi s’explique l’extrême pénurie de l’histoire en dehors des arides signalements du nomenclateur. Nous accablant de son nombre, l’insecte exotique garde presque toujours le secret de ses mœurs. Il conviendrait cependant de comparer ce qui se passe sous nos yeux avec ce qui se passe ailleurs; il serait excellent de voir de quelle manière, dans une même corporation de travailleurs, varie l’instinct fondamental lorsque varient les conditions climatériques.
Alors le regret des voyages me revient, plus vain aujourd’hui que jamais, à moins de trouver place sur le tapis dont nous parlent les Mille et une nuits, ce fameux tapis où il suffit de s’asseoir pour être transporté où bon nous semble. Oh! le merveilleux véhicule, bien préférable à la berline de Xavier de Maistre! Pourvu que j’y trouve un tout petit coin avec billet d’aller et de retour!
Je le trouve en effet. Cette fortune inespérée, je la dois à un frère des Écoles chrétiennes, au frère Judulien, du collège de la Salle à Buenos-Aires. Sa modestie s’offenserait des éloges que lui doit son obligé. Disons seulement que, sur mes indications, ses yeux remplacent les miens. Il cherche, il trouve, il observe, il m’envoie ses notes et ses trouvailles. J’observe, je cherche, je trouve avec lui par correspondance.
C’est fait: grâce à l’excellent collaborateur, j’ai place sur le tapis enchanté ; et me voici dans les pampas de la République Argentine, désireux de mettre en parallèle l’industrie des Bousiers sérignanais avec celle de leurs émules dans l’autre hémisphère.
Phanæus splendidulus.
Début superbe! Le hasard des rencontres me vaut d’abord le Phanée splendide (Phanæus splendidulus), qui associe les rutilances du cuivre au vert éclatant de l’émeraude. On est tout surpris de voir pareil bijou charger sa hotte d’ordures. C’est la gemme dans le fumier. Le mâle s’excave le corselet d’une large échancrure et se met aux épaules des ailerons tranchants; il s’implante sur le front une corne qui rivalise avec celle du Copris espagnol. Aussi riche d’éclat métallique, sa compagne n’a pas de bizarres atours, apanage exclusif de la coquetterie masculine chez les Bousiers de la Plata comme chez les nôtres.
Or que sait-il faire, le splendide étranger? Précisément ce que fait ici le Copris lunaire. Établi comme lui sous une galette bovine, il pétrit sous terre des pains ovoïdes. Rien n’est oublié : panse ronde de plus grand volume et de moindre surface; écorce durcie préservant d’une dessiccation trop prompte; mamelon terminal où se loge l’œuf dans une chambre d’éclosion; au bout du mamelon, clôture en tampon de feutre qui permet l’accès de l’air nécessaire au germe.
Tout cela, je l’ai vu ici, et je le revois là-bas, presque à l’autre bout du monde. La vie, régie par une immuable logique, se répète dans ses œuvres, le vrai d’une latitude ne pouvant être le faux d’une autre. Nous allons chercher bien loin spectacle nouveau pour nos méditations; nous l’avons sous les yeux, inépuisable, entre les murs de notre enclos.
Établi sous la somptueuse tourte du bœuf, le Phanée devrait, ce semble, en tirer riche parti et peupler son terrier de plusieurs ovoïdes, à l’exemple du Copris lunaire. Il n’en fait rien, préférant errer d’une trouvaille à l’autre et prélevant sur chacune de quoi modeler une seule pilule qui se confie isolée à l’incubation de la terre. L’économie ne lui est pas imposée, même lorsqu’il travaille le produit du mouton loin des herbages de Buenos-Aires.
Pilule du Phanée splendide.
Cela tiendrait-il à ce que le bijou des pampas ignore la collaboration paternelle? Je n’ose insister, car le Copris espagnol me donnerait un démenti; il me montrerait la mère occupée seule de l’établissement de la famille et peuplant tout de même son unique silo de pilules multiples. A chacun son lot d’usages, dont le secret nous échappe.
Ces deux-ci, le Mégathope bicolore et le Mégathope intermédiaire, ont quelques rapports d’aspect avec le Scarabée sacré, dont ils remplacent la couleur d’ébène par du noir bleui. Le premier fait en outre reluire sur son corselet de superbes reflets cuivrés. Avec leurs longues pattes, leur chaperon à dentelures rayonnantes, leurs élytres déprimés, ils sont des réductions, maigrement réussies, du célèbre pilulaire.
Ils en partagent aussi le talent. L’ouvrage de l’un et de l’autre est encore une sorte de poire, mais d’art plus ingénu, à col presque conique, sans gracieuses inflexions. Comme élégance, cela ne vaut pas le travail du Scarabée. En considération de l’outillage, dégagé de jeu et apte à l’enlacement, j’attendais mieux des deux modeleurs. N’importe: l’œuvre des Mégathopes est conforme à l’art fondamental des autres pilulaires.
Bolbites onitoïde, grossi 1 fois 1/2.
Ce quatrième, le Bolbites onitoïde, nous dédommage de répétitions qui élargissent, il est vrai, le champ du problème, mais ne nous apprennent rien de nouveau. C’est un bel insecte, à costume métallique, vert ou rouge cuivreux, suivant l’incidence de la lumière. Sa configuration quadrangulaire, ses longues pattes antérieures dentelées le rapprochent de nos Onitis.
Avec lui, la corporation des Bousiers se révèle sous un aspect bien inattendu. Nous connaissons des pétrisseurs de pains mollets; en voici maintenant qui, pour mieux conserver leur miche à l’état frais, inventent la céramique, se font potiers et travaillent l’argile dont ils enveloppent le manger des larves. Avant ma ménagère, avant nous tous, ils savaient, au moyen d’une jarre pansue, préserver les vivres de la dessiccation pendant les ardeurs de l’été.
L’ouvrage du Bolbites est un ovoïde, peu différent comme forme de celui des Copris; mais voici où éclate l’ingéniosité de la bête américaine. Sur l’amas intérieur, l’habituel gâteau de bouse, fourni par la vache ou le mouton, est appliquée une couche argileuse, bien homogène et continue, qui fait poterie solide, imperméable à l’évaporation.
Le pot de terre est exactement rempli par son contenu, sans le moindre intervalle sur la ligne de jonction. Ce détail nous dit la méthode de l’ouvrier. La jarre est fabriquée sur les provisions comme moule. L’ovoïde nutritif obtenu suivant les us de la boulangerie courante, et l’œuf déposé dans sa chambre d’éclosion, le Bolbites cueille l’argile voisine par brassées et l’applique, la comprime sur la pièce alimentaire. Quand l’ouvrage est terminé, lissé à point avec une patience que rien ne lasse, le minuscule pot, obtenu par application de morceaux, semble fait au tour et rivalise de régularité avec les nôtres.
Pilule du Mégathope intermédiaire.
Dans le mamelon terminal de l’ovoïde est ménagée, comme de règle, la chambre d’éclosion, où repose l’œuf. Comment se fera la respiration du germe et de la jeune larve sous ce revêtement argileux qui intercepte l’accès de l’air?
N’ayez crainte: le potier est très bien au courant de l’affaire. Il se garde bien de clore le haut avec la terre grasse qui lui a fourni la paroi. A quelque distance du sommet du mamelon, l’argile cesse d’intervenir et fait place à des parcelles ligneuses, à de menus débris de fourrage non digéré qui, rangés l’un sur l’autre avec un certain ordre, forment au-dessus de l’œuf comme la toiture en chaume d’une paillote. A travers ce grossier écran, le va-et-vient de l’air est assuré.
Section longitudinale de la pilule du Bolbites onitoïde, montrant la chambre d’éclosion, le feutre respiratoire et l’enveloppe d’argile.
On se prend à réfléchir devant cet enduit de glaise protecteur des vivres frais, et devant ce soupirail bouché d’une botte de paille, qui laisse libre accès à l’air tout en défendant l’entrée. Éternelle question si on ne s’élève pas au-dessus du terre-à-terre: comment l’insecte a-t-il acquis un art aussi judicieux?
Nul ne manque à ces deux lois: sécurité du ver et facile aération; nul, pas même celui-ci, dont le talent nous ouvre un nouvel horizon. C’est le Gromphas de Lacordaire.
Que ce nom rébarbatif de Gromphas, la vieille truie, ne nous donne pas une fausse idée de l’insecte. C’est, au contraire, comme le précédent, un élégant bousier, d’un bronzé obscur, trapu, carré de tournure comme notre Onitis Bison, dont il a presque la taille. Il en a aussi l’industrie, du moins dans l’ensemble de l’ouvrage.
Son terrier se ramifie en un petit nombre de loges cylindriques, demeures d’autant de larves. Pour chacune les vivres consistent en un aggloméré de bouse de vache, d’un pouce environ de hauteur. La matière, soigneusement tassée, remplit le cul-de-sac, ainsi que le ferait une pâte molle refoulée dans un moule. Jusque-là l’ouvrage est pareil à celui de l’Onitis Bison; mais la similitude ne va pas plus loin et fait place à des différences profondes, étranges, sans rapport avec ce que nous montrent les bousiers de nos pays.
En effet, nos mouleurs de saucisses, Onitis et Géotrupes, placent l’œuf à l’extrémité inférieure de leur cylindre, dans une loge ronde ménagée au sein même de la masse alimentaire. Leur émule des pampas adopte une méthode tout opposée: il place l’œuf au-dessus des vivres, à l’extrémité supérieure de la saucisse. Pour s’alimenter, le ver n’a pas à remonter; il doit, au contraire, descendre.
Il y a mieux: l’œuf ne repose pas immédiatement sur les vivres; il est installé dans une chambre argileuse dont la paroi mesure une paire de millimètres d’épaisseur. Cette paroi fait hermétique couvercle à la colonne nutritive, se courbe en godet, puis se relève et s’infléchit en voûte de plafond.
Le germe est de la sorte enclos dans une boîte minérale, sans rapport avec le magasin aux vivres, rigoureusement fermé. De ses premiers coups de dent, le nouveau-né doit rompre les scellés, effractionner le plancher argileux et y pratiquer une trappe qui l’achemine au gâteau sous-jacent.
Rude début pour la débile mandibule, bien que la matière à forer soit une fine argile. Les autres vers mordent immédiatement sur le pain tendre qui de partout les enveloppe; celui-ci, au sortir de l’œuf, doit faire brèche à travers une muraille avant de prendre réfection.
A quoi bon ces obstacles? Ils ont, je n’en doute pas, leur raison d’être. Si le ver naît au fond d’une marmite close, s’il doit mâcher la brique pour atteindre le garde-manger, certaines conditions de prospérité assurément l’exigent. Mais lesquelles? Les reconnaître exigerait des études sur les lieux; et, comme documents, je ne possède que quelques nids, choses mortes, d’interrogation difficultueuse. Voici cependant ce qu’il est possible d’entrevoir.
Une loge du Gromphas de Lacordaire.
Le terrier du Gromphas est peu profond; ses gâteaux, menus cylindres, y sont très exposés à l’aride. Là-bas, comme ici, la dessiccation des vivres est péril mortel. Pour conjurer ce danger, rien de plus sensé que d’enfermer les victuailles dans des vases exactement clos.
Eh bien, le récipient est creusé dans une terre imperméable, très fine, homogène, sans un gravier, sans un atome de sable. Avec l’opercule que lui forme le fond de la chambre ronde où l’œuf est logé, cette cavité devient une urne dont le contenu est pour longtemps à l’abri de la dessiccation, même sous un soleil brûlant. Si tardive que soit l’éclosion, le nouveau-né, trouvant le couvercle, aura sous la dent des vivres aussi frais que s’ils dataient du jour même.
Le silo d’argile, avec rigoureux opercule, est un excellent procédé, comme la conservation des fourrages n’en a pas de meilleur dans notre agronomie; mais il a un inconvénient: pour atteindre l’amas alimentaire, le vermisseau doit d’abord s’ouvrir un passage à travers le plancher de sa chambre. Au lieu de la bouillie réclamée par son débile estomac, il trouve, au début, de la brique à mâcher.
L’âpre besogne serait épargnée si l’œuf reposait directement sur les vivres, à l’intérieur même de l’étui. Notre logique fait ici fausse voie; elle oublie un point essentiel, que l’insecte se garde bien de méconnaître. Le germe respire. Son évolution a besoin d’air; et dans l’urne en terre grasse, à clôture parfaite, l’accès de l’air est impossible. C’est au dehors du pot que le vermisseau doit naître.
D’accord. Mais sous le rapport de la respiration l’œuf ne gagne rien à se trouver renfermé, au-dessus des vivres, dans un coffret d’argile tout aussi imperméable que la jarre elle-même. Examinons la chose de plus près, et satisfaisante réponse viendra.
La chambre d’éclosion a sa paroi soigneusement lissée à l’intérieur. La mère, avec des soins méticuleux, lui a donné le poli du stuc. Seule, la voûte est rugueuse, l’outil constructeur travaillant du dehors et ne pouvant atteindre, pour l’égaliser, la face interne du couvercle. De plus, au centre de ce plafond courbe, à bosselures, un étroit pertuis est ménagé. Voilà le soupirail d’aération, qui permet les échanges gazeux entre l’atmosphère de la boîte et celle du dehors.
Libre en plein, cette ouverture serait périlleuse: quelque ravageur en profiterait pour pénétrer dans le coffret. La mère prévoit le danger. Elle obstrue le pertuis respiratoire avec un tampon d’effilochures de bouse, obturateur éminemment perméable. C’est l’exacte répétition de ce que nous montrent les divers modeleurs au sommet de leurs gourdes, poires et calebasses. Tous, pour aérer l’œuf dans une enceinte imperméable, connaissent le délicat secret du bouchon de feutre.
Ton nom n’est pas beau, gentil bousier des pampas, mais ton industrie est bien remarquable. Parmi tes compatriotes, j’en connais cependant qui te dépassent en ingéniosité. Tel est le Phanée Milon, magnifique insecte, en entier d’un noir bleuâtre.
Phanée Milon.
Le corselet du mâle s’avance en promontoire. Sur la tête, large et courte corne aplatie, terminée par un trident. La femelle remplace cette parure par de simples replis. Tous les deux ont à l’avant du chaperon une double pointe, instrument de fouille à coup sûr, scalpel aussi de dépècement. Par sa configuration trapue, robuste, quadrangulaire, l’insecte rappelle l’Onitis Olivieri, l’une des raretés des environs de Montpellier.
Si la ressemblance des formes entraînait la parité des industries, on devrait attribuer, sans hésitation, au Phanée Milon des saucisses analogues à celles de l’Onitis Bison, ou mieux de gros et courts boudins comme en fabrique l’Onitis d’Olivier Ah! le mauvais guide que la structure quand il s’agit des instincts. Le bousier à échine carrée et à courtes pattes excelle dans l’art des gourdes. Le Scarabée sacré n’en fournit pas de plus correctes et surtout de plus volumineuses.
L’insecte trapu m’étonne par l’élégance de son œuvre. C’est d’une géométrie irréprochable: moins élancé de col, associant néanmoins la grâce à la force. Le modèle en semble pris sur quelque calebasse d’Indien, d’autant mieux que le goulot bâille et que la panse est gravée d’un élégant guillochis, empreinte des tarses de l’insecte. On dirait un bidon défendu par une armure de vannerie. Cela peut atteindre et même dépasser la grosseur d’un œuf de poule.
Ouvrage très curieux et d’une rare perfection, vu surtout la gauche et massive carrure de l’ouvrier. Non, encore une fois, l’outil ne fait pas l’artiste, pas plus chez les bousiers que chez nous. Pour guider le modeleur, il y a mieux que l’outillage: il y a ce que j’appelais tantôt la bosse, le génie de la bête.
Le Phanée Milon se rit du difficile. Il fait bien mieux: il se rit de nos classifications. Qui dit bousier, dit fervent ami de la bouse. Lui n’en fait cas ni pour son usage, ni pour celui des siens. Il lui faut la sanie des cadavres. C’est sous les carcasses de volaille, de chien, de chat, qu’on le rencontre, en compagnie des croque-morts attitrés. La gourde dont je donne le dessin gisait en terre sous les restes d’un hibou.
Explique qui voudra cette association des appétits du Nécrophore avec les talents du Scarabée. Quant à moi, j’y renonce, déconcerté par des goûts qu’il ne serait au pouvoir de personne de soupçonner d’après l’aspect seul de l’insecte.
OUVRAGE DU PHANÉE MILON
A, la pièce entière, grandeur naturelle.
Je connais dans mon voisinage un bousier, un seul, exploiteur lui aussi des ruines cadavériques. C’est l’Onthophagus ovatus Lin., hôte fréquent des taupes mortes et des lapins crevés. Mais le croque-mort nain ne dédaigne pas pour cela la matière stercorale; il y festoie comme les autres Onthophages. Peut-être y a-t-il ici double régime: pour l’insecte adulte, la brioche; pour la larve, les hautes épices des chairs faisandées.
Semblables faits se retrouvent ailleurs avec d’autres goûts. L’hyménoptère prédateur s’abreuve de miel puisé au fond des corolles; il nourrit les siens de venaison. Le gibier d’abord, et puis le sucre pour le même estomac. Faut-il qu’elle change en route, cette poche à digérer! Après tout, pas plus que la nôtre, dédaigneuse sur le tard de ce qui la régalait en sa jeunesse.
B, La même ouverte, montrant la pilule de charcuterie, la calebasse d’argile, la chambre de l’œuf et la cheminée d’aération.
Examinons plus à fond l’ouvrage du Phanée Milon. Les calebasses me sont parvenues dans un état de complète dessiccation. La dureté en est presque celle de la pierre; la coloration vire au chocolat clair. Pas plus à l’intérieur qu’à la surface, la loupe n’y découvre la moindre parcelle ligneuse, certificat d’un résidu d’herbages. L’étrange bousier n’utilise donc pas les galettes bovines, ni rien de similaire; il manipule des produits d’autre nature, assez difficiles à préciser tout d’abord.
Agité près de l’oreille, l’objet sonne un peu, comme le ferait la coque d’un fruit sec dont l’amande serait libre. Y aurait-il là dedans la larve ratatinée par la dessiccation? Y aurait-il l’insecte mort? Je m’y attendais et je me trompais. Il y avait bien mieux que cela pour notre instruction.
De la pointe du couteau, j’éventre avec ménagement la gourde. Sous une paroi homogène, dont l’épaisseur atteint jusqu’à deux centimètres dans le plus volumineux de mes trois spécimens, est enchâssé un noyau sphérique qui remplit exactement la cavité, mais sans adhérence nulle part avec l’enceinte. Le peu de jeu libre de ce noyau me rend compte des chocs que j’entendais en agitant la pièce.
Pour la coloration et l’aspect général de sa masse, le noyau ne diffère pas de l’enveloppe. Mais cassons-le, épluchons-en les ruines. J’y reconnais de menus fragments d’os, des flocons de duvet, des lanières de peau, des lambeaux de chair, le tout noyé dans une pâte terreuse, semblable à du chocolat.
Mise sur un charbon ardent, cette pâte, triée à la loupe et privée de ses parcelles cadavériques, noircit beaucoup, se couvre de boursouflures brillantes et lance des jets de cette âcre fumée où se reconnaissent si bien les matières animales brûlées. Toute la masse du noyau est donc fortement imprégnée de sanie.
Traitée de la même façon, l’enveloppe noircit également, mais moins bien; elle fume à peine; elle ne se couvre pas de boursouflures d’un noir de jais; enfin elle ne contient nulle part des lambeaux cadavériques pareils à ceux du noyau central. Dans l’un et l’autre cas, le résidu de la calcination est une fine argile rougeâtre.
Cette sommaire analyse nous renseigne sur la cuisine du Phanée Milon. Le mets servi à la larve est une sorte de vol-au-vent. Le godiveau consiste en un hachis de tout ce que les deux scalpels du chaperon et les coutelas dentelés des pattes antérieures ont pu détacher du cadavre: bourre et duvet, osselets concassés, bandelettes de chair et de peau. Dure maintenant comme brique, la liaison de ce salmis était au début une gelée de fine argile toute saturée du jus de la corruption. Enfin la caisse en pâte feuilletée de nos vol-au-vent est ici représentée par une enveloppe de la même argile, moins riche que l’autre en extrait de viande.
Le pâtissier donne à sa pièce élégante tournure; il l’embellit de rosaces, de torsades, de méridiens en côtes de melon. Le Phanée n’est pas étranger à cette esthétique culinaire. De la caisse de son vol-au-vent, il fait superbe gourde, ornementée d’un guillochis d’empreintes digitales.
L’enveloppe, croûte ingrate, trop peu imprégnée d’extrait sapide, n’est pas destinée, cela se devine, à la consommation. Que sur le tard, quand est venue la robusticité stomacale, non rebutée par un mets grossier, la larve ratisse un peu la paroi de sa pâtisserie, c’est possible; mais dans son ensemble, jusqu’à la sortie de l’insecte adulte, la calebasse reste intacte, au début sauvegarde de la fraîcheur du godiveau, en tout temps coffre protecteur du reclus.
Au-dessus du pâté froid, tout à la base du col de la gourde, est ménagée une loge ronde à paroi d’argile, continuation de la paroi générale. Un plancher assez épais de la même matière la sépare de la soute aux vivres. C’est la chambre d’éclosion. Là est pondu l’œuf, que je retrouve en place, mais desséché ; là éclôt le vermisseau, qui, pour atteindre la pilule nourricière, doit, au préalable, ouvrir une trappe à travers la cloison séparant les deux étages.
C’est, en somme, avec une architecture d’un autre style, l’édifice du Gromphas. Le ver naît dans un coffret qui surmonte l’amas nourricier, mais ne communique pas avec lui. La larve naissante doit, en temps opportun, percer elle-même le couvercle du pot à conserves. Plus tard, en effet, quand le ver est sur le godiveau, on trouve le plancher foré d’un orifice juste suffisant au passage.
Enveloppé de partout d’un épais revêtement de poterie, le fricandeau se conserve frais aussi longtemps que peut l’exiger la lenteur de l’éclosion, détail qui m’est inconnu; dans sa cellule, également d’argile, l’œuf repose en sécurité. Parfait; jusque-là tout est pour le mieux. Le Phanée Milon connaît à fond les secrets de la fortification et le péril des vivres trop tôt évaporés. Restent les exigences respiratoires du germe.
Pour y satisfaire, l’insecte n’est pas moins bien inspiré. Le col de la calebasse est percé, suivant son axe, d’un canalicule où s’engagerait tout au plus la plus fine des pailles. A l’intérieur, ce pertuis s’ouvre au sommet du dôme de la chambre d’éclosion; à l’extérieur, au bout du mamelon, il bâille en une embouchure évasée. Voilà la cheminée d’aération, protégée contre les intrus par son extrême étroitesse et par des grains de poussière qui l’obstruent un peu sans la boucher. C’est tout naïvement merveilleux, disais-je. Avais-je tort? Si pareil édifice est un résultat fortuit, il faut convenir que l’aveugle hasard est doué d’une singulière clairvoyance.
OUVRAGE DU PHANÉE MILON
La plus volumineuse des gourdes observées, grandeur naturelle.
Comment fait l’insecte lourdaud pour mener à bien construction si délicate et si complexe? Explorant les pampas avec les yeux d’un intermédiaire, je n’ai pour guide en cette question que la structure de l’ouvrage, structure d’où peut se déduire, sans grande erreur, la méthode de l’ouvrier. Je conçois donc ainsi la marche du travail.
Un petit cadavre est rencontré, dont les suintements ont ramolli la glaise sous-jacente. L’insecte rassemble plus ou moins de cette glaise, suivant la richesse du filon. Ici pas de limites précises. Si la matière plastique abonde, le collecteur la prodigue, le coffre aux vivres n’en sera que plus solide. Alors s’obtiennent des calebasses démesurées, dépassant l’œuf de poule en volume et formées d’une enceinte d’une paire de centimètres d’épaisseur. Mais, excédant les forces du modeleur, pareille masse se manipule mal et garde, dans sa configuration, la gaucherie d’un travail trop difficultueux. Si la matière est rare, l’insecte borne sa récolte au strict nécessaire; et alors, mieux libre dans ses mouvements, il obtient gourde superbe de régularité.
La glaise est probablement d’abord pétrie en boule, puis excavée en une ample coupe, très épaisse, par la pression des pattes antérieures et le labeur du chaperon. Ainsi se comportent le Copris et le Scarabée, préparant, au sommet de leur pilule ronde, le godet où doit se pondre l’œuf avant la manipulation finale de l’ovoïde ou de la poire.
En cette première besogne, le Phanée est simplement potier. Pourvu qu’elle soit plastique, toute argile lui suffit, si maigrement que l’imprègnent les sucs écoulés du cadavre.
Maintenant il se fait charcutier. De ses coutelas à dentelures, il taille, il scie quelques menus lambeaux de la bête pourrie; il arrache, il découpe ce qu’il juge convenir le mieux au festin de la larve. Il rassemble tous ces débris et les amalgame avec de la glaise choisie dans les points où la sanie abonde. Le tout, savamment malaxé, devient une boule obtenue sur place, sans roulement, ainsi que se prépare le globe des autres pilulaires. Ajoutons que cette boule, ration calculée sur les besoins de la larve, est de volume à peu près constant, n’importe la grosseur de la calebasse finale.
Voilà le godiveau prêt. Il est mis en place dans le bol d’argile, largement ouvert. Déposé sans compression, le mets restera libre, dépourvu de toute adhérence avec son enveloppe. Alors se reprend le travail de céramique.
L’insecte presse les grosses lèvres de la coupe argileuse, les lamine et les applique sur la préparation de charcuterie, qui finit par être enveloppée, au sommet, d’une mince paroi, partout ailleurs d’une épaisse couche. Sur la paroi du sommet, proportionnée à la faiblesse du vermisseau qui doit plus tard la trouer au moment d’atteindre les vivres, un fort bourrelet circulaire est laissé. Manipulé à son tour, ce bourrelet se convertit en un creux demi-sphérique, où l’œuf est aussitôt pondu.
Le travail s’achève en laminant et rapprochant les bords du petit cratère, qui se ferme et devient la chambre d’éclosion. C’est ici surtout qu’une délicate dextérité s’impose. En même temps que se façonne le mamelon de la gourde, il faut, tout en comprimant la matière, laisser suivant l’axe le canalicule qui sera la cheminée d’aération.
Cet étroit pertuis, qu’une pression mal calculée pourrait irrémédiablement obturer, me paraît d’une difficulté extrême. Le plus habile de nos potiers n’en viendrait pas à bout sans l’appui d’une aiguille, qu’il retirerait après. L’insecte, sorte d’automate articulé, obtient son canal à travers le massif mamelon de la gourde sans même y songer. S’il y songeait, il ne réussirait pas.
La calebasse est confectionnée, il reste à l’embellir. C’est œuvre de patientes retouches qui perfectionnent les courbures et laissent sur la glaise molle un pointillage d’empreintes analogues à celles que le potier des temps préhistoriques distribuait sur ses jarres pansues avec le bout du pouce.
Voilà qui est fini. Sous un autre cadavre on recommencera, car pour chaque terrier une calebasse et pas plus, ainsi que le Scarabée sacré le fait de ses poires.
Encore un de ces artistes des pampas. Tout noir et de la taille de nos plus gros Onthophages, auxquels il ressemble beaucoup par la configuration générale, le Coprobie à deux épines est, lui aussi, un exploiteur des cadavres, sinon toujours pour lui, du moins pour sa famille.
Ouvrage du Coprobie à deux épines.
Il innove d’originale façon dans l’art des pilules. Son ouvrage, semé, comme le précédent, d’empreintes digitales, est la gourde du pèlerin, gourde à double panse. Des deux] étages, joints par un col assez nettement étranglé, le supérieur est moindre et contient l’œuf dans une loge d’éclosion; l’intérieur, de plus grand volume, est l’amas de vivres.
Imaginons que la petite poire du Sisyphe renfle sa chambre d’éclosion en un globule légèrement moindre que la sphère de l’autre extrémité ; supposons entre les deux nodosités une sorte de gorge de poulie largement évasée, et nous aurons, à très peu près, pour la forme et les dimensions, l’ouvrage du Coprobie.
Mise sur un charbon ardent, la matière de cette gourde à panse double noircit, se couvre de pustules brillantes pareilles à des perles de jais, répand un fumet de substance animale grillée et laisse pour résidu une argile rouge. Elle est donc formée de glaise et de sanie. En outre, dans la pâte sont clairsemés de menus débris cadavériques. Au petit bout est l’œuf, dans une chambre à plafond très poreux, comme l’exige l’accès de l’air.
Le petit croque-mort a pour lui mieux que sa double andouillette. Comme l’Onitis Bison, le Sisyphe, le Copris lunaire, il connaît la collaboration paternelle. Dans chaque terrier plusieurs berceaux, et toujours père et mère présents. Que font-ils là, les deux inséparables? Ils surveillent la nitée, ils maintiennent en bon état, par d’assidues retouches, les mesquines andouillettes si menacées de crevasses et de dessiccation.
Le tapis enchanté qui m’a permis une excursion aux pampas ne me fournit rien autre digne d’être noté. D’ailleurs le nouveau monde est pauvre en pilulaires; il ne vaut pas le Sénégal et la région du haut Nil, paradis des Copris et des Scarabées. Nous lui devons néanmoins un renseignement précieux: la série que le langage vulgaire désigne sous le nom de Bousiers se partage en deux corporations, l’une exploitant la bouse, et l’autre le cadavre.
A de bien rares exceptions près, cette dernière n’a pas de représentants dans nos pays. J’ai cité le petit Onthophage ové comme un amateur de putrilages cadavériques, et mes souvenirs ne me rappellent aucun autre exemple similaire. Il faut aller dans l’autre monde pour trouver des goûts pareils.
Y aurait-il eu schisme chez les primitifs assainisseurs, qui, adonnés d’abord à la même industrie, se seraient partagé plus tard la mission hygiénique, les uns ensevelissant l’ordure de l’intestin, les autres l’ordure de la mort? La fréquence relative de telle ou telle autre provende aurait-elle amené la formation de deux corps de métier?
Ce n’est pas admissible. La mort est inséparable de la vie; partout où se rencontre un cadavre se trouvent aussi, çà et là disséminés, les déchets digestifs de l’animal vivant; et le pilulaire n’est pas difficile sur la provenance de ces résidus. La disette n’est donc pour rien dans le schisme si, en effet, le vrai bousier s’est fait croque-mort, ou bien si le croque-mort s’est fait vrai bousier. De tout temps, pour l’un comme pour l’autre, n’ont manqué les matériaux à exploiter.
Rien, ni la rareté des vivres, ni le climat, ni les saisons renversées, n’expliquerait cette étrange divergence. Forcément faut-il y voir des spécialités originelles, des goûts non acquis, mais imposés dès le début. Et ce qui les imposait, ce n’est nullement la structure.
Je mettrais au défi le plus habile de dire, avant de l’avoir appris expérimentalement et d’après le seul aspect de l’insecte, à quel genre d’industrie se livre, par exemple, le Phanée Milon. Se rappelant les Onitis, de tournure à peu près pareille et manipulateurs de matière stercorale, il verra dans l’étranger un autre manipulateur de bouse. Il aurait tort: l’analyse du vol-au-vent vient de nous l’apprendre.
La configuration ne fait pas le véritable bousier. J’ai dans mes boîtes, venu de Cayenne, un magnifique insecte que la nomenclature appelle Phaneus festivus, le brillant en habit de fête, charmant, gracieux, superbe à voir. Comme il mérite bien son nom! Il est d’un rouge métallique où miroitent les feux du rubis. Il fait contraste à cette splendide joaillerie en semant son corselet de larges taches d’un noir profond.
Sous ton soleil torride, quel est ton métier, rutilante escarboucle? As-tu les goûts bucoliques de ton rival en parure, le Phanée splendide? Serais-tu un équarrisseur, un ouvrier en charcuterie putride comme le Phanée Milon? Vainement je te regarde et je t’admire: ton outillage ne m’apprend rien. Qui ne t’a pas vu au travail est dans l’impuissance de dire ta profession. Je m’en rapporte aux maîtres de bonne foi, aux savants qui savent dire: je ne sais pas. De nos temps, ils sont rares, mais enfin il y en a, moins empressés que les autres dans la lutte sans scrupule qui fait les parvenus.
De ce voyage aux pampas se déduit une conclusion de quelque portée. Voici dans l’autre hémisphère, avec des saisons renversées, un climat différent, des conditions biologiques dissemblables, une série de vrais bousiers dont les moeurs, l’industrie répètent, en ce qu’elles ont d’essentiel, les mœurs et l’industrie des nôtres. Des études prolongées, et non faites, comme les miennes, par procuration, augmenteraient largement la liste des travailleurs similaires.
Et ce n’est pas seulement dans les plaines herbues de la Plata que les modeleurs de bouse procèdent suivant les principes usités ici; on peut affirmer, sans crainte d’erreur, que les superbes Copris de l’Éthiopie, que les gros Scarabées du Sénégal travaillent exactement comme les nôtres.
Même parité industrielle chez les autres séries entomologiques, si éloigné que soit leur pays. Mes lectures me renseignent sur un Pélopée de Sumatra, fervent chasseur d’araignées comme le nôtre, constructeur de cellules en boue à l’intérieur des habitations, et passionné, lui aussi, pour les tentures flottantes des rideaux de fenêtre, mobile appui de ses nids. Elles m’apprennent qu’une Scolie de Madagascar sert à chacun de ses vers le corpulent lardon d’une larve d’Orycte, de même que nos Scolies nourrissent leur famille avec des proies d’organisation voisine, à système nerveux très concentré, telles que larves de Cétoine, d’Anoxie et même d’Orycte.
Elles m’informent qu’au Texas un Pepsis, puissant giboyeur voisin des Calicurgues, donne la chasse à une redoutable Tarentule et rivalise d’audace avec notre Calicurgue annelé, poignardant la Lycose à ventre noir.
Elles me disent que des Sphex sahariens, émules de notre Sphex à ceintures blanches, opèrent des Criquets. Bornons là ces citations, aisées à multiplier.
Rien de commode comme l’influence des milieux pour faire varier l’animal au gré de nos théories. C’est vague, élastique, peu compromettant de précision; cela jette sur l’inexplicable un semblant d’explication. Mais est-elle aussi puissante qu’on le dit, cette influence?
Qu’elle modifie un peu la taille, le pelage, la coloration, les accessoires de l’extérieur, accordé. Aller plus loin serait faire mentir les faits. Si les milieux deviennent trop exigeants, l’animal proteste contre les violences endurées et succombe plutôt que de changer. S’ils procèdent avec douceur, l’éprouvé s’en accommode tant bien que mal, mais invinciblement se refuse à cesser d’être ce qu’il est. Vivre conforme au moule d’où l’on est sorti, ou bien périr: il n’y a pas d’autre alternative.
L’instinct, caractéristique supérieure, n’est pas moins rebelle aux injonctions des ambiances que peuvent l’être les organes, serviteurs de son activité. D’innombrables corps de métier se partagent l’ouvrage du monde entomologique; et tout membre de l’une de ces corporations est soumis à des règles que ne font fléchir ni le climat, ni la latitude, ni les troubles plus graves du régime.
Voyez les bousiers des pampas. A l’autre bout du monde, dans leurs immenses pacages inondés, si différents de nos maigres pelouses, ils suivent, sans variation notable, les méthodes de leurs confrères provençaux. Un profond changement de milieu n’altère en rien l’industrie fondamentale du groupe.
Les vivres disponibles ne l’altèrent pas davantage. L’aliment d’aujourd’hui est surtout la matière bovine. Mais le bœuf est, dans le pays, un nouveau venu, importé par la conquête espagnole. Que consommaient, que pétrissaient les Mégathopes, le Bolbites, le Phanée splendide, avant l’arrivée du fournisseur actuel? Le lama, hôte des plateaux élevés, ne pouvait alimenter les stercoraires confinés dans la plaine. Aux temps antiques, le nourricier était peut-être le monstrueux Megatherium, usine à bouse d’incomparable richesse.
Et des produits de la bête colosse, dont il ne reste plus que de rares carcasses, les modeleurs ont passé aux produits du mouton et du bœuf, sans modifier leurs ovoïdes et leurs gourdes, de même que notre Scarabée, sans cesser d’être fidèle à sa poire, accepte la tourte de la vache lorsqu’il lui manque le morceau préféré, la brioche du mouton.
Au midi comme au nord, aux antipodes comme ici, tout Copris façonne des ovoïdes avec l’œuf au petit bout; tout Scarabée pétrit des poires ou des gourdes, avec chambre d’éclosion dans le col; mais, suivant les temps et les lieux, la matière travaillée peut varier beaucoup, fournie par le Megatherium, le bœuf, le cheval, le mouton, l’homme et bien d’autres.
N’allons pas de cette diversité conclure aux changements de l’instinct: ce serait voir la paille et négliger la poutre. L’industrie des Mégachiles, par exemple, consiste à fabriquer des outres avec des morceaux de feuilles; celle des Anthidies cotonniers, à fouler des sacs d’ouate avec la bourre de certains végétaux. Que les pièces soient découpées sur les feuilles de tel arbuste ou de tel autre, au besoin sur les pétales de quelque fleur; que l’ouate soit récoltée ici ou là, suivant le hasard des rencontres, l’industrie ne change pas dans ce qu’elle a d’essentiel.
Ainsi ne change pas l’art du bousier, s’approvisionnant de matières dans tel ou tel autre filon. En vérité, voilà l’instinct immuable, voilà le bloc que n’ébranleront pas nos théories.
Et pourquoi changerait-il, cet instinct, si logique en son ouvrage? Où pourrait-il trouver, le fortuit aidant, combinaison meilleure? En dépit d’un outillage changeant d’un genre à l’autre, il inspire à tout bousier modeleur la configuration globulaire, édifice fondamental à peine altéré par la mise en place de l’œuf.
Dès le début, sans compas, sans roulement mécanique, sans déplacer la pièce sur sa base, tous obtiennent la sphère, le solide d’exécution délicate, supérieurement propice au bien-être du ver. Au bloc informe, exempt de soins, tous préfèrent le globe, amoureusement travaillé, dispendieux en manipulations; le globe, la forme par excellence, la mieux apte à la conservation de l’énergie, qu’il s’agisse d’un soleil ou d’un berceau de bousiers.
Lorsque Mac-Leay donna au Scarabée le nom d’Héliocanthare, Escarbot du soleil, qu’avait-il en vue? Les dentelures rayonnantes du chaperon, les ébats de l’insecte sous la vive lumière? Ne se remémorait-il pas plutôt le symbole de l’Égypte, le Scarabée qui, au fronton des temples, dresse au ciel, en guise de pilule, une sphère de vermillon, image du soleil?
Le rapprochement entre les grands corps de l’univers et l’humble bille de l’insecte ne répugnait pas aux penseurs des bords du Nil. Pour eux, la suprême splendeur trouvait son effigie dans l’extrême abjection. Avaient-ils bien tort?
Non, car l’œuvre du pilulaire pose grave question à qui sait réfléchir. Elle nous met dans cette alternative: ou bien faire au crâne aplati du bousier l’insigne honneur d’avoir résolu lui-même le problème géométrique des conserves; ou bien recourir à une harmonie régissant l’ensemble des choses sous l’œil d’une Intelligence qui, sachant tout, a tout prévu.