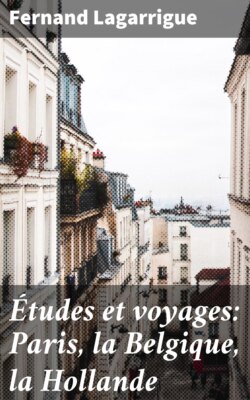Читать книгу Études et voyages: Paris, la Belgique, la Hollande - Fernand Lagarrigue - Страница 4
PARIS.
ОглавлениеSitôt descendu du wagon, le voyageur se met en quête d’un logement commode et bien ajourné. Son unique ambition, en ce moment, est d’habiter le plus près des boulevards, rendez-vous habituel de la fashion parisienne, et bordés sur presque tout leur parcours des théâtres et des salles de bals les plus recherchés. — Les rues Vivienne, Richelieu, Laffitte, du Helder, de la Chaussée-d’Antin, noms déjà connus par les lecteurs des romans à la mode, l’emportent sur toutes les autres. Ne nous récrions pas contre cette prédilection bien naturelle, et que nous partageons peut-être. Nous ne citerons pas les principaux hôtels, classés pour la plupart dans les adresses des Guides-Chaix; jamais, nous l’avouons sans honte, nous ne sommes descendu dans aucun. — Les chambres d’hôtels nous rappellent toujours involontairement les grandes infirmeries, où chacun occupe une chaise et un lit à part, mais où personne ne peut se dire chez soi. — Dans un hôtel, on dépend d’abord des propriétaires, du concierge, et quelquefois encore de ses nombreux occupants. Un brouhaha continuel dans les couloirs, les salles de conversation et autres, vous représentent la fébrile animation des ports maritimes, des gares de chemin de fer. Si, par hasard, vous rentrez après minuit, la dame qui tire le cordon vous fait la moue le lendemain, et M. votre voisin de chambre se fâche contre vos mœurs désordonnées et non avouables. Vous payez presque aussi cher que si vous étiez locataire d’une petite maison de l’avenue de l’Impératrice, et il vous semble toujours, on ne sait pourquoi, que votre petit réduit, vous le tenez de la bienveillance désintéressée d’un hôte qui vous est inconnu.
Pour vivre à Paris, vivre commodément et n’avoir rien à changer à ses habitudes, il faut éviter ces guet-à-pens que nous tendent les affiches trompeuses et les belles annonces de la quatrième page des journaux. Les maisons meublées avoisinant les boulevards des Italiens et Montmartre, toutes d’un confortable à satisfaire les plus difficiles exigences, ne laissent rien à désirer sous ces rapports. — Une fois installé, vous êtes ici chez vous, bien chez vous. Vous n’avez pas à craindre des visites importunes. Il est telle maison où nous avons logé plusieurs mois, qui, moyennant 100 ou 120 fr., mettra à votre disposition un local richement disposé, à son premier étage. Le concierge aura pour vous les prévenances les plus raffinées, et vous accueillera à toute heure le sourire sur les lèvres. Ces considérations, infimes en apparence, ne sont pas à dédaigner de notre temps.
Nous ne laisserons pas ce sujet sans parler des erreurs que certains avancent sur ce chapitre. Ils prétendent qu’avec de semblables intentions, on court le risque de laisser à Paris plusieurs billets de mille francs. — Ces préventions contre les garnis des beaux quartiers sont à nos yeux souverainement ridicules, et ne peuvent parler ainsi que les ignorants en cette matière. — A notre premier voyage à Paris, conseillé par de craintes vaines, nous essayâmes des rues les moins larges, les moins connues, les plus éloignées du centre. Outre que nous végétions entre la boutique obscure d’un charbonnier, honnête Auvergnat, et d’une laide fille normande, dame de comptoir chez un marchand de beurre, ou peut-être même un débitant de vin sucré, tandis que sur notre tête un industriel, qui a saint Crépin pour patron, battait sans relâche une mesure à deux temps, irrégulière mais persistante, nous pouvons assurer que notre bourse ne trouva rien à gagner dans ce changement tout à notre désavantage. — A certaines époques, nous avons tenté de nouveau cette expérience; toujours les résultats nous ont appris, sans réplique, qu’il y avait, au contraire, intérêt pour l’étranger à se rapprocher des boulevards, et d’être logé dans une maison bien tenue, élégante et confortable.
Affolés par des souvenirs romanesques, il est, nous le savons, des têtes brûlantes qui, touchant pour la première fois de leur pied mal affermi le sol de la capitale, ambitionnent la faveur précieuse d’adorer les dieux badins et légers de l’Olympe, dans une pauvre petite mansarde enfumée du quartier latin, compris entre la rue Saint-Jacques et la rue de la Harpe. Ceux-là jetteraient leur chapeau au vent pour nouer une intrigue amoureuse dans les combles d’une maison de la rue de Vaugirard. Que notre expérience leur serve d’exemple à suivre: Les grisettes de Henri Mürger et d’Alfred de Musset n’existent plus; ce type est mort, le moule, brisé, a été recueilli par un antiquaire. La Mimi, la Bernerette de 1858 ont oublié la signification idéale de ce doux mot: amour; elles ne savent plus, aujourd’hui, que la valeur d’une pièce de 20 francs.
Les maisons meublées, dont nous avons parlé, ne disposent que très-rarement d’une table d’hôte pour leurs locataires. — Ceux-ci doivent chercher ailleurs à satisfaire les fréquentes nécessités que leur suggère leur appétit. Nous leur indiquerons, en passant, les restaurants Bonnefoy, Vachette, Désiré Beaurain, au boulevard Montmartre; les tavernes anglaises des rues Saint-Marc et Grange-Batelière. Les cafés les mieux achalandés servent aussi à la carte, à toute heure du jour, et leur excellente cuisine ne le cède en rien à celle des maisons les plus célèbres.
Nous avouerons naïvement que les tentantes devantures des Vatels à la mode: Véry, Véfour, les Provençaux, ont produit sur nous un effet tout autre à celui auquel nous nous attendions. Ces gros fruits qui, avant d’embellir le dessert des habitués, ont été labourés dans tous les sens par de bruyants volatiles affamés, cette odeur épaisse qui nous saisit à la gorge toutes les fois que nous nous arrêtons devant les belles glaces de Véfour, nous font concevoir une triste opinion des tables les plus recherchées de l’Europe entière. Moins de luxe, mais une rigidité plus sévère sur le chapitre de la propreté : il ne doit pas être difficile de trouver cela à Paris!
Pourvu d’un logement agréable, à peu de distance des boulevards, au centre de Paris, dans un quartier qui tient un peu des mœurs et des coutumes de l’aristocratique faubourg Saint-Germain et de la Chaussée-d’Antin, entreprenons nos longues excursions à travers ce labyrinthe de rues. Voici la rue Vivienne, traversons la large et dangereuse voie qui nous sépare de la rive gauche des boulevards, et, après avoir consommé un grog au café Véron, dirigeons-nous vers le palais de la Bourse, là-bas, sur cette belle place que vous traverserez souvent, si, comme nous, vous choisissez le théâtre du Vaudeville pour utiliser vos longues soirées d’hiver.
Il est bon de monter, une fois, le perron de la Bourse, pour examiner attentivement les précieuses grisailles d’Abel de Pujol et Meynier qui décorent le plafond intérieur, et savoir au juste à quelles extravagances peut nous pousser la soif de l’or: auri sacra famés. Voyez-vous dans un des coins de la salle principale cet homme de quarante ans? C’est M. Chose, un hardi spéculateur, pauvre hier, riche de 10 millions aujourd’hui. Cet autre, qui ne cause pas avec lui, mais qui l’observe piteusement, possédait un somptueux et coquet équipage à faire damner de dépit les lorettes les plus à la mode, dans un temps où Chose ne savait pas le matin où, le soir, il reposerait sa tête. Par la protection d’une chance qui a souvent de terribles caprices, Chose a acquis légalement la fortune de ce malheureux. Les rôles sont changés, il n’y a rien que cela! Le misérable d’hier est recherché par tous les seigneurs de l’endroit aujourd’hui; quant à l’autre, il est pauvre, il a payé intégralement ses pertes: c’est un misérable. Ainsi va le monde!...
La Bourse a été élevée sur l’emplacement occupé, dans un autre siècle, par le couvent des Filles Saint-Thomas. La rue qui porte ce nom est en face. Ce parallélogramme parfait a une longueur de soixante mètres sur une largeur de quarante-un. Soixante-six colonnes de l’ordre corinthien ornent son péristyle surmonté d’un entablement et d’un attique du meilleur goût. L’entablement forme autour de l’édifice une galerie couverte, très-commode en hiver au régiment nombreux des soldats qui savent mourir pour le 3 et le 4 0/0. N’oubliez pas de vous arrêter devant les statues de MM. Duret et Pradier, placées l’une à l’angle du nord-ouest, l’autre à celui du sud-est.
La visite du tribunal et de la Chambre de commerce ne pouvant nous intéresser aujourd’hui, suivons encore la rue Vivienne pour arriver au Palais-Royal.
Avant Richelieu, à l’endroit occupé aujourd’hui par ce palais, était jadis l’hôtel de Rambouillet et celui du connétable d’Armagnac. C’est en 1624 que lé Cardinal-ministre acquit cet emplacement, sur la demande qu’il avait adressée au roi, et qu’il fit construire un hôtel appelé dès son origine, hôtel Richelieu. L’humilité de cette petite façade primitive, l’orgueilleux désir qui parlait si haut à ce puissant, roi de France sans en porter le nom, l’espoir d’ouvrir ses salons à des hommes qui pourraient le servir dans ses projets et le favoriser dans ses vues, l’entraînèrent à appeler à son secours l’architecte Lemercier, et à lui demander les plans d’un palais encore sans rival. Les fossés furent vite comblés, les murs de la ville tombèrent sous l’ordre et la volonté du Cardinal, et les travaux poussés avec une activité sans pareille, étaient à peu près terminés en 1636.
Outre une chapelle, remarquable par la richesse de ses décorations, on admirait une galerie des hommes illustres dont Philippe de Champagne (ou Champaigne) avait peint, avec un goût exquis, la voûte élevée. Rien ne manquait à cette habitation royale, il y avait même un théâtre conçu dans de larges proportions sur lequel, en 1639, on représenta une pièce inédite, Mirame, tragédie assez médiocre écrite par Richelieu en collaboration avec Desmarets. La cour assistait à cette soirée, intéressante surtout par l’attrait de la nouveauté et le nom de l’un de ses auteurs.
Dans cette galerie des illustres dont nous venons de dire un mot, le Cardinal ne comptait que vingt-cinq personnages. La vingt-quatrième place était réservée au roi Louis XIII; quant à la vingt-cinquième, le Cardinal, en flatteur bien appris ne l’avait offerte à personne: c’était lui-même qui l’occupait!
De retour de sa fameuse expédition dans le midi de la France, que la catastrophe de Cinq-Mars a à jamais rendue mémorable, Richelieu, tristement couché dans sa chaise de voyage, rendit le dernier soupir dans son palais, le 4 décembre 1642. Par son testament il léguait au roi «son hôtel, ses diamants, son buffet d’argent ciselé, etc.» Le roi n’eut pas le temps de jouir des bénéfices de cet héritage: il mourut cinq mois après.
La reine-mère, Anne d’Autriche, prit possession du Palais-Cardinal, le 7 octobre 1643. Elle amenait avec elle ses deux enfants, Louis, âgé de cinq ans, Philippe d’Orléans, plus jeune encore. Celui qui bientôt devait monter sur le trône occupa la chambre de Richelieu, comme pour apprendre à connaître le mystère des intrigues de cour, et à toujours se tenir en garde contre l’orgueilleuse arrogance de ses courtisans.
C’est dans la grande galerie qu’on dressa le pepetit lit de Philippe; Anne d’Autriche ordonna que l’inscription, placée sur le fronton de l’entrée principale disparût; elle la fit remplacer par cette autre: PALAIS-ROYAL; nom qui, après plusieurs changements successifs, lui a été enfin rendu par l’empereur Napoléon III.
Le Palais-Royal devint la propriété exclusive du frère de Louis XIV, Philippe d’Orléans, quand celui-ci eut épousé Henriette d’Angleterre, fille de Charles Ier, princesse qui, quelques années auparant, l’avait habité avec sa mère. Ce ne fut qu’en 1692 qu’elle y entra en souveraine.
Après avoir abrité ce couple heureux qui s’aimait sincèrement, et dont la séparation dernière troubla seule le bonheur, le Palais - Royal eut pour maître le duc d’Orléans, régent de la couronne. Voici ce que nous lisons dans Saint-Simon:
«Les soupers du Régent étaient toujours avec des compagnies fort étranges, avec ses maîtresses, quelquefois des filles de l’Opéra, souvent avec la duchesse de Berry, sa propre fille! — quelques dames de moyenne vertu et quelques gens sans nom, mais brillants par leur esprit et leur débauche. La chère y était exquise; les galanteries passées et présentes de la ville, les vieux contes, les disputes, rien ni personne n’y était épargné. On buvait beaucoup et du meilleur vin, et quand on avait fait du bruit et qu’on était bien ivre, on allait se coucher.»
Tous les détails que nous pourrions rapporter n’en apprendraient pas tant que ces quelques lignes du chroniqueur exact et impartial de la fin du XVIIe et des trente premières années du XVIIIe siècle. Saint-Simon est et sera toujours un conteur sans rival. On ne parle après lui que pour faire son éloge.
Sous la révolution de 1789, le Palais-Royal s’appela Palais-Egalité.
Napoléon Ier, consul, en fit le palais du Tribunat. En effet, cette chambre puissante à cette époque, y siégea de 1801 à 1807. On avait disposé pour ses séances une salle spéciale, dont on ne trouve plus de vestiges depuis 1827. — De 1807 à 1814 le palais resta désert. La Bourse et le Tribunal de commerce, établis sous l’Empire dans la grande salle du Tribunat, furent plus tard transférés ailleurs, comme nous l’avons déjà vu.
A l’époque de la Restauration, le duc d’Orléans, rentrant en possession des biens et domaines de sa royale famille, dépensa 12 millions de francs pour faire disparaître les traces qu’avaient laissées dans ce palais d’autres maîtres exilés. Les ruelles étroites formées par l’agglomération des boutiques de bois qui étaient groupées autour du Palais-Royal, disparurent complètement et firent place à de larges voies de communication, à des galeries bien aérées qui méritent de nos jours, à ces corps de bâtiments, une des premières places dans la description des monuments de Paris.
Certes, si nous n’avions pas à ménager l’espace dont nous disposons, nous pourrions facilement, aidés de nos souvenirs personnels et des récits qu’on a bien voulu nous faire, vous donner la primeur de certaines notes inédites qui ne manquent pas d’intérêt. Plus tard, peut-être, entreprendrons-nous ce travail de révision; pour aujourd’hui, je dois me contenter de vous inviter à venir vous reposer le soir des fatigues du jour sous la fraîcheur des tilleuls des square bordés d’allées qui s’étendent de la magnifique galerie d’Orléans, dite galerie vitrée, au café de la Rotonde. Vers six heures, une excellente musique militaire réjouit les alentours par de mélodieuses et entraînantes symphonies. La lorette qui s’était traîtreusement introduite ici, ne s’arrête plus au jardin du Palais-Royal; aussi, assis devant le Pavillon du café de la Rotonde, on peut aisément suivre les caprices de ses méditations ou de sa fantaisie, sans être persécuté par les séduisantes avances de ces femmes maudites.
Le jardin occupe un parallélogramme régulier de 230 mètres sur 100; au milieu, deux parterres embellis par un bassin circulaire à jet d’eau en gerbe, donne de la fraîcheur aux beaux arbustes disposés artistement. On y voit deux copies de Diane et de l’Apollon du Belvédère, une nymphe blessée par un serpent, de Nanteuil, un Enfant jouant avec une chèvre, par Lemaire; un Baigneur, par Despercieux. N’ayant pu obtenir l’autorisation de visiter l’intérieur du Palais, habité actuellement par le prince Jérôme, nous continuerons notre promenade, en passant par le jardin des Tuileries, où il faudra bien nous arrêter un moment pour rappeler son histoire. Tout ici-bas compte un passé ; qui peut se dire: j’aurai un avenir?
Le plus riche, le plus magnifique jardin qui soit au monde, c’est le jardin des Tuileries. Quelles impressions ne produisit pas sur nous la vue de cette grille aux traits dorés lors de notre premier voyage à Paris! Il nous semblait que notre esprit, empreint d’images fantastiques trompait nos yeux; ces merveilles nous éblouirent, et si les gamins qui jouaient sur les trottoirs ne nous avaient montré, par leurs joyeux «esbattements,» la réalité tout entière, nous nous serions cru dans le royaume d’Armide, ou, tout au moins, à la cour des sultans des Mille et une Nuits. Les voltigeurs de la garde, placés en sentinelles vigilantes, à chacune des portes du jardin, attristèrent cependant notre humeure d’ordinaire joyeuse. Pourquoi ces soldats? Quels sont donc les dangers qui menacent ces têtes si chères à nos cœurs et auxquelles nos suffrages unanimes ont confié les destinées de la France? La garde défend, et Napoléon III a-t-il besoin de défenseurs! Ne sommes-nous pas tous pour veiller sur cette vie si précieuse. Notre Empereur est notre maître, et, en sujets fidèles, notre premier devoir n’est-il pas de lui rendre en amour et en dévouement le faible tribut de reconnaissance que chacun des jours de son règne glorieux mérite à tant de titres? — Nous n’avions pas encore lu l’histoire des Tuileries, quand, dans notre primitive ignorance, nous ne pouvions pas comprendre la nécessité de cette précaution, aussi ancienne que notre pays, et dont nous reconnaissons malheureusement, tous les jours, la nécessité.
Le roi Henri IV ordonna que, pour embellir les abords du palais des Tuileries, un jardin conçu dans des proportions grandioses, s’étendît sur une longueur considérable au-devant de la façade principale. Dès le principe, il contenait un bois, un étang, une volière, une étroite orangerie, des parterres, une ménagerie, un labyrinthe et un théâtre. La scène d’un théâtre, n’est-ce pas là où s’étalent, aux feux de la rampe, les inextricables mystères du monde, et où nous apprenons, par les sujets qu’on y représente, à détester le vice, à aimer la vertu, enfin, à connaître et à juger les hommes à leur valeur exacte!...
Outre cela, il y avait encore une garenne, dont Louis XIII disposa en faveur de Renard, valet de chambre fin et dévoué du commandeur de Souvré. Renard s’engagea à défricher ces terres et à les couvrir de plantes rares et de fleurs recherchées. Satisfait des dispositions qu’il adopta, le roi permit à Renard d’ouvrir, dans le jardin, un cabaret qui ne tarda pas à gagner de la renommée, et dont parlaient avec éloge et considération les gentilshommes désordonnés qui menaient bon train l’existence, sous la minorité de Louis XIV.
En même temps que Lavau restaurait le Palais, Le Nôtre fut chargé de remanier ce qui avait été fait précédemment dans le jardin. Rien ne dut résister à la volonté aussi absolue qu’intelligente de l’architecte. On abattit plusieurs maisons étroitement situées sur les avenues; on alla même jusqu’à faire disparaître l’hôtel de Mlle de Guise, petite-nièce du cardinal de Lorraine. — Une pente de 1 mètre 75 centimètres, dans le sens de la largeur, fut habilement masquée par un talus imperceptible, et, de chaque côté, on établit une terrasse gracieuse qui ne contribuait pas peu à donner une élégance de plus à l’ensemble du jardin.
La Convention nationale décida que l’allée princicipale devait être élargie, et la terrasse des Feuillants, située à droite des Tuileries, replantée sur toute sa longueur. Dans chacun des massifs, on trouve encore une salle de verdure terminée par deux hémicycles de marbre blanc du plus charmant effet. Robespierre avait donc parfois d’excellentes idées. C’eût été, peut-être, un architecte de mérite?
L’empereur Napoléon 1er ne voulut pas passer sur le trône, sans laisser, dans ce jardin, des traces de son goût aussi épuré que délicat, et, comme il avait fait partout, il modifia les irrégularités du plan général. Le père d’un peuple ne doit pas tant seulement s’intéresser au bonheur et à la prospérité de son pays, il faut encore qu’il veille, avec un soin vigilant, à la conservation des propriétés et des édifices publics, pour marier ensemble l’utile à l’agréable.
La Restauration ne changea rien à ce qui avait été fait avant elle. On alla chercher, dans les ateliers des sculpteurs, des statues colossales, décorations indispensables aux allées longues et larges de ce jardin sans pareil. Le règne de Louis-Philippe fit beaucoup pour cette riche promenade. La terrasse située devant le pavillon de l’horloge fut remplacée par des plates-bandes, où fleurissent les plantes des premières graines. Ces sentiers, tenus avec un soin attentif, ne peuvent pas être visités en détail. L’entrée est réservée aux hôtes du palais.
Une barrière grillagée sépare ces allées étroites du reste du jardin. Ajoutons, pour être aussi complet que possible, que trois bassins, placés en droite ligne avec l’avenue des Champs-Elysées, décorent la partie la plus animée, et où s’arrêtent quelquefois les équipages de la cour. Le bassin central est le plus important par ses grandes proportions. C’est à peine si un enfant habile dans l’art de manier la fronde, peut, avec une pierre de petit appareil, franchir la prodigieuse distance qui le sépare de l’autre bord.
Énumérons maintenant les principaux ouvrages de sculpture qui peuplent cette promenade. Cela fait, nous irons parcourir rapidement les salles du château.
On se tromperait fort en croyant que ces nombreuses statues sont toutes des chefs-d’œuvre. Il y en a de plus ou moins bien réussies, comme partout ailleurs. Les unes se font remarquer par d’excellentes qualités, les autres ne mériteraient pas, par leurs défauts, d’être exposées aux yeux du public qui fréquente cette promenade. La nullité ne trouve-t-elle pas toujours, à force d’intrigues et de protection, une petite place sous le soleil? Et cette place, c’est souvent un artiste qui meurt de misère, qui y aurait droit!
Devant le château, sur le piédestal d’honneur, sont deux bronzes fondus par les frères Keller sur des modèles antiques: le Rémouleur et la Vénus accroupie, autrement nommée, quelquefois, la Vénus à la tortue. Vis-à-vis le pavillon de Flore, nous avons admiré une statue de marbre blanc due au ciseau habile de David (d’Angers), représentant les traits de Talma. On assure que cette image du grand acteur est très-ressemblante. Sur le devant du jardin particulier, on remarque encore un Faune flûteur, de l’immortel Coysevox, une Hamadryade du même; une Vénus à la Colombe, surtout, de Guillaume Coustou. — A chaque côté de l’entrée de la terrasse du bord de l’eau, sont accroupis deux lions, du célèbre Barye. Ces bronzes, aux proportions naturelles, sont, de l’avis des connaisseurs, deux vrais chefs-d’œuvre.
Autour du rond-point du bassin principal, deux morceaux précieux méritent toute l’attention des étrangers: Énée enlevant son père Anchise, et Lucrèce et Collatin, de Pierre Lepautre, artiste français du XVIIIe siècle, fils d’Antoine Lepautre, l’habile architecte qui construisit les deux ailes du château de Saint-Cloud, et que Monsieur, frère de Louis XIV, nomma son architecte particulier. N’oublions pas de mentionner un Prométhée, de Pradier, le Rhône et la Saône, de Coustou , et, enfin, les deux pilastres de l’entrée principale, ornés de deux groupes équestres dus à l’ébauchoir de Coysevox. Ces deux groupes sont indignes de leur auteur. — Remontons le jardin, et entrons, sans plus tarder, dans le palais des Tuileries.
L’emplacement sur lequel est situé le palais de Tuileries fut, d’après les chroniques, choisi par Louise de Savoie, mère de François Ier. La gracieuse mais étroite maison qu’on y bâtit d’abord, au lieu appelé les Sablonnières, et, plus communément, les Tuileries-Saint-Honoré, devint le petit séjour de la Reine-Mère, en raison même de son éloignement du Paris élégant et du Palais des Tournelles, où se tenait la cour. Les bâtiments primitifs et les terrains spacieux des Saisonnières furent achetés par François Ier au sieur Nicolas de Neuville de Villeroi, chevalier titulaire des finances et audiencier de France.
A peu de temps de là, le petit séjour passa en usufruit à Jean Thiercelin, maître d’hôtel du Dauphin. La Couronne ne rentra en possession de cette antique habitation royale qu’en 1564, alors que Catherine de Médicis, une autre Reine-Mère, son palais des Tournelles ayant été démoli, eut ridée de s’y établir, accompagnée de ses ministres et de ses courtisans. C’est à Philibert Delorme que fut confié le soin de construire, sur les bords du fleuve, un château de plaisance. Il se mit à l’œuvre la même année; Catherine mit à sa disposition les ouvriers les plus habiles, et malgré que le trésor eût eu déjà à souffrir de ses caprices inconsidérés, elle fit venir d’Italie les artistes les plus en renom.
Philibert Delorme éleva d’abord, au centre de ces nouvelles constructions, un pavillon grandiose surmonté d’un dôme, d’un contraste assez déplaisant avec l’architecture adoptée dans l’ensemble du château. Le rez-de-chaussée que chacun peut encore admirer à son aise, toutes les fois que l’Empereur est absent de Paris, était percé, dans le milieu, d’une porte à plein - cintre avec un fronton circulaire, remplacée, depuis, par une arcade élégante, qui donne passage de la cour extérieure au jardin. — A la place de la fenêtre du milieu, au premier étage, était un panneau-massif entouré de moulures et de chambranles à consoles, supportant une légère galerie et des écussons.
Comme encadrement, l’architecte avait établi, de chaque côté, deux pilastres composites à l’aplomb des colonnes du rez-de-chaussée, surmontées d’un entablement orné d’une frise légère. Sur chacun des quatre angles laissés vides par le retour de l’attique, était un campanile orné de sculptures et percé d’une fenêtre. C’est sous Henri IV que l’harmonie de ce pavillon fut détruite par Ducerceau, qui construisit le Pavillon de Flore et commença la galerie sur le quai. C’est lui aussi qui élargit les proportions du Pavillon de l’Horloge et qui substitua, plus tard, le toit quadrangulaire que nous voyons encore de nos jours, plus en rapport avec le reste du château, empreint de l’architecture des siècles anciens de l’histoire grecque.
Dans ses livres, que nous avons consultés, Philibert Delorme parle très-souvent de l’escalier qui occupait le pavilion du milieu. Cet escalier avait trois mètres de largeur, tournait, à droite, au premier étage, était bordé d’une rampe suspendue, et, sur son milieu, on avait ménagé un espace vide. Les pierres étaient toutes d’une forme particulière et coupées entre elles avec autant d’originalité que de justesse et de symétrie.
Lorsque Henri IV conçut, dans son vaste génie, le projet plus vaste encore, peut-être, de joindre le Louvre aux Tuileries, il existait, comme nous l’avons dit, du côté du Pavillon de Flore, une aile assez avancée qui montrait la place que devait occuper, plus tard, la galerie sur le quai. Ducerceau continua le travail commencé et espérait atteindre la galerie de jonction. Cette œuvre ne fut exécutée par lui que jusqu’au guichet de Lesdiguières. C’était à Thibaut Métézeau qu’était réservé le soin de terminer cette partie importante de cet immense édifice.
Louis XIV trouva les Tuileries dans cet état incomplet à son avènement sur le trône. Il chargea Louis Levau et son gendre, François d’Orblay, de régulariser ces constructions. Levau compléta le Pavillon de Bullant, situé au nord, construisit le pavillon Marsan et la courte galerie qui le rejoint au pavillon de Bullant. Il suivit, sans y rien changer, les dispositions que ses prédécesseurs avaient adoptées du côté de la rivière, et ne fut pas autre chose qu’un copiste servile, sans initiative; ses travaux ne sont empreints d’aucun cachet original.
Mais s’il ne pouvait prétendre à égaler ni Philibert Delorme ni Ducerceau, Levau, savant profond et entendu dans son art, corrigea le dôme circulaire du pavillon de l’Horloge, et fit un dôme carré d’une élégance moins banale et plus relevée. C’est à lui qu’on confia la distribution intérieure de tous les appartements des Tuileries, dont les peintures et les décorations sont dues au talent et à l’habileté de Banel, Cotella de Meaux, Nicolas de Loir, Girardon, Berthod Flamel, Francisque Millet, Nicolas Coypel, Noiret de Nancy, Hyacinthe Rigaud et Louis Lesambert. On avait représenté, dans presque tous les sujets qui ornaient les plafonds, Anne d’Autriche sous les traits de la déesse Minerve. Les flatteurs ne sont pas à l’abri de la loi commune, mais la flatterie est comme le phénix: elle renaît tous les cent ans de ses cendres!...
Ayant occupé sa jeunesse à vivre gaîment à Saint-Germain, au Palais-Royal et à Vincennes, Louis XIV se retira à Versailles, où, comme chacun le sait, des frivolités et des caprices le distraiyaient dans son ennui. L’homme vicieux et qui n’ose avouer à personne ses irritantes passions, aime toujours de n’avoir pour témoin que la belle nature; celle-ci ne manque pas de courtoisie et de sourires, sitôt que le plus petit rayon de soleil vient caresser son front serein comme l’espérance et les illusions de l’amour. Il essaya, néanmoins, de donner suite au projet de Henri IV, projet qui consistait à réunir le Louvre aux Tuileries. Quelques maisons et des jardins aussi improductifs que les plaines du Sahara, situés entre les deux palais, devinrent la propriété de l’Etat. C’est à cette époque qu’on résolut de masquer l’irrégularité qui existait dans leur parallélisme par un arc de triomphe qui s’éleverait en avant du pavillon central des Tuileries. Perrault dressa les plans de cet arc de triomphe; mais soit par cabale, soit par intrigue, on en confia aveuglément l’exécution à l’architecte Levau.
Louis XV, plus débauché encore que le royal époux de Mme de Maintenon, fixa, lui aussi, sa résidence à Versailles, et ses apparitions aux Tuileries furent si courtes et si rares, qu’il n’eut pas le temps de s’occuper des améliorations nécessaires à la conservation, à l’élégance, à l’amélioration des bâtiments du château.
C’est Napoléon qui, le premier, habita d’une façon stable et régulière ce magnifique palais; il dégagea le jardin, les allées des Feuillants et le pavillon Marsan, en faisant percer la rue de Rivoli. C’est à lui aussi que nous devons la cour intérieure, dite cour d’Honneur ou du Carrousel.
Sans les traces infâmes que lui laissèrent les insensés révolutionnaires de 1830, inconséquents insurgés de 1848, Louis-Philippe aurait trouvé les Tuileries a peu près telles que Napoléon les avait laissées quinze années auparavant. Ce roi, dont la France gardera longtemps un précieux et durable souvenir, grâce à son gouvernement aussi sage qu’éclairé, ne manqua pas de vite s’apercevoir de l’insuffisance de ce monument, et de l’inintelligente distribution intérieure. Le chef de la branche cadette, c’est M. Fontaine qui nous l’apprend dans son grand ouvrage sur les Tuileries, voulait non-seulement compléter la jonction des deux palais, mais encore élever de nouvelles Tuileries pour loger dans un même centre les ministères et les employés attachés à leur service. — Ce projet ne fut pas mis à exécution pour des motifs illusoires.
Un mot sur l’histoire des Tuileries:
Le 6 octobre 1789, la garde nationale et le peuple allèrent à Versailles chercher le roi et sa famille pour les conduire à Paris. Quelques jours auparavant une troupe de comédiens s’était installée dans le palais et réjouissait les curieux avides de spectacle par des représentations nocturnes, dont les pantomimes italiennes faisaient tous les frais. Les comédiens génois cédèrent la place au saint Louis du XVIIIe siècle, et tout le monde de s’écrier: «Nous ne manquerons plus jamais de pain, nous avons amené le boulanger, la boulangère et le petit mitron.» Toute la journée les alentours des Tuileries, les rues, les places, les jardins furent envahis par la foule qui prouvait, par ses fêtes et ses jeux, la satisfaction produite par le retour de Louis XVI au milieu de ses bons parisiens et cette promesse bienveillante du roi:» Je ferai désormais à Paris ma demeure habituelle!»
Le 19 du même mois, l’Assemblée constituante vint s’établir dans la capitale; elle siégea d’abord à l’archevêché attendant que le manège des Tuileries, habité depuis 1770 jusqu’en 1782 par la Comédie-Française, eût été mis en état de servir de local à ses séances .
Nous passons sans nous y arrêter sur les cent contes divers que des écrivains ingénieux, ou peut-être même en quête de nouvelles intéressantes et curieuses, ont imaginé pour amuser et distraire leurs lecteurs. L’épisode de l’armoire de fer n’est pas, sans doute, dénuée de tout fondement et nous pouvons y croire en partie, car elle eut pour conséquence la tentative d’enlèvement projetée par les officiers des grenadiers de service, anciens gardes-françaises, qui s’étaient introduits dans le palais sous prétexte de défendre le roi. Quelques mois après, un essai plus terrible par ses conséquences éclata, et le 20 juin couronna les complots révolutionnaires de ces huit cents gentilshommes dont l’histoire a conservé le nom et qu’elle appelle avec une impartiale sévérité : Les chevaliers du poignard.
Le pleuple déborda dans les Tuileries cinquante jours après.
Il y venait non pas pour se venger, mais pour immoler à sa rage féroce une noble victime dont le sang répandu sur le pas de l’échafaud de la place de la Concorde, est une infamante flétrissure, que tous nous portons sur notre front, et qui jamais ne s’effacera.
N’ayant pas à nous occuper des événements qui suivirent cette date mémorable (10 août), nous dirons, comme chacun le sait, que, le 10 mai 1793, le château des Tuileries devint le siège de la Convention nationale. Sur le lieu où s’élevait la salle des machines, on construisit une salle des séances improvisées. De l’avis de Prud’homme, c’était un parallélogramme étroit qui ressemblait, non à un sanctuaire des lois, à l’aréopage de la république, mais à une vaste école de droit à l’usage de quelques juristes. L’ancienne chapelle, qui fut convertie en temple de la liberté, séparait la chambre des séances des bureaux. C’est ici que durent se passer les plus terribles et les plus désolantes journées de cette époque. Dans ces salons richement décorés, chantaient, criaient, les hommes du pouvoir dont la tête superbe ne quittait jamais le bonnet rouge qui la surmontait. Du haut de ces fenêtres à l’élégante architecture, Robespierre, Marat, Danton assistaient aux supplices que les amis de la liberté et du progrès en toutes choses faisaient subir à l’ancienne noblesse et à la nouvelle bourgeoisie honnête et fidèle, à l’auguste Louis XVI, qui, au fond d’un noir cachot, attendait, ses lèvres attachées à un crucifix, les dernières volontés de ses juges inhumains et injustes.
A la Convention succéda le conseil des anciens; le conseil des Cinq-Cents siégeait dans le manège. Le 19 février 1800, Bonaparte, alors premier consul, vint s’y installer. La majeure partie de la grande galerie était réservée au conseil d’État; Cambacérès habitait l’hôtel d’Elbeuf, situé sur la place du Carrousel. On détruisit la salle de la Convention, les bâtiments qui bordaient la cour des Suisses, la cour Royale et la cour des Princes pour ouvrir une seule et vaste cour très-spacieuse, qui servit de champ de manœuvre militaire. Le Carrousel fut aussi considérablement agrandi. En même temps, on éleva à la gloire de l’armée française, dans l’axe du pavillon de l’Horloge, un arc de triomphe sur le dessin de MM. Perrier et Fontaine. La rue qui partait du Louvre passait sous cet arc de triomphe et venait aboutir aux Tuileries. C’était une nouvelle amélioration en faveur de la jonction de ces deux magnifiques palais, où l’on peut dire, que se fait l’histoire de France.
Les fêtes du mariage de Napoléon avec Marie-Louise et celles de la naissance du roi de Rome, semblaient présager de beaux jours à ce château, spectateur impassible des terribles événements dont, grâce à Dieu, le retour ne nous est pas promis. Mais 1814 vient de sonner! Voici encore un nouveau maître que le temps sur son aile rapide porte avec lui. Le 29 janvier, l’Empereur fait ses adieux à ses chers soldats, compagnons de ses victoires, de ses luttes, de ses vives et énergiques résistances. Deux mois après, l’Impératrice et son fils, dont la diplomatie devait trop vite disposer, quittent les Tuileries, et, le 3 mai, le roi Louis XVIII s’établit à leur place. Cette résidence... provisoire dura dix mois et demi (19 mai 1815).
Rentré le 20 mai au château, Napoléon l’abandonne le 12 juin pour aller prendre le commandement de l’armée à Waterloo. Le gouvernement provisoire en confie la jouissance à Fouché, le 23, et, enfin, le 8 juillet, Louis XVIII revient tout craintif prendre possession du palais, pour y régner neuf ans et y mourir sans gloire pour lui, et sans laisser un souvenir de quelque valeur, au pays qu’il a gouverné en paresseux.
Le passage de Charles X ne fut marqué par aucun changement digne d’être constaté. Il aimait peu d’entendre parler des réparations projetées par ses architectes, si bien que pour ne pas détruire un moment sa tranquillité ordinaire, il conserva le corridor en charpente légère que son frère avait fait construire, sur la terrasse, devant le jardin, pour se rendre, sans fatiguer ses jambes faibles et malades, de ses appartements à la chapelle et à la salle de spectacle.
Le 29 juillet 1830, après quelques heures d’un siège en miniature, le peuple s’empara de nouveau du palais et y rentra en vainqueur. Quatorze mois se passèrent sans que les Tuileries fussent habitées. Louis-Philippe devenu roi par l’assentiment unanime, craignant que la mauvaise influence de ce château ne contrariât la prospérité de son règne, continua d’habiter le Palais-Royal. Ce ne fut que le 16 octobre 1831 qu’il se décida à s’y établir définitivement, après avoir fait approprier l’intérieur aux nécessités de la résidence de sa nombreuse famille.
Voici ce que dit M. Julien Lemer dans les dernières pages de sa petite brochure sur les Tuileries .
«Dans ce château des Tuileries, vécut pendant plus de 16 années, cette famille qui a laissé d’impérissables souvenirs. Trois fois elle fut éprouvée par de terribles catastrophes; elle y porta le deuil de trois de ses membres: le duc d’Orléans, la princesse Marie, grande artiste et noble cœur, la sœur du roi, madame Adélaïde, jusqu’au jour où le reflux de la révolution la rejeta du palais où le flux l’avait apportée. Le 24 février 1848, les fils du peuple de 1830, les petits-fils du peuple du 10 août entrèrent aux Tuileries par le Carrousel, au moment où le roi en sortait par le jardin.
» Des scènes analogues à celles de 1830 se passèrent dans l’intérieur. Toutefois, on crut un instant avoir à craindre pour la conservation du monument, et, pour le sauver de toute mutilation, on eut l’idée de le consacrer à un HOSPICE DES INVALIDES CIVILS. Le bruit se répandit dans Paris qu’une véritable armée d’occupation s’était emparée du château et menaçait la tranquillité publique. Trois cents hommes armés y avaient en effet établi leur résidence; mais, loin de refuser d’en sortir, ils demandaient qu’un pouvoir régulier les déchargeât du dépôt dont ils avaient pris la garde; ils défilèrent en bon ordre devant l’état-major de la garde nationale qui s’installa à leur place.
» L’état-major de la garde nationale occupa à peu près seul les Tuileries pendant environ quatre années. En 1849, on fit dans les grandes salles l’exposition de peinture; mais de nombreuses réclamations s’élevèrent contre le choix de ces salons mal éclairés et distribués d’une façon peu commode pour la circulation d’un nombreux public. Un instant il fut question d’y transférer la bibliothèque de la rue Richelieu, mais le château était destiné à redevenir encore le théâtre des pompes officielles et des splendeurs gouvernementales.»
Le 25 janvier 1852, le président de la République inaugura le palais par un bal donné dans la salle des maréchaux; deux mois plus tard, le 29 mars, il y fit l’ouverture de la session du Corps législatif; enfin, au mois de mai, à l’occasion de la distribution des aigles, il y donna une grande fête dans cette jolie salle de spectacle, qui a été témoin du couronnement de Voltaire et de la première représentation du Barbier de Séville de Beaumarchais.
Depuis 1852, les fêtes de la cour se sont multipliées au château des Tuileries, résidence habituelle de l’Empereur, de l’Impératrice et du jeune Prince Impérial. Les pièces du premier étage que nous avons été admis à l’honneur de visiter, sont aménagées avec un luxe sévère du plus bel effet et qui imposerait par lui-même un sentiment de respect, si, en entrant dans ses admirables et vastes salles, on ne se rappelait tous les événements que nous venons de retracer au courant de la plume.