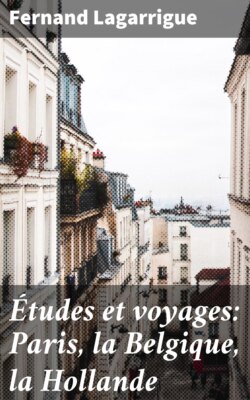Читать книгу Études et voyages: Paris, la Belgique, la Hollande - Fernand Lagarrigue - Страница 5
LE LOUVRE.
ОглавлениеAprès avoir sommairement parcouru l’histoire si variée des Tuileries, entrons dans le vieux palais du Louvre.
Bien que le nom de Louvre ait été officiellement prononcé pour la première fois en 1204, le palais qui, auparavant n’était qu’un château-fort, aux fortifications imprenables, était, dès le XIIIe siècle très-ancien, puisqu’on commença à s’occuper vers cette époque de le reconstruire. La fameuse et grosse tour du Louvre fut élevée sous le règne de Philippe-Auguste, selon M. Vitet, au milieu d’une cour carrée, qui existe encore, et sur laquelle nous avons souvent admiré l’ensemble gigantesque de ce magnifique monument.
Le Louvre, après la mort de Philippe-Auguste, fut abandonné jusqu’à saint Louis. Tout en embellissant le palais de la Cité et le château de Vincennes, Louis IX construisit dans l’aile occidentale du Louvre une vaste galerie à laquelle il donna son nom. Charles V remplaça la forteresse par un palais bien disposé ; rien ne fut changé à l’ancien périmètre, mais il l’exauça de cinq toises environ; il perça des fenêtres et y ajouta de nouvelles tours élevées et gracieuses. Raymond du Temple, architecte distingué, construisit sur l’ordre de Charles V et du côté d’une façade intérieure, un escalier en vis; les greniers, les chambres de dégagements ajoutés au palais du Louvre, furent reliés aux écuries et aux maisons de plaisance par des jardins un peu resserrés, mais qui faisaient un contraste avec les sombres murailles restées debout du vieux château des Carlovingiens. — C’est aux Tournelles, comme chacun sait, que vécurent, pendant leur passage à Paris, Louis XI, Charles VII, Louis XII et François Ier, à qui nous devons le Louvre moderne, et l’exécution des plans, peut-être confus, qu’il laissa en mourant à son fils Henri II.
A la nouvelle de l’arrivée prochaine de Charles-Quint dans la capitale de la France, l’idée vint à Francois Ier d’abattre et de réédifier le palais de ses ancêtres. Quelques heures d’observation lui suffirent pour comprendre que ce palais tomberait bientôt en ruine, et qu’il ne fallait pas laisser empirer la situation. Le plan de Serlio fut rejeté et celui de Pierre Lescot eut la préférence. Les travaux commencèrent en 1541 et, par respect pour Philippe-Auguste, on conserva sans y rien changer, les solides fondements sur lesquels repose encore de nos jours, la partie du Louvre qui s’étend du côté du pavillon de l’Horloge au Musée.
A la mort de François 1er, en 1547, les constructions sortaient à peine de terre, et le projet n’était pas définitivement arrêté. Sous Henri II, l’architecte habile termina l’aile de l’Ouest et conduisit jusqu’aux deux tiers celle du Midi. — Catherine de Médicis, ayant résolu d’abandonner le triste et incommode château des bords de la Seine, vint habiter la partie de l’ancien Louvre que la pioche des ouvriers n’avait pas eu le temps de démolir. L’aile du Nord et celle de l’Est, encore debout, obtinrent quelques légères réparations. On joignit le château-fort aux galeries commencées par François Ier et son fils, et la reine-mère campa deux ans dans cette étrange demeure. Voulant se donner un palais digne d’elle et de son nom, elle demanda à l’Italie un architecte que Sauvai appelle Chambiche, pour lui confier l’exécution du bâtiment qui s’avance vers le quai.
Charles IX et Henri III ne firent rien de remarquable et passèrent sur le trône sans avoir même le temps de modifier les irrégularités de ce qui avait été fait précédemment. Il était réservé au grand Henri IV. de changer toutes les dispositions défectueuses que des artistes sans expérience ou incapables de concevoir un tel projet avaient adoptées du consentement unanime.
Durcerceau, homme d’un savoir profond, fut choisi par le roi pour doter la ville de Paris d’un palais sans rival. Toujours fidèle aux dieux qu’il adorait, celui-ci ne tint aucun compte des plans de son prédécesseur et il s’empressa de substituer aux fines colonnettes les lourds et épais pilastres corinthiens du pavillon de Flore et de la galerie qui s’étend de ce pavillon au guichet de Lesdiguières. Ayant quitté brusquement la France à quelque temps de là, le peintre du roi, Etienne Dupeyrac, acquit sa succession, et puis ensuite, ce fut Thibault Métézéau.
C’est à Dupeyrac et Métézéau que nous devons la galerie qui part du guichet du Carroussel et finit au Musée. Nons n’y trouvons rien de bien digne d’être décrit.
Henri IV fut assez heureux pour voir cette grande construction terminée. Mais néanmoins, malgré les bonnes intentions de chacun, l’ensemble ne présentait pas un tout homogène et uniforme. Les styles architecturaux étaient indifféremment mêlés. Lemercier, attaché au service du cardinal de Richelieu, démolit sans pitié la façade du nord et de l’est pour mettre à nu l’œuvre de Pierre Lescot, car, à cette époque, tout le monde parlait avec respect de ses connaissances. Entreprenant, mais d’une rare inconstance, Lemercier présenta un dessin à Richelieu par lequel il s’appuyait surtout sur les réparations et les changements à faire. Son projet manquait d’originalité et tombait dans le commun.
Passons, sans nous y arrêter, sur les années qui nous séparent de l’avènement de Louis XIV, ce glorieux représentant de la monarchie, et arrivons aux architectes Louis Devaux et François Debay, qui, en 1660, furent chargés de réaliser la pensée toujours présente à l’esprit clairvoyant du roi.
La tour de Charles V disparut, et, sur l’emplacement de l’hôtel du connétable de Bourbon, sur celui des hôtels d’Aumont, de Créquy, de Longueville, de la Force et de Villequiers, le peuple salua les premières assises de la façade qui longe la Seine.
Vis-à-vis Saint-Germain-l’Auxerrois, on éleva cette splendide colonnade, œuvre enviée par toutes les capitales rivales, et due à la féconde imagination du médecin Claude Perrault. Les colonnes appartiennent à l’ordre corinthien; la façade a 167 mètres sur 28; la cymaise du fronton se compose de deux pierres uniques de 18 mètres de long sur 2m 50 de large; le bas-relief du fronton contient quatorze figures de 3 mètres de proportion, représentant Minerve, la Victoire et les Muses chantant les louanges de Louis XIV. Le bas-relief qu’on remarque sur la porte du milieu est de Cartelier; c’est une Renommée sur un char distribuant des couronnes.
Mais, dégoûté du Louvre par les interminables lenteurs de ses architectes, Louis XIV s’occupa désormais spécialement de Versailles, où, du reste, il avait toujours eu le projet de fixer sa résidence, car ses nombreuses amours avaient besoin d’un asile sûr et tranquille pour captiver son impatience naturelle et la bouillante précipitation dont déjà il avait donné des preuves en maintes circonstances. La colonnade terminée, il fallait cependant exhausser la façade de la même aile qui donne sur la cour, pour que les deux côtés fussent en harmonie et d’un coup d’œil satisfaisant. Ces améliorations terminées, les ouvriers rentrèrent dans leurs pénates, et le roi ne revint que très-rarement à Paris. Après plus de cinquante années, les travaux furent repris en février 1755. Pour mettre à niveau les façades du midi, de l’est et du nord, l’architecte Gabriel compléta celle du bord de l’eau et termina les trois étages que Perrault avait élevés sur la cour. Louis XVI aurait sans doute marqué son passage au Louvre si la Révolution ne l’avait forcé à renoncer à son projet; mais Napoléon 1er, à peine au pouvoir, décréta l’achèvement définitif de ce palais et sa réunion aux Tuileries. Les deux plus célèbres artistes de cette époque, Percier et Fontaine, chargés de cette tâche aussi importante que difficile, se mirent à l’œuvre en 1803, quoique, selon eux, dit M. L. Vitet, pour être bien mariés, ces deux palais avaient absolument besoin de faire ménage à part.
Jusqu’en 1814, les constructions marchèrent lentement. La galerie de la rue de Rivoli fut cependant poussée avec activité. De ce côté, elle s’étendit du pavillon de Marsan jusqu’à la rue de Rohan; mais les travaux projetés vis-à-vis le Musée n’avaient leur place marquée que par un amas de ruines.
La Restauration et Charles X laissèrent l’extérieur tel qu’ils l’avaient trouvé. Charles X se contenta d’orner l’intérieur de riches décorations, créa le Musée qui porte encore son nom, et bâtit deux mesquines travées au septentrion.
Le gouvernement de 1830 arrivait avec l’intention bien arrêtée d’achever cette gigantesque entreprise. Mais le projet de Louis-Philippe ne se réalisa point, et les hommes de février 1848, qui, eux aussi, voulaient s’essayer vers le même but afin de donner à la république un Palais du peuple, ne laissèrent ici, comme en tout autre endroit, de souvenirs durables. 11 était réservé à l’empereur Napoléon III, qui veut rendre son règne aussi immortel que le souvenir de son dévouement pour la France en des temps difficiles; il était réservé, dis-je, au souverain qu’une pensée de progrès dirige sans cesse, et qui restera toujours présent à notre mémoire, de réunir le Louvre aux Tuileries, et de donner aux constructions commencées par grand nombre de ses prédécesseurs, un relief et une élégance qui en font d’admirables chefs - d’oeuvre, dont chaque pierre restera dans les siècles futurs pour consacrer la gloire de son règne et l’incontestable supériorité artistique d’une époque que les immobiles et les retardataires décrient parce qu’il ne leur est pas permis de la comprendre.
Nous garderons le silence le plus complet sur le nouveau Louvre; laissons parler M. Théophile Gautier, passé maître dans l’art de la critique et de l’appréciation consciencieuse:
«Derrière l’immense enchevêtrement d’échafaudages dont la complication et la hauteur font penser à une Babel réussie, dit-il, le nouveau Louvre s’élève avec une rapidité qui tient de l’enchantement . Déjà, à travers les poutres et les escaliers montés et descendus par un peuple de travailleurs, on devine vaguement les profils du gigantesque édifice, plus grand que les palais tant vantés de Ninive, de Palmyre et de Rome.
» Ce qui semblait impossible s’accomplit sous l’impulsion toute-puissante d’une volonté suprême; l’encre de Chine est à peine séchée sur le plan de l’architecte, que les pierres se taillent, se mettent en place et réalisent un rêve que l’on a regardé longtemps comme chimérique, à moins de consacrer des siècles à son exécution. Un coin du nouveau Louvre est fini!
» Là commence le Louvre de Napoléon III, comme au pavillon de Lesdiguières finit le Louvre de Henri II. Une autre architecture succède aux frontons alternativement cintrés et triangulaires de Louis XIV. On n’a pas cherché à adoucir la transition, mais plutôt à la faire oublier par un contraste brusque qui occupe et distrait l’œil. Une raison de parallélisme motivait d’ailleurs ce pavillon, dont le pendant se trouve de l’autre côté de la place, à une assez grande distance, toutefois, pour qu’il suffise de la symétrie générale sans reproduction identique des détails.
» La variété dans l’unité est le caractère de toute bonne architecture. Le promeneur, dont le regard guette sur la ligne opposée des toits du Louvre un équivalent de l’élégant clocheton du pavillon Lesdiguières, est satisfait, et, s’il approche, il n’a pas l’ennui de rencontrer une contre-partie et en quelque sorte un surmoulage d’un objet déjà vu.
» Un comble écimé, surmonté d’un clocheton à jour, côtoyé de deux cheminées monumentales, historié d’une N couronnée et dorée, coiffe le pavillon, rompt heureusement la ligne horizontale du toit, et, sur son autre face, fait perspective au bout de la rue de Richelieu.
» Dans le fronton sont couchées, affrontées à l’écusson de l’Empire, deux statues allégoriques ailées, représentant l’Intelligence et le Travail, dont l’une défoule le plan du Louvre et l’autre tient une corne d’abondance. Auprès des deux figures sont placés divers attributs relatifs à l’architecture et à la sculpture, tels que ciseaux, maillets, équerres et aplombs.
» Plus bas, en dehors du groupe, assise dans ses ailes sur la volute d’un œil-de-bœuf qui coupe en deux le fronton de l’étage inférieur, une autre statue, d’un aspect noble et tranquille, s’appuie sur un sceptre et forme, avec les deux figures supérieures, une sorte de trinité sculpturée: c’est la France.
» Le mur où elle s’adosse est semé d’N et d’abeilles d’or. Les chapiteaux composites des colonnes et des zones d’arabesques qui marquent les étages répètent, parmi les acanthes et les entrelacements, le chiffre impérial, motif heureux, habilement imité de la façade du bord de l’eau, où l’H s’entremêle aux inépuisables fantaisies de la plus délicate ornementation.
» Napoléon III signe cette page du Louvre comme Henri II avait signé l’autre. Ce n’est pas la première fois, d’ailleurs, que le glorieux monogramme s’inscrit sur le monument.
» Trois ordres superposés s’appliquent à la façade; le premier, de piliers toscans à bossage en pointe de diamants; le second, de piliers corinthiens cannelés; le troisième, de colonnes composites. Au-dessus de l’arcade de la baie qui mène de la place du Carrousel à la rue de Richelieu, une tablette de marbre noir porte, écrits en lettres d’or, ces mots: Pavillon de Rohan.
» Un balcon de serrurerie capricieusement ouvragé, que Biscornette ne désavouerait pas, règne devant la fenêtre somptueusement encadrée du premier étage.
» Dans les tympans de l’arcade s’arrangent gracieusement deux nymphes, Victoires ou Renommées, d’une élégance qui rappelle Jean Goujon; des guirlandes de fleurs et de fruits, des trophées, des groupes de petits génies, profitant de chaque espace vide, complètent un ensemble de décorations auquel l’on pourrait peut-être reprocher un peu trop de richesse, si l’intention de l’architecte et des artistes n’avait été de faire un bijou de ce morceau, qui devait être découvert le premier.
» Quatre mois ont suffi pour bâtir, sculpter et ciseler ce délicieux pavillon, et, certes, la précipitation ne s’est fait sentir nulle part; le défaut serait plutôt l’extrême fini.
» Les trois statues du fronton, dues au ciseau de M. Dieboldt, ont la sérénité douce et gracieuse qui caractérise le talent de cet artiste. Leurs poses nobles et naturelles s’accommodent, sans effort, aux exigences de l’architecture. Elles sont à la fois vraies et décoratives, qualités difficiles à réunir.
» M. Dieboldt a fait aussi deux groupes d’enfant et d’attributs. Les figures des tympans de l’arcade du rez-de-chaussée, de M. Poitevin, sont très-jolies; si le temps avait passé son pouce dessus et les avait dorées de sa rouille, elles s’encastreraient aisément dans quelque portail de la renaissance.
» Maintenant, pourquoi ne nommerions-nous pas les ornemanistes qui ont exécuté ces fines arabesques, ces chapiteaux délicatement fouillés, ces guirlandes de fruits, ces groupes d’enfants?
» Il y a quelques jours, devant la merveilleuse façade en ruine du palais d’Othon Henri, à Heidelberg, nous cherchions en vain les noms des artistes inconnus qui ont élevé ce rêve de fée, qui semble aujourd’hui, au milieu des nappes de lierre et des touffes de fleurs sauvages, une création spontanée de la solitude; et nous regrettions de ne pouvoir suspendre notre admiration à quelque mémoire humble ou illustre.
» Aussi dirons-nous que les sculptures d’ornement de l’ordre du premier étage ont été faites par M. Knecht, celles de l’ordre composite du second étage par M. Hurpin; que MM. Désiré Hayon et Chambard ont sculpté les trophées et les panoplies, et MM. Carpaux et Gruyère, les deux groupes d’enfants représentant l’un la Navigation, l’autre l’Agriculture.
» L’aspect du pavillon est gai, riche, heureux. Sa blancheur charme et surprend. L’on n’est pas accoutumé à voir des chefs-d’œuvre neufs, et l’on ne réfléchit pas que les monuments admirés n’ont pas toujours eu la brune patine des siècles.
» Puisque nous voilà sur la place du Carrousel, essayons de deviner, à travers la forêt touffue des échafaudages, quelle sera la forme de la construction achevée. Dès à présent on peut la comprendre, tellement les travaux ont été menés avec activité.
» M. Visconti, saisi par la mort au début de ce gigantesque travail, le plus grand dont un architecte ait été chargé, n’a eu que le temps de tracer le plan d’ensemble, d’assurer les lignes générales.
» A lui l’honneur de la conception première; à M. Lefuel, son continuateur, le mérite des améliorations successives amenées par une étude approfondie, l’appropriation plus exacte des parties de l’édifice à leurs futurs emplois, l’invention perpétuelle des détails, le choix judicieux des ornements, toute une création dans la création même de Visconti.
» Le terrain sur lequel ont été bâtis, à plusieurs reprises et à diverses époques, les différents tronçons du Louvre, qu’il s’agit de relier ensemble et de rattacher aux Tuileries, offre de sensibles différences de niveau, dont les anciens constructeurs, insoucieux de l’effet général, ne se sont pas préoccupés.
» Il fallait, à tout prix, atténuer et masquer ces inégalités fâcheuses. C’est ce qu’on a fait avec beaucoup d’art, en rompant les lignes architecturales et en divisant le terrain en grandes proportions planes ou déclives.
» Ainsi, des Tuileries aux pavillons Rohan et Lesdiguières, ou, pour parler plus exactement, jusqu’aux angles des bâtiments encore enveloppés de charpentes, qui font saillie sur les espaces vagues, autrefois occupés par les rues du Doyenné, des Orties, de l’hôtel de Nantes et la rue de Rohan, le terrain descendra par une pente régulière et parfaitement de plein jalon, puis s’aplanira entre les nouvelles constructions, pour se relever du côté du vieux Louvre, qui fait face à l’arc de triomphe du Carrousel.
» L’espace vide sera rempli par deux squares entourés de grilles, soutenues par des hermès sculptés, et contenant chacun, au milieu de feuillages et de verdures, une statue équestre: l’une de Louis XIV, l’autre de Napoléon Ier. Une voie pour les piétons et les voitures, et traversant les deux pavillons centraux, les séparera. Vues du Carrousel, ces squares ne sembleront former qu’une seule masse verte. Ce sera pour l’œil un repos, pour l’architecture un repoussoir favorable, et aussi un moyen de dissimuler les défauts de parallélisme.
» Quelques arbres, mêlés aux monuments, en varient heureusement les lignes, et l’on a pu remarquer l’effet pittoresque que produisent, de l’autre côté de la rivière, les peupliers et les saules des bains Vigier, sur l’aile du Louvre qui aboutit au pavillon de Flore. Cette place s’appellera la place Napoléon III.
» Les bâtiments qui doivent l’entourer sont déjà montés jusqu’aux combles, et dans un état assez avancé pour juger de l’aspect qu’ils présenteront.
» Six pavillons, d’un style analogue à celui du pavillon central de la cour de l’ancien Louvre, trois à droite, trois à gauche, sont reliés entre eux par des corps de bâtiment, d’une architecture imitée de la face extérieure de cette même cour, qu’on apercevra au fond, au-delà des squares. Des surfaces tranquilles et sobres d’ornements, ménagées sur les parois, laissent leur valeur à la richesse de la corniche et à la sculpture des pavillons.
» Une galerie, formant terrasse de plain-pied avec le premier étage, et soutenue par des colonnes corinthiennes, règne tout autour de la place en passant à travers le rez-de-chaussée des pavillons, depuis l’aile de la rue de Rivoli jusqu’à l’aile du bord de l’eau. Sous ces arcades, les promeneurs ou les passants pourront s’abriter de la pluie et du soleil, et, par les temps les plus mauvais, franchir ce vaste espace à pied sec.
» Cette galerie ou ce portique, car c’est plutôt son nom, n’a d’égal comme grandeur que la colonnade du Bernin, autour de la place de Saint-Pierre de Rome. Il s’applique, en saillie, aux façades intermédiaires des six pavillons, et soutient, par sa projection bien accusée, des lignes qui, sans cela, eussent pu paraître pauvres.
» Au-dessus du chapiteau de chaque colonne s’élève une console à demi engagée dans la balustrade, et destinée à servir de socle à la statue de quelque nomme illustre ou utile, ce qui fera une sorte de panathénée des gloires de la France. Cette splendide décoration aura pour fond les parties les moins ornées de l’architecture, combinaison heureuse, qui évite à la fois la nudité et la surcharge.
» Les deux pavillons, faisant symétrie avec celui du vieux Louvre, seront ornés, à leur étage supérieur, de quatre groupes couplés de cariatides colossales soutenant un fronton sculpté. Leurs combles s’arrondiront en dôme à quatre pans, tandis que les toits des autres se couperont à angles droits.
» Une galerie à balustrade, entrecoupée de trophées et de groupes, régnera tout autour et formera la ligne extrême des corps de bâtiment. Les toits en retraite et les cheminées ne devront guère s’apercevoir d’en bas.
» Cette même partie contiendra, outre les salles pour l’exposition de peinture et de sculpture, la salle des Etats, des logements d’officiers de la couronne, un manège, des écuries et autres dépendances.
» L’autre partie sera occupée par le ministère d’Etat, le ministère de l’Intérieur, la bibliothèque du Louvre, reportée de l’endroit où elle est maintenant au pavillon central, dont le second étage sera consacré, d’après la bienveillante volonté de l’Empereur, à une exposition perpétuelle de tableaux et d’objets d’art, ayant pour but d’en faciliter la vente, et de mettre le public et les artistes en contact.
» En écrivant cet article, nous songions à la longue liste de rois, qui ont mis la main à ce Louvre interminable que nous verrons fini: François Ier, Henri II, Henri III, Catherine de Médicis, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Pierre Lescot, Ducerceau, Cambiche, Dupérac, Lemercier, Lebrun, Levau, Claude Perrault, MM. Mercier et Fontaine, toute une dynastie de talents; et nous nous disions avec orgueil qu’un seul règne le terminerait.»
La barrière du Trône et celle de l’Etoile, séparées par une distance de près de 8 kilom., sont reliées l’une à l’autre par les rues de Rivoli et du Faubourg Saint-Antoine. La rue de Rivoli, jusqu’en 1851, partait de la place de la Concorde pour finir à la rue de l’Echelle. C’est sur ce terrain qu’avant 1802 on voyait encore les anciennes écuries du roi, la cour du Manège et les couvents des Capucins, des Feuillants et de l’Assomption. En 1851, on la continua jusqu’à la place Birague, pour livrer cette importante partie de cette large voie cinq ans après.
La régularité des lignes a fait disparaître les rues Saint-Nicaise, de Chartres, Saint-Thomas-du-Louvre, Froidmanteau, Pierre Lescot. Les monuments que l’on rencontre à son extrémité et quelques pas avant de prendre le nom du quartier qu’elle traverse, sont la caserne Napoléon, l’Hôtel-de-Ville, la Tour Saint-Jacques de la Boucherie. Mais passons à la rue de Richelieu.
Après que Richelieu se fut installé dans son palais, il fit démolir le mur de Paris jusqu’à la rue du Rempart. La porte Saint-Honoré abattue se retrouva quelques mois après à la hauteur de la rue de la Concorde; c’est sur l’emplacement de cette porte détruite qu’il ouvrit une rue nouvelle. Sous le régime révolutionnaire, la rue Richelieu changea son nom contre celui de rue de la Loi. Après l’avénement de Napoléon, les principaux théâtres: les Français, l’Opéra, Feydeau et Favart habitèrent ce quartier aristocratique. Il avait encore un établissement très en réputation et qui a augmenté sa célébrité : je veux parler de la maison de jeu de Frascati.
La fontaine Molière, élevée en 1844, vis-à-vis la petite chambre où notre grand comique est mort le 17 février 1673, est peu éloignée de la Bibliothèque impériale. Cette fontaine a été un hommage tardif rendu au génie le plus vraiment français que nous puissions revendiquer, et cela sur l’idée d’un des plus merveilleux interprètes de ses œuvres.
Voici ce qu’en raconte M. Antony Béraud:
«Une de ces pensées qui ne viennent qu’aux cœurs vraiment artistes, un de ces faits qui glorifient le nom auquel ils se rattachent, sont un titre qui, à défaut de tous autres, suffirait pour honorer à jamais la mémoire de Régnier: nous voulons parler de l’hommage qu’à sa voix la nation a enfin rendu à Molière. Voici dans quelle circonstance, toute simple et toute naturelle, mais qui, par cette raison même, n’est pas sans quelque intérêt, vint à éclore dans l’esprit de Régnier celte pensée d’un monument à Molière.
Régnier et Provost rentraient chez eux après une répétition. Arrivés au carrefour formé par la rue de Richelieu, la rue Traversière (aujourd’hui rue de la Fontaine-Molière), et celles du Hasard et Villedo, Régnier remarqua qu’on avait commencé à démolir une maison récemment acquise par la ville de Paris, rue de Richelieu. Sur cet emplacement resté libre, il était question d’ériger une fontaine qui remplacerait celle de la rue Traversière.
— Sais-tu, dit Régnier à Provost, quelle statue on va placer sur la nouvelle fontaine?
— Non.
— Eh bien! c’est une nymphe. Depuis longtemps l’on s’étonne et l’on se plaint que la France n’ait pas élevé un monument à l’immortel génie qui, aux yeux de l’Europe, est notre plus grande gloire littéraire. Jamais emplacement pourrait-il être mieux choisi pour lui ériger une statue que celui-ci, dans le double voisinage de la maison où il est mort, et du Théâtre-Français où il revit tous les soirs? Les anciens avaient coutume de placer les statues de leurs grands hommes auprès des monuments d’utilité publique. C’est ce qu’on a fait récemment pour Cuvier: pourquoi n’en ferait-on pas autant pour Molière?
— Ton idée est magnifique! s’écria Provost, et il faut la mettre sur-le-champ à exécution. Écris à M. de Rambuteau, et envoie-lui tout bonnement ta lettre par la poste.
— Ma lettre sera comme non avenue... on ne me répondra pas.
— On te répondra, je le parie! Ecris, te dis-je, au préfet de la Seine.
Régnier, encouragé par son ami, écrivit dès le soir même, en indiquant, comme moyen d’exécution, une souscription nationale... Huit jours après, le 14 mars 1838, il recevait la visite de l’architecte Visconti et une réponse de M. de Rambuteau:
«Je m’associe de vœu et d’intention, écrivait le préfet, à un pareil projet, et, autant que personne du monde, je me réjouirais de voir la ville de Paris rendre enfin à Molière le même hommage que d’autres villes de France ont déjà rendu à Montaigne, à Pascal, à Corneille, à Racine, à Bossuet et à Fénelon. Aussi n’hésiterai-je pas à en faire l’objet d’une proposition au conseil municipal, avec la confiance que les hommes honorables qui y siègent, fidèles interprètes des sympathies de leurs concitoyens, accueilleront favorablement l’idée de payer un juste tribut d’admiration à l’un des plus beaux génies de la France, et, peut-être, à la plus grande des illustrations parisiennes.»
Inutile de dire que le projet reçut l’assentiment unanime et que, grâce aux talents réunis de Visconti, de Seurre et de Pradier, cette statue de Molière est un véritable chef-d’œuvre digne de celui dont il nous montre les traits et l’agréable physionomie.
C’est le roi Jean qui a fondé la Bibliothèque impériale. Charles V réunit 910 volumes et les fit placer dans la tour du Louvre, où il allait quelquefois lui-même travailler. Un riche Anglais, le duc de Bedford, en devint acquéreur sous Charles VI, et elle fut transportée à Londres par ses soins. Louis XI, Charles VIII et Louis XII s’occupèrent très-sérieusement de payer à leurs concitoyens la dette que leurs prédécesseurs avaient laissée, et malgré les divers déplacements que la Bibliothèque dut subir, avant François Ier on comptait plus de 25,000 volumes. Ce dernier l’enrichit de manuscrits grecs et orientaux. Henri IV ajouta à cette précieuse collection celle que Catherine de Médicis lui avait laissée. Du Collége de Clermont, on la transféra rue de la Harpe. Louis XIII rendit alors l’ordonnance qui obligeait tous les libraires à déposer deux exemplaires des ouvrages publiés par eux. Elle posséda bientôt 11,000 imprimés et 6,000 manuscrits de plus qu’auparavant. Le ministre de Louis XIV, Colbert, la plaça dans une maison voisine de son hôtel, situé rue Vivienne. Mais en 1721, les bibliothèques de Dupuy, de Baluze, Gaignères, de Brienne, du comte de Béthune, de Loménie, de Dufresne et de Fouquet, ayant rendu le local insuffisant (car elle possédait 70,000 volumes), le régent l’établit dans son local actuel, grande dépendance du palais Mazarin. D’après M. Théophile Lavallée, si expert en ces matières, le total de ses richesses est inconnu et s’élève peut-être à un million de livres imprimés, à 80,000 manuscrits, à 1,500,000 estampes, à 100,000 médailles, outre une multitude d’antiquités et d’objets précieux, provenant des trésors de Saint-Denis, de Sainte-Geneviève, de Saint-Germain-des-Prés, etc.
Un large escalier de pierre, orné d’inscriptions antiques en relief de la muraille, conduit aux principales salles. La Bibliothèque est divisée en quatre départements: les livres imprimés, les manuscrits, les médailles et les estampes, cartes et plans.
Dans le salon, on trouve une statue de Louis XVIII, de peu de valeur, et que le Parnasse français en bronze, donné par Titon du Tillet, laisse bien loin après lui. Ce groupe représente l’image réduite de nos principaux écrivains, assis sur le mont sacré, chacun à la place qu’il occupe d’après l’appréciation impartiale de la postérité. On voit aussi, dans cette galerie transversale, l’imitation réduite des pyramides de Djizzeh, les bustes de Jérôme et de Paul Bignon qui, nous a-t-on dit, étaient bibliothécaires de leur vivant, et le bassin où fut baptisé Clovis.
Parmi les bouquins précieux (cette expression est ici prise en bonne part) que possède la bibliothèque, on cite un psautier imprimé à Mayence six ans après la découverte de l’imprimerie (1456), et la Bible de Mazarin, portant le même millésime.
Parmi les nombreux manuscrits, on trouve divers papyrus intéressants; les tablettes de cire, état des dépenses sous Philippe le Bel; le Télémaque, écrit de la main de Fénelon; un Koran; l’original des Pensées de Pascal, et la liste des victimes de Robespierre, catalogue de trois cents pages, que nous n’avons certainement pas eu le courage de parcourir.
C’est au rez-de-chaussée qu’on remarque le monument astronomique connu sous le nom de zodiaque de Dendérah.
Avant de nous diriger d’un autre côté, puisque la Comédie-Française s’est si bien recommandée à notre attention par la louable spontanéité d’un de ses pensionnaires, lisons sur sa façade, et en parcourant ses mille corridors, quelques pages de son histoire.
En 1791, les Variétés amusantes, dont nous avons eu l’occasion de parler quelques pages plus haut (PALAIS-ROYAL), devinrent le théâtre de la Liberté, le théâtre de la République en 1793; en 1799, le Théâtre-Français y fut enfin transféré. Les acteurs qui composaient cette excellente troupe avaient appartenu aux compagnies qui desservaient les scènes de la rue de l’Ancienne-Comédie, Guénégaud, de l’ancien hôtel de Condé, Feydeau, etc. On remarquait au commencement de ce siècle Fleury, Saint-Prix, Michot, Baptiste aîné, Baptiste cadet, qui se sont retirés de 1818 à 1828, et Talma, mort, dans toute la splendeur de ce talent extraordinaire qui recommande son nom à la postérité, le 19 octobre 1826. Bien que le passé nous laisse des vides à jamais regrettables, car nous sommes obligé de reconnaître notre impuissance à les combler, on peut citer parmi les artistes qui desservent ce théâtre, certaines intelligences qui tiennent encore sur la tête de l’art tragique et dramatique une belle et riche couronne. A leur tête, n’oublions pas Samson, comique fin, judicieux; Provost, financier, au jeu nerveux, naturel; Geffroy, correct, mais trop recherché peut-être; Régnier, ce comédien d’une verve qui ne tarit pas, gai sans tomber dans la plaisanterie de mauvais goût; Monrose, dans l’esprit duquel la réputation de son père semble laisser quelques déceptions; Mlle Augustine Brohan, cette femme aussi charmante que belle, aussi spirituelle au théâtre que dans ses proverbes ou dans les articles légers qu’elle a écrits; sa sœur, Madeleine, jeune, intelligente, à la diction pure, élégante et facile; Mme Arnould-Plessy, l’indispensable interprète de Marivaux et de tous les auteurs amoureux, malins, qui ont accès à la Comédie-Française.
Nous passons sous silence les diverses impressions que nous avons éprouvées en assistant aux représentations des théâtres impériaux et des nombreuses troupes parisiennes. Cependant, nous devons engager tous ceux qui, comme nous, étrangers à Paris, vont de temps en temps prendre leurs vacances dans la capitale, à ne pas manquer leurs visites aux artistes de talent qu’ici chaque scène peut montrer avec un orgueil facile à comprendre et à pardonner. Les plaisirs les moins frivoles sont, sans contredit, ceux auxquels on participe en assistant à une représentation théâtrale. Non-seulement le cœur et l’instruction y trouvent leur compte, mais en écoutant les ouvrages des auteurs célèbres dans lesquels il est rare de ne pas trouver quelques conseils dont on puisse faire profit, on évite bien des déceptions dans le monde, on apprend d’utiles leçons qui, mises en pratique, ne laissent pas sans nous être utiles.
A Paris, surtout, il est toujours dangereux de passer ses soirées dans le désœuvrement et l’isolement. Notre principe, à nous, est d’utiliser le mieux qu’il nous est possible les heures qui suivent les occupations de la journée. Et certes ne vaut-il pas mieux applaudir Meyerbeer ou Rossini, Molière ou Sedaine, MM. Octave Feuillet, Alexandre Dumas fils ou Emile Augier et Jules Sandeau, que toutes ces ballerines qui, dans les bals ou ailleurs, étalent des charmes frelatés pour nous séduire et quelquefois nous perdre sans retour!.....
Revenons sur nos pas; descendons la rue de Rivoli: voici la place de la Concorde.
Après qu’elle eut fait construire son petit château des Tuileries, Marie de Médicis ordonna qu’une promenade ombragée par une triple rangée d’arbres fut artistement dessinée devant sa nouvelle demeure. On l’appela le Cours-la-Reine, qui devint bientôt le rendez-vous des courtisans et des dames d’honneur. En 1670, tous les terrains qui étaient en culture jusqu’au faubourg Saint-Honoré, une fois acquis par l’État, entrèrent dans les clôtures de ce parc grandiose; mais on leur laissa leur aspect pittoresque, leurs gazons inégaux, les petits sentiers qui allaient se perdre dans les parties les moins fréquentées. Comme elle n’était ouverte qu’aux favoris de Louis XIV, cette promenade, qui occupait une si grande étendue, manquait d’animation, et il était rare même d’y rencontrer quelques rêveurs attirés vers elle par la bienfaisante fraîcheur de ses ombrages, la solitude de ses allées, le gracieux et original effet de ses sites. Louis XV voulut, en 1748, qu’on éleva sa statue votée, pour la forme, par la ville de Paris «sur l’emplacement situé entre le fossé qui termine le jardin des Tuileries, l’ancienne porte et le faubourg Saint-Honoré, les allées de l’ancien et du nouveau Cours et le quai qui borde la Seine. Cette statue, modelée par Bouchardon et fondue d’un seul jet, avait quatorze pieds de proportion; elle reposait sur un piédestal en marbre blanc de vingt-et-un pieds de haut sur quatorze de long et huit de large; à ses angles, on voyait quatre figures colossales en bronze, représentant la Force, la Paix, la Prudence et la Justice. Pigale avait exécuté les fantaisies et les accessoires de ce piédestal. — La place n’avait pu être encore inaugurée quand fut célébré le mariage du Dauphin avec Marie-Antoinette, et déjà son martyrologe était ouvert: cent trente-huit personnes y périrent écrasées par la foule.
Neuf années plus tard, la Révolution arriva, et ce malheur, inopinément survenu au milieu de cette place en un jour de réjouissances publiques, devait se perpétuer longtemps encore en des jours d’opprobre et de deuil pour la, France entière.
Au 14 juillet, les gardes-françaises en chassèrent les troupes royales qui venaient d’y camper; le 10 août, les derniers Suisses échappés comme par miracle des Tuileries, s’y firent courageusement tuer en combattant pour le droit, la justice et l’honneur. Le lendemain, tout fut converti en un immense et horrible massacre. La statue de Louis XV roula dans le sang des amis du roi, et, au milieu de la place, on dressa la pâle image de dame Liberté, assise et coiffée du trop célèbre bonnet phrygien. Le 23 du même mois, le conseil général de la Commune autorisa d’infâmes sicaires à installer la guillotine sur l’emplacement qu’il avait naguère adopté pour l’érection de la statue d’un roi qu’il bafouait aujourd’hui, et dès-lors commencent les fastes de cette boucherie humaine dont le souvenir seul nous fait verser des larmes.
Oh! que la Révolution eût laissé de belles, de sublimes pages dans l’histoire, si ces pages n’étaient souillées du sang pur de ses innocentes victimes! Que nous serions fiers de ces ancêtres de 1789 s’ils ne s’étaient hâtés d’arriver à 1792! Abattre les préjugés, c’est bien; renverser l’arbre de l’orgueil et des fausses prérogatives, c’est mieux encore 1 Mettre le feu aux parchemins qui veulent en imposer, bravo, bravo! Mais se servir du glaive dont Dieu seul peut disposer, mais envoyer devant le tribunal de l’éternité tous ces hommes que la voix de la raison et l’éclat de la lumière auraient sans doute mis de notre côté, c’est là toujours une accusation terrible qui condamne à notre haine vengeresse les insensés assassins qui se sont rendus coupables de tous ces crimes.
Oui, nobles et rois faisaient peser lourdement les chaînes de l’esclavage sur la tête du peuple! Qu’était-ce alors que le travail, que l’honnêteté, la sagesse de cette plèbe intelligence et si féconde depuis en hommes de mérite? Qu’était-ce qu’un bon père de famille sous la domination puissante, accablante de prétendus seigneurs qui, parce que la tour de la féodalité défendait leurs sottises et leur arrogance, se croyaient alors autorisés à commettre les actes les plus inconséquents?
Ainsi qu’il est aisé de le comprendre, nous ne cherchons pas à amoindrir les fautes ni de l’un ni de l’autre côté ; ces fautes, pesées dans une balance, donneraient entre elles les mêmes résultats. — La nation française voulait être libre, elle voulait vivre et non pas se voir lâchement étouffée par une autorité fictive. — Niveler les positions, égaliser les caractères, donner à tous le droit de parler et de se faire entendre, certes c’était là un but très-méritant.
La victime la plus digne de nos regrets comme de nos prières, Louis XVI, comprenait les élans et les aspirations populaires. Qui sait? peut-être les aurait-il même encouragés si son entourage ne lui eût pas fait peur et ne l’eût condamné à mourir de cette mort résignée et terrible qui émût longtemps encore après l’événement, ceux-là même qui y avaient joué les principaux rôles.
Dès l’aurore du gouvernement révolutionnaire, la place prit le nom de la Révolution, et, en 1795, les chevaux de Marly , œuvre de Coustou le jeune, que l’on a laissés toujours à l’entrée de la grande allée, servirent à sa décoration du côté nord.
Une fois la Restauration arrivée, on songea à ériger, au milieu d’elle, un monument expiatoire à la mémoire du fils de saint Louis. La première pierre fut posée le 3 mai 1826. On parlait même de donner à cette place le nom de Place Louis XVI. Malheureusement tous ces projets échouèrent pour ne plus être repris.
Le roi Louis-Philippe y fit transporter, en 1836, l’obélisqué de Louqsor, et cette fois enfin elle reprit tout de bon le nom de Place de la Concorde, qu’elle n’a pas perdu depuis. C’est l’habile M. Hittorf qui fit daller et macadamiser le sol; il éleva le piédestal de l’obélisque, construisit deux fontaines d’un travail très-soigné et remarquables surtout par le gracieux effet qu’elles produisent quoique entourées de monuments, de promenades capables de les écraser et de les faire oublier aux yeux des étrangers. Il n’en est rien néanmoins: c’est là le plus bel éloge que l’on puisse donner à l’artiste qui en est l’auteur et dont le nom nous échappe.
N’oublions pas de mentionner les huit statues colossales posées sur des blocs de pierre très-élevés et représentant nos principales villes de province. Ces sujets allégoriques nous ont semblé, pour la plupart, traités supérieurement, mais non pas toutefois à l’abri d’une critique raisonnée et sérieuse.
Le soir, cette immense place, une des plus belles du monde par son étendue et ses charmantes décorations, toutes de bon goût, est éclairée par une lumière brillante qui jaillit de cent quarante-six becs de gaz.
L’allée principale des Champs-Elysées, sans contredit la plus belle avenue de la capitale, se termine par la barrière de l’Étoile. — Mais si vos jambes demandent grâce, pendez-vous à mon bras, et avant d’arriver à l’arc de triomphe, n’oublions pas d’examiner tout ce qui nous entoure.
Ce qui surtout contribue à rendre cette promenade admirable et unique dans son genre, ce sont les riches hôtels nouvellement construits des deux côtés. Les plantations, étouffées dans leurs racines par l’asphalte, et peut-être aussi par la prodigieuse hauteur des maisons voisines, sont maigres et chétives. Tous les insectes semblent s’être donnés rendez-vous sur leurs feuilles pâles et presque sèches au printemps. Le système d’arrosage, si digne d’éloges à Paris, est aussi bien appliqué aux Champs-Elysées que partout ailleurs; mais ses résultats, en dépit des soins les plus minutieux de ceux qui en sont chargés, restent toujours négatifs. A maintes reprises, on a voulu remédier à cet état de choses, et jamais il n’a été possible d’obtenir une solution satisfaisante.
Nous n’avons pas à écrire l’histoire des Champs-Elysées; nous en avons dit quelques mots dans les pages précédentes, en parlant de la place de la Concorde. Leur étendue est de deux kilomètres; le soir, ils sont éclairés par une multitude de candélabres pas assez élégants pour en faire l’objet d’une mention particulière, surtout quand, étrangers à Paris, on est naturellement attiré par ses souvenirs à les comparer à ceux de la place de la Concorde. Mais si la décoration de cette longue et belle avenue est trop mesquine en temps ordinaire, le 15 août, le jour de la fête toujours impatiemment attendu d’un bout de l’empire à l’autre, elle présente, en revanche, un coup œœil féerique. Des chevaux de Marly jusqu’à la barrière, ce ne sont que verres de couleurs, oriflammes livrés aux caprices des vents, lustres factices, ou plutôt énormes boules de feu d’une clarté plus brillante que le diamant, et dont les derniers reflets vont se perdre sous les portiques de l’arc de triomphe de l’Etoile.
Dans les premiers jours du mois d’avril, les courses de Longchamp égayent et animent cette promenade. Les beaux équipages s’y montrent aussi fréquemment, car c’est par les Champs-Elysées qu’il est seulement possible de se rendre au bois de Boulogne.
A l’ancien grand carré, qu’on appelle aussi le rond-point, est le vaste palais de l’Industrie. Ce serait, j’imagine, vouloir aligner des mots les uns à la suite des autres, sans but et sans nécessité, que de s’arrêter dans ses diverses salles. Un de nos confrères, dont la réputation ne reste pas à faire, a publié chez notre intelligent éditeur, une étude très-remarquable sur ce sujet . Nous y renvoyons donc le lecteur.
Plus haut, au carré Marigny, se trouve le Cirque de l’Impératrice. Ses représentations n’ont lieu que pendant sept mois de l’année. Directeurs et écuyers déménagent au mois d’octobre pour continuer leurs exercices au Cirque Napoléon, situé au boulevard du Temple.
En 1857, le jardin d’hiver, administré par une société de capitalistes, était encore très-florissant. Il n’était pas rare d’y rencontrer une société convenable et toujours décente. La rotonde, habitée par d’intrépides Célarius et de gracieuses jeunes filles, était d’une disposition aussi intelligente que somptueuse. Plus loin, les massifs de plantes exotiques, que de petites lumières cachées dans le feuillage semblaient faire revivre tous les soirs, et qui mêlaient leur ramage au bruit argentin des microscopiques fontaines, heureusement placées dans les coins les plus sombres, étaient sans cesse visitées par une foule qui allait toujours en grossissant. Mais la spéculation est venue un beau matin abattre ce frais jardin d’hiver, et je ne puis maintenant vous montrer que la place qu’il occupa pendant un rêve trop court.
Ubi Troja fuit!
Voici Mabille, le Château des fleurs. De l’autre côté, l’immortel Guignol avec ses immortelles et toujours jeunes marionnettes. Plus loin beuglent, pleurent, soupirent les malheureux et piètres chanteurs des cafés Morel et des Ambassadeurs. Laissons passer ces chèvres poussives attelées, Dieu sait comment, à une calèche de quelques centimètres de hauteur; et saluons, de loin, l’hôtel de M. Emile de Girardin, de Mme de Montijo, du Prince Napoléon, pour arriver plus vite à l’Arc-de-Triomphe. Ne m’en veuillez pas si je ne dis mot sur l’Hippodrome; il nous faudrait marcher encore jusqu’à moitié route de Saint-Cloud, et, ma foi, c’est trop loin.
L’arc de triomphe de l’Etoile est le plus colossal monument de ce genre que je connaisse; voilà qui ne doit pas vous étonner, car il n’en existe pas conçu dans de plus larges proportions. Il fut commencé sur les dessins de Chalgrin, et c’est le 15 août 1806 qu’on en posa la première pierre. Lors du retour de l’île d’Elbe, les travaux durent être abandonnés. Ils furent repris en 1823, et l’on songea alors à retracer, sur la pierre, les traits des héros de la fameuse expédition d’Espagne. Son édification ne marchait pas bien vite, puisque reprise enfin en 1832, sous la direction de M. Blouet, elle ne put être complètement achevée qu’en 1836. La hauteur de l’Arc-de-Triomphe est de 50 mètres, sa largeur de 45, son épaisseur enfin de 25. De sa situation sur l’éminence qui domine tout le quartier bas de Paris et la riante campagne des environs, il tire un caractère particulier qui en impose. Sur ses quatre faces, on a sculpté l’histoire de la France de 1792 à 1814; des bas-reliefs, qui demanderaient une étude d’autant d’heures qu’il y a de personnages (et le. nombre en est grand!), représentent les principaux événements de nos grandes victoires, remportées sur le champ de bataille. Sur les faces intérieures sont inscrits, en grosses lettres, le nom de nos généraux et de nos jours glorieux. C’est donc là le récit fidèle de la première période de la politique française au XIXe siècle.
Puisque vous me pressez de vous accompagner à l’église de la Madeleine et à l’Hôtel-de-Ville, veuillez, mon jeune ami, prendre place dans cette voiture, dont le cocher, au facies rubicon, sollicite notre course; et redescendons les Champs-ELYSÉENS, comme dit mon confrère le vicomte de Charny, en fumant un londrés de la civette.
La rue Royale, qui part de la place de la Concorde, occupe la place des anciens remparts et de la porte Saint-Honoré. Au n° 6 mourut, en 1817, une femme charmante âgée de cinquante-deux ans; et au 13, en 1817 aussi, un littérateur plus orgueilleux et plus infatué de son peu de savoir, que spirituel et facile à lire: cette femme, c’est Mme de Staël; ce gros bonnet de la littérature farinacée de l’Empire, M. Suard.
L’église de la Madeleine, quoique projetée à l’époque où la place Louis XV reçut les plus grands développements, ne fut commencée qu’en 1764. Constant d’Ivry avait fait approuver, par le roi, un plan gigantesque. Les colonnes sortaient à peine de terre quand l’heure de la révolution sonna, avec un bruit effrayant, à l’horloge des Tuileries. A son arrivée au trône de Charlemagne, Napoléon ordonna de faire de l’église en voie d’exécution un temple de la Gloire, qu’il voulait dédier aux soldats de la grande armée. Les constructions déjà exécutées étaient comprises dans la pensée que Vignon soumit à l’Empereur; mais le chef de l’État étant partout, sauf à Paris, on s’occupa peu de la réalisation du désir qu’il avait émis, et la Restauration surprit ces travaux si embrouillés par la négligence des architectes. Le nouveau gouvernement resta trop longtemps à se décider, pour savoir ce qu’il devait faire du monument commencé. Louis-Philippe n’hérita pas heureusement de la paresse de Louis XVIII et de Charles X, et il confia à Havé cet amalgame de pierres, de chaux et de briques, d’où devait sortir, en 1842, cette église au perron si élégant, que l’on baptisa du nom de l’église de la Madeleine.
La Madeleine est la plus remarquable imitation de l’art antique que nous possédions. Ce monument est, dans ses moindres détails, un chef-d’œuvre de correction et de style. Sa façade est grandiose. Lemaire, qui en est l’auteur, a représenté sur le fronton une des scènes les plus attendrissantes de la vie de la pécheresse qu’un éclair de piété ramena à la religion et à son Dieu. Sa colonnade est sublime, ses proportions admirables et elles laissent bien loin après elle tout ce qui a été fait dans ce genre. Mais entrons dans l’église, sans oublier les portes principales, en fer repoussé, œuvre très-estimée de M. Truquéty .
Pour peu qu’on ne se laisse pas éblouir par l’éclat des dorures, l’élégance déplacée de l’ameublement, on se sentira blessé dans ses pures croyances de chrétien par la magnificence trop mondaine de cet asile de la prière et du recueillement. Depuis qu’il nous a été permis de comprendre et de sentir, de raisonner et de faire comprendre aux autres par des preuves basées sur la vérité et le bon sens, nous sommes à nous demander où veulent en venir ceux qui s’ingénient du matin au soir à donner à nos églises, déjà si imposantes par leurs proportions matérielles, les indignes caractères d’une époque aussi mobile dans ses principes que dans ses croyances. Ce qu’il faut à Dieu, ce qu’il demande, ce qu’il préfère à toutes ces futilités, c’est une vive et sincère ferveur au fond de l’âme. Jésus est né dans une misérable crèche à Béthléem; il est mort crucifié entre deux larrons. Assurément, Dieu par sa toute puissance, aussi infinie que le temps, aussi grande que les admirables merveilles de la création, n’avaient qu’à vouloir pour donner à la mission qu’il avait confiée à son fils un commencement et une fin plus dignes du rédempteur des hommes. Aimer Dieu dans une salle surchargée d’inutiles prestiges, l’aimer dans un temple pauvre et dépourvu de ces décorations trop souvent funestes à notre imaginatien ardente, n’est-ce donc pas la même chose? Mais, ne pouvant pas remédier à de pareils errements, examinons les pièces rares et curieuses qu’on a rassemblées dans cette église.
Il était au dessus du talent le plus exercé de n’importe quel artiste d’approprier la forme carrée de ce temple grec aux convenances nécessitées par le culte catholique. La Madeleine ne possède qu’une seule nef, divisée dans sa longueur par trois travées assez étroites dont la voute a été divisée en une infinité de cassons. Des colonnes réunies séparent les travées; les chapelles latérales sont indiquées par un petit ordre ionique convenablement traité et présentant de belles parties. Le maître-autel est relégué dans une travée qui ne diffère en rien des autres. On est charmé, il est vrai, par l’ensemble des délicates dispositions, tant des dorures, des statues, que des orgues renfermées dans de riches buffets. Tout cela paraît coquet, mignon, gracieux. Mais est-on aussi satisfait quand on étudie chacun de ces détails séparément. Ici c’est le genre grec, le genre romain; plus loin, voici le style quasi-renaissance!...
M. Marochetti a sculpté sur la table du maître-autel une Assomption en marbre blanc à laquelle on s’accorde assez généralement à trouver de grandes qualités. Quant à moi, je préfère la scène très-compliquée de M. Ziégler, cachée comme à dessein dans l’arrière partie du chœur. Dans cette composition, l’artiste a représenté la patronne de l’église aux pieds du Christ entouré des apôtres et des évangélistes. Clovis, Godefroy de Bouillon, Constantin, Barberousse, Jeanne-d’Arc, Raphaël, Dante et Napoléon entourent ce sujet des plus intéressants. Cette peinture est soignée, il y a surtout la tête de la Madeleine d’une expression fort bien réussie. Couderc, MM. A. de Pujol, L. Cogniet, Schnetz, Bouchot et Signol ont reproduit certains épisodes de la conversion de cette pécheresse; les grisailles de M. A. de Pujol sont dignes du pinceau de celui que la voûte de la Bourse a à jamais rendu célèbre.
Si nous avons passé sans en rien dire devant les belles statues de MM. Rude, Pradier et Foyatier, qui ornent le péristyle, c’est qu’il nous a semblé inutile de les recommander à l’attention des visiteurs.
Autour de cet édifice, et sans en descendre le perron, d’une conception large et hardie, se trouvent quatorze statues. L’action du temps n’est pas sans nuire à la parfaite conservation qu’on a toujours le droit d’exiger pour les œuvres d’art. La sainte Christine, de M. Walcher, est un des meilleurs morceaux de cette galerie.
a L’histoire de l’Hôtel-de-Ville serait l’histoire même de la France,» dit le savant chercheur, M. Th. Lavallée. Veuillez donc, mon bienveillant ami, me permettre de continuer encore ma promenade. Si vous ne m’accompagnez pas aujourd’hui, demain, je l’espère, vous rouvrirez peut-être ce livre .
Une fois arrivé devant la façade principale de l’Hôtel-de-Ville, je vais vous dire en quelques lignes ce que mes souvenirs et mes notes de la bibliothèque impériale m’ont appris sur la place de Grève.
D’où vient son nom d’abord? Dans l’origine ce n’était qu’une grève abandonnée, souvent couverte par les eaux du fleuve qui l’avoisine. Vers la fin du XIIIe siècle, le lit de la Seine fut considérablement élargi, d’après les volontés des bourgeois au pouvoir, et ils établirent leur parlouer, ou parloir, dans la maison dite aux piliers. C’est de cette époque que date la trop grande célébrité de cette place. Qu’elle serait longue la liste de ces nobles et innocentes victimes mortes sur le bûcher ou sur son échafaud! Qu’elles tortures n’ont pas tourmenté les membres des infortunés qui, sur l’imputation de fautes dont ils ne s’étaient pas rendus coupables, étaient condamnés au dernier et terrible supplice.
Sous ce sable que mes pieds foulent craintivement, n’allons-nous pas trouver encore les restes oubliés de Jean de Montaigu (1409), le connétable de Saint-Pol (1475), Jacques de Pavans (1525), Louis de Berquin (1529), Barthélemy Milon (1535), Anne Dubourg (1559), La Mole, Coconas (1574), Montgommery (1574), Montmorency, Bouteville, des Chapelles (1627), le maréchal de Marillac (1632), la marquise de Brinvilliers (1676), le comte de Horn (1720), Cartouche (1721), Damiens (1757), Lally (1766), Favras (1790), Fouquier-Tinville! — Demerville, Arena, Topino, Cerracchi, Georges Cadoudal, Tolleron, Louvel ne se réveilleront-ils pas? «Si tous les cris, dit Charles Nodier, que le désespoir y a poussés sous la barre et sous la hache, dans les étreintes de la corde et dans les flammes des bûchers, pouvaient se confondre en un seul, il serait entendu de la France entière.»
Que de sombres événements ont pris pour théâtre cette immense arène! que de pleurs et que de sourires, que de chagrins et que de joies! Ah! certes les jours heureux dont nous jouissons, maintenant que la civilisation, de concert avec la politique de l’Empire, ont réuni leurs efforts puissants pour hâter le progrès dans tous les milieux de la société, nous ont coûtés des sacrifices de toutes sortes. Pour s’en convaincre, il ne suffit pas d’exalter sa situation présente; il faut étudier et comprendre les accablements et les douleurs du passé !...
Depuis que Dieu nous a donné pour réparateur celui qui porte le nom le plus héroïque, le plus prestigieux des temps modernes, le calme est tout-à-fait rétabli sur la place de Grève. Si elle a conservé sa primitive désignation, c’est que depuis un siècle elle est encore le lieu de rassemblement des ouvriers sans ouvrage.
Le régime municipal de la ville de Paris remonte aux nautes, corporation de marchands par eux établie dans les temps les plus éloignés. Au XIIe siècle elle devint la hanse parisienne. En 1258, le chef de cette corporation prit le titre de prévôt des marchands, et ses compagnons celui d’échevins. Les échevins étaient au nombre de quatre; plus tard on leur adjoignit vingt-six conseillers qui, dans les élections et dans les assemblées, avaient voix délibérative. Le désintéressement de ces honorables et riches citoyens fut constamment au-dessus de tous les éloges. Presque tous consacraient les revenus de leur charge à l’embellissement de la ville. Ils se seraient cru deshonorés s’ils n’avaient été attentifs aux réclamations qui leur étaient adressées, et s’ils ne s’étaient sans cesse occupés, tant de l’amélioration des rues, des places, des promenades, que de remédier de leur mieux à la misère du peuple qui les avait élus. Les plus célèbres des prévôts sont: Etienne Barbette, Jean Gautiers, Etienne Marcel, Jean Desmarets, Michel Lallier, Jean Bureau, Auguste de Thou, Lachapelle Marteau, François Miron, Jean Scarron, Claude Lepelletier, Etienne Turgot, Jérôme Bignon, Lamichodière, Caumartin, Flesselles.
Jusqu’au 14 juillet 1789, l’ancienne municipalité n’eût à subir aucune modification dans sa nature. La loi du 21 mai 1790 créa une administration nouvelle, composée d’un maire, d’un conseil municipal et d’un conseil général; mais son existence fut de courte durée. La révolution du 10 août créa la puissance souveraine de la fameuse Commune de Paris, puissance qui dura jusqu’au 9 thermidor. D’autres combinaisons compliquèrent les rouages administratifs; ce qu’une révolution avait embrouillé, une autre révolution devait le modifier en le corrigeant. Le 20 juillet, la Préfecture de la Seine fut rétablie, et depuis, deux préfets, l’un de la Seine, l’autre chargé de la police, combinent leurs efforts pour maintenir l’ordre et la bonne exécution des lois dans la capitale. Le premier de ces deux fonctionnaires est aidé dans sa tâche par une commission municipale, que le gouvernement renouvelle à des époques périodiques.
Sous le règne de François Ier, on établit les bases de l’Hôtel que nous voyons aujourd’hui. Une fête splendide consacra la date du 15 juillet 1533. Dominique de Corne donna les dessins géométriques de cet édifice qui, en 1560, n’avait qu’un étage. Les guerres civiles retardèrent la continuation des travaux. Ils furent repris en 1605, sous la direction de Durcerceau, aidé de la collaboration et des secours de François Miron, prévôt des marchands. Vers l’année 1628, on en célébra avec pompe l’inauguration. Il présentait une seule façade régulière et surmontée de deux tourelles à campanile. L’œuvre de Pierre Biard, la statue d’Henri IV, était déjà à la place où nous la voyons encore. La cour intérieure, entourée de portiques, avait à son milieu la statue de Louis XIV, médiocre ébauche de Coysevox. L’unique salle qui méritât une visite était celle du Trône, où étaient reçus les souverains et les princes des puissances amies, que des nécessités de politique ou des raisons de santé amenaient à Paris. Elle était ornée des tableaux de Largillière, de Troy, de Porbus, représentant des cérémonies royales et municipales. Dans cette salle, la Commune du 10 août s’installa pour diriger l’attaque des Tuileries; c’est là aussi que Robespierre se fracassa la tête d’un coup de pistolet.
L’Hôpital du Saint-Esprit, le bureau des pauvres, l’église Saint-Jean en Grève ayant été démolis en 1801, on fit servir les terrains déblayés à l’agrandissement de l’Hôtel-de-Ville. Malgré ces réparations, il était encore insuffisant pour les services administratifs, puisque plusieurs bureaux avaient dû se loger dans des maisons voisines. Aussi, en 1836, la rue du Martroy et plusieurs autres, expropriées pour cause d’utilité publique, permirent à l’architecte de prolonger la façade primitive, au moyen de deux ailes bâties dans le même style. Trois faces furent ajoutées à celle qui existait, et comptant avec raison tant sur les libéralités du gouvernement que sur les sacrifices que la ville allait s’imposer, on termina dans quelques années un palais d’une parfaite harmonie dans tout son ensemble, de forme rectangulaire, ayant 180 mètres de long sur 80 de large. Sa position, sur les bords de la Seine, en face de l’Ile de la Cité, est vraiment unique et rend sa masse encore plus imposante. Dans l’intérieur on admire avec ébahissement, outre la salle du Trône, qu’on a su réparer avec discrétion, celle des Arcades, de l’Empereur, le Salon Jaune et Bleu, la Grande-Galerie des Fêtes, où les lustres, les colonnes, les dorures sont à profusion; les deux Salons des Arts, la Salle des Cariatides, celle de la Paix, les deux Salons des Prévôts, dont les murs sont garnis des bustes des prévôts de Paris, depuis Evreux jusqu’à Trudaine. Ces diverses salles occupent un espace de plus d’un kilomètre de long. Les peintures à fresque y abondent: Schopin, MM. Ingres, H. Lehmann, Cabanel, Landelle, E. Delacroix, Müller, J. Flandrin, Léon Cogniet et tutti quanti ont rendu cet Hôtel le rival des plus sérieux que puissent craindre et envier les palais les plus richement décorés de l’Europe.
Bien que cette description de l’admirable capitale qui nous attire vers elle où que nous soyons, bien que ces notes écrites au courant de la plume et sans prétention donnent prise à la critique la moins acerbe et la moins chicaneuse, si vous vous sentez satisfait par ces premières études incomplètes, traînés par deux fringants chevaux, nous vous accompagnerons dans la seconde partie de votre voyage. Entrons dans les rues étroites de la cité, c’est là que nous trouverons d’abord l’Eglise métropolitaine, Notre-Dame. Dans quelques pages, c’est-à-dire après quelques heures d’un examen rapide, je vous désignerai chaque pont par son nom spécial, et nous franchirons enfin le fleuve qui nous sépare du Luxembourg, du Jardin des Plantes, du Châtelet, du théâtre de l’Odéon, de l’Institut, etc., et des principaux quais de Paris. Si j’oublie quelques-unes des merveilles de Paris ne m’en veuillez pas, cher compagnon. Paris est peuplé de merveilles, et ce serait être d’une prétention qui aurait le droit de me nuire dans votre estime, que de vous promettre une histoire détaillée. Mon seul désir est de vous intéresser en vous racontant tout ce qu’une ingrate mémoire a pu retenir.