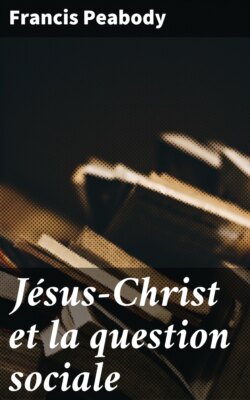Читать книгу Jésus-Christ et la question sociale - Francis Greenwood Peabody - Страница 9
Les essais de solution de la question sociale sur le terrain du christianisme
ОглавлениеParmi les nombreux projets proposés il en est un qui se distingue des autres par son extrême simplicité, c’est celui qui consiste à en revenir à la manière de vivre des premiers chrétiens. Les disciples, lisons-nous dans le livre des Actes, avaient toutes choses communes; ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait; «et personne ne disait que ce qu’il possédait fût à lui en particulier.» Ces paroles ont donné naissance à de nombreux essais de communisme chrétien, tantôt monastique tantôt simplement ascétique, inspirés par un même désir de fonder une communauté vraiment chrétienne au milieu d’un monde où le christianisme est peu en honneur. Il est impossible de songer à ces communautés paisibles où se groupaient des âmes pieuses et obscures sans éprouver pour elles une certaine admiration, et l’on est heureux de penser que les désirs de la chair qui gouvernent tant d’existences ont été impuissants à les troubler. Celles qui de nos jours en s’isolant du monde essaient de faire revivre la vie apostolique sont pour notre époque ce que les meilleurs monastères étaient pour leur temps, des refuges tranquilles au milieu de l’activité dévorante du monde.
Mais ces tentatives consciencieuses de ressusciter la manière de vivre des premiers disciples ne se justifient ni au point de vue économique ni à celui de l’histoire de l’Eglise. Il faut remarquer tout d’abord qu’elles n’apportent aucune solution au problème de la vie économique moderne, car elles se bornent à l’esquiver. Comment des communautés de cette sorte pourraient-elles jamais rivaliser avec les procédés de la grande industrie, et fournir les produits indispensables soit à leur propre existence soit à celle de la société au milieu de laquelle elles vivent? Le communisme religieux en tant qu’il se montre hostile à l’ordre économique régnant, reste emprisonné dans son étroit domaine, et il arrive alors que ce sont les usines, les chemins de fer, les grandes villes et les échanges commerciaux qui rendent possible la vie calme et retirée d’un certain nombre de privilégiés. Il en était de même du temps des couvents, du moins pour un certain nombre d’entre eux. Les affaires poursuivaient leur cours et ces saints vivant dans l’oisiveté étaient pour la plupart entretenus par les travailleurs peu croyants qui demeuraient autour de ces monastères. Le communisme chrétien, même le meilleur, n’est donc pas un progrès, mais un recul; ceux qui le professent s’illusionnent eux-mêmes en s’imaginant avoir vaincu le monde alors qu’ils n’ont fait que de le fuir. Le seul moyen de faire cesser les désordres et les imperfections de la vie économique c’est de descendre dans la mêlée, et de nos jours la vie chrétienne ne doit pas consister à retourner en arrière vers un passé chimérique mais à chercher le moyen de préparer un meilleur avenir.
Ces soi-disant reproductions du christianisme primitif ne se légitiment d’ailleurs pas davantage au point de vue scripturaire. La vie sociale des premiers disciples lorsqu’on l’examine de près, nous apparaît comme un état de choses entièrement différent à la fois de la vie monastique avec ses vœux de pauvreté et de la société moderne avec le contrôle qu’elle exerce sur l’industrie et la vie de famille. C’est méconnaître absolument l’esprit qui régnait à cette époque primitive que de nous représenter les premiers disciples comme des hommes préoccupés de l’idée d’établir un système économique ou de réglementer la vie sociale. Il n’est d’ailleurs nullement prouvé que ce qui nous est raconté de la petite communauté de Jérusalem ait été pratiqué d’une manière générale, car il n’est fait mention dans le livre des Actes d’aucun autre essai de communisme, et nous pouvons y constater que la mère de Marc continue à habiter une maison à Jérusalem et que l’Eglise d’Antioche envoie un secours, chacun agissant selon son pouvoir. L’apôtre Paul ne fait aucune allusion à une réglementation du communisme.
«Que chacun, dit-il, donne selon qu’il l’a résolu
«en son cœur, non à regret ni par contrainte.
«Que chaque premier jour de la semaine
«chacun de vous mette à part chez soi et ras-
«semble ce qu’il pourra selon sa prospérité.
«Nous les conjurons, dit-il, de la part de notre
«Seigneur Jésus-Christ de travailler et de man-
«ger leur pain paisiblement.» Il faut conclure de là que le communisme du jour de la Pentecôte a été comme le don des langues décrit dans le même chapitre, un fait spontané, unique, une manifestation momentanée de cet esprit de ferveur et de communion spirituelle qui a marqué la petite communauté de son empreinte lors de l’éclosion première de sa nouvelle foi. Et puis il ne faut pas oublier non plus que cette égalité des biens qui à un moment donné a été un symptôme de fraternité parfaite n’avait aucun caractère obligatoire. Le récit mentionne tout de suite après un disciple nommé Barnabas, qui «ayant un fonds de terre le vendit, en apporta le prix et le mit aux pieds des Apôtres» ce qui semblait vouloir dire qu’il avait déployé une extraordinaire générosité. Dans le cas relatif à Ananias et à Saphira ce n’est pas le fait d’avoir gardé une part du prix du champ qui est l’objet d’un blâme, mais celui d’avoir menti au Saint-Esprit. «Si tu l’eusses gardé, ne te demeurait-il pas, et l’ayant vendu n’était il pas en ton pouvoir d’en garder le prix?» Cet homme et cette femme voulaient faire croire qu’ils avaient fait un très grand sacrifice comme Barnabas et c’était leur dissimulation seule et non le fait de garder une propriété privée qui donnait à leur péché un caractère si vil.
Ainsi le communisme de l’Eglise primitive n’était pas autre chose qu’une relation fraternelle, joyeuse, expansive, familiale de bons services mutuels telle que toute Eglise de notre temps doit s’efforcer d’en créer de nos jours; elle ne supprimait en aucune façon la distinction entre le riche et le pauvre, et n’entrait nullement en concurrence avec l’industrie telle qu’elle existait alors; sa règle économique était celle d’une famille où l’on s’aime; chacun pouvait garder ses biens mais «personne ne disait que ce qu’il possédait fût à lui». Les cœurs des premiers croyants débordaient d’oubli d’eux-mêmes, d’esprit de sacrifice; l’Eglise de Jérusalem n’avait pas tardé à devenir un lieu d’asile pour les pauvres; mais il n’y a aucune raison de penser que la foi chrétienne se soit jamais identifiée avec une méthode économique particulière. Si le Christ a approuvé cette fraternité qui «avait toutes choses communes», comme il le ferait encore pour l’amour désintéressé dont fait preuve plus d’une humble Eglise d’aujourd’hui, le communisme envisagé comme un moyen de résoudre la question sociale telle qu’elle se pose dans le Nouveau Testament n’en est pas moins une utopie insoutenable au point de vue historique; mais fort heureusement pour nous, Jésus n’a pas emprisonné la vie chrétienne dans les limites restreintes d’une théorie sociale ou d’un programme inconciliable avec l’organisation du monde actuel.
Un second essai, plus facile à appliquer, de solution de la question sociale sur le terrain de l’Evangile est celui de la philanthropie chrétienne. Ici, il n’est plus question d’une imitation chimérique de la vie sociale primitive, car le rôle assigné à la religion en face des besoins urgents auxquels il faut répondre, consiste à projeter sur le monde le jet de lumière d’œuvres de bienfaisance et de relèvement. «A cela on connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l’amour les uns pour les autres.» Cette mission-là est apparue avec raison comme un devoir positif pour le croyant. Jamais on n’a insisté autant qu’aujourd’hui sur la responsabilité sociale de ceux qui se disent chrétiens; jamais on n’a vu se multiplier comme de nos jours les œuvres philanthropiques chrétiennes de tout genre et tous sont d’accord sur ce point que le grand critère religieux invoqué à nôtre époque, c’est la puissance inspiratrice du christianisme en ce qui concerne les œuvres de charité.
En 1849, le pasteur Wichern, le fondateur de la Mission Intérieure en Allemagne adressait un message à la nation pour mettre sur la conscience des croyants le souci des grands problèmes actuels, afin de prouver d’une manière irréfutable que la religion chrétienne peut faire ce qu’aucune sagesse et puissance humaine ne peuvent accomplir sans elle; et cette manière de prouver l’efficacité du christianisme par ses œuvres est devenue un des traits caractéristiques du christianisme de notre temps. Une centaine de modes d’assistance très variés, des visites à domicile, des secours matériels, des œuvres de tempérance et de moralisation, de vastes établissements avec des lieux de culte appropriés sont le produit de cette influence religieuse s’exerçant dans le domaine de l’activité sociale. Et toutefois ce grand déploiement d’action chrétienne, si beau et fécond qu’il soit et qui fournit une si belle preuve de la vitalité du christianisme, ne peut être considéré comme une solution de la question sociale telle qu’elle se pose de nos jours, car cette question, nous l’avons déjà vu, s’étend au-delà de l’horizon de la philanthropie et ne peut être résolue par des paroles de compassion à l’égard des malheureux, ou des aumônes faites aux pauvres; ce qu’elle réclame, c’est la justice, une modification dans la condition du pauvre plutôt que des témoignages de pitié et dès lors, il est évident que l’esprit de charité chrétienne, quels que soient les progrès qu’il a accomplis ne donne pas satisfaction aux revendications modernes.
Il en est à cet égard comme d’un médecin qui s’occuperait de cas spéciaux de maladie alors qu’il y aurait des recherches plus approfondies à faire sur les causes du mal et les moyens propres à en empêcher le retour. Pour être à la hauteur de la question sociale telle qu’elle se présente à nous aujourd’hui, la religion a quelque chose de plus à faire que de se montrer simplement compatissante et généreuse; elle doit se faire sa place au soleil dans cette grande enquête d’amélioration économique qui s’impose à l’attention de tous.
Le désir de mettre fin au désordre et à l’imperfection qui règnent dans le monde industriel a donné naissance dans le sein de l’Église chrétienne à de nombreux projets et à des essais de tout genre, qu’on peut faire rentrer dans un petit nombre de types déterminés. Il faut mentionner en premier lieu, sur les confins de ces divers programmes, ce qu’on peut appeler l’œuvre prophétique. Le prophète n’est pas plus, au point de vue social qu’en religion, un faiseur de systèmes ou un homme qui prédit l’avenir; il est l’avocat de la justice, dévoile les péchés du peuple, prononce sur eux un jugement; il formule les principes de l’équité et de la paix et promet à la justice une récompense. C’est là une des missions qui incombent au prédicateur de l’Évangile; il n’a pas besoin en effet de faire l’apprentissage de l’économie sociale pour flageller les péchés sociaux, et la passion pour la justice qui se manifestait chez les prophètes hébreux a sa raison d’être et sa place marquée dans le ministère chrétien. Le prophète peut ignorer quelle forme revêtira cet avenir meilleur, et passer quand il le décrit pour un visionnaire épris de rêves chimériques; son rôle n’en consiste pas moins à proclamer la loi éternelle de la justice et les conséquences désastreuses du péché pour l’individu et pour les peuples. «Le
«prophète a eu un songe, s’écrie-t-il; ma parole
«n’est-elle pas comme un feu, dit l’Éternel, et
«comme un marteau qui brise le roc? Voici,
«j’en veux à ceux qui prophétisent des songes
«faux; je vous rejetterai vous et la ville que j’avais
«donnée à vous et à vos pères» et au prophète fidèle il dit ceci: «Je leur donnerai un cœur
«pour qu’ils connaissent que je suis l’Éternel;
«ils seront mon peuple et je serai leur Dieu; je
«les regarderai d’un œil favorable et les ramè-
«nerai dans ce pays.»
Parmi les prophètes sociaux de notre temps, il y en a deux qui ont exercé sur la conscience chrétienne une influence extraordinaire: ce sont Carlyle qui a fait une magnifique satire de l’amour de l’argent, du dilettantisme de la vie moderne et dépeint le monde tel qu’il serait si l’on y voyait refleurir la paix et la tranquillité d’autrefois, et Ruskin qui a dénoncé l’économie politique actuelle comme un état anormal, illusoire, et proposé de lui substituer un ordre social tout différent basé sur le sentiment de l’honneur et qui ferait couler dans le sein de l’humanité «le sang pur et coloré d’êtres humains vraiment heureux sur la terre». Il est impossible de lire ce qu’ils ont écrit tous deux sur l’injustice sociale sans être en sympathie avec eux, et s’adresser des reproches de conscience. Pour plus d’un esprit engourdi dans la satisfaction de ses aises et d’une richesse mal acquise, les appels de Carlyle ont été comme ceux d’un nouveau Moïse plaçant devant le peuple un idéal moral supérieur, et pour plus d’un homme d’aujourd’hui dégoûté des laideurs et dés défectuosités de la civilisation moderne, Ruskin a été le révélateur de trésors de beauté et d’harmonie. Au lieu d’une Angleterre de commerçants impitoyables et de politiciens bavards, Carlyle a conçu la pensée d’une Grande-Bretagne héroïque, de grands industriels capables d’entreprendre une sainte croisade; à la richesse qui dégrade et entraîne un homme au fond de la mer comme le naufragé portant de l’or sous sa ceinture, Ruskin propose d’en substituer une autre d’un genre bien différent: «La seule
«richesse véritable, dit-il, est la vie, tout le
«reste n’est pas un bien, mais un mal; j’aime
«à saluer de loin le jour où l’Angleterre aban-
«donnant aux nations barbares toute préten-
«tion de posséder les trésors qui leur appar-
«tenaient à l’origine, leur enverra ses fils en
«leur disant: voilà mes joyaux!»
Mais ces prophètes du devoir et de la beauté, dès qu’ils abandonnent le terrain de l’inspiration pour se placer sur celui de l’enseignement économique nous révèlent les côtés faibles de l’œuvre qu’ils ont entreprise. Carlyle propose d’échanger la liberté de la vie industrielle contre l’esclavage de l’ancienne féodalité. «Je suis,
«dit-il, pour la permanence des institutions
«en toute chose. Gurth, le serf de i, avec
«son collier de cuivre jaune autour du cou n’est
«peut-être pas ce qu’on pourrait appeler un
«type de félicité humaine, mais il me paraît
«heureux si je le compare à plus d’un homme
«de notre temps qui n’est l’esclave de personne.
«La liberté de mourir de faim n’a rien de
«divin.» Ruskin, à son tour, imagine un système d’échanges destinés à faire disparaître toutes les différences provenant de l’habileté ou de la probité commerciales et à produire l’égalité dans le travail, chose qu’il déclare d’ailleurs impossible. Il n’y a rien de plus bizarre dans l’histoire de la littérature que le rôle joué par Carlyle et Ruskin en matière de réforme sociale; ils se sont montrés l’un comme l’autre nettement hostiles à la tendance démocratique de la politique et de l’industrie modernes; tous deux ont été des aristocrates, des réactionnaires n’éprouvant aucune sympathie pour le programme socialiste, se rangeant du côté de l’autorité, de l’ordre, de l’obéissance passive; Ruskin s’est donné lui-même pour un antilibéral et Carlyle a parlé en termes de mépris de l’agitation anti-esclavagiste; ils ont cherché dans les institutions du moyen-âge un dérivatif aux maux de la société actuelle, mais le caractère utopique de leurs théories économiques ne détruit en rien la magnificence de l’œuvre qu’ils ont conçue sur le terrain de l’esthétique et de la morale.
A côté du rôle de prophète, il y a celui qui consiste à considérer la religion comme une force sociale et à lui assigner une place dans la vie économique de notre temps. Le specimen le plus connu et le plus modéré de cette tendance est la méthode qui s’appelle l’opportunisme chrétien. Un opportuniste n’est pas nécessairement un homme s’orientant d’après le vent qui souffle; c’est un réformateur qui saisit au vol chaque occasion à mesure qu’elle se présente, n’a pas de programme défini et définitif, mais est prêt à choisir les voies et moyens qui, à un moment donné, lui paraissent réalisables; il se fraie un chemin à travers les possibilités pour s’élancer vers ce qu’il désire. Tel est l’état d’esprit de la plupart de ceux qui cherchent à faire intervenir le christianisme dans la question sociale.
On peut en juger par les Congrès sociaux qui se tiennent chaque année en Europe; ce qu’ils réclament de leurs adhérents, ce ne sont pas des œuvres proprement dites accomplies au nom de la religion, mais simplement des études, des enquêtes, une certaine habileté de main pour appliquer l’élément religieux à la vie sociale chaque fois que la chose est possible; ce qu’ils impliquent, c’est un esprit toujours en éveil, pour amener une entente entre les grandes confessions chrétiennes, en profitant des circonstances et pour adopter parfois une attitude très différente de celle qu’on avait prise au début. On peut citer comme exemple de ce genre d’activité sociale, Maurice et ses collaborateurs en Angleterre. L’unique théorie économique que ces hommes généreux avaient devant les yeux, était leur profonde conviction que l’état social actuel est en opposition avec les principes du christianisme. Kingsley y voyait une manière étroite, hypocrite, anarchique et immorale de concevoir l’univers. En fait d’enseignement positif, ils n’avaient qu’un bagage bien mince. «Je ne vois plus mon chemin, a dit Maurice, en dehors de cette affirmation: la rivalité des intérêts qu’on nous présente aujourd’hui comme la loi de l’univers, n’est qu’un mensonge.» L’attitude de ce groupe était donc à l’origine celle d’une simple expectative, mais par une heureuse coïncidence le mouvement coopératif anglais que les travailleurs les plus humbles, il faut le rappeler avec orgueil, ont inauguré par leur propre initiative et sans demander conseil aux esprits cultivés, commençait justement alors à prendre une extension rapide, et Maurice trouva dans cette tentative économique nouvelle un mode d’expression pour son christianisme social. «La concurrence commerciale, a dit encore Kingsley, enfante la mort, tandis que la coopération produit la vie.» Les opportunistes anglais se sont donc ralliés en masse au mouvement coopératif et s’en sont déclarés très satisfaits au point de vue de leurs idées sociales particulières bien que cette théorie ait été imaginée par d’autres que par eux.
Un autre essai de conciliation entre la question sociale et l’idée chrétienne est celui qui cherche cette solution dans une interprétation des données du christianisme lui-même. Il y a à cet égard deux manières de procéder; on peut répudier les théories révolutionnaires violentes ou les accepter; dans l’un et l’autre cas, il y a effort pour provoquer l’intervention directe de la religion dans la sphère de la vie industrielle. Comme exemple du premier type, on peut citer ce qu’on appelle volontiers la réaction scientifique, dont le but est de soumettre à un travail de révision les faits sur lesquels repose la question sociale, en les interprétant dans le sens d’une activité morale et individuelle plutôt qu’au point de vue économique et social. On peut citer dans cet ordre d’idées, les travaux de l’ingénieur français, Le Play, qui était un savant de premier ordre et un ardent catholique. A peine la tempête révolutionnaire eût-elle cessé de se déchaîner qu’il se mit à appliquer au désordre social les mêmes procédés d’investigation dont il s’était servi dans l’étude de la géologie. Il entreprit d’étudier avec une étonnante sagacité et un esprit d’observation sans précédent les conditions de la vie domestique et industrielle, en divers pays et à des degrés différents de civilisation, résuma dans des tableaux statistiques le budget de recettes et de dépenses représentant la situation économique des catégories diverses de travailleurs, et les résultats auxquels il aboutit furent en opposition complète avec les théories révolutionnaires déjà alors à la mode en France. La conclusion de ses recherches fut que la question sociale ne pouvait être résolue ni par une transformation économique ni par l’abolition de certains privilèges, mais seulement par la restauration complète de la vie de famille, de l’honnêteté commerciale, de l’éducation morale et de la religion prise au sérieux. La question était donc à ses yeux morale plutôt qu’économique; ce qui seul pouvait assurer la sécurité de la France, c’était une vie domestique mieux comprise, plus d’esprit d’économie, une plus grande habileté de main industrielle, et le réveil de la foi dans l’ordre moral. Le libéralisme scientifique de Le Play a été très apprécié, particulièrement par le conservatisme de l’Eglise romaine et il s’est maintenu sous la forme de statistique historique grâce à plusieurs hommes distingués qui en ont été les chauds défenseurs.
Mais cette théorie réactionnaire si opposée au programme socialiste a fait place même en France et dans le sein de l’Eglise catholique à une manière de voir plus éclairée. Quelque importance que l’on doive attribuer aux vertus domestiques et à l’éducation morale, cet élément là ne suffit pas (beaucoup d’esprits religieux l’ont compris) pour résoudre la question sociale, et ils ont eu le sentiment très net qu’il faut aborder ce problème de la transformation de l’industrie en se plaçant sur le terrain de l’Eglise chrétienne. L’Eglise, disent-ils, doit avoir son programme social; il existe une doctrine chrétienne économique, et le mouvement socialiste révolutionnaire doit être adouci, tempéré par l’esprit de foi. Telles sont les idées qui ont trouvé leur expression dans les différents types de ce qu’on est convenu d’appeler le christianisme social et qui ont réussi à grouper dans une sorte d’alliance assez étrange des catholiques et des protestants, des Français et des Allemands, des hommes d’Eglise très conservateurs et des prédicateurs aux idées les plus avancées.
C’est en Allemagne que la première note de ce concert a retenti et ce n’est pas un pasteur protestant qui l’a fait entendre, comme on aurait pu le supposer, mais un prêtre catholique. Ce fait peut s’expliquer par diverses raisons. L’Eglise romaine par le fait qu’elle a derrière elle une antique tradition de responsabilité ecclésiastique était peut-être mieux placée que toute autre pour formuler la théorie d’unité économique qui caractérise le mouvement social moderne; de plus, c’est elle qui représente en Allemagne le parti de l’opposition, et son exclusion des affaires publiques lui a permis de se mettre à la tête de l’agitation sociale, tandis que l’Eglise établie ne l’aurait jamais osé. Déjà avant la révolution de 1848, l’abbé Lamennais, insistant avec force sur la nouvelle mission qui incombait à l’Eglise catholique, avait trouvé dans la menaçante devise: liberté, égalité, fraternité, non seulement des symptômes de révolution sociale, mais encore les signes précurseurs d’un renouvellement de la foi chrétienne. Sa voix a, du reste, retenti dans un désert, celui de la tradition réactionnaire, et sa doctrine a été condamnée par le pape Grégoire XVI. A mesure que la question sociale revêtit une forme plus distincte et que la classe ouvrière adopta les idées socialistes, l’Eglise catholique prit à l’examen de ce problème un intérêt plus vif. Au début de la période actuelle, Lassalle, qui a toujours été plus idéaliste que Marx mit en avant son projet relatif à des associations d’ouvriers placées sous le contrôle de l’Etat, proposition qui, au premier abord, fut bien accueillie par le parti démocratique allemand, mais ne tarda pas à être remplacée par un plan de révolution sociale plus vaste.
La conception de Lassalle n’en fut pas moins une semence qui prit racine sur le sol étranger. Le baron de Ketteler, archevêque de Mayence, un prince de l’Eglise, trouva dans le projet de Lassalle le point de départ d’un programme économique pour l’Eglise elle-même. Dans son remarquable ouvrage intitulé : La chrétienté et la question du travail, il accepta le principe et parfois même le langage des théories socialistes. L’appel à la confiance en soi-même adressé aux pauvres par les libéraux de son temps lui fait l’effet d’une moquerie; pour délivrer les ouvriers du joug du capitalisme il faut, dit-il, les inviter à s’associer entre eux en vue d’écouler leurs produits, mais tandis que Lassalle avait réclamé de l’Etat aide et protection pour une organisation de ce genre, de Ketteler le demande à l’Eglise, et propose que les croyants s’entendent pour fournir par des dons volontaires les ressources nécessaires à cette émancipation industrielle. Ce qu’il faut d’après lui c’est un retour à l’esprit des anciens jours qui a fondé des monastères et construit des cathédrales; notre siècle a besoin d’un déploiement de libéralité chrétienne pareil à celui qui a enrichi la France et l’Angleterre des splendeurs de l’art gothique. «Que Dieu dans sa bonté, s’écrie-t-il, suscite bientôt des hommes qui répandent à pleines mains l’idée féconde des associations ouvrières chrétiennes.»
Il y avait quelque chose de noble et de généreux dans cette manière de comprendre le devoir social de l’Eglise; l’Allemagne se trouvait alors dans des conditions peu favorables à la réussite d’un pareil projet, mais la conception du baron de Ketteler, bien qu’elle ait disparu de l’horizon pour faire place à d’autres plans de socialisme catholique, n’en a pas moins été l’instrument d’un mouvement social intéressant sur le terrain de l’autorité de l’Eglise romaine. A peine le désordre social de 1871 eut-il pris fin en France, qu’un groupe de légitimistes cléricaux entreprit de réorganiser le travail sous l’égide de la religion. Le principal représentant de ce parti est aujourd’hui le comte de Mun qui, avec son éloquence toute militaire, réussit à trouver dans le programme du baron de Ketteler modifié par quelques autres catholiques sociaux allemands ce qu’il considère comme le nœud de la situation. Il faut, à l’en croire, faire revivre de nos jours ce système féodal connu au moyen âge, sous le nom de corporations; la liberté économique n’est qu’une illusion des temps modernes; la prétention des socialistes de faire reposer l’industrie sur la base d’une propriété collective est légitime et ne peut être écartée, mais cette propriété commune doit avoir un caractère religieux, être administrée par l’Eglise. La religion doit restaurer l’ancien ordre de choses et utiliser la législation dans ce but. L’Etat doit prêter main forte à l’Eglise, mais c’est à elle qu’incombe la tâche d’entreprendre, sous le patronage de la religion, la reconstitution des associations ouvrières que Lassalle a cherché vainement à ressusciter en faisant appel aux travailleurs.
A côté de cette résurrection originale de la féodalité industrielle, on a vu surgir en France un certain nombre d’associations fondées sur le principe volontaire qui ont imprimé une direction pratique à ce mouvement religieux et social. Il n’y a rien de plus idyllique dans le monde moderne que le spectacle offert par la fameuse usine créée par Léon Harmel au Val-des-Bois, où sous le nom de famille ouvrière s’abrite toute une population vivant d’une vie à part et formant un tout bien homogène; on peut se représenter d’après cela ce que serait le monde de l’industrie si tous les travailleurs français étaient catholiques et animés de la ferveur religieuse de Harmel. D’ailleurs, l’Eglise romaine elle-même, bien qu’elle ne se soit inféodée à aucune méthode particulière, a donné son approbation au projet de former une grande association catholique industrielle, car le pape en faisant allusion dans son Encyclique du 15 mai 1891 aux divers moyens d’assistance économique, s’est exprimé comme suit: «En
«premier lieu viennent les corporations artis-
«tiques et industrielles; les nécessités crois-
«santes de la vie actuelle exigent que l’on orga-
«nise aujourd’hui ces corporations en les adap-
«tant aux besoins de notre temps.» Un pareil langage, malgré toutes ses réticences, montre clairement quel intérêt on a pris à des entreprises comme celles de Harmel et aux projets parlementaires du comte de Mun. Un retour aux corporations peut nous sembler chimérique, excepté dans les étroites frontières d’une communauté de dévots, mais il puise sa force dans le fait qu’il est pour l’Eglise romaine le seul moyen de résoudre le problème économique et qu’il a reçu l’approbation de cet homme si habile et si diplomate qui a ambitionné le titre de Pape des classes ouvrières et des travailleurs.
Si nous jetons maintenant un coup d’œil sur le développement du christianisme social dans le protestantisme allemand, nous y trouverons avec moins d’esprit de suite et de clarté dans l’élaboration d’un programme une résolution non moins ferme de donner au mouvement social actuel un caractère religieux. L’histoire de ces essais a débuté avec l’œuvre d’un homme fort distingué, bien qu’on n’en parle plus guère aujourd’hui, le savant Victor Huber. Il s’était initié pendant ses séjours en Angleterre aux entreprises philanthropiques de Maurice, tout en correspondant avec le baron de Ketteler, et c’est ainsi qu’il devint comme un trait d’union entre le christianisme social d’Angleterre et celui d’Allemagne. Au premier, il emprunta sa foi dans la coopération industrielle dont il appliqua le principe non seulement aux Sociétés de production et de consommation, mais aussi à celles qui ont en vue des constructions, des prêts et, sous le nom de colonies familiales, la fondation de villages industriels; il puisa dans le second une grande confiance dans un système d’organisation chrétienne de l’industrie, qui eut pour résultat la fondation de ses «Associations en vue de l’ordre et de la liberté chrétienne». Mais Huber n’était pas fait pour vivre à une époque comme la nôtre; il s’était rattaché en politique au parti libéral de l’ancienne école, également opposé au mode de gouvernement paternel qui s’était déjà acclimaté en Allemagne et au socialisme révolutionnaire qui commençait à élaborer son programme; ses idées sociales manquaient, par suite, de point d’appui solide, car, d’une part, il ne voulait pas pour les Sociétés coopératives le secours de l’Etat et, de l’autre, refusait l’appui des démocrates sociaux. Il ne comptait pour réussir que sur l’initiative privée et le sentiment chrétien volontaire; il avait vu en Angleterre un petit nombre de gens instruits se consacrer avec ardeur aux œuvres sociales et s’était imaginé qu’il trouverait facilement en Allemagne des hommes d’initiative et d’action; mais il n’avait pas tenu compte du sentiment de réaction violente qui pousse les travailleurs allemands à refuser toute alliance avec les classes aisées; il manquait aussi un peu trop d’esprit de conciliation et s’isolait trop dans ses pensées. Aussi sa vie fut-elle pleine de déboires; il se retira en 1851 de l’Académie de Berlin pour aller vivre pendant dix-huit ans dans la retraite des montagnes du Hartz, et le résultat de ses efforts fut passager et médiocre. Il n’en fut pas moins, ne l’oublions pas, le premier protestant allemand qui proposa d’adopter au nom de la religion chrétienne un programme social déterminé. La philanthropie chrétienne, disait-il, ne doit pas se contenter de donner des aumônes et des secours aux malheureux; elle doit fournir aux nouveaux débouchés de l’industrie une organisation compacte et un appui fondé sur la mutualité. Mais tandis que les efforts tentés par Maurice, avaient trouvé en Angleterre un terrain propice, les projets du baron de Ketteler et de Huber, rencontrèrent en Allemagne de grandes difficultés, et grâce au socialisme d’Etat et au mouvement révolutionnaire, le libéralisme chétien eut de la peine à trouver un sol favorable à la réalisation de ses plans, et toutefois le jour viendra peut-être, où lorsqu’on aura expérimenté jusqu’au bout la prétendue prospérité résultant de la législation de l’Etat, on verra refleurir l’esprit d’entreprise individuelle et d’initiative religieuse, et si ce jour se lève jamais, on reconnaîtra alors les mérites de cet homme de foi qui crut à l’activité spontanée d’une Eglise vraiment chrétienne.
Une œuvre plus en harmonie avec le caractère ardent et passionné que le mouvement social a revêtu de nos jours est celle qui a été entreprise par cet autre Apôtre du christianisme social si éloquent et si puissant, qui s’appelle le pasteur Stocker. Pendant trente-cinq ans ce brillant orateur a été l’un des hommes les plus en vue et les plus critiqués de toute l’Allemagne. On a rarement incriminé les mobiles de sa prodigieuse activité, mais on ne peut songer aux brusques revirements politiques de sa carrière sans avoir l’impression d’une grande puissance gaspillée. Dès l’année 1878 alors qu’il était prédicateur de la Cour à Berlin il organisa son «association socialiste chrétienne du travail», sur la base de la foi chrétienne dans le but de «diminuer la distance qui sépare
«le riche du pauvre et d’assurer une plus
«grande mesure de sécurité économique». Il
répudia le parti démocratique social qu’il traitait de chimérique, antichrétien, antipatriotique, et chercha à substituer aux idées qu’il représentait un programme chrétien. Ce programme ne devait avoir aucun caractère ecclésiastique, car il estimait que l’Eglise n’est nullement chargée de ce soin; ce qu’il préconisait ce n’était pas une œuvre de secours faite par un clergé, mais une fédération de travailleurs associés dans le but de s’aider eux-mêmes. Il était difficile, on le comprendra aisément, à un prédicateur de la Cour d’une tournure d’esprit essentiellement conservatrice et entouré d’hommes appartenant à la classe des gens cultivés de gagner la confiance des ouvriers allemands; ses projets furent d’ailleurs battus en brèche par les lois que le gouvernement édicta contre les socialistes, car elles eurent pour effet de rendre les positions de ces derniers plus fortes et de détourner les esprits du parti du travail que Stocker avait réussi à fonder. Aussi son ardeur ne tarda-t-elle pas à dégénérer en une croisade moins noble et moins généreuse; la sympathie que lui avaient refusée les ouvriers, il la rencontra dans les rangs des petits commerçants dont la prospérité industrielle était menacée par un accroissement extraordinaire d’influence et de puissance parmi les Juifs. Les idées sociales de Stocker en se combinant avec ses vues théologiques le conduisirent peu à peu à transformer son socialisme chrétien des premiers jours en antisémitisme et depuis lors il a été plus connu comme l’adversaire acharné des Juifs que sous le nom d’ami des travailleurs. En 1895, ayant fini par comprendre que ses plans de rénovation sociale dans le domaine de l’industrie étaient irréalisables, il conçut avec ses partisans de plus vastes projets inspirés par un esprit plus conservateur que celui d’autrefois. Il organisa à Eisenach un parti du christianisme social, destiné dans sa pensée à «grouper d’après les prin-
«cipes chrétiens et patriotiques des gens appar-
«tenant à toutes les classes de la société, à
«toutes les catégories de travail et animés de
«l’esprit du christianisme social; leur but
«devait être de s’occuper des questions rela-
«tives à l’amélioration de la condition des
«ouvriers, de consacrer leurs efforts à favori -
«ser toutes les entreprises de production soit à
«la ville, soit à la campagne, dans le domaine
«de l’agriculture, de la vie industrielle et du
«travail intellectuel.» Ce parti qui devait avoir pour mission de «combattre toutes
«les théories antichrétiennes et anti-alle-
«mandes du faux libéralisme, du capita-
«lisme oppressif, du judaïsme rapace et du
«socialisme révolutionnaire», réunissait et combinait dans un seul et même programme les diverses conceptions sociales en vue desquelles Stocker était successivement parti en guerre, mais ce projet eut peu de succès à cause de son étendue même qui déroutait les esprits, et bien qu’appuyé par des hommes influents non seulement il ne fut pas voté par le Parlement, mais fut attaqué très vivement par le parti anticlérical. Le législation que Bismarck dirigea contre le socialisme rendit la position de Stocker intenable; en 1890, il résigna ses fonctions de prédicateur de la Cour, et depuis cette époque il est resté au Parlement comme un personnage isolé considéré par les uns avec une certaine admiration hésitante et par d’autres avec une hostilité toute particulière; mais quoi qu’il en soit il n’en demeure pas moins un des protestants allemands les plus éloquents, un de ceux qui ont insisté le plus fortement sur le devoir qui incombe à l’église chrétienne de notre temps de prendre toujours plus à cœur la question sociale.
Si donc le socialisme chrétien allemand a su se montrer ardent et généreux, on ne peut pas dire de lui qu’il ait réussi à élaborer un programme industriel bien défini et à exercer une action profonde. Il s’est trouvé placé entre deux feux, le dédain gouvernemental et celui de la démocratie sociale; il s’est heurté d’une part à l’attitude de l’empereur qui ne veut pas que le clergé fasse de politique, et de l’autre à cette thèse socialiste qui consiste à prétendre que la religion est une superstition destinée à travailler au maintien d’un capitalisme spoliateur. Il n’est pas étonnant qu’en face d’un pareil état de choses les projets mis en avant par les socialistes protestants d’Allemagne avec une certaine crânerie aient été taxés de don quichotisme et de pure chimère. L’avertissement donné par l’empereur se comprenait fort bien, car un pasteur desservant une Eglise officielle ne peut pas remplir les fonctions de son ministère et en même temps entrer en relation fraternelle avec le mouvement ouvrier. De deux choses l’une; ou bien sa liberté de parole lui fera perdre sa place ou bien il ne s’adressera qu’aux propriétaires et aux patrons. Le seul moyen qu’il ait de sortir de cette impasse, c’est de renoncer au ministère pastoral, de former un nouveau parti au Parlement et de se jeter dans la politique. Le socialisme chrétien doit être envisagé comme une solution politique destinée à remplacer celle de la démocratie sociale qui a la confiance du parti ouvrier; il accepte donc le programme économique des socialistes mais l’explique et le développe dans le sens de la religion chrétienne. Or quelque noble et désintéressée que soit une entreprise pareille, elle ne peut pas être considérée comme un pas en avant, car abandonner l’Eglise pour cause de religion, chercher dans la politique un moyen de provoquer un réveil religieux, faire alliance avec le parti socialiste pour tâcher de le supplanter, ce n’est pas un progrès, loin de là, et jusqu’à ce jour la désertion du ministère évangélique par ces pasteurs transformés en tribuns, n’a nullement exercé dans le domaine politique l’action puissante qu’on en attendait.
Il est inutile de citer d’autres exemples de socialisme chrétien; par les divers essais mentionnés plus haut, la vie chrétienne moderne a affirmé son droit de commenter et de diriger l’agitation sociale de notre époque, mais lorsqu’on songe aux nombreuses tentatives auxquelles l’aiguillon de ce grand devoir a donné naissance, on ne peut s’empêcher d’observer que l’un des éléments de cette enquête qui semble avoir le plus d’importance, est resté à l’arrière-plan. Au-dessus de toutes les obligations qu’il est nécessaire de rappeler à l’Eglise chrétienne et de toutes les revendications sociales que doivent faire entendre sur le terrain du christianisme les disciples du Christ, plane une question antérieure à toutes les autres, c’est celle de son enseignement. Qu’est-ce que Jésus-Christ a dit lui-même de ces diverses sphères de devoir social? Qu’elle est la doctrine de l’Evangile sur ce point? C’est là une question de première importance, car les différentes manières d’y répondre ne peuvent manquer d’influer au point de vue pratique sur l’esprit d’un disciple sincère et loyal du Christ.