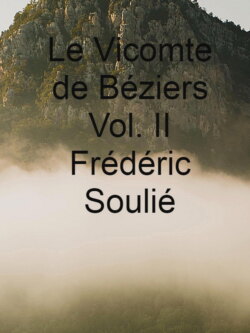Читать книгу Le Vicomte de Béziers Vol. II - Frédéric 1800-1847 Soulié - Страница 4
II.
Suites et Conséquences.
ОглавлениеLorsqu’un homme tombe d’un point élevé, du sommet d’une tour ou d’un arbre, le premier sentiment de sa chute n’a, pour ainsi dire, rien de douloureux, ou pour mieux dire, ce sentiment n’a rien d’aigu ; c’est un choc affreux, mais confus, qui peut tuer, mais sans que la victime ait la conscience de ce qui le tue, ni par où cela le tue. Ce premier instant passé, lorsque celui qui est tombé veut se relever, les douleurs se dessinent et se particularisent, c’est un bras rompu, un pied dénoué, le crâne entr’ouvert qui fait souffrir ; cet assommement universel se brise en souffrances partielles, moins complètes, sans doute, mais plus insupportables, car la conscience du mal revient, et la supputation de la douleur peut se faire à l’aise. Soit physique, soit morale, toute chute a de pareils résultats ; tout choc violent est suivi d’un anéantissement où se confondent toutes les douleurs, après lequel vient toujours l’heure où l’on compte les trahisons, les lâchetés, les abandons, les liens rompus, les espérances éteintes, trop heureux s’il ne reste pas au cœur quelques affections à moitié déchirées, et qui s’achèvent, dans le premier effort qu’on fait pour reprendre sa vie, et se remettre debout.
Si cette observation n’est pas vraie pour tous les hommes et toutes les circonstances, elle l’est du moins pour Roger et pour l’événement qui a fait la matière du dernier chapitre que nous avons écrit. Dès que Roger fut rentré dans sa maison, il demeura quelque temps silencieux et absorbé dans la réflexion de tout ce qui venait de se passer et de tout ce qu’il avait entendu. En se remettant en mémoire l’audace de l’interdit lancé contre lui, et l’habileté qui avait tissu les moindres actions de sa vie pour en faire un piège où il devait être pris, il s’irritait et se réjouissait presque ; il s’irritait de tant d’insolence, et se réjouissait de la nécessité où on le mettait de combattre et de briser sans ménagement toute cette tourbe qui s’attaquait à lui. Mais lorsqu’il arrivait aux derniers détails de cette scène, l’abandon de la plupart des chevaliers lui apparaissait dans tout son danger ; le triomphe de cette usurpation qu’il avait si vivement dénoncée lui semblait chose assurée, et il voyait se mourir toutes les flammes d’ambition qui couvaient depuis longtemps dans son esprit.
Si, comme la plupart de ceux de son temps, Roger n’eût porté en lui que la prétention d’être le plus terrible combattant de la Provence, rien de ce qui s’était passé n’eût sans douté porté atteinte à son orgueil ; mais Roger n’avait pas seulement le désir d’être un brave chevalier, cette gloire il l’avait acquise trop aisément, et la possédait trop supérieure et trop incontestable pour qu’elle pût lui suffire ; il avait surtout souhaité celle du politique, celle de l’homme hautement capable et intelligent. Son jeune génie avait même si bien compris l’époque où il vivait, que ce n’était pas d’elle qu’il attendait sa juste appréciation et sa récompense ; il espérait en l’avenir, soit pour le mettre à sa place, soit pour lui être reconnaissant de la puissante association qu’il voulait organiser pour la défense et l’indépendance de la Provence ; et c’est tout plein de ces hautes pensées, à l’instant même où il avait entrepris de les produire, qu’il se trouvait arrêté par la fourbe d’un moine et son audacieuse accusation. Son orgueil se révoltait de se voir réduit au rôle ordinaire des suzerains de son temps. Quelquefois il se demandait si Dominique l’avait deviné à toute sa portée, et si son acharnement ne venait point de ce qu’il avait conçu la puissance de ses desseins, la hauteur de ses vues ; mais alors il s’irritait, par-dessus tout, de la petitesse des moyens par lesquels on l’écrasait ; des intrigues de femme, des rapports avec des brigands, sa protection donnée à un hérétique, un baiser d’esclave, toutes actions qu’il ne comptait point dans sa vie comme associées à son existence politique, et avec lesquelles on tuait cependant celle-ci. Tout cela lui paraissait odieux et misérable.
Dans le cours de ses pensées, quelques soudaines illuminations d’espoir, non pour sa fortune, mais pour sa gloire, venaient cependant le consoler. Assuré qu’il ne pouvait triompher de la ligue qu’on allait organiser contre lui, il entrevoyait cependant que sa défaite pouvait le relever à la hauteur qui échappait à sa victoire, et qu’il pourrait forcer ses ennemis à le combattre par des moyens si énormes, qu’ils rendraient, malgré eux, sa chute un digne objet d’admiration. Toutes ces longues agitations de son âme s’étaient passées en lui, sans autre expression extérieure que celle d’une profonde et active préoccupation ; mais lorsqu’il se fut arrêté à cette dernière pensée, et qu’il l’eut changée en une détermination irrévocable, l’heure de douleur commença. C’est quand il voulut se relever, qu’il sentit tout ce qu’il y avait de brisé en lui.
Le premier soin qui lui vint à l’esprit fut d’appeler autour de lui ses plus fidèles amis ; le premier ami auquel il pensa fut Pons de Sabran. Ce simple souvenir changea tout le cours des pensées du vicomte ; l’homme intime, l’homme dévoué, l’homme qui vit d’amitié, d’amour et de puissantes affections se trouva meurtri, blessé, atteint au cœur. Cet abandon d’un jeune homme si loyalement aimé, si loyalement ami, désespéra sa courageuse résolution ; quelques larmes lui vinrent aux yeux. Il en triompha et voulut poursuivre ; mais son jour de malheur n’était pas fermé, et, comme nous l’avons dit plus haut, il se trouva d’autres sentiments qu’il ne soupçonnait pas atteints et qui achevèrent de se déchirer en lui et de se séparer de lui, dès qu’il voulut s’y rattacher ; et nous aurons le courage d’en faire le récit, pour montrer jusqu’où la fatalité poursuivit cet homme, jusqu’où elle le tortura, pour qu’il se trouve parmi nos lecteurs une larme de regret à tant d’infortune, un salut d’admiration donné à tant d’héroïsme.
Voilà où en était le vicomte depuis une heure à peu près qu’il était rentré. Lorsqu’il fut revenu de la stupeur où il était plongé d’abord, et de la préoccupation qui lui avait succédé, il fit appeler Buat ; dès que celui-ci fut entré :
— Buat, lui dit-il, prends vingt de tes hommes les plus déterminés, cours chez Catherine Rebuffe, dis-lui que l’heure est venue de tenir sa promesse, que le danger que je lui avais prédit s’est levé, qu’il faut qu’elle quitte Montpellier à l’instant ; tu lui diras de choisir pour sa demeure l’une de mes meilleures villes ; conseille-lui Carcassonne, et conduis-la cependant où elle désirera.
Buat s’éloigna, et au même instant parut Arnauld de Marvoill ; il avait l’air grave et soucieux, et considéra longtemps le vicomte avant de lui adresser la parole. Celui-ci, dont l’esprit agitait tout l’avenir de sa nouvelle destinée, s’apercevait bien de la présence d’Arnauld, mais il n’avait ni le temps, ni le désir d’interrompre ses réflexions pour lui donner audience. Enfin, Marvoill s’adressa à lui :
— Sire vicomte, lui dit-il, je viens vous demander votre congé pour quitter votre service.
— Toi ! s’écria Roger, ramené par ce peu de mots à la douleur de sa position, toi, tu me quittes, Arnauld, toi aussi ?
— Ne devais-je pas le faire hier ? dit Arnauld.
— Et mon malheur n’a pas changé ta résolution ; c’est d’un cœur héroïque : eh bien ! soit ; va-t’en.
— Je ne pars point seul, reprit Arnauld, et je vous apporte, sinon d’autres adieux, du moins d’autres désirs.
— De quel abandon vous êtes-vous fait messager ? reprit Roger ; parlez vite, maître : j’ai hâte de me sentir libre et éclairé dans mes amitiés et dans mes haines. Quel nouvel ennemi trouverai-je de plus au bout de ma lance ?
— Ce n’est point un ennemi, vicomte de Béziers, c’est une femme que vous avez chassée et qui s’en va.
— Agnès !
— Agnès qui n’accepte point votre ordre, mais qui vous transmet ses résolutions. Lorsque vous la chassiez pour lui sauver, disiez-vous, la honte de vous abandonner dans l’infortune, elle ne savait pas que cette infortune lui imposerait cette séparation comme un devoir.
— Vous avez trouvé ce devoir dans mon infortune, messire poète ; c’est d’un habile homme.
— Je l’ai trouvé dans la dignité d’Agnès de Montpellier, vicomte de Béziers. Aujourd’hui qu’il est publiquement reconnu qu’elle ne vous est que la dernière des femmes, moins que Catherine Rebuffe à qui vous donnez vos meilleures murailles pour asile, moins qu’une esclave noire que vous protégez contre son maître, et que vous avez impudiquement introduite dans le sanctuaire où languissait votre épouse, à quel titre voulez-vous qu’elle demeure dans cette maison ?
— À aucun titre, s’écria Roger, à aucun titre ; la pauvre enfant ! qu’elle parte, qu’elle me quitte, ce n’est pas à elle que j’en voudrai de me croire coupable. Allez, dites-lui que je veux la voir avant son départ ; j’ai à lui parler.
— À elle ? dit Marvoill.
— À elle, dit le vicomte avec hauteur, sans intermédiaire de conseiller, ni d’ami. Dites-lui que je l’en prie, et souvenez-vous que je le veux.
Le ton dont ces derniers mots avaient été prononcés ne permit pas à Arnauld la plus légère observation ; il sortit. Le vicomte frappa le timbre qui était à côté de lui ; Kaëb parut. Le vicomte toujours absorbé dans les pensées qui lui occupaient l’esprit, calculant sans cesse à part lui les mesures qu’il avait à prendre pour la grande lutte où il lui fallait se préparer, vît entrer son esclave sans le regarder, et lui dit tout aussitôt :
— Fais-moi venir mon argentier ; dis à Peillon de rassembler tout ce qu’il a des douze mille sols melgeriens qu’il a reçus de Raymond Lombard, et de les tenir prêts d’ici à une heure.
En disant ces mots, Roger avait la tête baissée et les yeux fixés à terre ; depuis quelques minutes il se croyait obéi, lorsqu’en relevant ses regards devant lui, il rencontra ceux de Kaëb qui semblaient vouloir plonger au plus profond de son cœur. Sans doute, il comprit la pensée de l’esclave, ou bien il la supposa telle qu’il l’aurait eue lui-même, car en l’apercevant ainsi debout et immobile, il se leva avec une expression de colère terrible.
— En suis-je donc là que je doive compte à chacun de mes actions, ou qu’il me faille répondre à tous ceux qui m’entourent des paroles qu’on a élevées contre moi ? Esclave, sors et obéis ; tais-toi et ne me regarde pas ainsi ; va-t’en, va-t’en donc ; ne vois-tu pas que je t’aurais déjà poignardé, si tu m’avais adressé une question ?
— Vous m’avez donc trahi puisque vous voulez me tuer, répondit Kaëb ; alors soyez meurtrier pour que je ne le devienne pas. Et tout aussitôt il se mit à genoux et tendit sa tête comme un condamné au bourreau.
Le vicomte se prit à rire, et le poussant du pied avec mépris, il répondit :
— Ton sang sur mon épée ! esclave, tu es fou ; il n’est bon que pour le fouet de mes chiens.
— Le fouet de vos chiens est usé, reprit Kaëb ; car une peau noire est dure à déchirer.
— C’est ce que mes valets sauront bientôt.
— Ils l’ont déjà appris, et ils sont fatigués pour l’avoir appris.
— Fatigués ! reprit Roger avec quelque surprise.
— Fatigués pour avoir frappé une femme sans avoir pu la faire crier.
— Une femme ! s’écria Roger à qui chaque parole de Kaëb paraissait une énigme, quelle femme ?
— Celle que tu leur as livrée d’abord, pour la livrer ensuite au bucher de tes prêtres.
— Oh ! je deviens fou, ou tu l’es déjà, esclave ; quelle est cette femme ? réponds.
— Ne l’entends-tu pas ? dit Kaëb ; ils ont enfin triomphé, écoute comme elle crie ; il faut qu’ils l’aient déchirée jusqu’aux mamelles pour que Foë crie ainsi.
Roger tout aussitôt en s’approchant de la fenêtre vit Foë qui se débattait entre les bras de ses valets ; ceux-ci la faisaient monter dans une litière qui s’éloigna au trot de deux mules qui la portaient.
Roger ne comprenait rien à tout ce qui se passait ; il avait appelé un de ses valets, qui était accouru, et il lui demandait d’une voix si irritée, qui avait donné l’ordre barbare de maltraiter ainsi cette malheureuse, que le serf stupéfait le regardait, la bouche béante, comme plus étonné que tremblant de cette question. On voyait qu’il paraissait n’avoir exécuté qu’un commandement de son maître. Enfin, il répondit à Roger dont la colère croissait à chaque moment :
— Nous avons obéi au sire de Saissac qui nous a dit que votre volonté était que cette esclave fût fouettée honteusement, et ensuite rendue au sire Raymond Lombard ; et c’est lorsque nous avons exécuté cette dernière partie des instructions du sire de Saissac, qu’elle s’est prise à crier et qu’elle s’est échappée de nos mains, car elle était demeurée immobile et silencieuse tant qu’avait duré le supplice.
Roger cherchait à comprendre les paroles de ce valet, et à s’expliquer comment le nom de Saissac se trouvait mêlé à sa réponse, lorsque le vieux chevalier parut lui-même. Il était accompagné de Pierre de Cabaret et de quelques autres châtelains des comtés de Roger, entr’autres, Guillaume de Minerve et Gérard de Pépieux. Roger, en voyant entrer Saissac, se plaça devant lui, croisa les bras, et le mesurant d’un regard irrité, il s’écria violemment :
— C’est donc toi, suzerain de Saissac, qui es descendu de ton nid de vautour pour prendre le commandement de mes valets et en faire des bourreaux de femme ? Tu crois donc que Milon m’a laissé beaucoup de patience, à défaut de beaucoup de puissance, pour supposer que je ne punirai pas cette insolente cruauté, tant qu’il me restera une main libre et une épée entière ?
— Roger, répondit Saissac sans prendre garde à cette menace, il faut que je te parle. Et d’un geste impératif il fit signe aux valets qui étaient accourus de s’éloigner.
Cependant Roger ne le quittait pas de l’œil, le mesurant des pieds à la tête, comme pour lui dire qu’il n’y avait place si bien couverte d’acier sur tout son corps que, lui Roger, ne pût la percer de son poignard, s’il n’avait eu pitié de sa vieillesse. Le peu d’instants que les valets mirent à sortir de la chambre porta au comble l’impatience de Roger qui s’écria, dès qu’ils furent seuls avec les autres chevaliers :
— Maintenant je t’écoute.
— Roger, dit Saissac, je sais tout ; il y a deux heures que je suis à Montpellier, et Pierre de Cabaret m’a tout appris. Il ne s’agit pas de te blâmer, il faut te sauver ; j’y ai dévoué ma vie ; écoute, et, au nom de ta mère je t’en supplie, crois une fois en ta vie les conseils de l’expérience.
Roger s’assit, et le regardant moqueusement il répondit :
— Voyons ces conseils.
Saissac ne se laissa point emporter par la colère qu’eût pu lui inspirer ce dédain, et il reprit avec la persévérance d’une véritable amitié :
— De tous les griefs que renferme l’accusation de Milon, trois seulement présentent quelque caractère de gravité, mais tous trois sont faciles à renverser. Le premier est ton aventure avec cette esclave ; la punition que je lui ai fait infliger et l’empressement que tu as mis à la rendre à son maître détruiront facilement cette accusation et il sera aisé de n’y montrer qu’une calomnie maladroitement inventée.
Roger écoutait, en souriant avec dérision, les raisonnements de Saissac ; celui-ci continua :
— Le second grief concerne la protection donnée au meurtrier de Pierre de Castelnau. Sans doute, tu prouveras facilement que tu ne le connaissais pas lorsque tu la lui as accordée, et, en le livrant à la punition qu’il mérite, tu satisferas aux justes réclamations de Milon.
Roger ne put retenir un rire de mépris et pitié à la fois ; ce rire était ensemble si insolent et si triste, qu’il étonna Saissac qui s’arrêta et dit au vicomte :
— Ne veux-tu pas m’entendre ?
— Oh ! je veux t’entendre, au contraire, répondit Roger en s’agitant sur sa chaise ; tu peux continuer.
— Saissac acheva : Le dernier grief est celui où tu es accusé d’hérésie ; la seule preuve qu’on en donne c’est que tu as assisté à l’hérétication d’un nommé Pierre Mauran, dans la maison d’une fille nommée Catherine Rebuffe. Eh bien ! il faut porter la peine d’une faute lorsqu’on l’a méritée ; mais il ne faut pas accepter le poids d’un interdit pour une légèreté excusable à ton âge. Tu diras la vérité, et tu avoueras que tu étais en amourette chez cette ribaude Catherine Rebuffe.
À ces mots Roger se redressa, pâle, agité, les dents serrées et les poings fermés, et demeura un instant immobile devant Saissac. Un instant il discuta en lui-même s’il ne le tuerait pas sur la place ; et, à coup sûr, si à ce moment il y eût eu devant lui un homme au lieu de ce vieillard ; si sur le visage de ce vieillard, au lieu d’y lire le dévouement maladroit d’un ami qui croyait avoir beaucoup fait pour son salut, Roger eût trouvé le moindre signe de bravade et de commandement, certes, homme ou vieillard, il l’eût saisi à la gorge, et de son bras forcené il lui eût brisé le crâne contre un mur ; mais cet homme était un vieillard, ce vieillard était un ami ; et Roger, se prenant la tête dans les mains, se pressa le front avec désespoir, et s’écria :
— Ah ! ces hommes sont fous ; sur mon âme, ils sont fous. Oh ! il faut qu’ils soient fous.
À leur tour les chevaliers considérèrent Roger avec étonnement, ils se parlèrent entre eux ; mais Roger, les interrompant soudainement, dit à Saissac avec une explosion terrible :
— Tu as appelé Catherine Rebuffe une ribaude, Saissac, et je te pardonne ; car tu es vieux, et je t’ai aimé comme mon père, car je n’ai pas eu le temps d’aimer mon père. Tu veux que je me défende d’un mensonge, et tu me demandes de faire le plus infâme mensonge que puisse faire un homme en cette terre ; un mensonge d’un homme contre une femme, d’un chevalier contre une femme, d’un suzerain qui a quatre comtés contre une femme, d’un soldat qui a une épée et une lance contre une femme : et cette femme est une fille bourgeoise sans puissance ; et cette femme est une enfant qui n’a ni frère ni père pour m’assassiner, s’ils ne pouvaient me combattre ; et cette femme est un ange de pureté et d’innocence. Ah ! j’ai raison, te dis-je, tu es fou ; il faut que tu sois fou.
— Je suis ton ami, Roger, reprit Saissac ; et si ce que j’ai dit te blesse si profondément, n’en parlons plus. Il nous reste d’autres moyens de satisfaire aux exigences de Rome ; et je pense que la fantaisie qui t’a livré cette esclave infidèle ne te tient pas si vivement au cœur que la nécessité de la rendre à son maître excite en toi la même colère.
— Vrai, dit Roger, nous l’avons fait fouetter comme une chienne de chasse, et nous l’avons jetée toute saignante à Raymond Lombard, et nous jurerons que c’est une calomnie d’avoir dit que j’avais cherché les baisers de cette femme ! Et si c’est une calomnie réellement, ne vois-tu pas que la vérité sera aussi impossible et aussi inutile en cette circonstance que le mensonge tout à l’heure ? Et ne vois-tu pas que si c’est une calomnie, et mes ennemis le savent, et mes amis ne l’ont pas supposé ; ne vois-tu pas que si c’est une calomnie, ils l’ont sans doute si habilement arrangée, que mes serments ne paraîtront que parjures, et que ma cruauté ne sera qu’un crime de plus ? Oh ! je te dis que tu es fou.
— Ainsi cette esclave,… dit Saissac.
— Cette esclave ! s’écria Roger avec emportement ; que m’importe cette esclave et son amour ? l’ai-je accepté ? l’ai-je partagé ? Suis-je coupable de ce qu’un moment elle s’est jetée comme une folle dans mes bras, et de ce qu’elle a touché mes lèvres des siennes ? Non ; mais pour cela il ne faut pas que je lave la souillure de ma bouche avec son sang ; il ne faut pas que je sois son bourreau.
— Eh bien ! dit Saissac, ce qui est fait est fait. Mon ignorance de tes rapports avec cette esclave nous a plus servi que nos meilleurs calculs ; car elle a été au-delà de ce que tu eusses voulu, et de ce que je t’eusse conseillé : il faut en profiter ; il faut accomplir l’œuvre par un dernier effort, par un dernier sacrifice.
— Et ce dernier effort, ce dernier sacrifice ?
— C’est de livrer l’assassin de Pierre de Castelnau à la justice des clercs et à ses bourreaux.
— Oh ! dit Roger amèrement et tristement, il faut que j’aie du cœur et de l’intelligence pour tous ; mais me croyez-vous donc si fort que vous m’apportiez en outre de mes dangers, en outre de mes peines, tous les embarras et toutes les douleurs de vos conseils et de vos résolutions folles ? Ce que tu me dis de faire, Saissac, j’en ai eu un instant la pensée ; un instant, quand tu as prononcé le nom de ribaude à côté de celui Catherine, il m’a pris envie de donner ce Buat au bourreau, et d’en réclamer la tête pour te l’envoyer ; je ne l’ai pas fait cependant, je ne le ferai pas, parce que, moi, j’aime ceux que j’aime, autrement que vous ne savez aimer, vous autres ; parce qu’il y a du sang et des larmes que je ne puis pas faire couler, moi…
— Roger, lui dit doucement Saissac, je ne te comprends pas ; mais si le sacrifice de cet homme doit te coûter, arme-toi de courage, car il est nécessaire.
— Saissac, n’en parlons plus ; bientôt tu sauras mes raisons.
— Bientôt ! dit Saissac ; il sera trop tard, l’heure presse.
— Ah ! dit Roger en reprenant son impatience, tais-toi ; d’ailleurs cet homme n’est plus à Montpellier.
— Il y est, dit Saissac.
— Il en est parti à cette heure.
— À cette heure il doit être arrêté en sortant de chez Catherine Rebuffe où on l’a vu entrer.
— Et c’est par ton ordre ? s’écria Roger reprenant toute sa colère.
— C’est par mon ordre.
— Oh ! Saissac, reprit Roger en saisissant son manteau et son chaperon, et s’avançant vers la porte ; tu répondras de cet homme à l’âme qui est au ciel, s’il a péri ; tu répondras de Catherine à moi, si elle est perdue par ta faute.
— Elle est perdue pour vous, dit un homme en entrant.
— Buat ! s’écria Roger ; car c’était Buat qui venait d’entrer. Buat, Catherine est perdue pour moi, dis-tu, et par ta faute, Saissac, sans doute…
— Par sa volonté ; lisez. Et il remit à Roger un parchemin roulé.
Pendant le temps qu’avaient duré toutes les scènes que nous venons d’écrire, la nuit était venue, et Roger ne put lire à l’instant le billet de Catherine ; il appela pour qu’on lui apportât un flambeau, et, pendant qu’un de ses serviteurs courait le chercher, il se mit à interroger Buat.
— Que t’a-t-elle répondu ?
— Rien.
— L’as-tu vue ?
— Oui.
— Lui as-tu dit ce que je t’avais dit ?
— Je le lui ai dit.
— Tout ?
— Tout.
— Mes propres paroles ?
— Vos propres paroles.
— Et que t’a-t-elle répondu ?
— Rien.
— Rien !… Il faut que je la voie.
— Vous ne la verrez plus.
— Est-elle partie ?
— Comme elle me remettait cet écrit, la garde des consuls est arrivée. Le sire de Rastoing la commandait. Il a fait monter Catherine dans une litière ; et ils se sont éloignés.
— C’est violence, cria Roger.
— Elle a dit au sire de Rastoing : Je vous attendais.
À ce moment on apporta le flambeau. Roger le saisit, et se retourna pour lire la lettre de Catherine. Il aperçut alors les chevaliers excités tout bas par Saissac ; ils avaient tiré leurs épées, et s’étaient glissés le long de la porte. Aussitôt Saissac s’écria :
— Voilà l’assassin de Pierre de Castelnau ! saisissez-le. Et comme ils allaient s’élancer vers lui, Roger, par un mouvement rapide et irrésistible comme la foudre, saisit Saissac par le bras ; et, le traînant jusque auprès de Buat, il lui cria avec une colère mêlée d’une singulière émotion :
— Mais regarde-le donc, malheureux, regarde-le donc.
À ces mots, il posa son flambeau près du pâle et beau visage de Buat. À cet aspect, Saissac laissa tomber son épée qui retentit sur le pavé, et ses bras tendus vers Buat pour le saisir semblèrent s’ouvrir pour l’embrasser ; mais Roger, l’arrêtant encore, lui dit rapidement, d’une voix triste et profonde :
— Pas devant eux, pas devant moi, Saissac. Ne vois-tu pas qu’il y a un nom qui doit m’être sacré, et sacré à toute la terre, que vous prononceriez dans vos embrassements !
Et sur-le-champ il les laissa l’un en face de l’autre, et se mit à lire la lettre que lui avait apportée Buat. La voici :
« Roger, je t’ai dit : On m’appellera une fille perdue, quoique je sois innocente ; mais j’aurai ton amour en place de renom et de vertu, et je vivrai heureuse. On m’appelle une fille perdue, et je n’ai pas ton amour. Je n’ai pas pu mourir : plains-moi. Foë est donc bien belle ! »
— Oh ! s’écria Roger en tombant sur un siège avec désespoir. Elle aussi ! elle !… Ils me l’ont tuée et prise. Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !
Puis il éclata en amères exclamations et en cris terribles et sans suite, qui lui déchiraient la poitrine ; et Saissac, qui venait de comprendre qu’il y a d’autres dangers que ceux de la puissance menacée, d’autres douleurs que celles du suzerain en guerre avec tous ceux de sa contrée, Saissac s’approcha pour le consoler. Mais Roger ne l’écoutait ni lui ni les autres. Quant à Buat, il ne parlait pas ; Buat était un cœur de la trempe de Roger, qui sait qu’il y a des tortures de l’âme pour lesquelles il n’y a pas de baume dans les paroles d’un homme. Nos lecteurs ont bien deviné qu’ils étaient frères.
Il y a de ces fatalités ingénieuses, de ces heures terribles qui trouvent à croître la douleur quand il semble qu’il n’y a plus matière à souffrance dans l’homme, et alors il arrive qu’à ce moment de comble les plus faibles sont les plus accablantes ; les plus présumables deviennent les plus imprévues ; les plus indifférentes sont tortionnaires. Après la perte de Catherine, que restait-il d’amour à briser au cœur de Roger ? après l’abandon de Pons, quel abandon le pouvait étonner ? Ce ne fut rien, presque rien ; mais ce fut la goutte d’eau surabondante, le vase en déborda. Un homme entra. C’était Arnauld de Marvoill.
— Agnès de Montpellier, dit-il, attend votre bon plaisir de la recevoir avant de s’éloigner de cette maison.
Roger essuya ses larmes, et se remit : cependant il n’eut pas la force de se lever. Agnès entra. Elle était pâle, et avait les yeux baissés. Elle s’approcha en tremblant.
— Buat, dit-il, fais appeler Peillon. Puis il se tourna vers la vicomtesse.
— Agnès, lui dit-il, vous allez me quitter ; mais il ne faut pas, je ne veux pas que vous ayez à mendier de qui que ce soit, fût-ce de votre frère d’Aragon, ou de votre sœur Marie, un asile qu’un mot ou un regard pourrait vous reprocher ou vous rendre odieux. Aujourd’hui, dans cette ville qui m’est ennemie, je ne puis faire pour vous tout ce que je dois ; car, Dieu sait, dans l’état d’interdit et de malédiction où je suis, si j’y trouverais des hommes pour approuver de leur sceau et témoigner par leurs noms des donations que je veux vous faire. Les temps viendront, je l’espère, où j’accomplirai ce devoir. Ne considérez donc ce que je fais en ce moment que comme le premier paiement de la dette que je contracte ici envers vous. C’est tout ce que je puis, Agnès. J’espère que je n’ai pas perdu si complètement l’estime de toutes les âmes que vous ne soyez assurée que je fais tout ce que je puis.
— Seigneur vicomte, dit Agnès, je ne puis ni ne dois…
— Ne me refusez pas, Agnès, dit le vicomte, je vous en prie. Ce que je vais vous donner ne suffit pas à la vie d’une femme ; ce qui me restera, dût-on m’arracher mes quatre comtés, suffira toujours à la vie d’un homme. Il me restera mon épée, et quand je n’aurai plus ni ville, ni bourg, ni palais, ni chaumière, ni toit où abriter ma tête, je la planterai sur quelque lande stérile ou sur quelque grève déserte et je me coucherai à côté, sûr de ma vie comme sous la main de Dieu.
Agnès ne répondit pas, et Buat rentra aussitôt : mais il avait à la fois l’air consterné et irrité.
— Peillon est parti, s’écria-t-il ; Peillon s’est enfui, emportant votre trésor et tout l’or que vous lui aviez confié.
— Peillon est parti, s’écria Roger en se relevant le visage consterné et le regard perdu.
— Seigneur, dit Agnès timidement, je n’ai besoin de rien.
— Oh ! merci, merci, de votre pitié, Madame, dit Roger en se laissant aller à pleurer comme un enfant ; vous voyez bien que je suis le plus malheureux des hommes.
Et comme Agnès, entraînée par Arnauld, s’éloignait lentement, et en jetant sur Roger un regard qui semblait lui demander la permission de rester, il se reprit à dire, comme un homme sans force et sans courage :
— N’est-ce pas que je suis bien malheureux ?
Puis quand cette jeune fille fut sortie, comme si elle emportait sa dernière espérance, comme si elle brisait le dernier lien qui l’attachait au monde, cette jeune fille, qu’il détestait la veille, il tomba à genoux et s’écria :
— Mon Dieu, mon Dieu ! prenez pitié de moi ! Et il s’évanouit.