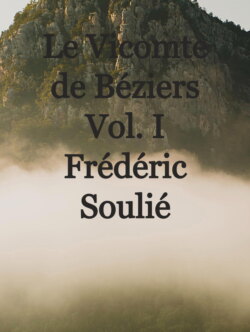Читать книгу Le Vicomte de Béziers Vol. I - Frédéric 1800-1847 Soulié - Страница 6
III.
L’ESCLAVE.
ОглавлениеLa nuit commençait et les sommets des Pyrénées se perdaient dans les brumes qui s’élevaient à l’horizon, lorsque Roger arriva à la poterne. Deux chevaux étaient préparés, non point bardés de fer et le frontail en tête comme pour une bataille, mais tous deux avec une étroite couverte en fourrure de renard, retenue par une seule sangle sans étriers ni caparaçons. Un filet suffisait à les gouverner. Tous deux de taille moyenne, tous deux de pure race arabe ; l’un noir et luisant comme le plumage d’un corbeau ; l’autre de ce bai brun ondulé comme l’écorce des châtaignes mûres. À l’approche de Roger les chevaux pointèrent leurs courtes oreilles, et le beau coursier noir hennit à diverses fois en relevant la tête et en piétinant.
— Bien, Algibeck, dit Roger en le flattant, tu es beau mon cheval ; alerte ! cette nuit nous allons voir Catherine.
Et il sauta sur le noble animal, qui partit comme un trait ; et Roger, calmant sa fougueuse rapidité, se penchait jusque sur son cou ; et, passant ses mains dans ses longs crins, comme s’il caressait un enfant, il l’apaisait et lui parlait tout bas.
— Doucement, mon beau cheval, lui disait-il, la route est longue, et si tu pars ainsi tu épuiseras ton haleine. Nous n’allons pas seulement aujourd’hui à l’abbaye de Saint-Hilaire boire le vin des religieux, au milieu des danses et des chansons des jongleurs ; nous n’allons pas non plus chez les recluses de Campendu, où les mains blanches des plus belles filles du Razez te donnent l’avoine et te préparent un lit de fougère. Je n’ai plus désir ni de leurs voix célestes, ni de leurs baisers d’amour ; ces courses de quelques heures t’ont rendu impatient ; mais calme-toi, car nous ne verrons pas le but de notre voyage avant la nuit prochaine. Montpellier est loin d’ici ; et je ne veux pas que tu arrives sous les fenêtres de Catherine, haletant et fourbu. Je veux qu’elle te trouve beau aussi, noble Algibeck : doucement ! plus doucement encore.
Et le joyeux coursier volait en bondissant ; quelquefois il recourbait sa tête de côté comme s’il voulait mordre le bout du pied qui serrait ses flancs. Alors il caracolait ; il semblait agacer son cavalier ; il arrondissait son galop et ployait comme un cygne son cou noir et nerveux, puis il le relevait vivement comme un arc qui se détend, et s’élançant plus rapide, l’œil brûlant, les naseaux ouverts, il jetait au vent des flammèches d’écume et faisait siffler derrière lui les pierres du chemin qu’il broyait de ses pieds mordants. Ainsi coururent longtemps le cheval et son cavalier, comme deux compagnons qui se comprennent : le maître, quelquefois immobile et pensif sur la course unie et facile de son cheval, d’autres fois gai et souriant, tandis que le coursier hennissait, secouant sa crinière et fouettant l’air de sa queue ; tous les deux quelquefois tourmentant, l’un sa pensée par d’amères réflexions qui se combattaient dans son esprit, l’autre son galop qui devenait inégal et heurté.
Kaëb venait, suivant son maître de près. Cependant depuis qu’il était parti, sa marche était restée uniforme, et, bien que son cheval parût moins vigoureux que celui de Roger, sa rapidité patiente l’avait maintenu à une courte distance, sans que rien décelât en lui la moindre fatigue. La nuit était enfin tombée, et, soit crainte de surprise, soit toute autre raison, Kaëb peu à peu s’était rapproché de Roger, et bientôt il marcha tout à fait à ses côtés. Roger jeta un léger coup d’œil sur son esclave. Puis, après un moment de silence, il lui dit :
— Je n’ai pas été content de toi ce matin, Kaëb : à vingt ans on lance une flèche mieux que tu ne l’as fait.
— C’est que mes bracelets me gênent, répondit Kaëb en montrant ces signes de son esclavage.
— Fais-toi chrétien, et ils tomberont demain, reprit Roger.
— Votre pape écrivit la même chose que vous venez de me dire à Asser, calife de Bagdad : savez-vous ce que celui-ci lui répondit ? Je me ferai chrétien quand vous vous ferez mahométan.
— Reste donc ce que tu voudras, ajouta Roger avec insouciance, mais musulman ou chrétien, esclave ou libre, tâche de savoir mieux te servir d’un arc et d’une flèche.
— La flèche est une arme qui a l’œil et le vent pour guides, répondit froidement Kaëb ; le poignard est plus sûr, il ne quitte pas la main.
— Mais, ajouta Roger en faisant allusion à sa querelle avec Saissac, le nid du vautour est si élevé quelquefois que nul bras ne peut l’atteindre et que le vol d’une flèche y peut seul arriver.
— Les serpents de l’Afrique, reprit Kaëb toujours insensible, se nourrissent des œufs du condor qui bâtit son aire sur des pointes de roc où nulle flèche ne pourrait monter.
— Et comment y arrivent-ils ? répliqua Roger avec dédain.
— En rampant, répondit l’esclave.
À ce mot, Roger, par un mouvement instinctif, serra dans sa main son long bâton ferré avec lequel il jouait nonchalamment ; il regarda Kaëb, mais rien ne transpirait sur son visage des sentiments de son âme. C’était un masque immobile, un regard indifférent, une inexpression complète. Ils continuèrent leur route. Tout à coup, comme d’un commun accord, les chevaux ralentirent leur course ; celui de Kaëb aspira l’air avec force, et pointa ses oreilles. L’impatient Algibeck, lui-même, prit aussi un galop moins hardi, et, le nez au vent, il sembla flairer l’espace. Le vicomte se retourna vers Kaëb, qui ne laissa voir ni surprise, ni crainte ; seulement son œil plus ouvert et qui rayonnait d’un éclat singulier semblait vouloir percer l’obscurité.
— Il y a quelqu’un sur la route, dit le vicomte d’un ton d’interrogation et de menace à la fois.
— Oui, dit Kaëb, des hommes à cheval à coup sûr, car nos coursiers, d’abord intimidés, reprennent leur vol ; voyez comme ils s’étendent et se déploient : il y a quelque chaude cavale sur cette route.
Et en effet, les deux chevaux s’allongeaient rasant la terre comme des lévriers, côte à côte, déjà rivaux, essayant d’échanger une morsure, ruant dans leur galop et hennissant aux fades odeurs de la brise. Ils s’animèrent l’un l’autre, et, bien que Kaëb ne parût pas presser son coursier plus qu’il n’avait fait jusqu’à ce moment, sa marche devenait si rapide qu’elle dépassait quelquefois la course d’Algibeck. Un soupçon vint à l’esprit de Roger ; il savait combien d’ennemis sa fougueuse jeunesse lui avait attirés. L’un d’eux n’avait-il pas pu être averti par son esclave de ses projets de voyage nocturne ? une embûche ne pouvait-elle pas avoir été dressée sur son passage ? et Kaëb ne l’entraînait-il pas alors dans un piège adroitement préparé ? Le vicomte discutait avec lui-même ce qu’il devait résoudre ; car, quoique la conduite de Kaëb ne lui eût jamais donné lieu de croire à une trahison de sa part, cependant son caractère taciturne pouvait cacher une profonde astuce aussi bien qu’un complet dévouement. La rapidité de la course de Kaëb s’augmentait encore, et Roger s’apprêtait à l’arrêter lorsqu’une bouffée de vent leur apporta le bruit lointain d’un hennissement, et soudain le cheval de l’esclave, bondissant deux fois sur lui-même, s’arrêta immobile et comme si ses pieds s’étaient fichés en terre. Roger retint Algibeck, et l’Africain, se tournant alors vers son maître, lui dit :
— Roger, mon maître, ceci est l’heure de la vie ou de la mort pour moi. Pour toi, c’est l’heure de faire de Kaëb un malheureux qui brisera sa chaîne, fût-elle d’acier ; dût-il le faire avec son poignard ; aujourd’hui ou demain ; dans sa poitrine ou dans la tienne. C’est l’heure aussi de faire de Kaëb un esclave avec un cœur de chien et les ongles d’un tigre, un esclave qui te prêtera son corps pour marchepied, qui t’obéira comme ta main t’obéit, qui frappera comme ta main peut frapper sans réflexion ni révolte. Cet esclave sera un bras de plus à ton corps ; un bras qui descendra ou montera où le vicomte Roger ne peut peut-être ni monter ni descendre. Ce sera un œil qui verra tout, une oreille qui entendra tout, une bouche qui dira tout. Ce sera tout un homme qui n’a au cœur ni crainte superstitieuse qui fasse plier ses genoux ou son poignard devant l’anathème d’un prêtre chrétien, ni fol orgueil qui l’empêche de se coucher à terre pour attendre ses ennemis dans l’ombre. Choisis entre ces deux hommes.
— Je ne crains pas le premier, et n’ai pas besoin du second, répondit hautainement Roger ; mais tu m’as menacé, esclave, et tu seras puni : tourne la bride de ton cheval et rentre à Carcassonne.
Pour la première fois depuis un an que Kaëb appartenait à Roger, l’obéissance ne fut pas aussi rapide que le commandement. Roger était presque sans armes, et Kaëb avait gardé son sabre courbé et son poignard de Damas ; le vicomte reprit tout à coup ses soupçons.
— M’as-tu entendu, esclave ? s’écria-t-il avec colère.
— Je t’ai entendu, maître, répondit Kaëb avec résolution ; mais toi, tu ne m’as pas entendu. Vois cette route, chasse-moi devant toi du côté où nous allons, au lieu de me faire retourner en arrière, et tu auras l’esclave fidèle ; tu auras le cœur, le bras et la vie d’un homme, plus à toi que ton bras, que ton cœur, que ta propre vie ; car tu pourras les jeter à qui tu voudras, à un crime et à un bourreau. Mais si tu me fais retourner en arrière, alors, Roger, ce sera le serpent que tu auras dans ta main.
— Encore une menace, répliqua le vicomte avec emportement, retourne !
Et comme Kaëb n’obéit pas, un coup du lourd bâton de Roger tomba sur la main gauche qui tenait la bride, et la main brisée laissa pendre la bride sur la crinière du cheval. Nul cri ne s’échappa de la poitrine de Kaëb à cette douleur : on eût même dit qu’il n’avait pas été atteint ; car, la tête tournée vers l’horizon, il semblait écouter. Une rafale de vent leur apporta encore le même bruit, le même hennissement, mais plus lointain et comme plaintif. Kaëb ramena ses regards sur son maître, et soulevant son poignet qui pendait inerte et brisé, il lui dit doucement :
— Eh ! maintenant encore, accepte, Roger, accepte.
— Des conditions de mon esclave ! reprit le vicomte, aucune.
— Alors, dit Kaëb, tue-moi tout de suite, car je ne retournerai pas. Sens-tu cette haleine de vent qui m’apportait la vie que tu vas m’ôter, laisse-moi la respirer un moment.
Et le bruit lointain arriva encore une fois ; mais si effacé qu’il troubla à peine le profond silence de la nuit. Kaëb tressaillit.
— Oh ! maître, dit-il en sanglotant et en montrant la route ; là-bas, là-bas !
Roger, étonné de cette obstination, ne put s’empêcher de lui dire :
— Mais nous y courions tous les deux.
— Mais il faut que j’arrive seul, dit l’esclave, seul à l’endroit d’où part ce bruit. Retardez d’une heure votre course, d’une demi-heure seulement, et cet instant vous aura valu une longue vie de dévouement.
— Mais pourquoi ? demanda Roger en qui la curiosité faisait place à la colère.
— Parce que, répondit Kaëb… Et comme il allait continuer, une nouvelle ondée de vent souleva les cheveux de Roger ; mais muette et sans rien apporter avec elle, ni bruit pour Roger, ni espérance, ni joie pour Kaëb ; il baissa tristement la tête, et tournant son cheval du côté de Carcassonne, il dit à voix basse :
— Ah ! ma vie s’en va, ma vie s’est en allée.
Roger le regardait s’éloigner, lorsque Kaëb se redressa soudain, et revint près de son maître ; puis, avec une inexprimable prière dans le regard, dans la voix, dans le geste, il lui dit en lui tendant sa main droite :
— Maître, casse-moi encore ce bras et laisse-moi partir.
— Kaëb, lui dit son maître, vaincu par cette singulière et sombre résolution, pars donc ; tu vas à un amour ou à une vengeance ; car on ne marche pas si obstinément à une trahison. Mais je te veux rendre le temps que je t’ai ravi. Prends cette écharpe de lin, enveloppe ton bras et monte mon bel Algibeck qui te portera comme le vent.
— Roger, lui répondit Kaëb avec un regard de joie, garde ton cheval et ton écharpe, tu m’as donné tout ce que je voulais de toi, et pour ce que tu m’as donné, je t’appartiens désormais, car c’est moi qui me donne à toi maintenant. Regarde donc ce que tu as acheté pour un mot ; car tu ne connaissais ni Kaëb ni son coursier.
Aussitôt, de sa main droite, il descendit jusqu’à son poignet le bracelet d’or qui entourait son bras gauche, et, le serrant violemment dans ses dents, il l’aplatit et le rendit assez étroit pour maintenir la fracture, puis, s’inclinant sur le garrot de son cheval, il le fit partir avec une rapidité dont nulle expression ne peut donner l’idée.
Algibeck surpris de ce départ s’élança à son tour, et tandis que Roger s’occupait à le calmer et à le retenir, Kaëb disparut, et bientôt après le bruit de son galop ardent diminua rapidement, et s’éteignit tout à fait dans le silence de la nuit.