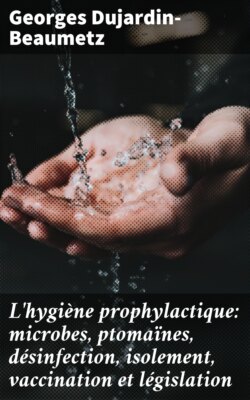Читать книгу L'hygiène prophylactique: microbes, ptomaïnes, désinfection, isolement, vaccination et législation - Georges Dujardin-Beaumetz - Страница 5
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA DOCTRINE MICROBIENNE
ОглавлениеMESSIEURS,
L’année dernière, j’ai consacré mes leçons à l’hygiène thérapeutique proprement dite, dont j’avais exposé une partie déjà l’année précédente en parlant de l’hygiène alimentaire . Je veux aujourd’hui compléter ce sujet en consacrant ces conférences à l’hygiène prophylactique. Nous aurons ainsi successivement passé en revue, dans ces trois années, toutes les ressources que l’hygiène peut fournir à la thérapeutique pour la cure et la préservation des maladies.
La prophylaxie est entrée dans une voie scientifique nouvelle, basée tout entière sur les deux grandes découvertes suivantes: d’une part, sur la découverte des micro-organismes pathogènes, de l’autre, sur la production incessante faite par l’économie d’alcaloïdes toxiques, ptomaïnes ou leucomaïnes. Aussi, pour que vous puissiez bien saisir les développements dans lesquels j’entrerai dans la suite de ces conférences, je me propose d’étudier d’une manière générale ces microbes pathogènes et ces alcaloïdes toxiques, puis une fois ces données acquises, nous verrons comment nous devons aujourd’hui comprendre les mots infection et intoxication, et je m’efforcerai d’établir que si l’infection est le résultat des microbes pathogènes, l’intoxication résulte, au contraire, de la présence en trop grande quantité de ces ptomaïnes et leucomaïnes.
Mais avant d’aller plus loin, il me paraît nécessaire de jeter un coup d’œil d’ensemble sur les progrès imprimés à la thérapeutique et à l’hygiène par les découvertes de Pasteur, et je consacrerai cette première conférence à des considérations générales sur la doctrine microbienne.
De toutes les découvertes déjà si importantes de notre illustre compatriote, il n’en est pas de plus utiles que celles qui trouvent leur application dans le domaine hygiénique et médical, et, par le seul fait de ces découvertes, Pasteur doit être considéré comme l’un des hommes qui ont le plus fait pour l’humanité et dont le nom doit être placé bien au-dessus de celui de Jenner; car, comme on l’a fort bien dit, si celui-ci a fait une rencontre de génie, Pasteur, par l’ensemble de ses découvertes, a trouvé une méthode de génie.
De la santé et de la maladie.
On a défini de façons bien différentes la santé et la maladie, et ces définitions reflètent les opinions dominantes des diverses écoles médicales qui les ont données. Spiritualistes et dynamiques avec les vitalistes, ces définitions sont devenues iatro-chimiques, solidistes avec les organiciens et organo-vitalistes avec les éclectiques. Je ne veux pas ajouter une définition nouvelle à celles qui ont été déjà données, mais pour que vous saisissiez bien le rôle que jouent les micro-organismes pathogènes dans l’économie, il me paraît nécessaire de vous montrer comment nous pouvons comprendre, de nos jours, l’état de santé.
Les immortels travaux de Bichat avaient déjà porté un coup sensible aux adeptes de la doctrine barthézienne, qui voulait que la maladie fût une affection du principe vital. Mais ce fut surtout le perfectionnement apporté aux études histologiques qui modifia le plus profondément cette doctrine éminemment vitaliste. L’histologie montra que nous pouvons ramener la constitution vivante de nos tissus à une seule unité, la cellule; cette cellule qui a sa vie propre, son mode d’alimentation spécial, ses produits d’excrétion, nous la retrouvons dans les organismes rudimentaires comme dans les êtres les plus perfectionnés.
De la doctrine cellulaire.
Ces unités vivantes, selon l’heureuse comparaison que Duclaux en a donnée dans son beau livre sur le Microbe et la Maladie, constituent par leur agglomération un véritable empire, réunion de cités plus ou moins florissantes, ayant chacune leur vie propre, mais exigeant pour leur existence des conditions spéciales. Cellules policées, elles réclament une nourriture particulière qui doit leur être apportée d’une façon suffisante par les nombreux vaisseaux qui relient ces cités entre elles, comparables à nos routes et à nos canaux. Il faut aussi que le produit excrémentitiel de chacune d’elles trouve une issue rapide et qu’un système d’égout, permettez-moi l’expression, conduise au dehors leurs excrétions journalières. Il faut enfin qu’elles puissent communiquer les unes avec les autres et qu’elles obéissent au pouvoir central qui les dirige; ce rôle est dévolu au système nerveux dont les branches représenteraient, dans la comparaison que je viens de vous faire, les fils télégraphiques d’un réseau admirablement organisé.
La santé résulte du bon fonctionnement de chacune de ces cités, de l’harmonie des concours que chacune y apporte, et de l’appui réciproque qu’elles se prêtent l’une à l’autre. Examinons maintenant quelles sont les circonstances qui viennent rompre cette harmonie. D’abord, c’est l’âge même de ces cellules, et cet empire, si florissant au début de la vie et à l’âge adulte, verra ses forces s’amoindrir à mesure que les années s’avanceront; puis les périodes de déclin et de décrépitude se feront sentir, la mort surviendra et, de cet empire puissant, il ne restera plus que les parties minérales, vestiges de la grandeur du passé, comparables à ces monuments que l’explorateur découvre par des fouilles persévérantes et qui indiquent, par leur présence, qu’une grande cité ou qu’un grand peuple a existé sur ce sol aujourd’hui désert.
Dans d’autres circonstances, c’est la nourriture nécessaire à la vie de chacune de ces cellules qui ne lui parviendra pas en quantité suffisante; la route destinée à les faire arriver s’oblitérant, la cité succombera.
Ou bien ce seront les voies d’excrétion qui seront bouchées, et, de même que nous voyons nos grandes villes infestées par le mauvais fonctionnement de leurs égouts, de même l’économie sera empoisonnée plus ou moins rapidement par cette rétention des produits excrémentitiels.
Enfin, il peut arriver que certaines cités rompront le pacte qui les unit entre elles; elles voudront vivre d’une vie indépendante; leurs cellules prendront un développement anormal et, n’obéissant plus au pouvoir central, elles constitueront une cause d’affaiblissement et de mort pour l’organisme tout entier; c’est ce qui arrive pour les tumeurs de nature maligne.
Des microbes pathogènes.
Cet empire, si bien organisé, a sur ses frontières de nombreux ennemis qui l’attaquent incessamment. Ces ennemis, ce sont les barbares qui ne connaissent qu’une loi, la loi de la multiplication; ils ont une existence individuelle, vivant d’ailleurs de peu, de rien pour ainsi dire, ce sont les microbes pathogènes.
Que la moindre fissure se fasse à l’extérieur, ces microbes pénétreront dans l’économie, et il leur suffira de quelques heures, dans certains cas, pour détruire à jamais cet organisme si résistant. Mais il n’en est pas toujours ainsi, et par bonheur, grâce à la bonne organisation de l’économie tout entière, grâce à la surveillance si active qu’elle exerce sur toutes ses frontières, l’invasion ne pourra se produire, ou si elle se fait, les premiers occupants seront rapidement expulsés au dehors ou détruits.
Dans certaines circonstances, la résistance fléchira sur quelques points et nous verrons alors les micro-organismes occuper, soit à titre permanent ou passager, soit à titre définitif, certains points du territoire. Ainsi cantonnés, les micro-organismes tendront à faire des excursions nouvelles sur le pays ennemi, mais si les mesures sont bien prises, si les nouvelles frontières sont bien gardées, l’infection restera toute locale, et même l’organisme, ayant pris de nouvelles forces et ayant rassemblé de nouveaux éléments de combat, pourra chasser hors de son territoire les barbares qui l’occupent. C’est ce qui arrive pour bien des affections, pour la tuberculose, par exemple, que nous voyons rester pendant des années, pendant toute la vie, localisée en un point du corps et pouvant même guérir sans que pour cela les bacilles aient envahi l’économie tout entière.
Dans d’autres circonstances, la multiplication incessante des micro-organismes, qui a été une des causes de la victoire qu’ils ont remportée sur l’organisme qu’ils attaquent, est aussi une cause de leur déchéance. Au début, ils trouvaient dans le pays conquis une nourriture abondante; mais leur nombre toujours croissant diminue rapidement cette prospérité passagère; la misère et la mort les frappent bientôt à leur tour, et si l’économie a encore quelques cités non compromises, nous verrons l’empire renaître de ses cendres et, après avoir passé par des phases diverses, reprendre l’activité et la splendeur des temps de prospérité. C’est ce qui arrive dans les cas de maladies où la guérison survient après un temps plus ou moins long.
Enfin, quelquefois pour combattre l’ennemi envahisseur, l’économie peut lever, pour ainsi dire, des troupes spéciales et faire, comme l’a dit très spirituellement notre collègue Legroux, une mobilisation cellulaire, composée d’unités connaissant la tactique de l’ennemi envahisseur et qui, habituées par des attaques antérieures au mal qui veut les frapper, résistent à l’invasion et la rejettent hors des frontières. Metschnikoff a donné à ces troupes spéciales le nom de phagocytes, et vous verrez le rôle important qu’on leur a fait jouer dans l’immunité que confèrent soit des vaccinations antérieures, soit des atteintes antérieures de certaines maladies infectieuses ou virulentes.
D’autres fois, l’économie peut appeler à son aide des micro-organismes qui viendront combattre l’ennemi envahisseur. C’est ce que l’on a décrit sous le nom de bactériothérapie. Cantani, Emmerich, et plus récemment Paulowski, ont montré sur quelle base pouvait être établie cette nouvelle thérapie.
Dans cette lutte que soutient chaque jour et à chaque instant l’économie contre l’élément envahisseur, la thérapeutique et l’hygiène peuvent-elles intervenir et aider l’organisme à se débarrasser de ces éléments divers qui concourent à sa perte? Assurément oui, et j’espère vous montrer par la suite de ces leçons, combien peut être active et profitable notre intervention, et cela sous des formes bien diverses.
Mais avant d’aller plus loin, il me paraît nécessaire, dans cette nouvelle stratégie, de bien connaître l’ennemi auquel on va s’attaquer, et c’est ce que je me propose de faire dans la seconde partie de cette leçon, en vous résumant aussi brièvement que possible ce que nous savons sur l’histoire et la physiologie, ou plutôt la biologie de ces micro-organismes.
Un physicien anglais qui vivait au dix-septième siècle, Robert Boyle, qui fut, on peut le dire, un des précurseurs de la méthode expérimentale et positive et qui voulut soumettre tous les phénomènes du monde physique à ses investigations et à ses expériences, a écrit ces mots:
«Celui qui pourra sonder jusqu’au fond la nature des ferments et des fermentations sera sans doute beaucoup plus capable qu’un autre de donner une juste explication des divers phénomènes morbides, aussi bien des fièvres que des autres affections. Ces phénomènes ne seront peut-être jamais bien compris sans une connaissance approfondie de la théorie des fermentations.»
Ces paroles mémorables trouvent leur entière confirmation dans l’histoire de la découverte des micro-organismes. Après ses beaux travaux sur les acides tartrique et paratartrique, Pasteur, à l’âge de trente-deux ans, était nommé doyen de la Faculté des sciences de Lille. Dans ce pays où la production des alcools joue un rôle industriel si important, Pasteur pensa intéresser son auditoire en faisant des fermentations l’objet de son cours.
Des ferments et des fermentations.
La théorie de Liebig était alors triomphante et cette théorie était admise sans conteste et sans discussion. Pour Liebig et son école, le ferment était une substance albuminoïde plus ou moins altérée qui agissait par contact sur les substances liquides ou solides et permettait leur fermentation. Ces substances jouissaient d’une force spéciale dite force catalytique ou de présence qui leur permettait d’agir sans perdre de leur activité.
Cagniart de Latour avait bien constaté que la levure de bière était constituée par un organisme se multipliant par bourgeonnement et il s’était demandé, sans résoudre toutefois la question, si cette végétation n’était pas en rapport avec la fermentation. Liebig, tout en reconnaissant l’existence de ces organismes, montra que s’ils jouaient un rôle dans cette fermentation, c’était les portions qui avaient cessé de vivre auxquelles pouvaient être attribuées ces propriétés, comme à toute substance albuminoïde en voie de décomposition.
Pasteur résout le problème et montre que la fermentation est en rapport direct avec le développement de ces organismes et qu’il suffit d’empêcher leur reproduction pour s’opposer à la fermentation. Il multiplie de toutes façons ses preuves démonstratives, et pour saper la théorie de Liebig par sa base, il détermine la fermentation dans un milieu minéral où les substances albuminoïdes font absolument défaut.
Puis il approfondit ce problème et en montre toute l’étendue en découvrant que chaque fermentation a son organisme spécial. C’est ainsi qu’il découvre la fermentation acétique, le ferment de l’acide lactique, puis celui de l’acide butyrique, découvertes qui devaient en entraîner d’autres encore plus importantes. Le ferment butyrique, le bacillus amylobacter montre en effet à Pasteur que certains de ces organismes peuvent vivre sans air et constituent une exception à cette loi que l’on croyait générale que tout être vivant a besoin d’oxygène, et cela lui permet d’établir cette distinction si importante des microbes aérobies ou vivant dans l’air et des microbes anaérobies ou vivant sans air.
La fermentation lactique et la fermentation butyrique sont produites par des organismes ayant une apparence différente de ceux de la fermentation alcoolique; ils constituent des bâtonnets auxquels on a donné le nom de bacilles et de bactéries: de bacillus lacticus, pour le ferment lactique et de bacillus amylobacter pour le ferment butyrique. C’est l’analogie existant entre ces micro-organismes de la fermentation lactique et butyrique avec ceux qu’avait découverts Davaine dans le sang charbonneux qui conduisit Pasteur à passer du domaine des fermentations à celui des maladies.
Ces micro-organismes, causes des fermentations, dont Pasteur étudia la culture et le mode de développement, de manière à régulariser les fermentations et à repousser de ces milieux de culture les autres organismes causes de fermentations vicieuses, vivent au même titre que les grands végétaux et de même, par exemple, que la betterave tire de sa racine les éléments qui serviront au développement de ses feuilles et de ses tiges, de même ces micro-organismes vivent en soustrayant aux liquides, avec lesquels ils sont en contact, certains éléments propres à leur existence et qui transforment ainsi le sucre en alcool, l’alcool en vinaigre, l’urée en ammoniaque, etc., etc.
De la putréfaction.
Deux découvertes importantes firent suite à ces premières recherches: ce fut d’une part la démonstration de l’identité de la putréfaction et de la fermentation, et d’autre part la solution de cette grande question des générations spontanées. Ces micro-organismes facteurs de la fermentation sont aussi ceux de la putréfaction.
Lorsque la vie a cessé dans les organismes vivants, elle fait place à une autre vie; le corps est envahi par des microbes aérobies et anaérobies qui donnent lieu à des générations successives amenant peu à peu la combustion de tout l’organisme et, comme l’a dit, il y a bien des années, Hameau:
Partout la vie est dans la vie
Et partout la vie dévore la vie.
De toute cette organisation, il ne reste plus que des spores ou des germes, des micro-organismes qui ont amené cette destruction et cette putréfaction, germes et spores qui resteront à l’état latent, jusqu’à ce qu’ils trouvent un nouveau terrain favorable à leur œuvre de destruction et de combustion. Comme le dit fort bien l’auteur du beau livre de l’Histoire d’un savant, racontée par un ignorant, que je voudrais voir entre toutes les mains, ces micro-organismes sont les maîtres du monde et si par la pensée on les supprimait, la surface du globe encombrée de matières organiques deviendrait inhabitable.
De la génération spontanée.
La question des générations spontanées fut résolue avec la même rigueur scientifique qui avait été appliquée à la question des fermentations. Les idées les plus étranges régnaient sur la génération spontanée et l’on n’était pas loin d’adopter l’idée de Van Helmont qui avait donné des formules pour la production spontanée des souris. «Prenez, disait le célèbre professeur de Louvain, une chemise sale, placez dans cette chemise des grains de blé, mettez le tout à la chaleur et au bout d’un certain temps il y aura transmutation du blé en souris.» Si pour les êtres élevés ces idées avaient été reconnues fausses, il n’en était plus de même des organismes inférieurs, et malgré les expériences si intéressantes faites en 1668 par un des médecins du grand-duc de Toscane, Francesco Redi, qui montra que les vers qui paraissent se développer dans la viande en putréfaction provenaient en réalité des larves que les mouches y déposaient, on était cependant prêt à admettre cette génération spontanée.
Pouchet, alors directeur du Muséum d’histoire naturelle de Rouen, publiait en 1859 un livre sur l’Hétérogénie, qui était un plaidoyer éloquent sur la génération spontanée, plaidoyer qu’il appuyait sur des expériences qu’il croyait irréfutables. Dans ces recherches, la théorie avait devancé les démonstrations expérimentales, car dans la préface l’auteur s’exprime ainsi: «Lorsque par la méditation il fut évident pour moi que la génération spontanée était encore un des moyens qu’emploie la nature pour la reproduction des êtres, je m’appliquai à découvrir par quels procédés on pouvait parvenir à en mettre les phénomènes en évidence.» Voici l’expérience fondamentale de Pouchet:
Dans une cloche, placée sur une cuve à mercure, il introduisait de l’oxygène, puis de l’azote de manière à constituer un air artificiel, puis il prenait du foin qu’il avait soin de placer dans une étuve de 100 degrés et même 200 degrés et l’introduisait dans la cloche à travers le mercure, et au bout d’un certain temps on voyait se développer des micro-organismes en grand nombre sur ce foin. Qu’objecter à une pareille expérience?
Pasteur montra par quel point péchait cette expérience soi-disant irréfutable et fit voir que c’était le mercure qui renfermait les germes des organismes, causes de cette génération spontanée et que c’était en traversant ce mercure que le foin entraînait ces germes. Il varia d’abord à l’infini ses expériences, répondant à chaque séance de l’Académie des sciences aux objections qui lui étaient opposées, et triompha à ce point de ses adversaires, qu’aujourd’hui le fait est admis sans conteste, il n’existe pas de génération spontanée.
De la théorie des germes.
Cette théorie des germes que Tyndall, de son côté, en Angleterre, appuyait de ses ingénieuses expériences à l’aide des pinceaux lumineux traversant des espaces clos, avait une importance capitale, car elle ne détruisait pas seulement une erreur dans le domaine des sciences naturelles, mais une doctrine médicale s’écroulait sous l’influence de ce fait, la doctrine de la spontanéité.
Le moment était proche où Pasteur devait passer, comme l’avait prévu Boyle, du domaine des fermentations dans celui de la pathologie. Déjà, la théorie des germes qu’il venait d’appuyer de ses célèbres expériences avait été un trait de lumière pour la chirurgie; le dernier assaut que livraient les hétérogénistes ayant à leur tête Pouchet en France, Bastien en Angleterre, venait d’être repoussé et l’on vit alors les pansements ouatés appliqués par notre maître Alph. Guérin et surtout les beaux travaux de Lister s’appuyer entièrement sur ces nouvelles doctrines, et alors commença cette révolution qui devait transformer la chirurgie moderne et lui faire obtenir des succès qu’elle n’eût jamais osé espérer autrefois.
Des micro-organismes pathogènes.
Ce fut le charbon qui servit d’intermédiaire entre l’étude des fermentations et celle des maladies, et ce lien fut dû à une découverte que firent Davaine et Rayer. Davaine écrivait ces mots dans une communication faite à la Société de biologie en 1850:
«On trouve, dit-il, dans le sang des animaux qui meurent du charbon, de petits corps filiformes ayant environ le double en longueur des globules sanguins.»
La similitude entre ces petits corps filiformes et ceux que Pasteur avait découverts, de 1857 à 1860, comme les agents de la fermentation lactique et butyrique, amena Davaine à étudier de nouveau cette question en 1863, et il se demanda alors si ces petits corps ne joueraient pas le même rôle que ces ferments et si leur développement ne serait pas la cause de la mort de l’animal. La démonstration fut pour lui évidente, et il s’efforça de démontrer que la bactérie était la cause essentielle de la maladie.
Pasteur appliqua alors à cet organisme, si analogue aux ferments lactique et butyrique, les procédés de culture qu’il avait mis en usage pour l’étude de ces ferments, et, grâce à cette méthode, il démontra d’une façon irréfutable le rôle de cette bactérie, cause essentielle de la maladie, et non seulement il signala le mécanisme de la mort déterminée par cette bactérie, mais encore les voies de contagion du charbon. Toutes ces communications, qui furent faites à partir de 1877, eurent pour collaborateurs les aides dévoués que Pasteur avait appelés autour de lui: Joubert, Chamberland et Houx. Ces aides lui étaient nécessaires, depuis l’attaque d’apoplexie qui l’avait atteint en 1868.
Les découvertes à partir de ce moment se succédèrent rapidement. Pasteur, après avoir démontré l’existence de la bactérie charbonneuse, découvre ensuite le microbe de la septicémie, puis celui d’une maladie qui décimait les poulaillers et qu’on décrivait sous le nom de choléra des poules. Cette dernière découverte devait en entraîner une beaucoup plus importante, celle des virus atténués.
Signalé par un vétérinaire de la haute Alsace, Moritz, en 1878 par Péroncito, reconnu par Toussaint en 1879, le micro-organisme du choléra des poules fut cultivé par Pasteur à l’aide du bouillon de muscles de poule. Grâce à ces cultures, qui permettaient à Pasteur d’isoler, pour ainsi dire, le germe de la maladie des autres micro-organismes, Pasteur montra que lorsque ces cultures étaient anciennes, au lieu de provoquer la mort de l’animal, elles lui donnaient une affection passagère, mais que ces poules, ainsi inoculées, étaient préservées, par cela même des atteintes du mal et résistaient à des inoculations faites avec un liquide très virulent.
Des virus atténués.
Ainsi donc Pasteur était arrivé, suivant l’heureuse expression de Bouley, à domestiquer ces micro-organismes, et, grâce à cette découverte, le micro-organisme, agent virulent de la maladie, devenait cultivable et au gré de l’expérimentateur il en augmentait ou en diminuait la virulence. C’était, on peut le dire, la plus grande découverte de ce siècle, celle des virus atténués, et ce fut au milieu des applaudissements des médecins du monde entier, réunis à Londres au Congrès international de 1881, que Pasteur prononça ces paroles:
«J’ai prêté à l’expression de vaccination une extension que la science, je l’espère, consacrera comme un hommage aux immenses services rendus par un des plus grands hommes de l’Angleterre, Jenner.»
Puis, Pasteur appliqua cette même donnée au traitement du charbon, et ce fut le 5 mai 1881 qu’eut lieu à 3 kilomètres de Melun, à Pouilly le Fort, la célèbre expérience qui montra que, désormais, grâce au virus atténué, l’art vétérinaire était en possession d’une méthode préservant les animaux du terrible fléau qui chaque année s’abattait sur eux. La doctrine des virus atténués était désormais un fait acquis et elle devait aussi, quelques années plus tard, servir de base aux inoculations anti-rabiques.
Chacun des chaînons de cette chaîne qui commence à la fermentation pour se terminer à l’application des virus atténués, constitue un progrès incontestable, indiscutable, et c’est avec le sentiment d’un juste patriotisme que je tenais à vous montrer l’admirable ensemble de toutes ses découvertes. Avant de terminer, il nous faut jeter un coup d’œil général sur ces micro-organismes, qui jouent un rôle si important dans la pathologie, et que le docteur Dubief, dans ses leçons successives, vous fera connaître d’une manière précise et approfondie.
Morphologie des micro-organismes.
Ces migro-organismes, ces barbares, comme nous les avons appelés, qui assiègent de toutes parts notre organisme, se présentent sous des formes différentes, aujourd’hui bien connues, et dont l’histoire naturelle est faite d’une manière complète; ce sont tantôt des petits corps sphériques auxquels on donne le nom de micrococcus, ou des corps plus allongés, que l’on décrit sous le nom de bactéries, de bacilles ou de spirilles, si leur volume est encore plus considérable. D’ailleurs, la morphologie de ces micro-organismes n’a qu’une importance secondaire dans la question qui nous occupe. Les récentes expériences de Charrin sur un microbe qu’on trouve dans le pus coloré, le microbe de la pyoscyanine, montrent qu’en modifiant le bouillon de culture, non seulement on modifie la sécrétion de la matière colorante par ce microbe, mais encore sa forme, et selon le liquide ajouté à ce bouillon de culture, on voit la forme ainsi varier: tandis qu’avec l’acide borique, on obtient des filaments droits allongés, avec d’autres substances, ce sont des spirilles ou des bacilles en croissant, ou en virgule et même des bâtonnets très courts, voire des micrococcus. Cette expérience si intéressante montre le polymorphisme accusé de ces microbes.
Reproduction des micro-organismes.
Ces micrococcus, ces bactéries, ces bacilles se développent avec une extrême rapidité, et, pour vous donner une idée de ce développement fantastique, je vous citerai ici le passage emprunté au livre de Duclaux, qui invoque des expériences de Cohn
Certaines bactéries, en se segmentant, produiraient, en trois jours, pour un seul individu, 4772 billions d’êtres. Au bout de vingt-quatre heures, la progéniture d’une bactérie ne pèserait qu’un cinquantième de milligramme; mais, au bout de trois jours, elle pèserait 7 500 tonnes, c’est-à-dire remplirait à elle seule un de ces immenses transatlantiques qui font l’orgueil de notre navigation.
Cette génération des micro-organismes se fait de différentes façons: tantôt c’est par scissiparité ; les bâtonnets se divisent ou se séparent en deux ou plusieurs anneaux, et c’est même cette génération par scissiparité qui a fait donner par les botanistes le nom de schizomycètes ou de schizophytes à tous ces champignons, du mot grec σχɩ́ξεɩν, fendre. On donne aussi à ces schizomycètes, dont chacune des parties, en se détachant, devient le point de départ d’une colonie nouvelle, le nom d’arthrosporées. Tantôt c’est par sporulation, et l’on voit alors se développer dans l’intérieur du bacille des spores, qui se trouveront mises en liberté lorsque la paroi de la bactérie aura disparu; ce sont les schizomycètes endosporées. Puis ces spores, si elles trouvent un milieu favorable à leur développement, donneront naissance à des bactéries nouvelles. Ce sont ces spores ou germes qui résistent le plus à nos moyens de destruction les plus énergiques.
Biologie des micro-organismes.
Chacun de ces micro-organismes, comme toute cellule vivante, a besoin pour vivre de conditions spéciales, et il faut, pour qu’il se développe, qu’il trouve un milieu de culture favorable, milieu variant suivant le microbe observé, et il suffira ou d’abaisser ou d’élever la température de ce milieu pour voir s’arrêter ou se développer ces micro-organismes, et je ne connais pas de meilleur exemple à vous citer à cet égard que les curieuses expériences de Pasteur sur la bactérie charbonneuse. Pour le développement de cette bactérie, il faut une température moyenne; si elle est trop élevée, la bactérie succombe; c’est ce qui explique que les gallinacées, dont la chaleur animale est supérieure à celle du mouton, sont rebelles au charbon. Ainsi, prenez une poule, inoculez-lui des bactéries charbonneuses, elle résistera à cette inoculation; mais, pour la voir succomber, il vous suffira de la placer dans un milieu réfrigérant, dans l’eau froide, par exemple.
Ce qui montre combien le terrain de culture peut être modifié par des conditions bien faibles, ce sont les expériences de Raulin. Raulin opérait sur ces moisissures, qui se développent si facilement dans les milieux acides, les tranches de citron, par exemple, mycodermes spéciaux, auxquels on a donné le nom d’Aspergilus niger. Il créa un milieu de culture essentiellement minéral, renfermant des substances nombreuses, à l’ensemble desquelles on a donné le nom de liquide de Raulin, et dont voici d’ailleurs la composition:
Il suffit dans ce milieu de modifier l’un des éléments pour qu’immédiatement la production de l’Aspergilus niger s’affaiblisse et disparaisse. Ainsi, la suppression de la potasse fait tomber la production de 1/25, celle du zinc de 1/10. Mais il y a plus; lorsqu’on ajoute à ce mélange d’autres substances comme du nitrate d’argent et dans la proportion incroyable de 1/1600000, la production cesse immédiatement. Mais ce qui est encore plus étonnant, c’est que là où la chimie se montre impuissante à trouver des traces de ce métal, le liquide néanmoins devient impropre à la culture par le seul fait d’être en contact avec un vase d’argent.
Si l’on considérait l’Aspergilus niger comme une bactérie pathogène et que l’on se basât sur les chiffres précédents, il suffirait, pour la détruire complètement dans le corps d’un homme pesant 60 kilogrammes, de 60 milligrammes de nitrate d’argent; et, si cette bactérie ne se développait que dans le sang, la dose de 5 milligrammes serait suffisante.
Ces micro-organismes que nous venons de voir se développer avec une si extrême rapidité soit par bourgeonnement, soit par segmentation, soit par sporulation, fabriquent, comme toute cellule vivante, des produits excrémentitiels plus ou moins toxiques. On attribue à ces leucomaïnes une importance capitale, et les adversaires des doctrines microbiennes ont soutenu cette théorie: que le microbe n’est rien, et que la leucomaïne produite par ce microbe joue le rôle prépondérant dans la production des phénomènes morbides. Nous aurons à revenir sur ce point dans l’une de nos prochaines conférences.
Des doctrines microbiennes
Le nombre des microbes pathogènes augmente de jour en jour; mais il ne suffit pas de découvrir un micro-organisme chez un être malade pour attribuer à ce micro-organisme une action pathogène, il faut pouvoir l’isoler, il faut de plus qu’une culture spéciale permette de le reproduire et de le perpétuer; il faut enfin qu’inoculé aux animaux ou à l’homme, il reproduise toujours un ensemble symptomatique identique. Vous verrez combien est difficile souvent la réalisation de ces trois conditions.
Quoi qu’il en soit de ces réserves, cette question de microbiologie s’impose aujourd’hui à tous les observateurs; dans les milieux scientifiques de l’Europe et du monde entier, elle est soumise à l’étude; les moyens de culture et les procédés scientifiques qui permettent d’observer et d’isoler ces micro-organismes se perfectionnent de jour en jour. Sous l’influence de pareilles études, nos doctrines médicales sont profondément modifiées, et les mots contagion, épidémicité, virulence, prophylaxie, ont pris des acceptions nouvelles; il m’a semblé que le moment était venu de faire profiter à son tour l’hygiène thérapeutique de pareilles recherches.
Grâce au concours de mon chef de laboratoire, M. le docteur Dubief, auquel on doit un manuel si pratique et si utile de microbiologie , j’ai pu établir dans mon laboratoire de thérapeutique tous les appareils et instruments nécessaires pour mener à bien de pareilles recherches. Aussi est-ce appuyé d’une part sur les travaux de mes devanciers, et de l’autre sur les travaux que dirige le docteur Dubief, travaux qui passeront sous vos yeux, que je me propose d’étudier, dans les leçons qui vont suivre, cette question si intéressante des doctrines microbiennes appliquées à l’hygiène prophylactique. Mais, avant d’arriver au cœur même de mon sujet, il me faut consacrer quelques leçons à l’étude des microbes pathogènes et des ptomaïnes. C’est ce que je ferai dans mes prochaines conférences.
L’ardeur avec laquelle sont conduites ces nouvelles études microbiennes amène chaque jour la découverte de nouveaux microbes pathogènes; dans son éloquent discours fait l’année dernière au Congrès médical de Washington, par mon excellent ami le sénateur Semmola, sur la médecine scientifique et la bactériologie, l’éminent professeur de Naples se plaint de cette multiplicité et de cet envahissement de la médecine par la microbiologie, et, au nom de la méthode expérimentale, il repousse ces recherches trop hâtives et trop multipliées. Je ne puis partager ce rigorisme. Oui, l’avenir fera une part entre ces découvertes incessantes de tous les expérimentateurs qui sont entrés dans la voie que Pasteur leur a ouverte. Il acceptera les unes, repoussera les autres; mais il ne faut pas amoindrir l’ardeur de ces laborieux travailleurs, car le champ qu’ils labourent est si vaste et si fécond que tous y peuvent trouver place.
Quant à moi, ce n’est pas sans un sentiment profond de patriotique admiration que je constate le chemin parcouru depuis dix ans, depuis le moment où, le 30 avril 1877, notre illustre compatriote lisait, à l’Académie des sciences, ses travaux sur la bactérie charbonneuse.
Je précise cette date, parce qu’on a prétendu que ces doctrines microbiennes avaient une origine plus ancienne. C’est là, messieurs, une erreur qu’il faut combattre. Le parasitisme, tel que le comprenaient nos anciennes doctrines médicales, n’a rien de commun avec l’étude des microbes pathogènes, et les réclamations que Raspail faisait au nom de son père doivent être absolument rejetées du domaine scientifique.
La doctrine de Raspail, si l’on peut donner ce nom à cet ensemble d’assertions plus ou moins étranges et incoordonnées sur la causalité des maladies, et où l’on voit les maladies telles que la fièvre typhoïde, la variole, la rougeole, la scarlatine, etc., être déterminées par l’influence des comètes, donne au parasiticisme une acception bien différente, comme vous pouvez en juger par le passage suivant. Le célèbre révolutionnaire attribue aux maladies comme causes: «le parasitisme externe ou interne d’œufs aquatiques, de vers, de larves, de mouches, de chénilles, d’acares, d’insectes parfaits (poux, puces, punaises, coléoptères), enfin d’helminthes ou vers intestinaux, qui prennent l’homme au berceau et ne l’abandonnent souvent qu’à la tombe pour le livrer en pâture à des vers plus âpres qu’eux à la curée» ; et il a soin d’ajouter, lui qui d’ailleurs n’était pas médecin, cette phrase aimable à l’adresse des praticiens: «Parmi les parasites les plus nuisibles, il faut compter, ne vous déplaise, le mauvais médecin, le médecin qui déraisonne; ses piqûres peuvent être et sont souvent mortelles, et il est d’avance excusé .» Nous sommes loin, comme vous le voyez, des doctrines microbiennes dont je viens de vous parler.
S’il fallait donner une priorité à cette doctrine des germes vivants des virus, il faudrait l’attribuer à Jean Hameau (de la Teste). Dans un curieux travail sur les virus, publié en 1847 et qui résumait des expériences entreprises depuis 1836, Hameau s’exprime ainsi: «Toute matière hétérogène qui peut s’introduire dans un corps vivant et y rester dans l’inaction, s’y multiplier et ensuite en sortir pour agir de même dans un corps vivant, me paraît avoir un principe de vie.»
Puis, comme à cette époque les données microscopiques étaient dans leur enfance, Hameau compare les virus à l’organisme qui, pour lui, se présente sur le plus petit volume, à l’acare de la gale, et considère la multiplication des virus comme analogue à celle de ces petits êtres. Enfin, il précise sa pensée en disant: «Les virus ont des germes qui les reproduisent.»
Des progrès de la médecine.
C’est une chose banale que d’entendre dire que la médecine ne progresse pas et que, tandis que la chirurgie fait chaque jour des acquisitions nouvelles, la médecine reste en arrière. Répondez à ces détracteurs, j’allais dire à ces ignorants, par des faits; montrez-leur le principe virulent et contagieux des maladies, isolé, cultivé, domestiqué ; montrez-leur la vaccine agrandissant, par les virus atténués, le champ de son action préservatrice, protégeant nos bestiaux d’épizooties meurtrières et ramenant à une mortalité pour ainsi dire infime une maladie jusqu’alors réputée incurable, la rage; montrez-leur aussi l’hygiène et la prophylaxie des maladies basées désormais sur des données précises et exactes; montrez-leur, enfin, l’antisepsie s’efforçant de passer du domaine de la chirurgie dans celui de la médecine, et dites-leur que, tous ces progrès, nous les devons à ces nouvelles études. Aussi suis-je prêt à m’écrier, comme le faisait naguère Bouley, dans une de nos enceintes académiques: «Une doctrine nouvelle s’ouvre pour la médecine, et cette doctrine m’apparaît puissante et lumineuse; un grand avenir se prépare; je l’attends avec la confiance d’un croyant et le zèle d’un enthousiaste. »