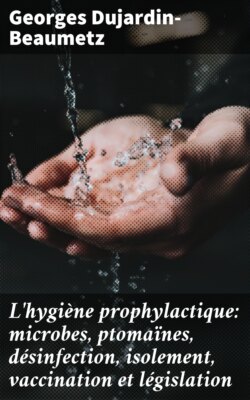Читать книгу L'hygiène prophylactique: microbes, ptomaïnes, désinfection, isolement, vaccination et législation - Georges Dujardin-Beaumetz - Страница 7
DES MICROBES PATHOGÈNES
ОглавлениеMESSIEURS,
Avant d’aller plus loin dans l’étude de l’hygiène prophylactique, il me paraît nécessaire de consacrer deux leçons à l’étude des microbes pathogènes et des alcalis organiques qui jouent le rôle le plus important dans les maladies où cette hygiène prophylactique trouve ses plus sérieuses applications.
N’attendez pas de moi une description complète des microbes pathogènes; pour accomplir une pareille tâche, il faudrait consacrer à ce sujet non pas une conférence, mais toutes celles que je me propose de faire devant vous cette année. Je vais simplement vous exposer, aussi brièvement que possible, quelques données sur les principaux microbes pathogènes en prenant pour type de ma description l’un des microbes les plus connus, la bactérie charbonneuse.
Pour ceux qui voudraient compléter leurs connaissances à ce sujet, je les renverrais aux traités et aux monographies qui ont été consacrés à cette étude des bactéries et des micro-organismes, ouvrages. aujourd’hui si nombreux qu’ils constituent une véritable bibliothèque, et en particulier, pour ce qui concerne les travaux français, à l’ouvrage si important de Cornil et Babès , à la traduction que le docteur Henrijean (de Liège) a donnée du travail de Flügge sur les micro-organismes et enfin au traité si pratique et si utile de mon chef de laboratoire, le docteur Dubief . C’est aidé des préparations et des cultures qu’il a faites, préparations et cultures qui passeront sous vos yeux, que j’appuierai les développements dans lesquels je vais entrer.
Comme je vous le disais dans ma précédente leçon, c’est la découverte de la bactéridie charbonneuse qui a permis de créer le groupe des microbes pathogènes, dont l’étude devait modifier d’une façon si profonde nos connaissances sur les maladies infectieuses, et l’histoire de cette découverte est assez intéressante pour que j’y insiste quelque peu dans cette conférence. Je le ferai surtout en me servant des belles leçons que mon ami, le professeur Straus, a faites sur ce sujet .
Des maladies charbonneuses.
Jusqu’à Chabert, les maladies charbonneuses, qui déciment. nos troupeaux et qui atteignent parfois l’homme, constituaient un chaos assez confus, où l’on réunissait dans une même description la septicémie, les maladies gangreneuses et les maladies charbonneuses. L’illustre successeur de Bourgelat à la direction d’Alfort, Chabert, dans son beau traité sur le charbon paru en 1779, établit nettement la distinction entre les maladies gangréneuses et septiques et la maladie charbonneuse ; il décrit à cette dernière trois formes cliniques: la fièvre charbonneuse, le charbon essentiel et le charbon symptomatique.
Les découvertes de la bactériologie ont modifié cette manière de voir: tandis que pour Chabert ces diverses formes n’étaient que des aspects différents d’une seule et même maladie, le charbon ou anthrax, la science moderne a disloqué cette conception uniciste en montrant qu’il y avait là encore des maladies différentes. Tandis que la fièvre charbonneuse de Chabert correspond au sang de rate causé par le bacille de Davaine, les deux autres formes répondent à une maladie différente causée par un second micro-organisme, maladie qui porte le nom de charbon symptomatique.
Du sang de rate.
Découverte de la bactérie charbonneuse.
C’est en examinant le sang d’un mouton mort du sang de rate, maladie si fréquemment observée dans nos troupeaux de la Sologne et de la Beauce, que Davaine et Rayer, en 1850, signalèrent la présence de petits corps filiformes n’offrant aucun mouvement spontané et ayant le double en longueur du globule sanguin . Ils ne font d’ailleurs jouer aucun rôle à ces petits corps et se contentent de signaler leur présence.
Cinq ans après, en 1855, Pollender , en examinant du sang charbonneux, retrouve ces petits corps, dont il décrit la forme et fait un pas de plus dans la question, en montrant qu’ils appartiennent à des espèces végétales. J’ajoute qu’il est certain que Pollender n’avait aucune connaissance du travail de Davaine et Rayer, ce qui fait qu’en Allemagne on attribue à Pollender la découverte de la bactérie charbonneuse, tandis qu’en France, nous basant sur la date même des publications, nous considérons Davaine et Rayer comme ayant observé les premiers les bâtonnets caractéristiques du charbon.
Un accident malheureux arrivé à l’Ecole vétérinaire de Dorpat au chauffeur de l’amphithéâtre de dissection, qui meurt en 1857 à la suite d’une inoculation charbonneuse, permet à Brauell de pousser un peu plus loin la découverte de Davaine et de Pollender. En inoculant, en effet, le sang de ce chauffeur à des moutons, il amène la mort de ces animaux par le charbon et constate la présence des bâtonnets. Mais il réunit dans la même description les vibrions septiques doués de mouvements et les bâtonnets immobiles décrits par Davaine, et, dans le travail qu’il fait paraître l’année suivante, en 1858, il persiste dans cette confusion et refuse à ces bâtonnets une valeur caractéristique.
Leisering, la même année, partage l’opinion de Brauell , et il faut arriver au beau travail de Delafond pour voir la séparation s’établir nettement entre les vibrions septiques et les bâtonnets.
Delafond résout presque complètement le problème, puisqu’il cherche à cultiver ces bâtonnets, qu’il sait être d’origine végétale, pour en obtenir des graines ou des spores. A cette date, en 1860, on n’était pas encore en possession des procédés de culture des micro-organismes, et l’on comprend que les tentatives de Delafond aient été infructueuses. Mais il faut reconnaître que la première idée de cette culture lui appartient tout entière.
Trois ans après, Davaine , éclairé par les expériences de Pasteur sur les fermentations et rapprochant certains de ces ferments, et en particulier ceux de la fermentation lactique et butyrique déterminée par le Bacillus lacticus et le Bacillus amylobacter, des bâtonnets qu’il avait observés dans le sang des animaux morts du charbon, reprend à nouveau cette importante question et il démontre alors, dans des communications successives, que c’est bien le bâtonnet qui est la cause de la virulence du charbon, et il le caractérise du nom de bactéridie charbonneuse.
Cependant, deux professeurs du Val-de-Grâce, Leplat et Jaillard , mettent en doute l’affirmation de Davaine. Ayant inoculé à des lapins du sang charbonneux qui leur avait été envoyé par un équarrisseur de Sourres (aux environs de Chartres), ces lapins succombent rapidement, sans qu’on puisse constater la présence de bactéries dans leur sang. Davaine démontre alors par des recherches très précises que ce n’est pas le charbon que Leplat et Jaillard ont inoculé aux lapins, mais une maladie septique, qu’il appelle la maladie septique de la vache, et il affirme de nouveau la nécessité de la présence de la bactéridie pour caractériser le charbon .
La question, comme vous le voyez, s’était grandement simplifiée, et désormais il paraît acquis que les bâtonnets entrevus par Davaine en 1850 sont les éléments de la virulence du sang de rate. Cependant il restait encore des points bien obscurs dans la question: à savoir le mode de propagation de la maladie et la persistance de la virulence dans certains cas.
Koch , par la découverte de la sporulation des bactéries en 1876, nous fournit à ce dernier point de vue d’importantes indications. Déjà, en 1869, dans son beau travail sur la maladie des vers à soie, Pasteur, en étudiant la flacherie, avait remarqué que le bacille pathogène de cette maladie, bacille qui se développe dans le tube digestif de ces animaux, pouvait se reproduire de deux façons, tantôt par scissiparité, tantôt par des noyaux se développant dans leur intérieur, noyaux auxquels il avait attribué la dénomination caractéristique de corpuscules-germes. Cohn , de son côté, en 1872, rapprochant, comme l’avait fait Davaine au point de vue de sa constitution, le Bacillus subtilis, qui présente ces mêmes noyaux ou spores à l’intérieur, du Bacillus anthracis, signale la possibilité de cette sporulation comme mode de reproduction de ce dernier bacille. Mais à Koch, revient l’honneur de cette démonstration.
A partir de ce moment, toutes les découvertes sur le charbon tiennent dans les travaux de Pasteur et de ses élèves Roux et Chamberland: dès l’année 1877, ils signalent les procédés qui permettent d’isoler, de cultiver, de domestiquer ce micro-organisme; ils démontrent sans réplique que le bacille est bien l’agent de la virulence; car, après avoir soigneusement filtré sur de la porcelaine du sang charbonneux et l’avoir ainsi privé de ses bacilles, l’inoculation de la substance filtrée reste inoffensive, tandis que l’inoculation d’une minime partie de la substance restée sur le filtre provoque un charbon mortel. Enfin, poussant plus loin leurs investigations, ils arrivent à atténuer le terrible microbe; et lorsque dans une leçon prochaine j’aurai à parler de l’atténuation des virus, je vous exposerai en détail l’histoire des belles recherches qui ont amené cette grande découverte de la vaccination charbonneuse.
Fig. 1. — Bacillus anthracis dans le sang d’un cobaye, examiné à l’état frais. Sous la forme de bâtonnets droits, flexibles.
Du Bacillus anthracis.
Il nous reste maintenant à étudier le bacille en lui-même. Il se présente sous trois états: sous forme bacillaire, sous forme filamenteuse, sous forme sporulaire. La forme bacillaire est celle sous laquelle on le trouve dans le sang des animaux qui ont succombé au sang de rate, et c’est sous cette forme que Davaine les a le premier aperçus. Il se présente, comme vous le montre cette figure (voir fig. 1), sous la forme de bâtonnets droits, flexibles, cylindriques, immobiles, homogènes, transparents comme le verre, réfringents, dont l’épaisseur est de 1 à 1,25 µ, tandis que leur longueur est de 5 à 20 μ. Leur transparence nous oblige pour les observer à colorer les préparations, et vous pouvez vous servir à cet effet des matières colorantes dérivées de l’aniline (fuchsine, violet de méthyle, etc.).
Fig. 2. — Filaments du Bacillus anthracis cultivés à la chambre humide dans l’humeur aqueuse du lapin.
Fig. 3. — Colonie du Bacillus anthracis sur plaque de gélatine à un faible grossissement.
Lorsqu’on cultive ces bâtonnets dans un milieu approprié, on les voit considérablement s’allonger et former alors de longs filaments qui, même au bout d’un certain temps, se réunissent et forment alors une véritable colonie présentant une masse considérable de ces filaments agglomérés entre eux; les deux figures ci-dessus vous montrent bien les dispositions que je viens de vous signaler (voir fig. 2 et 3).
Enfin, l’on voit se développer, dans ces filaments, des spores; ce sont des points réfringents développés dans l’intérieur même du filament, spores qui, augmentant de plus en plus, remplissent tout le contenu du bâtonnet; ce sont ces spores qui résistent le plus énergiquement à tous nos moyens de destruction (voir fig. 4).
Fig. 4. — Filaments du charbon en sporulation après douze heures de culture en chambre humide, dans du bouillon de bœuf stérilisé.
Lorsque ces spores trouvent un terrain favorable à leur développement, elles s’accroissent, et subissant une marche inverse, elles se transforment en bacilles. La figure ci-dessus vous montre les différentes phases de cette germination (voir fig. 5).
Fig. 5. — a, b, c, d. Phases diverses do l’évolution d’une spore charbonneuse pendant sa germination jusqu’en e, où elle est bactérie adulte.
Lorsque, dans l’autopsie des animaux qui succombent au charbon, on examine les organes au point de vue histologique, c’est toujours dans les capillaires sanguins que l’on retrouve la bactéridie, constituant ainsi de véritables injections pathologiques dans tout le système vasculaire. La coupe que je vous présente du poumon d’un cobaye ayant succombé au charbon, met bien en lumière la disposition que je viens de vous signaler (voir fig. 6.)
Aérobie par excellence, le Bacillus anthracis vit en parasite dans les liquides où l’oxygène se trouve à l’état naissant, car il ne possède pas de chlorophylle et, par cela même, il est impuissant à dégager l’oxygène des milieux où ce gaz est en combinaison. C’est donc dans le sang que ce bacille se développe avec le plus de facilité.
Fig. 6. — Coupe de poumon de cobaye charbonneux.
La température a une influence très notable sur son développement; la plus favorable est celle de 35 degrés. A cette température et dans un milieu approprié, il produit, en vingt heures, des spores. Si l’on élève la température à 42 ou 43 degrés, il y a production de filaments, mais la sporulation n’a plus lieu; quelques degrés plus haut, à 45 degrés, la formation de filaments cesse; enfin, à 50 degrés et au-dessus, les bactéries adultes succombent.
Lorsque, au contraire, au lieu d’élever la température on l’abaisse, voici ce qu’on observe: il y a un ralentissement de la formation des spores; ainsi, à 30 degrés, il faut trente heures pour les obtenir, et à 18 degrés il faut deux ou trois jours. Mais, pour cela, la virulence n’en existe pas moins et le froid ne paraît pas modifier cette virulence. C’est ainsi qu’on a pu exposer du sang charbonneux à une température de — 110 degrés, sans lui faire perdre sa virulence. Quant aux spores, elles résistent à une température très élevée, et on ne peut les détruire qu’en dépassant la température de 120 à 130 degrés. Pour le milieu de culture, celui qui paraît de beaucoup préférable est le bouillon de veau alcalinisé.
Une fois ces connaissances biologiques acquises, sur le Bacillus anthracis, il est facile de se rendre compte de la symptomatologie du charbon.
Prenons un cobaye et, avec la seringue de Pravaz, inoculons-lui sous la peau quelques gouttes d’une culture de bactéries charbonneuses. Pendant trente-six à quarante heures, ce cobaye ne présentera aucun symptôme appréciable, si ce n’est un peu de rougeur au point inoculé ; puis, au bout de ce temps, l’animal deviendra inquiet, sa respiration s’accélérera, il urinera fréquemment, sa démarche deviendra incertaine, sa vivacité disparaîtra, puis quelques convulsions se produiront et l’animal succombera dans le coma.
Si l’on suit pas à pas la propagation du microbe pathogène, on verra, comme l’a montré Colin (d’Alfort), que c’est d’abord dans les ganglions lymphatiques du point inoculé que se fait la multiplication des microbes pathogènes; ils pénétreront ensuite dans le sang, où ils se développeront avec une extrême facilité, et, grâce à la circulation, on les verra envahir tous les organes. Avides d’oxygène, amenant probablement, par les ptomaïnes qu’ils sécrètent, un état agglutinatif des globules, la mort résultera de ces deux circonstances: elle sera produite par asphyxie et par embolie capillaire. Le charbon, comme vous le voyez, représente donc le type des maladies infectieuses aiguës, et c’est pourquoi j’ai si longtemps insisté sur l’histoire de ce microbe pathogène, et bien souvent, dans ces conférences, vous me verrez revenir sur cette bactéridie.
Du charbon symptomatique.
Jusqu’ici, nous ne nous sommes occupés que du charbon vrai, du sang de rate; il me reste maintenant à vous dire quelques mots de cet autre charbon, dit charbon symptomatique, qui frappe surtout les bêtes à cornes, et en particulier les troupeaux de bovidés qui paissent dans les montagnes; de là les noms de charbon emphysémateux des bœufs, et de mal des montagnes. Ce charbon est, de beaucoup, le plus fréquent, et c’est lui qui a fait donner le nom générique de charbon à ce groupe d’affections, à cause de la couleur noire et gangréneuse que prennent les tumeurs emphysémateuses arrivées au summum de leur évolution. Vous verrez d’ailleurs, par la suite, que c’est une maladie absolument distincte du sang de rate, et que les deux bacilles ont des propriétés en tous points opposées.
Je vous ai déjà dit que Chabert avait entrevu cette forme de charbon, dont Sanson, en 1868, avait donné une excellente description dans le rapport qu’il fit au sujet d’une épidémie de mal de montagnes qui frappait nos bestiaux de l’Auvergne. Mais c’est aux travaux d’Arloing, de Cornevin et Thomas, que l’on doit la connaissance du bacille pathogène de ce charbon, à la suite des travaux qu’ils ont entrepris de 1879 à 1884. Ce charbon se présente sous deux formes: dans l’une, le mal débute par une tumeur emphysémateuse mal définie, se développant dans les parties les plus charnues de l’animal, puis, des symptômes généraux se produisent rapidement et l’animal succombe. Dans l’autre forme, ce sont d’abord les symptômes généraux qui apparaissent, et la tumeur emphysémateuse ne se produit qu’aux périodes ultimes de la maladie. Ces deux formes ont la même origine et leur différence symptomatique résulte simplement du point où s’est faite l’inoculation; s’est-elle faite par la peau? c’est le charbon emphysémateux; s’est-elle faite par voie interne? c’est le charbon essentiel.
C’est le seul point commun qui existe entre le charbon symptomatique et le sang de rate, car, s’il existe, pour le sang de rate communiqué à l’homme, une forme avec pustule maligne, il en est une autre, au contraire, dans laquelle l’inoculation se fait par l’intestin, et que l’on a décrite sous le nom de charbon intestinal ou de mycose intestinale.
Du Bacterium Chauvei.
Le microbe pathogène de ce charbon symptomatique, qu’Arloing, Cornevin et Thomas ont décrit sous le nom de Bacterium Chauvei, se présente sous une forme absolument différente du Bacillus anthracis. Il est mobile, il est essentiellement anaérobie, il ne se rencontre pas, par cela même, dans le sang pendant la vie; il est moins long et plus épais, son épaisseur est, en effet de 0μ,5 à 0μ,6, et sa longueur de 3 μ. Sa culture est extrêmement difficile, et ce n’est que dans le vide ou en présence de l’acide carbonique que l’on peut le cultiver dans le bouillon de veau ou de poulet. Nous verrons, lorsque nous étudierons les virus atténués, comment on est parvenu à constituer, avec ce bacille, une vaccine contre le mal de montagnes.
Un autre fait qui sépare très nettement encore ces deux micro-organismes pathogènes, c’est que, tandis que pour le Bacillus anthracis, le lapin constitue un des réactifs les plus sensibles, cet animal se montre, au contraire, absolument réfractaire aux inoculations du Bacterium Chauvei. Le porc, le chien, le chat, le rat, le canard, la poule, le pigeon sont, comme le lapin, réfractaires au charbon symptomatique. Le cobaye peut prendre ce charbon, mais, au bout d’un certain temps, il acquiert une immunité et ne succombe plus à cette affection. D’ailleurs, si la connaissance du charbon symptomatique importe aux agronomes, elle intéresse beaucoup moins la pathologie humaine, et nous ne connaissons pas jusqu’à présent de maladie causée chez l’homme par le Bacterium Chauvei.
Du rouget des porcs.
Je passerai rapidement sur le rouget des porcs, et cela, parce que nous sommes loin d’être renseignés positivement sur le micro-organisme qui détermine cette maladie spéciale à l’espèce porcine, dénommée mal rouge, fièvre entérique ou choléra des porcs.
C’est, comme vous le savez, une maladie caractérisée essentiellement par une éruption exanthématique superficielle, et par des lésions internes consistant en ulcérations de la valvule iléo-cœcale et du côlon, et de lésions pulmonaires et cardiaques de nature infectieuse.
On a trouvé, dans ce rouget des porcs, plusieurs microbes, mais cette pluralité indique l’incertitude dans laquelle on se trouve, sur le véritable microbe pathogène. Aussi, Cornil est-il d’avis que l’on n’a pas encore le véritable micro-organisme infectieux de cette affection. Il est probable, comme l’a fort bien dit Dubief, qu’il existe plusieurs maladies exanthématiques du porc, comme on trouve plusieurs septicémies, et que chacune d’elles a son microbe pathogène spécial. La récente communication de Cornil sur la diarrhée pseudo-membraneuse du porc, diarrhée produite par un microbe spécial, confirme cette hypothèse, car elle fait entrevoir qu’il en sera pour le rouget des porcs comme pour le charbon et que sous ce nom on a décrit sans doute deux maladies fort distinctes: le rouget des porcs proprement dit et la diarrhée pseudo-membraneuse.
Du choléra des poules.
J’arrive à une autre maladie qui frappe encore l’espèce animale, mais qui atteint presque exclusivement les poules, je veux parler du choléra des poules. Ce nom de choléra est déplorable, appliqué à cette maladie, car il permet un rapprochement qui n’existe, à aucun titre, entre cette affection et le choléra véritable, et cette confusion a même été un obstacle à la mise en œuvre du procédé si curieux que Pasteur a proposé à l’effet d’obtenir la destruction des lapins qui ravagent l’Australie.
Cette maladie est caractérisée par un état de dépression de la poule, qui reste immobile, s’efforçant de se réchauffer au soleil; elle se traîne sur le sol, sa crête devient violacée, puis noire; elle a une diarrhée séro-muqueuse très abondante et succombe rapidement. Ce choléra des poules constitue une maladie épidémique qui décime les poulaillers et qui a paru, vers la fin du siècle dernier, en 1789, en Lombardie. Nous la trouvons en France, aux environs de Paris, en 1830; elle est bien étudiée, en 1851, par Renaut et Delafond, et plus récemment, en 1877, par Joannès et Mégnin, puis par Semmer (de Dorpat).
Fig. 7. — Microbe du choléra des poules (d’après Pasteur).
C’est en 1878 que Péroncito découvre le micro-organisme pathogène de ce choléra des poules; en 1879, l’année suivante, Toussaint montre que ce microbe est bien la cause de la maladie, mais c’est en 1881 que Pasteur isole et cultive ce microbe et fonde, sur cette étude, la première application des virus atténués.
On trouve le micro-organisme en grande abondance dans les liquides diarrhéiques, mais son milieu de prédilection est le sang des volatiles, où l’on peut facilement constater sa présence; ce microbe, comme le montre la figure ci-dessus, est un microcoque qui a de 0μ,2 à 0μ,3 de diamètre (voir fig. 7). Ces micro-organismes sont liés deux par deux, ou en huit de chiffre; ils sont animés d’un mouvement très rapide. C’est une bactérie très aérobie, elle absorbe l’oxygène du sang et détermine l’asphyxie; on la cultive sur la gélatine peptonisée. Si le cobaye résiste à l’inoculation du choléra des poules, il n’en est pas de même des lapins, et c’est sur ce fait qu’est basée l’application de ce choléra des poules à la destruction de ces rongeurs, expérience aujourd’hui en voie d’exécution, suivant les conseils de Pasteur, par son élève Loir.
Nous allons quitter maintenant le domaine de la pathologie animale pour aborder la pathologie humaine, et nous commencerons, si vous le voulez bien, par la fièvre typhoïde.
Fig. 8. — Bacille typhique. Ses aspects différents dans une culture sur gélatine-peptone inclinée.
Du Bacillus typhosus.
C’est en 1864 qu’un professeur de Sienne, Tigri, signala, le premier, la présence des bactéries dans les veines pulmonaires et la cavité gauche du cœur d’un individu ayant succombé à la dothiénentérie. Puis deux professeurs de l’Ecole de Nancy, Coze et Feltz, décrivent dans le sang des typhiques des bâtonnets ayant de 5 à 6 μ de longueur. Longtemps après, en 1871, Recklinghausen constate la présence, dans des abcès miliaires du rein chez un typhique, d’une grande quantité de microbes. En 1874, Klein retrouve ces bacilles dans diverses lésions de la maladie. Sokoloff signale leur présence la même année dans les ganglions lymphatiques, et Browicz, en 1875, dans la rate. Mais c’est surtout Eberth qui, dans la série de travaux qu’il a fait paraître de 1880 à 1883, donne la meilleure description du bacille typhique, complétée par celle de Klebs, en 1881, et que Coast et Crook décrivent à leur tour en 1882. Ce n’est qu’en 1884 que Gaffky obtient des cultures de ce bacille dans la gélatine.
En 1885, Artaud, dans sa thèse inaugurale, décrit un microbe en navette qui serait caractéristique de la fièvre typhoïde, mais il ne parvient pas à le cultiver. Enfin, en 1887, paraissent les remarquables travaux de Chantemesse et Widal, et c’est sur l’ensemble de ces travaux que nous pouvons aujourd’hui baser la description du Bacillus typhosus. Il se présente sous des formes variables; il est plus long que large, et il peut avoir de 2 à 6 μ de longueur sur 1 à 2 μ de largeur. Il est très mobile, et la figure suivante vous montrera l’aspect qu’il présente ordinairement (voir fig. 8).
Fig. 9. — Bacille typhique (d’après Artaud).
Souvent, il offre à sa partie centrale un espace clair qui lui donne alors cette forme en navette qu’Artaud avait signalée comme caractéristique de ce bacille. On a émis plusieurs opinions pour expliquer cette forme en navette: les uns veulent y voir une sporulation; d’autres, comme Chantemesse, un commencement de scissiparité ; Dubief soutient qu’il s’agit là simplement d’un artifice de préparation, et que c’est le chauffage et la dessiccation qui produisent cette forme spéciale en navette, forme que vous trouvez reproduite nettement dans cette figure empruntée à Artaud (voir fig. 9).
Fig. 10. — Sporulation du bacille typhique (d’après Chantemesse et Widal).
Ce bacille se reproduit par scissiparité et par sporulation. Cette sporulation se fait, comme l’ont montré Widal et Chantemesse, à l’extrémité du bacille, et la figure que je vous montre vous donne une bonne idée de cette sporulation (voir fig. 10).
Ces spores sont très résistantes à nos moyens de destruction; la dessiccation ne les tue pas, et il faut dépasser 90 degrés pour les détruire. Ce bacille produirait une ptomaïne très toxique que Briéger a décrite sous le nom de typhotoxine. Il se retrouve, après la mort, dans toutes les lésions pathologiques déterminées par la fièvre typhoïde, mais même pendant la vie, on peut retrouver ce bacille soit en pratiquant des ponctions capillaires dans la rate, ponctions d’ailleurs absolument inoffensives, soit en examinant les urines, comme l’a signalé Bouchard, dès 1881, soit en examinant les matières fécales. Souvent même, les bacilles, contenus dans les matières fécales, trouvent dans certaines eaux un milieu favorable à leur développement, et l’on peut, comme l’a fait Chantemesse, retrouver leur présence dans ces eaux contaminées. Lorsque je vous parlerai de la prophylaxie par l’alimentation, je reviendrai plus longuement sur ce point si important de la propagation de la fièvre typhoïde par les urines et les matières fécales.
Fig. 11. — Bactéries du choléra dans une culture sur gélatine-peptone.
Il ne resterait plus aucun point obscur sur la biologie du Bacillus typhosus si l’on pouvait, chez les animaux, reproduire la fièvre typhoïde. Malheureusement pour l’expérimentation, les animaux ne prennent pas la fièvre typhoïde et, malgré les essais si habilement dirigés par Chantemesse et Widal sur les souris et les rats, l’introduction du Bacillus typhosus dans le péritoine de ces animaux détermine une mort rapide, en vingt-quatre heures, ce qui rapproche plus ces phénomènes toxiques de la septicémie que de la fièvre typhoïde.
Du bacille en virgule.
Cette même impossibilité de déterminer chez les animaux, avec le microbe pathogène, la maladie infectieuse dont il est le vecteur, se retrouve pour le choléra. La contagiosité du choléra était admise depuis de longues années et paraissait définitivement démontrée. Mais c’est Koch qui a fait connaître, le premier, dans sa communication du 26 juillet 1884, à l’office sanitaire allemand, le microbe pathogène de cette maladie infectieuse, auquel il a donné le nom de Koma bacillus, ou bacille en virgule, à cause de la forme qu’il présente. C’est un bacille aérobie, ayant 3 μ de longueur et 0μ,8 de largeur; il est doué de mouvements très actifs, et sa forme caractéristique que reproduit le dessin que je vous présente, résulte probablement, comme l’a fort bien dit Dubief, de la fragmentation d’un spirille (voir fig. 11).
On ne retrouve ce bacille que dans l’intestin et dans les garde-robes. Il n’existerait ni dans le sang ni dans les autres organes. Koch nous a montré comment on peut obtenir des cultures pures de ce bacille; elles se font soit sur la gélatine peptonisée, soit sur l’agar-agar, soit sur le sérum gélatinisé. Ces cultures liquéfient la gélatine, et les colonies qu’on en obtient ont une forme caractéristique; elles constituent des zones concentriques dont le centre légèrement déprimé donne à l’ensemble de la colonie une forme de cupule.
La température la plus favorable à son développement est celle de 37 à 38 degrés; à 40 degrés, la culture cesse, et, entre 50 et 55 degrés, le bacille meurt. Le froid ne détruit pas ce bacille; mais, en revanche, la dessiccation le détruit. De là, cette proposition si étrange de Koch, de ne pas laver les rues pendant les épidémies de choléra.
Le point le plus intéressant de l’histoire de ce bacille-virgule, c’est qu’il ne se développe que dans les milieux alcalins, et il suffit de traces à peine appréciables d’acides pour le détruire. C’est là une des circonstances qui expliquent l’inefficacité des tentatives faites chez l’homme pour l’inoculation du choléra, le suc gastrique détruisant les bacilles. Chez les animaux, on a procédé d’une façon différente, mais toujours par des artifices de préparation. C’est ainsi que Nicati et Rietsch lient le canal cholédoque chez les animaux, avant d’introduire dans le duodénum le bacille. Koch commence par introduire du bicarbonate de soude dans l’estomac, puis il injecte le bacille et, pour obtenir l’arrêt des contractions intestinales, il introduit dans le péritoine de la teinture d’opium. Doyen a proposé de substituer à la teinture d’opium l’alcool, qui produit le même effet. Ce sont là des procédés complexes, qui vicient le résultat de l’expérience. Nous verrons, lorsque je vous parlerai des vaccins atténués, comment Gamaleïa, d’Odessa, est parvenu à constituer avec le liquide qui a servi à la culture de ce microbe du choléra inoculé au pigeon, un vaccin préservatif du choléra.
Du Bacillus tuberculosus.
Les mêmes difficultés expérimentales ne se retrouvent pas pour le bacille de la tuberculose, et ici au contraire, bien avant la découverte du bacille, l’expérience s’était prononcée sur l’inoculabilité du tubercule. C’est Villemin qui, en 1865, consacra par ses belles recherches cette inoculabilité du tubercule; il confirmait ainsi la pensée de Laënnec, qui croyait que le tubercule n’était qu’un parasite développé en dehors des tissus de l’économie et vivant à leurs dépens. La nouvelle définition que Villemin donnait de la tuberculose, qu’il considérait comme une maladie virulente et inoculable, ne fut pas admise sans conteste. On soutint, avec expériences à l’appui, que toute substance étrangère introduite chez les animaux pouvait déterminer ces tubercules, et l’on considéra certaines espèces d’animaux comme éminemment tuberculisables, le lapin par exemple.
Les belles expériences d’Hippolyte Martin montrèrent quelle confusion s’était produite parmi les expérimentateurs. Il existe, en effet, des pseudo-tubercules absolument analogues, au point de vue histologique, avec le tubercule vrai, et qui n’en diffèrent que par ce point seul, que ces pseudo-tubercules ne peuvent se transmettre par inoculation en série, c’est-à-dire que, produits une première fois chez un lapin par exemple, ils ne pourront être transmis de lapin à lapin par des inoculations successives. Au tubercule vrai seul appartient cette propriété.
L’explication de ce fait devait nous être donnée, quelques années plus tard, par la découverte de Koch en 1882. Avant Koch, Klebs en 1877 et Toussaint en 1880 avaient signalé deux micro-organismes différents, qu’ils considéraient comme caractéristiques de la tuberculose; l’un et l’autre s’étaient efforcés de cultiver ce micro-organisme, et les tentatives d’inoculation faites par Klebs et Toussaint avaient donné des résultats positifs. Mais c’est à Koch que revient l’honneur de la découverte du Bacillus tuberculosus. Par des procédés de coloration spéciaux, il permit de reconnaître facilement ce bacille, qui est composé de bâtonnets ayant de 3 à 5 μ de longueur sur 0μ,3 à 0μ,5 de largeur; Il est légèrement arqué, suivant son grand axe. Lorsqu’on l’examine avec de forts grossissements, on constate dans son intérieur des parties claires et des parties foncées; les uns veulent y voir des spores; les autres au contraire, comme Dubief, de simples artifices de préparation.
Koch a cultivé ce bacille sur le sérum gélatinisé. Aujourd’hui, le meilleur terrain de culture, comme l’ont montré Nocard et Roux, serait l’agar-agar glycériné. Les colonies qui se forment constituent de petites écailles superficielles, qui ont besoin pour se développer d’une température de 38 à 39 degrés. La culture cesse, dès que la température dépasse 40 degrés. Il vous suffira de jeter les yeux sur la planche qui accompagne cette leçon, où j’ai reproduit la culture en tubes de la plupart des microbes, pour voir l’apparence que prennent les colonies du Bacillus tuberculosus. Ces cultures ne liquéfient pas la gélatine, et, pour les obtenir parfaitement pures, il est nécessaire de faire une série de ces cultures. Elles transmettent la tuberculose, et aujourd’hui tout le monde est d’accord pour considérer ce bacille comme le micro-organisme pathogène de la tuberculose. Je passerai rapidement sur les expériences d’inoculation sur les animaux, me proposant de revenir plus longuement sur ce point, lorsque dans la dernière leçon j’établirai avec vous le traitement prophylactique de la tuberculose, et je passe maintenant à l’étude du micro-organisme pathogène de la pneumonie.
Fig. 12. Pneumocoque de la pneumonie.
Du pneumocoque.
La nature parasitaire de la pneumonie est un des points les plus intéressants, j’allais dire les plus étranges, de la doctrine microbienne, et j’avoue qu’on nous eût bien étonnés au début de nos études médicales si l’on nous avait dit qu’un jour la pneumonie, type des maladies inflammatoires, viendrait augmenter le groupe des maladies infectieuses et virulentes.
Lorsque l’on examine les poumons d’individus ayant succomb à une pneumonie, on trouve en raclant la surface du poumon des micro-organismes, ayant une forme lancéolée caractéristique, qui sont tantôt isolés, tantôt réunis deux par deux, comme vous pouvez en juger par la figure ci-dessus (voir fig. 12).
Quelques-uns de ces pneumocoques sont entourés d’une capsule sur laquelle on a longuement discuté. Décrite pour la première fois par Grunther, cette capsule a été considérée comme caractéristique du pneumococcus par Friedlander, tandis que Talamon, Afanassiew, Cornil et Franckel lui dénient toute valeur caractéristique. Ce pneumococcus se cultive dans des bouillons de culture ou sur la gélatine, qu’il ne liquéfie pas. La meilleure température pour obtenir un rapide développement de ce pneumocoque est celle de 30 à 35 degrés. Lorsqu’on prend ce micro-organisme à l’état de pureté et qu’on l’inocule directement dans le poumon des animaux, on développe chez eux de la pneumonie. Ce pneumocoque, en effet, provoque une exsudation fibrineuse considérable qui amène l’oblitération des alvéoles pulmonaires et l’hépatisation. Quant à la transformation purulente de l’exsudat, elle serait provoquée par d’autres micro-organismes, ceux de la suppuration.
Fig. 13. — Staphylococcus pyogenes aureus, d’après une culture sur gélatine-peptone ensemencée avec du pus d’ostéomyélite aiguë.
La découverte de ce micro-organisme est d’ailleurs de date récente. Quoique Billroth en 1873 et Klebs en 1876 aient décrit des micro-organismes dans les crachats et dans les exsudats des pneumoniques, ce n’est qu’en 1882 que Friedlander a surtout appelé l’attention sur le diplocoque de la pneumonie, et presque en même temps en France Talamon signalait de son côté l’existence de ces micro-organismes. Il est bon d’ailleurs d’ajouter que, dans les crachats des pneumoniques, on trouve différents autres microbes et en particulier ceux de la salive, que Pasteur a décrits le premier et qui, inoculés aux lapins, déterminent chez ces animaux de la congestion pulmonaire et des phénomènes toxiques mortels, à l’ensemble desquels on a donné le nom de maladie de Pasteur, et je terminerai ce rapide aperçu en vous disant quelques mots des septicémies.
Des septicémies.
C’est là un des sujets les plus complexes et les plus difficiles de la bactériologie, et, pour y mettre un peu d’ordre, j’adopterai la division de Dubief qui a classé les septicémies en trois grands groupes: les septicémies suppuratives, c’est-à-dire celles où la formation du pus constitue l’élément le plus important; les septicémies septiques, dans lesquelles les accidents graves et foudroyants peuvent avoir lieu avec ou sans formation de pus, et dont certaines formes d’empoisonnement puerpéral présentent le type le plus complet; enfin, les septicémies gangréneuses, où l’on voit se produire des emphysèmes et des gangrènes plus ou moins étendus. Toutes ces septicémies, qu’elles soient suppuratives, septiques ou gangréneuses, peuvent être déterminées par un grand nombre de microbes, et il est facile de comprendre qu’il peut y avoir en quelque sorte des septicémies mixtes, où les trois espèces de microbes suppuratifs, septiques et gangréneux, peuvent agir de concert; c’est, vous le savez, le cas pour certaines formes de fièvre puerpérale.
Fig. 14. — Streptococcus pyogenes.
Des septicémies suppuratives.
Pour les septicémies suppuratives, on a décrit plusieurs micro-organismes pouvant produire le pus, et je vous signalerai tout particulièrement le Staphylococcus pyogenes aureus qui est caractérisé surtout par la coloration jaune que produit sa culture sur l’agar-agar; il liquéfie la gélatine. La figure ci-contre vous montre la forme de ces cocci cultivés (voir fig. 13).
A côté de ces micro-organismes qui sont les plus fréquents dans le pus, il faut placer le Staphylococcus pyogenes citrus, le Staphylococcus pyogenes albus et le Staphylococcus flavescens, qui ne diffèrent de l’aureus que par la coloration différente que donne leur culture dans l’agar-agar. A tous ces cocci, il faut joindre un microbe que Pasteur a trouvé dans l’eau de Seine et qui produit chez les animaux des abcès métastatiques, c’est le microbe pyogénique de Pasteur, ainsi qu’un autre microbe de très petit volume, que Rosenbach a décrit sous le nom de Staphylococcus pyogenes tenuis. Tous ces microbes liquéfient la gélatine.
Des septicémies septiques.
A côté de tous ces microbes de la suppuration, il en est un qui mérite une mention spéciale, c’est le Streptococcus pyogenes, que vous voyez représenté dans cette figure (fig. 14). Ce streptoccoque ne liquéfie pas la gélatine, et il a par ses propriétés générales et sa forme en chapelet de grandes affinités avec les parasites de l’érysipèle et de certaines formes d’infection puerpérale; un fait à noter, c’est qu’on le trouve toujours dans les suppurations ayant pour siège une séreuse. Cet organisme sert de transition et de trait d’union entre les microcoques de la suppuration et les microcoques septiques; en effet, il ne produit pas toujours la suppuration quand on l’injecte aux animaux et c’est alors une série d’accidents septiques purs qu’on voit se développer.
Une expérience faite sur l’homme dans notre laboratoire, a montré que, même dans notre espèce, ce microbe provenant cependant d’un foyer de suppuration où il existait seul ne produisait pas fatalement la suppuration. Cette expérience toute involontaire faillit tourner au tragique: le docteur Dubief, en faisant des expériences sur des lapins avec des cultures pures de ces microcoques recueillis dans un cas de pleurésie purulente, et aidé par notre fille de laboratoire, piqua celle-ci au bras par mégarde; l’on vit bientôt se développer avec une extrême rapidité des accidents septicémiques de la plus haute gravité, qui firent craindre pendant vingt-quatre heures que la malade succombât. Les symptômes graves disparurent après une crise urinaire sans qu’il se soit montré trace de suppuration. Nous avions eu ainsi sous les yeux un cas type de septicémie septique.
Certaines formes de septicémies puerpérales présentent ainsi ces septicémies toxiques; mais ce sont habituellement des septicémies mixtes, dans lesquelles on trouve côte à côte, des accidents septiques et du pus. On a d’ailleurs trouvé un grand nombre de microbes différents dans les lésions post-puerpérales et je vous renvoie pour cela aux travaux de Pasteur et Doléris.
Des septicémies gangreneuses.
Quant aux septicémies gangréneuses, elles sont produites par des vibrions et en particulier par le vibrion de la septicémie. C’est une bactérie très allongée, ayant de 5 à 6 μ de longueur, g douée de mouvements très actifs, et évoluant ainsi au milieu des globules sanguins; elle est anaérobie, et on l’a confondue, comme je vous l’ai dit au début de cette leçon, avec le Bacillus anthracis. C’est à ces vibrions que sont dus les œdèmes malins, les érysipèles bronzés, etc., en un mot, toutes ces septicémies où la gangrène joue un rôle important.
A côté de ces septicémies spéciales à l’homme, il existe des septicémies expérimentales propres à des variétés d’animaux: la septicémie du lapin, la septicémie de la souris, si curieuse par ce fait que les souris des maisons succombent à cette septicémie, tandis que les souris des champs y résistent.
Mais ce qu’il faut retenir surtout de cette étude encore si confuse des micro-organismes des maladies septiques, c’est que, qu’il s’agisse de suppuration, d’intoxication ou de phénomènes gangréneux, on trouve toujours un ou plusieurs micro-organismes comme cause des accidents, et l’on a pu établir cette loi, que la chirurgie de nos jours a confirmée, c’est que l’absence de ces micro-organismes amène la disparition absolue de ces phénomènes, de telle sorte que l’on peut prendre comme devise de la chirurgie antiseptique ces mots: Pas de microbes, pas de pus.
Fig. 15. — Streptococcus de l’érysipèle.
De l’érysipèle.
L’érysipèle a quelques points communs avec ces septicémies, mais il est important de distinguer ce qui est propre à l’érysipèle et à la septicémie; dans nos salles de médecine, l’érysipèle est une maladie bénigne et la mort est exceptionnelle. Dans les salles de chirurgie, au contraire, vous connaissez tous la gravité de l’érysipèle. Il est donc probable que les érysipèles dits chirurgicaux sont toujours compliqués de septicémie, et qu’au microbe de l’érysipèle, le Streptococcus erysipelatus, se joignent les micro-organismes des septicémies. Ce streptococcus est disposé en chaînette et composé de cocci arrondis ayant un diamètre de 0μ,3.
La figure que je mets sous vos yeux donne une idée très nette de ce micro-organisme (voir fig. 15).
J’ajouterai que récemment on a rapproché le microbe de J’érysipèle de certains organismes en chaînettes trouvés dans des cas d’infection puerpérale . Ce rapprochement était d’ailleurs fait depuis longtemps par les cliniciens qui avaient été maintes fois frappés de la coïncidence de l’érysipèle avec le développement des accidents puerpéraux, à une époque où l’antisepsie obstétricale et l’isolement des femmes en couches n’étaient pas mis en pratique dans nos hôpitaux. D’ailleurs les découvertes s’accumulent de jour en jour et il est probable que chacune des suppurations aura son micro-organisme spécial. C’est ainsi que nous voyons Albarran et Hallé signaler une bactérie pyogène propre aux suppurations du rein et de la vessie . Ajoutons que comme pour le choléra les bactéries pyogènes paraissent sécréter des ptomaïnes qui doivent jouer un rôle dans la manifestation des phénomènes septiques, ce qui vous montre combien est encore complexe cette grande question de la septicémie.
De la blennorrhagie.
La blennorrhagie est entrée aussi dans le groupe des maladies microbiennes. Jousseaume avait trouvé, en 1862, des algues dans le pus de la blennorhagie, qu’il avait dénommées du nom de genitalia. Déjà auparavant, Hallier, en 1859, avait signalé des cocci dans le pus blennorrhagique. Bouchard, longtemps après, en 1878, indiqua des microcoques ayant l’apparence de virgules. Mais c’est à Neissler que l’on doit la découverte du microbe de la blennorrhagie. Ce micro-organisme, le gonococcus, est arrondi, isolé, ne forme pas de chaînette, paraît mobile; son diamètre varie de 0μ,3 à 0μ,4. Il a été cultivé par Bumm, qui considère le sérum du sang humain comme le meilleur terrain de culture. Inoculé localement dans la muqueuse de l’urèthre, ce microbe déterminerait la blennorrhagie.
Il me resterait à vous parler des micro-organismes de la lèpre, de la fièvre intermittente, de la fièvre jaune et de la diphthérie; mais sur toutes ces affections, nos données microbiologiques sont encore bien incertaines. D’ailleurs, j’étendrais outre mesure cette leçon déjà si longue; je m’arrête donc là, et j’espère que ces données si incomplètes vous suffiront cependant pour suivre les développements dans lesquels je vais entrer dans le cours de ces conférences, où nous reviendrons à chaque instant sur la biologie et la physiologie pathologique de ces microbes. Je vous montrerai par la suite de ces leçons que c’est sur ces études que doit être absolument basée la prophylaxie des maladies infectieuses.