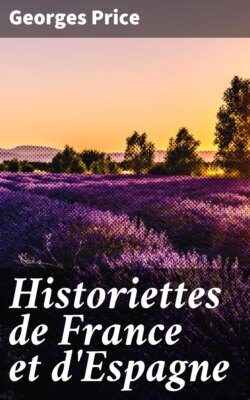Читать книгу Historiettes de France et d'Espagne - Georges Price - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA
TÊTE DE CIRE
PLAIDOYER DE L’ACCUSÉ
ОглавлениеTable des matières
… Je commencerai, messieurs les jurés, par vous retracer les débuts de ma vie jusqu’au jour du crime. Je raconterai ensuite le crime lui-même, et l’enchaînement des faits psychologiques par lesquels j’en suis arrivé à assassiner ce malheureux coiffeur. Le mot psychologique a amené un sourire sur vos lèvres… Non, messieurs, je ne fais pas de pose: un homme qui défend sa tête n’y songe guère. Mais je suis bien forcé d’employer le mot propre, et je crois que toute l’humilité que peut imposer la situation d’accusé ne saurait aller jusqu’à m’obliger d’user sciemment d’un autre mot que celui qui rend ma pensée.
Pendant ma détention préventive, aussi bien que pendant ma maladie, j’ai longuement réfléchi. Cette maladie, cette terrible congestion cérébrale qui m’a frappé après mon arrestation, a été la détente furieuse d’un cerveau pour ainsi dire comprimé jusqu’à la folie. On m’a arraché à la mort naturelle pour me mettre aux prises avec la mort civilisée; et, dans la période de repos qui suit ces atroces secousses, un phénomène étrange s’est passé en moi: tout mon être moral, insensibilisé, a revécu sa vie passée sans la souffrir, sensation analogue à celle qu’éprouverait l’âme d’un homme entrée par hasard dans celle d’un inconnu: elle assisterait à tous les drames intérieurs de la vie intellectuelle, elle les jouerait même: mais les dénouements ne lui en causeraient ni joie ni douleur. Cet état m’a permis de tout analyser, froidement, comme a pu le faire le médecin expert dont vous avez entendu le rapport. C’est donc un témoin qui va parler, un témoin impartial, quelque bizarre que cela puisse vous paraître. Car, tout en défendant ma vie, j’ai assez d’arguments dans le simple récit de la vérité pour dédaigner un mensonge. Ne vous étonnez donc pas si ce témoin, que je suis aujourd’hui, dissèque devant vous le cœur et l’existence de l’homme que je fus jusqu’au jour du crime; et si, dans sa nomenclature, il ne trouve pas le mot juste, veuillez le lui pardonner.
Les faits clairs, brefs, et avoués d’ailleurs, sont ceux-ci:
J’ai tué un coiffeur sur son simple refus d’enlever de son étalage une poupée de cire.
L’enquête la plus minutieuse n’a pu révéler un autre mobile.
Je n’en ai indiqué aucun.
On a cherché la femme. On ne l’a pas trouvée.
Mon défenseur vient de plaider la folie. M. le médecin aliéniste l’avait démenti d’avance, et tout en rendant justice au sentiment qui a dicté l’argumentation de mon avocat, je suis avec le médecin légiste: j’espère vous prouver que je ne suis pas fou.
Enfin, on s’est demandé si quelque immense malheur n’avait pas jeté dans ma tête un trouble passager; si la poupée de cire n’était pas l’image d’une femme éperdûment aimée et infidèle.
Rien, toujours rien. On n’a pas trouvé dans ma vie ces déchirements aigus, ces effondrements qui peuvent éteindre un libre arbitre. J’ai aimé une femme, une brune. La poupée de cire, comme vous pouvez le voir sur la table des pièces à conviction, est blonde avec des yeux bleu d’acier.
Alors, on s’est rejeté sur un instinct sanguinaire longtemps contenu et qui se serait fait jour, sur une de ces bestialités féroces qui se manifestent par d’horribles éclats chez de grossières natures: un savant phrénologue m’a découvert une protubérance des plus accusées à la place de la destructivité, et M. le procureur général m’a accusé de m’être amusé, dans mon enfance, à empoisonner, avec tous les métalloïdes connus, d’innocents coléoptères. On a même relevé contre moi une autre charge accablante: à quatorze ans, j’ai tué un chien dans un champ, et je suis rentré en me glorifiant de ma prouesse. Messieurs, si j’ai la bosse de la destructivité, j’ai à un degré égal celle de la bienveillance. Collectionneur d’insectes, je cherchais un moyen de les piquer sur mes lièges et de les tuer immédiatement sans leur faire subir la torture de la mort par l’empalement. Quant au chien. c’est vrai, messieurs; à quatorze ans, j’étais fier de l’avoir tué; il était enragé!
Je ne veux pas me donner comme un homme d’une douceur exceptionnelle, mais je ne vois rien là qui dénote chez moi un instinct de bestialité quelconque. Je suis simplement un homme comme il y en a beaucoup, plutôt bon que mauvais.
A dix-neuf ans, je quittai ma petite ville natale. Deux mots sur ce départ, qui est une des charges de l’accusation. Oui, messieurs, j’ai quitté mon père et ma mère, sans leur consentement, avec cent francs dans ma poche, pour venir à Paris. Leur situation n’était pas brillante. Est-ce parce que je ne pouvais supporter ma part de leur misère que je suis venu l’affronter seul à Paris? Est-ce pour fuir cette bonne pauvreté du foyer, éclairée par les lueurs d’espérance qui jaillissent du contact de trois cœurs unis, que je me suis jeté dans le sinistre dénûment de l’homme seul perdu dans la grande ville? Vous sentez bien que non. Je suis parti parce que, grisé par des lauriers de collège et des succès de petite ville, je me croyais un avenir littéraire: que le prix de discours latin, montant sur l’estrade banalement décorée pour y recevoir le baiser officiel et distrait, qui ne s’est pas vu escaladant les gradins de l’Institut, me jette la première pierre. Je me croyais là un trésor à mettre au jour, une mine qui fournirait plus tard aux besoins de ma famille, et qui nous rendrait tous fiers de moi. C’est une erreur, non une faute: j’étais ambitieux de la même ambition qui a conduit Sardou à l’Académie française.
Je vins donc à Paris. Je vous l’ai dit, j’avais cent francs dans ma poche et une dizaine de manuscrits.
J’arrivai à cinq heures du matin. C’était au printemps. Il commençait à faire jour. En débarquant à la gare Montparnasse… pardonnez-moi ces détails… je frappai fièrement le sol de cette ville, que je n’avais vue qu’une fois, où je voulais me faire une belle et large place. Je marchais le front haut; j’allais gagner ma vie. J’aurais des obstacles sans doute: d’autres les avaient surmontés. J’allais droit devant moi, regardant les écriteaux des grandes voies, assistant avec ivresse au réveil matinal des rues, symbole du renouveau de mon esprit. Je me trouvai, je ne sais comment, au Luxembourg, où j’entrai. J’avais fait trente heures de chemin de fer. Je n’étais pas fatigué. A dix heures seulement, je pris une petite chambre rue de Vaugirard, bien sombre, bien pauvre, au quatrième sur la cour. Mais je l’illuminai en y entrant de toute la splendeur de mes rêves. Je mis en ordre mes manuscrits et partis en campagne.
Je ne connaissais personne à Paris. Mais j’entrai dans un café et relevai sur le Bottin les adresses de tous les journaux et de tous les libraires.
Après quoi, je commençai ma tournée.
Ce jour-là, je fis onze visites.
Je fus onze fois éconduit par des garçons de bureaux à moustaches; et malgré la brutalité de ma nature, comme dit M. le procureur général, je me retirai partout sans rien dire. Le soir, rentré dans ma chambrette, je me reprochai de m’y être mal pris: les rédacteurs en chef devaient être si occupés! Je me rejetterais sur les secrétaires de rédaction. En attendant, pour changer, j’irais le lendemain chez les libraires.
Je fus reçu par des commis. Ceux-là, du moins, me dirent:
–Mettez ça là et repassez dans quinze jours.
C’était l’espoir.
Je repris les journaux, je refis les onze visites. On me remit onze fois à la porte, un peu moins poliment que la veille.
Alors, j’allai dans un théâtre porter une pièce en trois actes. Il fallait en faire faire trois copies. Coût net, 45francs. Il ne me restait plus un rouge liard. Mais ma chambre était payée. Il fallait vivre. Je rencontrai par hasard un de mes camarades de collège. Plus âgé que moi de deux ou trois ans, recevant de sa famille une pension suffisante, et, de plus, absolument dans les idées politiques du jour, il s’était fait une place dans le petit journalisme. Au lycée, il ne faisait pas une dictée sans fautes. Mais chacun sait que pour écrire, aujourd’hui, il n’est pas besoin de savoir le français, au contraire. Mon camarade était directeur d’une feuille infime. Je me crus sauvé. Je lui exposai ma situation et mes projets. Il m’écouta d’un air distrait, en distribuant des poignées de main à droite et à gauche, en envoyant des bonjours familiers à des femmes qui passaient en Victoria,– nous étions sur le boulevard. Puis il s’apprêtait, lui aussi, à m’éconduire, quand subitement il se ravisa.
–Ecoute, mon cher ami, ta situation m’intéresse; je fais, dans ce moment-ci, un travail très sérieux pour le journal; je vais te faire une proposition: Peux-tu, toi qui es ferré sur le grec et le latin, me faire, en trois articles, en puisant aux sources, un résumé de l’histoire de tout ce qui a ressemblé à un Sénat, depuis le commencement du monde jusqu’à nos jours?
–En trois articles?
–Ni plus ni moins.
–Mais c’est mille fois plus difficile que de le faire en cinquante!
–Parbleu!
–J’essayerai.
Il fallait bien!
–Alors, dans huit jours!
–Merci de m’avoir pris pour ton collaborateur.
–Non, pardon.... pas collaborateur. Plus tard, nous verrons. Mais, pour le moment, je dirais. secrétaire, si tu n’étais pas un camarade. Tu conçois bien que ton inexpérience, ton peu d’habitude du journalisme, etc., etc. Je serai obligé de retoucher, peut-être de refaire. Je te payerai cela cent francs.
Je me mis à l’œuvre. Je vendis ma bague et une épingle. Mes trois articles parurent intacts, furent reproduits par dix journaux et signés par mon camarade.
Voilà, messieurs, quels furent mes débuts. Si j’ai abusé, pour vous en faire le récit, de votre patience et de votre attention, c’est que tout le reste de ma vie, jusqu’au jour où je vins habiter rue des Moines, c’est-à-dire jusqu’à il y a un an, n’a été qu’une suite de chapitres semblables ajoutés à ce commencement.
L’éternelle histoire des mises à la porte de celui qui vient proposer le fruit de son travail; des manuscrits rendus, tout ficelés–quand on vous les rend; des heures passées dans les antichambres; des réceptions vingt fois remises, finalement refusées; la longue épopée de l’homme que ses traditions de famille et le respect de lui-même obligent à être convenablement vêtu et qui se gante d’un déjeuner et se chausse de douze dîners, en mangeant du pain sec. Je vivais de mes articles pour mon camarade. Il me recevait au milieu des littérateurs de sa connaissance. Jamais il ne me présenta à aucun. Sans un seul ami, sans une porte entr’ouverte, je me plongeai dans un travail opiniâtre, enragé. Mes travaux pour lui me rapportaient cent francs, quelquefois cent cinquante par mois. Je ne faisais pas de dettes, et je vivais. Je fouillais la bibliothèque de la Sorbonne. J’ai appris seul ainsi le sanscrit et l’arabe. J’ai fait une Histoire de la famille en trois volumes; j’ai effleuré la physique et approfondi la chimie; je me suis assimilé avec fureur tout ce que j’ai pu des connaissances humaines. J’ai creusé la philosophie comme un fils de Leibnitz et la théologie comme un bénédictin.
Oui. messieurs, je vivais; mais de quelle vie de privations pour une âme élevée!
Ah! je laisse de côté les privations physiques, . ces coups d’épingle, bien durs pourtant, qui font que le cerveau, vide du vide de l’estomac, laisse flotter la pensée indécise, que la main transie se raidit sur la plume, que le froid de décembre, riant du vieux pardessus d’été, attaque votre poitrine et vous donne la fièvre. Mais la torture morale de se sentir une valeur, quand ce ne serait que celle de l’instruction acquise, et de trouver impitoyablement fermée devant soi la porte de bois brutale close partout devant l’homme inconnu, n’est-ce pas quelque chose d’effrayant?
Je ne me plaignais pas pourtant; j’espérais toujours. La foi est si tenace à vingt ans! J’eus une première douleur aiguë et poignante, au milieu de toutes ces piqûres: mon père et ma mère moururent à deux jours l’un de l’autre. Je n’avais pas d’argent pour aller leur fermer les yeux. C’est invraisemblable, pensez-vous? Ah! sans doute, pour vous, messieurs de la cour, qui occupez dans la société une si haute et si noble place, pour vous, dont la vie bien commencée, régulièrement conduite, a pu prévoir toutes les éventualités, c’est invraisemblable! Pour vous, messieurs les jurés, pour vous qui, par des situations honorables et peut-être laborieusement acquises, avez pu vous ménager, dans des relations longtemps cultivées, les dévouements de l’amitié, c’est invraisemblable! Mais moi! L’homme pour lequel je faisais des articles était absent. Son intérêt, à défaut de son cœur, l’eût poussé à m’obliger. Je connaissais seulement deux jeunes gens, voisins de travail à la Sorbonne: l’un eût pu me rendre service; mais il refusa et me fit sentir que, quand on n’avait pas cent francs pour aller assister aux derniers moments de ses parents, on ne portait pas des gants, et du linge aussi éblouissant. L’autre m’avoua en rougissant qu’il était trop pauvre.
Celui-là, messieurs, j’aurai à y revenir.
Ce chagrin laissa en mon âme une trace profonde.
Eh bien, messieurs, je sortis de cette épreuve brisé, mais sans haine. Je me jetai plus que jamais dans le travail sombrement acharné qui est l’alcoolisme de l’intelligence. De nouvelles charges s’ajoutaient d’ailleurs au soin de ma vie. Il fallait liquider les quelques dettes que mon père, depuis la perte de sa fortune, n’avait pu éteindre encore, et que j’avais naturellement acceptées. Je recommençai mes courses, mes recherches. Vous avez parfois entendu dire, en parlant d’un malheureux homme de lettres: Le pauvre diable fait des traductions. Eh bien, messieurs, savez-vous que celui-là est un privilégié, et que, les traductions, … n’en fait pas qui veut! Là, comme ailleurs, j’échouai. Mais pourtant je trouvai un moyen d’augmenter mes revenus. En travaillant aux Halles, comme auxiliaire, de minuit à cinq heures du matin, je gagnais cinq francs. Dès lors, je dormais quand je pouvais. Mais j’aimais mieux cela. Le brouhaha des arrivages nocturnes, le labeur machinal qui consistait à écrire sur un registre les chiffres que des voix embrumées me jetaient à travers mon guichet, contrastant avec le silence recueilli des salles de bibliothèque et mes efforts du cerveau, tout cela me faisait croire à un repos que n’aurait pu me donner ma couche enfiévrée!
Ici se place, messieurs, ma seule aventure romanesque. Ne m’accusez pas d’un manque de pudeur morale, ni de je ne sais quelle fatuité de cour d’assises; encore une fois, je ne suis qu’un témoin, et je me suis engagé, vis-à-vis de vous, comme de moi, à dire toute la vérité.
L’histoire est banale et brève d’ailleurs. Vivant avec la chasteté austère d’un travailleur obscur, je me jetai avec furie dans mon premier amour et donnai toute mon âme à la première femme qui eut l’air d’avoir souci de la prendre. Je l’adorai. Elle n’eut qu’un caprice. Le manque d’équilibre amena la rupture, et je retombai, plus seul et un peu plus brisé, dans mon abandon.
Elle m’a donné quelques jours de bonheur, les seuls que j’aie jamais connus. Ils mirent un peu de clarté dans mon âme. Combien en fut plus amèrement sombre la nuit qui leur succéda! Je pris en horreur tous les endroits qui pouvaient me la rappeler. Je quittai mon pauvre logis de la rue de Vaugirard. Le cœur étreint par une de ces angoisses qui contiennent à la fois la désillusion des espoirs perdus et l’appréhension des sombres avenirs, je dis un dernier adieu à ces pauvres meubles, confidents de mes beaux rêves, de leurs tristes et longs réveils, témoins d’un amour brisé.
Il y avait trois ans que j’y étais entré: j’avais vingt-deux ans.
Avec cette superstition de ceux qui n’ont plus la foi, je voulus changer de milieu, me transporter dans une autre partie du monde parisien, comme le joueur malheureux qui change de table. J’allai travailler une dernière fois dans ces vieilles salles de la Sorbonne, à l’aspect familial; je voulais revoir encore ces sympathiques physionomies de travailleurs de la rive gauche; vieux savants à l’œil doux et distrait, portant sur leur calme visage le reflet serein de toute une vie cloîtrée dans une tranquille étude, jeunes chercheurs, comme moi, pâlis sur le labeur. Enfin, je désirais serrer la main à la seule personne avec qui je me fusse lié.
C’était le voisin de travail dont j’ai parlé, à propos de la mort de mes parents, celui-là même qui, faute d’argent, n’avait pu me rendre service.
Arnoldi était dans la même situation que moi. Je ne savais que son nom. Je ne connaissais rien de sa vie, si ce n’est qu’il arrivait à la bibliothèque en même temps que moi et que nous en sortions ensemble. C’était une nature étrange, un mélange bizarre de froideur et de passion. Italien élevé en France, grand, d’une beauté arabe saisissante, il était toujours mis avec une correction sous laquelle je devinais la lutte avec la misère que je soutenais moi-même. Je l’ai dit, nous sortions en même temps. Nous allions ensemble jusqu’au Luxembourg. Là, nous nous séparions. Il continuait sa route vers la rue Vavin, et je rentrais rue de Vaugirard. Nous parlions science, philosophie. Nos idées se rencontraient sur beaucoup de points. Je sentais qu’il avait passé par des épreuves comme les miennes, qu’il les subissait encore, » mais que, dans cette âme plus vigoureuse, le malheur, au lieu de laisser comme dans la mienne une fatigue nerveuse, une irritabilité saignante, avait tout dévasté pour n’y semer qu’un scepticisme effrayant: ainsi la maladie a plus de prise sur un corps robuste que sur une constitution moins forte.
Cet homme a-t-il eu pour moi une réelle affection? a-t-il simplement cédé à ce besoin de société si impérieux chez les plus misanthropes? Je ne l’ai jamais su. Toujours est-il que, quand je lui annonçai mon intention d’aller demeurer sur la rive droite, il parut attristé. Je lui promis, sur sa demande, de lui faire connaître mon adresse; je lui donnai une poignée de main…, je partis.
Le même jour, je m’installais rue des Moines, au numéro27. Mon nouveau logis était une grande pièce, située à l’entresol d’une vieille maison. Il avait dû autrefois être luxueusement meublé, et avait gardé de cette splendeur éteinte de hautes tentures d’étoffe épaisse et sombre, que le temps avait décolorées et effrangées par places. Le jour, passant entre les grandes bâtisses de la rue, avait peine à y pénétrer. C’était triste. Comme tous ceux qui sont habitués à souffrir, j’éprouvai comme une amère jouissance à demeurer dans cette chambre, où rien ne m’arracherait à mes mélancolies, où je pourrais à mon aise ruminer mes douleurs.
En face était une modeste boutique de coiffeur de faubourg. En sortant de chez moi, je remarquai dans sa vitrine un objet qui me déplut.
On trouve dans la vie des personnages sympathiques ou .antipathiques. Il y a de même des choses qui vous attirent ou vous repoussent, indépendamment de la nature même de l’objet et des idées que peut éveiller son usage: il est évident qu’une guillotine vous fait fuir, qu’au contraire une belle statue vous attire. Mais il y aura souvent, dans l’ordre des objets indifférents, tel ou tel être inanimé, une table, si vous voulez, qui vous plaira, tandis qu’une chaise vous causera un vrai sentiment de répulsion, et cela sans aucune explication possible tirée de l’esthétique ou du raisonnement. Cela tient à une disposition particulière du moment dans notre esprit. C’est une sympathie ou antipathie dont la cause est toute subjective. La chose inerte reflète pour vous l’état moral actuel de votre esprit. Voulez-vous un autre exemple de ce phénomène bien humain? Vous êtes triste. Vous rencontrez un ami heureux. Vous lui dites: Mon PAUVRE ami. Pauvre se rapporte à la situation personnelle de votre esprit, et vous transportez cet état à votre ami.
Cette digression, messieurs, n’est pas inutile. Elle vous explique comme quoi, si les choses ont des larmes au dire du poète latin, de même elles peuvent avoir des ironies. L’objet qui se trouvait dans la vitrine de mon voisin me causa une impression d’ironie, impression d’autant plus cuisante que j’en avais honte, et que la conscience que j’en avais m’apportait mon premier doute sur ma vigueur morale. C’est cette tête de cire.
Moitié pour me rendre compte de ce sentiment, moitié pour ne pas me l’avouer à moi-même, je m’approchai et je regardai.
Elle avait absolument l’air d’une tête coupée. Vous le voyez d’ailleurs, ce n’est pas un buste comme d’ordinaire chez les coiffeurs. C’est une simple tête, remarquablement exécutée d’ailleurs. Encore maintenant, en la regardant sur cette table, je ne puis me défendre d’un frisson. Elle est très blonde, du blond d’Ophélie. Les cheveux, relevés haut et rejetés en arrière, puis retombant épars, sont dans un savant désordre. Et les yeux de verre bleu d’acier ont un éclat métallique profond.
Cette tête se détachait dans le pauvre étalage sur un rideau de serge rouge qui en faisait le fond. Elle était là, posée sur la tranche de son cou, et regardait, la lèvre fine et mince arquant sa ligne rouge en un sourire méchant et hautain. Je continuai ma route, et j’allai, pensif, à mes affaires. Ce jour-là fut un jour encore plus malheureux. Le directeur de journal me refusa la majeure partie de mon travail. Le soir, plus triste encore que d’ordinaire, je revins vers dix heures. La devanture était pauvrement éclairée par une mauvaise lampe. Seuls, deux points brillants reluisaient comme des diamants: c’étaient les yeux de la femme de cire.
A cette vue, je fus épouvanté de ce qui se passait en moi. Je rentrai dans ma chambre et me demandai si je ne devenais pas fou, tant je trouvai bizarre l’action exercée sur mon être physique et moral par le reflet de ces morceaux de verre. Je résolus de me soustraire au danger en m’imposant la consigne rigoureuse de ne pas regarder du côté du coiffeur quand je sortirais ou rentrerais. Pendant huit jours, je me tins religieusement parole. Ce ne fut pas sans efforts, messieurs. Cette étrange attraction qu’exercent en général sur nos regards, les objets qui devraient les repousser, se faisait sentir avec une violence inouïe. J’éprouvais de véritables tiraillements du côté de la poupée. Néanmoins, je fus assez fort pour y résister.
Pendant cet intervalle, je reçus à deux reprises la visite d’Arnoldi. Notre liaison devint plus intime. Je lui confiai quelques particularités de ma situation. Il m’initia à certains côtés de la sienne. Je fus sur le point de lui parler de la tête de cire et de l’effet qu’elle produisait sur moi. Mais la honte d’avouer ce que je considérais comme une faiblesse me retint. Qui sait pourtant? Une analyse de mon état, faite en compagnie de cet esprit sceptique, eût peut-être exercé sur mon âme une salutaire influence!
Le huitième jour, la fascination de ces yeux mornes fut la plus forte. Je regardai.
Dès lors, chaque jour, cette sensation troublante vint prendre sa place parmi les autres amertumes de ma vie. Au bout de quelque temps, je finis par l’accepter, comme un malheureux rongé par un parasite sans cesse renaissant, qui • finit par se laisser dévorer et porte sur lui son bourreau sans chercher à s’affranchir, par une opération douloureuse, d’une souffrance qu’il sait devoir fatalement renaître.
Ma vie matérielle était toujours la même. Chaque semaine, j’allais porter à mon camarade de collège mon travail de huit jours. Il taillait dans ma pensée, rejetait ceci, prenait cela, me payait et me donnait une nouvelle tâche. De collaboration, il n’était plus question depuis longtemps. Là aussi, je ne cherchais même plus à réagir. J’acceptais la situation telle quelle. Mais, chaque samedi, j’endurais un nouveau supplice, et, chose extraordinaire, au lieu de m’y habituer, j’éprouvais chaque fois un froissement plus aigu, comme si les douleurs passées fussent restées vivantes pour s’ajouter à la douleur nouvelle.
Et quand, en revenant à mon logis, je voyais cette figure de ’décapitée darder sur moi le rayon lumineux de ses yeux fixes, je fermais les miens, établissant je ne sais quel lien mystérieux entre ma destinée et ce regard mort.
Un samedi, je vins au journal.
Mon camarade était en province. Il allait poser sa canditature à un siège de député. Il paraît qu’il s’était fait un nom. Mon pain était parti avec lui.
Je rentrai, rapportant mes manuscrits. La rue des Moines était sombre et déserte. Seules quelques femmes, semblables à des ombres dans le crépuscule, causaient immobiles et à voix basse sur le seuil des allées noires. Je regardai de loin si la boutique du coiffeur était éclairée: je respirai avec un véritable soulagement en voyant que tout était sombre, et je hâtai le pas. J’éprouvais, au milieu de mon désespoir, un âcre plaisir à pouvoir regarder cette vitrine où mon imagination surexcitée voyait une relation étrange entre une effigie sans vie et mon malheur constant. Je marchais vite, les yeux fixés sur l’étalage inoffensif: je rentrerais donc chez moi sans l’avoir vue!
J’allais tourner dans mon allée. Trois pas encore, j’étais à l’abri. A ce moment, un bruit sec retentit; le bec de gaz de la rue s’alluma juste au-dessus de la boutique, une rafale de vent fit battre et grincer les plateaux de cuivre, et la figure fardée m’apparut soudain et me jeta son défi.
Je traversai la rue, j’entrai.
Je voulais obtenir du coiffeur qu’il ôtât cette enseigne de son étalage.
L’homme s’avança avec empressement, me présenta son fauteuil de cuir vert, releva le dossier, alluma le gaz et se mit à battre son savon. Je m’assis machinalement et me laissai faire la barbe, cherchant comment j’allais m’y prendre, tremblant de lui laisser voir ma peur.
–Vous avez là une singulière poupée de cire.
–Vous trouvez, monsieur?
–Oui. Est-ce que cela vous est bien utile de garder cette tête dans votre vitrine?
–Mais sans doute, monsieur. Cela attire les clientes du quartier qui jugent par sa coiffure de notre talent. Et puis c’est un accessoire du métier.
–C’est vrai. Mais pourquoi ne mettez-vous pas un buste? Vous devriez mettre un buste. D’autant plus que, avec un commencement d’épaules et un bout de draperie de satin, la coiffure ressort bien mieux.
–Mon Dieu, monsieur, vous avez raison; mais cela fait une grosse dépense. Et, dans notre quartier, on a tant de frais et si peu de recettes!
–C’est égal. Votre poupée a l’air d’une tête coupée. Il y a des gens que cela peut impressionner… et tenez, je connais précisément quelqu’un…
Je n’osai continuer; le barbier stupéfait s’était arrêté, son rasoir en l’air, regardant si j’étais sérieux. Puis il se mit à rire et me dit: L…, la concierge d’en face, est enceinte; elle ne s’est pas encore plainte. Ses six autres enfants sont bien venus.
................................................................
Je rentrai dans un état d’agitation impossible à décrire. Le départ de celui qui me faisait vivre, mon insuccès près du coiffeur, la certitude que cette tête continuerait à me poursuivre, l’inquiétude du présent et de l’avenir, la rage de mon intelligence inutile comme mon instruction, tout cela agissait sur mon cerveau et me donnait une de ces veilles fiévreuses où l’esprit saute d’une idée à une autre, évoque le passé, bâtit des projets insensés, tandis qu’une voix intérieure fredonne malgré vous perpétuellement le même air, généralement un air sautillant, indice du trouble d’une âme où la mémoire se révolte contre le raisonnement: suprême ironie de la faiblesse de notre nature. Je pris du chloral et je dormis.
Et, le lendemain, il fallut recommencer la lutte, cette lutte pour la vie dont parle Darwin; l’absence du directeur de journal me fermait toute issue pour gagner ma vie par les lettres. Dès lors j’y renonçai. Je dévorai les Petites Affiches, les pages d’annonces, ces fameuses offres et demandes d’emplois, où il y a toujours cent demandes pour une offre. Partout, on voulait des références. Qu’avais-je fait jusqu’alors? Du journalisme! On souriait et on me disait qu’on n’avait pas de place. Un jour, j’apprends… qu’une place de garçon de bureau était vacante dans un journal. J’en étais là, messieurs. Je me présente.
–Que savez-vous faire?
–Je sais, monsieur… Je sais lire et écrire.
On m’accepta.
Mais trois jours après, un matin, seul dans le bureau, voyant devant moi une plume et du papier, la tentation fut trop forte. Je me mis à écrire une réponse à un article paru la veille dans le journal. Je fus interrompu par une voix.
–Je vous ai pris pour balayer les bureaux, et non pour faire des articles. C’est trop drôle, parole d’honneur! Passez à la caisse, faites-vous payer vos trois jours, et allez collaborer ailleurs!
Il est superflu de dire que, au milieu de toutes ces souffrances, ma santé était profondément ébranlée. Je ne vivais que de fièvre. Néanmoins, je retournai aux Halles la nuit. Et toujours, quand je partais, chaque soir à dix heures, les yeux de la tête de cire me poursuivaient de leur sinistre adieu.
N’y tenant plus, décidé à tout plutôt qu’à voir se prolonger ce supplice, je fis taire ma honte et retournai chez le coiffeur. Je parlai d’une maladie nerveuse, j’avouai humblement que sa poupée me causait une impression sinistre, je le priai de l’ôter, j’insistai, je le suppliai même. Sa femme était là. Ils se regardèrent en riant, et l’homme me dit que si j’étais malade il fallait me faire soigner; que j’étais d’ailleurs libre de déloger; qu’au surplus, il ne voyait pas pourquoi il pâtirait, lui, de mes folies à moi, qui n’étais même pas un client. Messieurs, je me retirai, la tête basse, reconnaissant en moi-même que cet homme avait raison. Voyez si je suis l’homme farouche qu’on vous a dépeint!
Déloger! Sans doute, j’aurais pu déloger. Mais on me payait chaque nuit mon travail, et comme il fallait pourvoir aux besoins journaliers, je ne pouvais jamais réunir à la fin du mois le quart de la somme, bien modique pourtant, qui m’était nécessaire pour quitter ma chambre et en payer une autre d’avance. Le perruquier avait raconté l’histoire dans le quartier: on guettait ma sortie et ma rentrée. On jouissait de ma lutte avec la tête de cire. On riait, on me montrait du doigt. Il y avait, trois portes plus loin que la mienne, un petit établissement de lingerie. Là travaillait une jeune fille de seize ou dix-sept ans, jolie, avec de grands yeux doux et tristes. Peut-être malheureuse, elle aussi, elle avait laissé s’établir entre nous une sympathie pure et muette. Un regard, et c’était tout. Un jour, en passant devant la boutique, je quêtai mon regard quotidien. La jeune fille tira vivement par la manche une de ses compagnes. Celle-ci regarda. Elles échangèrent quelques mots à voix basse et rirent aux éclats! Il m’arriva, messieurs, pour éviter ces tortures, de passer trente heures hors de chez moi, marchant toujours, les pieds dans la neige, en plein hiver, avec une redingote noire. Et cependant, comme il fallait bien dormir quelquefois, je rentrais, marchant vite, détournant les yeux, entendant les ricanements des voisins, ou, par un suprême effort de volonté, recevant en face, sans broncher, ce regard qui, maintenant, m’allait jusqu’au cœur et glaçait mon cerveau!
J’arrive, messieurs, au22février.
Ce jour-là,–un mardi,–je vis, en parcourant un journal, que mon ancien proviseur était nommé en la même qualité dans un lycée de Paris et avait pris depuis trois jours possession de son poste. Ce fut mon premier éclair d’espoir depuis bien longtemps. Une heure après, j’étais chez lui. Je sortais, après une courte entrevue, la joie au cœur: une famille italienne, la famille Colboni, qui partait pour l’Australie, l’avait chargé de chercher un précepteur. Cette famille devait arriver dans deux jours au Grand-Hôtel. Sitôt qu’on pourrait me recevoir, on m’aviserait.
Mon premier mouvement fut de courir chez Arnoldi pour lui faire part de cette bonne nouvelle. Vivre! j’allais vivre! vivre sans souci du lendemain, voyager, m’arracher enfin à ce Paris infernal! Je lui dis tout cela avec ce naïf égoïsme du premier moment de bonheur. Il m’écouta avec une froideur que j’attribuai à la nature de son caractère, me demanda quelques détails que je lui donnai de grand cœur, me félicita et me reconduisit chez moi.
J’attendis quatre jours, guettant l’arrivée du facteur, ouvrant ma porte chaque fois qu’il entrait Ceux qui ont connu l’attente comprendront le degré de surexcitation où j’arrivais! J’attendais la vie. Je ne bougeais pas de ma fenêtre. Je puisais dans l’espérance un courage surhumain, qui me permettait de braver la tête de cire. L’éclat bleuâtre de ses yeux venait me remuer jusqu’aux moelles. Par moments, il me semblait la voir remuer dans une négation sinistre. Je tressaillais. J’entendais des rires; mais je restais là, cramponné à la barre d’appui, tremblant, les yeux chauds: j’attendais.
Le quatrième jour, la nuit tombait. J’étais dans ma chambre, sans lumière,–pour cause,–et les dernières lueurs du crépuscule, filtrant à travers les hautes tentures sombres, donnaient cette clarté indécise où les objets, sans contours définis, revêtent les formes les plus étranges. J’avais quitté la fenêtre, et, brisé de fatigue, je m’étais assis dans mon unique fauteuil. L’ouïe veillait seule au milieu des sens assoupis dans une somnolence maladive, tandis que le cerveau donnait carrière à une fiévreuse activité. Je voyais de riants tableaux soudain voilés par d’horribles scènes: l’immense Océan, un beau navire, l’air, l’espace… Puis tout cela s’embrumait, se fondait en figures nouvelles, de hideuses danses, la tête de cire et ses yeux figés.
Un pas m’éveilla.
C’était le facteur.
La lettre!
J’allumai une allumette, et je lus:
«Pardon, j’ai pris votre place. J’étais trop malheureux. Pardon!
» ARNOLDI.»
Il me sembla que ma tête éclatait. Je m’abattis sur ma table, devant la fenêtre.
............................................................
Une heure après, peut-être, je sortis de mon lourd évanouissement. Par la fente des rideaux fermés, une grande lueur éblouit mes yeux. Machinalement, je levai la tenture.
La tête de cire, entourée de dix lumières, apparaissait dans une splendide auréole, et sa bouche me lançait son sourire triomphant et moqueur.
Deux secondes, et j’étais dans la boutique.
–Vous êtes un misérable lâche!
–Quel fichu soldat tu ferais, poltron, répondit l’homme en ricanant.
Messieurs, un rasoir se trouvait là.
........................................................
Et maintenant, messieurs, pardonnez-moi d’avoir si longtemps abusé de votre patience. Ne cherchez pas dans mes paroles la révolte haineuse et banale d’un impuissant contre la société, mais simplement la peinture de faits que vous coudoyez tous les jours. Voyez si je suis un grand coupable, et jugez selon votre conscience. Il restera toujours de cette cause vingt hommes de cœur qui seront initiés à des misères inconnues; et, si ma destinée implacable peut se résoudre pour les autres en un peu de bien, vraiment, messieurs, condamnez-moi, je mourrai content!