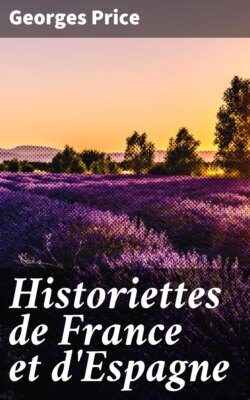Читать книгу Historiettes de France et d'Espagne - Georges Price - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеLa lampe arabe, à trois branches, en cuivre, mourait sur la table basse recouverte d’un riche tapis d’Orient, et ne jetait plus, dans la haute et vaste salle, qu’une lueur indécise et tremblante, semant de quelques étincelles les arabesques d’or perdues dans la pénombre. Les grandes fenêtres en ogive se drapaient d’immenses tentures dont les riches couleurs se fondaient en teinte sombre, et on ne distinguait le plafond à rosaces géométriques que par quelques lignes claires aux arêtes des poutrelles de cèdre.
Grenade, encore endormie, n’envoyait aucun bruit dans la maison silencieuse. Seule, la cloche de la Véla, vibrant dans les airs à de longs intervalles, disait que les gardiens du palais de Boabdile veillaient et que le kalife pouvait reposer en paix sous les lambris merveilleux de son Alhambra.
A demi couché sur un divan, près de la table, un homme soutenait son front dans ses deux mains; et le manuscrit, depuis longtemps déroulé à la même place, devant lui, indiquait que sa pensée, égarée dans quelque rêverie, était loin des lignes qui couraient sur le parchemin jauni. Il était impossible de distinguer ses traits. On voyait seulement son turban de soie blanche, et le grand manteau bleu qui, couvrant ses épaules, tombait en longs plis sur le divan.
Une porte s’ouvrit et quelqu’un entra.
Le nouveau venu, de moyenne stature, portait la brillante tenue de capitaine des gardes du kalife. La taille, bien prise, était emprisonnée dans une cuirasse dorée, ciselée en capricieux dessins. Sa tête était coiffée d’un casque d’acier léger, damasquiné, et surmonté d’une pointe de laiton poli. De larges braies de soie noire brochée d’or entraient dans des bottes rouges de Cordoue à grands éperons; et un cafetan écarlate, accroché aux deux épaules, se drapant en mille plis, et relevé à la ceinture, complétait son costume.
Il s’avança sans bruit, grâce aux épais tapis de Smyrne, jusqu’auprès du rêveur, qui, toujours absorbé dans ses songes, ne soupçonna pas sa présence. Arrivé là, il s’arrêta, et, les bras croisés, il regarda la scène muette qui s’offrait à lui. Il garda quelque temps cette attitude contemplative, et l’on eût pu lire sur ses traits fins une expression de tristesse, et dans ses yeux voilés la sollicitude attendrie qu’on éprouve pour les peines d’un ami.
Enfin, il sortit de son immobilité, et touchant légèrement l’épaule de l’homme:
–Hassan! dit-il.
Hassan écarta lentement ses mains et découvrit une figure encore jeune, mais fatiguée et pâle de cette pâleur mate des bruns du Midi. Les yeux qui brillaient grands et noirs sous le turban blanc, et la barbe brune, taillée en deux pointes, qui encadrait son visage amaigri, donnaient à cette belle physionomie une étrange et douloureuse expression.
–Ah, c’est toi, Mohammed, dit-il en se levant, –et sa figure s’éclaira un instant d’un vague sourire.–C’est toi? Je te croyais encore de garde au palais.
–Hier, mon pauvre ami!
–Comment, hier?
–Mais sans doute. Nous sommes au matin.
Et, allant aux fenêtres, Mohammed écarta vivement les rideaux. La lumière, entrant à flots, éclaira soudain les magnificences de l’architecture arabe, les recherches du luxe oriental, et Hassan, chancelant sous cette vive et brusque clarté, se rassit sur le divan.
–Vois, ami, reprit Mohammed en ouvrant la fenêtre, le soleil dore les neiges éternelles du pic de la Veleta. La plaine s’éveille. Les porteuses d’eau vont s’approvisionner aux citernes de l’Alhambra; et, depuis une heure déjà, la voix du muezzin a appelé les croyants à la prière matinale.
–Le matin, murmura Hassan, comme se parlant à lui-même, le matin! Encore une nuit peuplée de souvenirs et veuve d’espérances! Mourrai-je?......
Mohammed revint près d’Hassan et lui prit la main.
–Tu n’es donc plus mon ami, dit-il, et tu as donc oublié les jours d’autrefois où tu m’appelais frère, où tu n’avais pas de secrets pour moi, comme je n’avais pour toi rien de caché?
–Je n’ai rien oublié, puisque, seul de tous, tu pénètres chez moi à toute heure.
–Qu’importe cette faveur, si tu gardes ton chagrin comme un amant jaloux sa maîtresse, et si tu refuses de m’en faire part comme tu ferais d’une joie! Jusqu’ici, j’ai respecté ton silence. Tu te taisais: je ne demandais rien, et j’espérais qu’un jour, désireux de soulager ton âme en confiant à la mienne une part de ton fardeau, tu me dirais la cause de tes tristesses.....
–Mais il n’y a nulle cause. C’est une disposition de mon esprit, une maladie mélancolique, si tu veux.
–Tu voudrais me tromper, ami! Tu es jeune et riche, parent du roi, et tu peux aspirer aux plus hautes destinées. Tu es beau, et bien des yeux noirs te suivaient sous les voiles quand tu passais à cheval à la tête de nos armées. Tout ce qui peut faire le bonheur dans la vie, tu l’as. Ton palais rivalise avec l’Alhambra. Les eaux vives de tes vastes jardins font oublier celles du généralife. Les plus magnifiques chevaux de la Syrie viennent peupler ton écurie. Toutes tes ambitions sont satisfaites, tous tes désirs sont accomplis sur l’heure, et les femmes alliées avec la fortune ne t’ont rien refusé. Que désires-tu? que regrettes-tu?
–Tais-toi!......
–Non, je suis venu te trouver aujourd’hui décidé à en finir: si je suis impuissant à te consoler, je pourrai pleurer avec toi. Quand j’ai eu mes chagrins, tu en as demandé ta part: je te l’ai donnée. C’est mon tour maintenant. Tu n’as pas le droit de me refuser. Tous nos amis te regrettent. Tous veulent se joindre à moi pour te guérir. On se distrait de tout: nous te distrairons. Ne sais-tu pas qu’on s’use à rester ainsi seul à seul avec sa douleur, et qu’un homme qui s’y abandonne est aussi lâche que le guerrier qui, ayant encore le bras droit sauf, rend ses armes et demande merci. Tu fuis les plaisirs de la cour: je veux que tu y reparaisses. Je veux que tu reprennes ta part de nos fêtes, de nos joies et de nos batailles. Tous les jours, nous avons des rencontres avec Aragon et Castille, et, dans la mêlée, nos soldats étonnés cherchent en vain ta bannière. As-tu donc oublié les longues expéditions, les combats singuliers avec les chevaliers d’Espagne, et le retour triomphal dans Grenade, et la guerre, et l’amour?
–Je ne veux plus d’amour ni de guerre.
–Si l’amour t’a blessé, tu sais bien qu’il guérit les blessures qu’il a faites; mais toi, Hassan, quel coup as-tu pu en recevoir?
–Aucun.
–Aucun! Et cependant tu souffres. Et de quoi souffrirais-tu? nieras-tu cette rêverie dans laquelle tu étais plongé quand je suis arrivé, cette rêverie qui, toute une nuit, t’a fait oublier les heures?
–Je dormais: j’ai voulu lire hier la philosophie d’A-Ken, et le sommeil m’a vaincu.
–La philosophie d’A-Ken!
Mohammed marcha vers la table et prit le manuscrit.
–La philosophie d’A-Ken… ! Ce sont les poèmes de Sadi, et voilà les strophes sur lesquelles tu t’es arrêté:
Regarde ces ci eux où scintillent
Tant d’astres aux joyeux rayons
Il est des étoiles qui brillent
En vifs, mais passagers sillons.
L’éclat de leur route éphémère
A peine illumine la terre
Du feu vite éteint de son cours:
Il s’enfuit comme la pensée,
Et sa splendeur sitôt passée
Est une image de nos jours!
Regarde la rose effeuillée
Par le souffle de l’Aquilon
De sa couronne dépouillée,
Elle penche humblement son front.
Ses feuilles à l’éclat superbe,
Qui tour à tour vont joncher l’herbe,
Tristes débris de sa beauté,
Sont l’image de nos années
Qui s’envolent, bientôt fanées,
Sur l’aile de l’éternité!
Il a raison, le doux Persan, continua Mohammed; la vie est un temps court. Il faut en user et ne pas consumer dans des chagrins imaginaires peut-être, stériles à coup sûr, les brèves années qu’Allah veut bien nous donner.
–Ces années sont encore trop longues!
–Comment, c’est toi qui parles ainsi! toi, un homme que j’ai toujours vu véritablement fort!
–Toutes les forces peuvent se briser!
–Quand la volonté ne les double pas.
–Ou quand elle se brise elle-même!
–Alors tu n’as même plus le désir de guérir: tu t’abandonnes; la lutte a paru trop dure à ton âme subitement amollie et la résistance trop rude à ton courage. C’est bien. Tu refuses l’aide de mon amitié. Elle ne peut rien si tu ne veux rien. Tu fuis ses consolations, et le partage avec elle t’effraye: je n’ai rien à dire. Mais, comme je ne peux ni supporter impassible la vue de tes souffrances, ni me faire le complice de ta faiblesse, adieu, Hassan Adieu, frère! Je ne t’importunerai plus.
Et le capitaine se dirigea vers la porte.
Hassan le regarda s’éloigner, morne et comme s’il n’eût pas compris. Mais, quand il vit Mohammed près de franchir le seuil et s’arrêter sous la draperie soyeuse, pour lui envoyer un long et dernier regard de triste adieu, il se redressa vivement, courut à lui, et cet homme de haute taille, à figure bronzée, se laissa aller sur l’épaule de son ami et pleura silencieusement. Les pleurs d’une femme éveillent une tendresse protectrice; celles d’un enfant, une sollicitude émue; celles d’un homme, ces grosses larmes qui roulent sur le visage contracté pour les retenir, celles-là font naître une sensation poignante et, quand l’homme est un ami, vous bouleversent.
Remué jusqu’à l’âme, Mohammed ramena Hassan au divan, le fit asseoir et prit place à côté de lui.
–Parle, ami, dit-il. La confiance te fera du bien. Et puis… qui sait? tu as un chagrin d’amour. Eh bien, si celle que tu aimes est de notre nation, elle est à toi. Si c’est une chrétienne, nous irons ensemble l’enlever, fût-ce au cœur des Espagnes et dans le palais de Ferdinand!
–C’est une morte!
–Une morte!
–Je vais tout te dire, ami.
–Parle.
–Il y a deux mois, tu dois t’en souvenir, une expédition fut résolue contre Menjibar. Il s’agissait d’effrayer, par une de ces incursions qui nous sont habituelles, le gouverneur de la ville qui préparait une attaque contre nous.
–Je devais y prendre part; la volonté du roi m’a cloué au palais. C’est toi qui as commandé les trois mille hommes qui ont envahi le territoire de Menjibar.
–Précisément. Tu sais qu’à peu de distance de la ville se trouve le grand couvent de Santa-Marta. Le bruit courait que, derrière les épaisses murailles de cette retraite, qui est une véritable forteresse, le comte de Salastro, gouverneur de la province, avait caché ses trésors; et j’avais reçu du kalife l’ordre de m’en emparer, après avoir, toutefois, mis la ville dans l’impossibilité de venir au secours du monastère. La première partie de ces ordres avait été exécutée; et, après avoir taillé en pièces la garnison sortie pour nous attendre, après avoir levé sur la cité une large contribution de guerre, et choisi, parmi les notables, des prisonniers de riche rançon, nous étions revenus camper sous les murailles de Santa-Marta.
Le lendemain, je fis donner l’assaut. La place, bien fortifiée et encore mieux défendue, nous repoussa avec de grandes pertes. J’accordai à mes soldats un jour de repos, et, le jour suivant, nous fîmes une seconde tentative: elle ne réussit pas mieux que la première. Pendant dix jours le soleil éclaira chaque fois un nouvel assaut, terminé chaque fois par une nouvelle défaite.
–Je sais tout cela; et je sais aussi que, toujours dans les premiers sur les échelles, tu n’en es jamais descendu: elles se sont rompues sous toi.
–C’était mon devoir. Le onzième jour, mes hommes, décimés par la garnison du couvent, exaspérés par la mort de leurs camarades, livrèrent une dernière et furieuse attaque. Celle-ci fut plus heureuse. Emportés par la rage des insuccès répétés les nôtres se précipitèrent comme des tigres sur les remparts. Grêle de pierres énormes, pluie d’huile bouillante et de plomb fondu ruisselant des mâchicoulis, ruisseaux de poix enflammée, rien ne put les arrêter: les échelles se brisent; on appuie les fragments les uns sur les autres, et, ur ces degrés mouvants, on cherche à atteindre les créneaux. On y touche. On s’y cramponne. Les assiégés coupent à coups de hache les poignets des premiers arrivés: ils tombent: d’autres les remplacent, et au bout de deux heures d’une lutte sauvage, pendant laquelle on entendait, dans les courts repos de la mêlée, les hymnes chrétiens chantés par les voix fraîches des nonnes invoquant leur Dieu; après un effroyable carnage des deux côtés, nous fûmes maîtres du chemin de ronde.
Tu sais que j’ai l’horreur du sang versé. Implacable dans la bataille, j’aime à préserver ensuite les vies désormais inoffensives. Nous étions vainqueurs. Les chrétiens demandaient merci à nos soldats, qui inondaient de toutes parts les murailles, et je n’eus plus dès lors qu’une préoccupation: empêcher les massacres. Je fus impuissant. En vain je courais d’un point à l’autre, menaçant ici, suppliant là; mes hommes ne m’obéissaient plus. C’est à peine si l’on cessait de tuer en ma présence pour recommencer sitôt que je volais ailleurs. Tous les défenseurs, sauf quelques-uns que j’avais pu prendre sous ma protection immédiate, furent passés au fil de l’épée. Et, pendant ces horribles scènes, j’entendais toujours, dominant par intervalles le bruit des armes et les cris des victimes, le chant pur et régulier des nonnes, qui, enfermées dans la chapelle, attendaient la mort.
Tout à coup, les voix se turent. Occupé à sauver quelques malheureux, je ne songeai pas d’abord à m’expliquer ce subit silence. Mais, au bout de peu d’instants j’en compris le terrible sens: je courus à la petite église où s’étaient refugiées les chrétiennes: la porte était enfoncée; il était trop tard. Douze femmes, passant de la prière à la mort, avaient été égorgées et gisaient sur les dalles. Nos soldats, ivres de sang, affolés par la résistance meurtrière du couvent; enflammés, de plus, par les prédications fanatiques d’un de nos prêtres qui accompagnait l’armée, avaient jeté à terre un grand Christ et avaient ordonné aux nonnes d’y poser le pied. Toutes avaient refusé: toutes étaient mortes.
Saisi d’horreur et transporté de colère, je courus à l’instigateur de ces meurtres, et j’allais, dans mon indignation, faire justice moi-même. Le prêtre, immobile, les bras croisés sur sa poitrine, me regardait en face, comme si, certain que son action avait été agréable au Prophète, il eût défié mon cimeterre. Mes hommes indécis murmuraient sourdement et semblaient vouloir le soutenir. Soudain, je m’arrêtai.
Une porte venait de s’ouvrir, et une jeune religieuse, portant la crosse des abbesses, s’était arrêtée sur le seuil, nous regardant. Elle avait été mettre en lieu sûr les vases sacrés et revenait partager le sort de ses compagnes. Belle comme les anges de son ciel, les yeux resplendissants d’une flamme divine, elle attendit, droite et fière.
Alors le prêtre me lança un regard de défi. Il étendit le bras vers la femme, et, avant que j’eusse pu faire un pas, maîtrisé d’ailleurs par mes propres soldats révoltés que fascinait son fanatisme, je vis de mes yeux cette magnifique créature traînée vers la croix couchée à terre. Je vis déchirer ses vêtements. Je vis, en me débattant, fou de rage, ses longs cheveux d’ébène ruisseler sous ses voiles et cacher son sein blanc mis à nu, et, dans cette chair virginale, un poignard s’enfoncer!
Elle tomba sur les genoux, pâle, un ruisseau rouge sur la poitrine. Elle leva au ciel ses grands yeux noirs, puis les tourna vers moi, et, voyant mes efforts, comprenant que je voulais la défendre, elle eut un faible sourire et s’abattit sous un dernier coup… Eh bien! je l’aime!
Le reste importe peu. Je ne te parle pas du châtiment terrible infligé à ses assassins quand des fidèles m’eurent délivré: je l’aime! j’aime cette morte. J’ai passé une longue nuit seul, près de son cadavre, qui gardait encore sur les traits char. mants du visage l’expression sublime du martyre. Puis j’ai coupé une mèche de ses cheveux, et j’ai renvoyé son corps à sa famille illustre et désolée, à sa mère, qui peut-être me maudit comme son bourreau.
Je l’aime! je l’aime comme jamais une vivante n’a été aimée. Je passe avec son souvenir de longues heures, et quand, en rêve, je me vois près d’elle, quand il me semble, à genoux à ses pieds, respecter sa prière et couvrir sa foi de mon amour, quand mon imaginatiou fiévreuse, niant la réalité, la fait revivre, quand je l’évoque jusqu’au vrai…, le passé me crie:
–Elle est morte!
Voilà pourquoi je suis sombre, ami. Tous les amours, même les plus insensés, sont éclairés par un vague espoir, et le berger des Alpujarras, amoureux de la sultane, peut voir dans ses rêves quelque lampe merveilleuse trouvée dans une grotte et le faisant puissant. Les murs les plus épais qui séparent les êtres peuvent tomber et les réunir dans leur chute. Un seul est éternel: la mort! Et c’est celui qui me sépare de ma bienaimée! Comprends-tu, frère, que je sois malheureux, et m’en veux-tu encore?
–Pauvre Hassan! non, je ne t’en veux pas. Mais j’avais raison d’appeler ta confiance, car je comprends ta peine. N’est-ce pas un soulagement que de dire sa souffrance? Il est bien faible encore, mais tu le sentiras grandir; bientôt tu chercheras mon oreille amie de tes douleurs, et, sûr de les épancher dans l’âme d’un frère qui, sous ses dehors insouciants, cache aussi de cruels souvenirs, tu aimeras à parler de ton mal avec moi qui ai souffert. Et puis, tu as encore un espoir.....
–Lequel?
–L’oubli!
–L’oubli!.....
–Oh! non pas l’oubli qui efface et détruit, mais celui qui voile légèrement d’abord les anciennes douleurs et, peu à peu, ajoutant chaque jour un nouveau et insensible nuage, laisse seulement subsister une image vague et affaiblie, dont la vue éveille dans l’âme, au lieu d’un cuisant chagrin, une sensation presque douce de mélancolique tristesse. Je sais ce que tu vas me répondre: tu ne veux pas de l’oubli. Tu te complais dans le mal qui te consume. Mais moi, j’ai le devoir de t’y arracher. Un citoyen obscur a tous les droits, même celui de mourir: tu ne l’as pas. Tu es malheureux aujourd’hui, plus malheureux que le pauvre prisonnier qui répare nos routes: mais, jusqu’au jour de la chute, tu as eu toutes les faveurs du ciel. Ces privilèges, ces dons d’Allah, qui jusqu’ici ont embelli ta vie, t’imposent des devoirs auxquels ta nature droite et virile ne peut faillir. Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille jurent de détruire ce qui reste de notre empire. Ce n’est pas en un pareil moment que tu peux rester inactif et oublier qu’un prince du sang des kalifes se doit à sa patrie. Toi sur qui le royaume fait reposer sa plus chère espérance, toi qui, si souvent, nous a conduits aux victoires que dédaignait Boabdil, tu dois te consacrer au salut de Grenade, et t’y consacrer tout entier. Tu dois marcher à notre tête, non comme un corps que son âme a déserté, mais comme un homme vaillant, en possession de tout son être, de toutes ses nobles facultés, comme l’homme que tu étais hier. Tu dois tout tenter pour chasser tes tristesses, reparaître à la cour, reconquérir ton influence qui s’en va, et forcer Allah à écrire sur son redoutable livre qu’il te conservera, que Grenade sera sauvée, et qu’elle le sera par tes mains!
A ce mâle langage, Hassan se leva, et, saisissant les mains de Mohammed:
–Tu as raison, frère, dit-il, dispose de moi, et que les dessins d’Allah s’accomplissent!