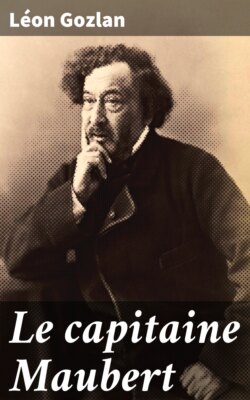Читать книгу Le capitaine Maubert - Gozlan Léon - Страница 5
ОглавлениеLES DEUX CONFIDENCES.
La nuit qui suivit fut d’une sérénité ravissante. Constance en passa une grande partie à la croisée pour découvrir, à la lumière si douce et si égale de la lune, l’endroit de la forêt où elle et Francis s’étaient égarés dans la journée. Les heures s’écoulaient, et elle ne se lassait pas d’attacher son regard sur un bouquet d’arbres d’un vert mélancolique. C’est sous ces arbres qu’elle avait entendu ces mots: «Constance, j’avais quelque chose à vous dire.»
Constance avait, à ce doux moment de sa vie, seize ans, âge un peu trop déprécié depuis que les femmes ont indéfiniment reculé les limites des tendres erreurs. On aurait bien dû cependant ne pas leur sacrifier entièrement ce qu’on appelait, avant cette Révolution dont tout n’est pas à blâmer, l’âge des amours, le printemps de la vie, expressions surannées sans doute, mais s’appliquant à une chose qui ne vieillira jamais, la jeunesse. Qu’y a-t-il de plus vieux que les roses, le lis, l’innocence, le premier amour, le premier baiser? Indulgence donc pour tout cela! usons de générosité envers ces vieilleries auxquelles nous avons cru, et auxquelles on croira encore longtemps après nous. C’est un tort de n’avoir pas tout de suite trente ans, mais quel grade bien mérité ne s’acquiert pas avec les années? Les grands maréchaux du sexe ont commencé par être conscrits.
Constance avait seize ans; on aurait à coup sûr, trouvé mieux pour représenter l’époque fleurie à laquelle elle touchait; car elle n’était ni frêle, ni blonde, ni délicate. Sa taille cependant était flexible, son cou dégagé portait une tête du plus beau type créole. Sur ses lèvres épaisses, et renversées comme les bords roses et veloutés d’un champignon des bois, se peignait l’éclair bleuâtre d’un duvet gracieusement viril; ni aquilin ni relevé, son nez un peu fort avait l’épatement des races du Nord. Là où elle était belle et digne d’exercer la plume de l’écrivain, c’était à la partie supérieure du visage: quand son regard doux lançait une étincelle lumineuse, il en restait longtemps le souvenir dans la mémoire. Le blanc de ses yeux était doré, par on ne sait quel mélange du sang, qui se remarque chez quelques femmes douées d’une grande beauté. Ses cheveux étaient d’un noir qu’il ne faut comparer à rien; car chaque belle chevelure noire ou blonde a son ondulation, son velouté, son caractère, qui ne se reproduisent jamais sur une autre tête. Le teint de Constance n’était pas beau, excepté pourtant pour les peintres. Il était chaud, brun, et parfois d’un sombre métallique, quand quelque peine troublait sa santé, bonne mais inégale. Elle avait de fort jolies mains; rien n’était charmant, tout le monde en convenait, comme de la voir occupée à croiser le grand cachemire blanc de sa mère, lorsque l’hiver elle s’en enveloppait auprès de la cheminée.
Madame de Rétal, qui n’avait pris ce nom qu’en devenant la femme de M. de Rétal, son second mari, ne portait aucun attachement à sa fille aînée. Constance, son unique enfant du premier lit. Deux causes, l’une assez romanesque, l’autre fondée sur l’intérêt, produisaient chez elle cet éloignement. Constance avait été mise en nourrice fort loin de Paris, dans un hameau de la Picardie, où sa mère n’était allée la voir qu’au bout de deux ans et demi, et par suite d’une circonstance tragique. Le feu ayant, une nuit d’hiver, dévoré le hameau, la nourrice et une petite fille qu’elle avait du même âge que l’enfant de madame de Rétal périrent étouffées dans les flammes. Quand madame de Rétal, avertie du malheur par le curé de l’endroit, se fut rendue dans la chaumière à demi consumée, elle n’y trouva qu’une femme étrangère, berçant un enfant brûlé au visage et aux mains, presque défiguré. Cette petite fille était-elle bien la sienne? n’était-elle pas celle de la nourrice? tel fut le doute soudain dont elle fut saisie en ne rencontrant auprès d’elle, au milieu des cendres, aucune personne en position de lui dire la vérité sur ce point. Les gens consultés par elle avaient toujours entendu la nourrice donner le même nom d’amitié à l’une et à l’autre enfant; son mari, d’ailleurs, était si dûr, si sauvage, qu’ils osaient rarement venir la voir. En emportant sa fille avec elle, madame de Rétal resta dans la même obscurité.
Une bonne mère n’aurait pas connu cette anxiété, car elle ne serait jamais demeurée deux ans sans aller voir son enfant.
Élevée au couvent, Constance éprouva, en recevant une éducation étroite et solitaire, les premiers effets de l’indifférence maternelle. D’autres chagrins lui étaient réservés. Madame de Rétal devait sa position nouvelle à son second mari. S’il n’était pas riche, il possédait du moins une aisance suffisante, et les enfants qu’elle avait de lui fondaient des espérances certaines sur les parents de sa branche. Les frères de M. de Rétal, tous riches, presque tous célibataires, ne comptaient d’autres héritiers que leurs neveux. Il ne s’agissait que d’attendre avec patience la mort de ces oncles opulents. Jusque-là, on vivait modestement à la campagne. Ainsi, tous les enfants de madame de Rétal, excepté Constance, ne craignaient rien de l’avenir. Constance seule, quoique l’aînée de la famille, n’avait pour espoir que le mariage: mais qui voulait, à cette époque ambitieuse, d’une fille pauvre? qui serait allé la chercher, pour ainsi dire, au milieu des bois?
Toutes ces considérations mettaient fort à l’aise madame de Rétal pour faire à sa fille la confidence qu’elle lui ménageait depuis des années. Le moment lui parut enfin arrivé d’ouvrir cet entretien sérieux. Un matin elle appella Constance et s’enferma avec elle.
Peu de jours avant cette entrevue, Francis avait appris les intentions de son père sur lui. Destiné par sa naissance et par son titre d’aîné à embrasser la profession des armes, il irait en étudier les éléments à l’école militaire de Bapaume; au bout de deux ans, il entrerait au service du roi dans quelque régiment. Cette détermination ne blessait en rien les goûts du jeune Cramayenne. D’un esprit méditatif, il entrevoyait déjà l’arme à laquelle il se vouerait de préférence: c’était le génie, beau côté de la guerre, sa face la plus intelligente. Il serait de ceux qui ouvrent aux armées des routes à travers les rochers, jettent en une nuit sur un fleuve rapide des ponts que n’écrasent ni les chevaux ni les canons, et qui disent, à une minute près, le moment où s’écrouleront les murs d’une forteresse perdue dans les nuages. Ils sont le cerveau de l’armée; ils triomphent, et leurs doigts ne sont jamais tachés que par l’encre. Dès que son père lui eut révélé ses intentions, Francis n’eut plus d’autre pensée que d’en faire part à Constance. Ne serait-ce pas, pensait-il, l’occasion que je cherche depuis deux mois, le motif bien simple et bien naturel de lui dire combien je vis dans l’espoir de demander un jour sa main, si véritablement elle m’aime? Il doutait qu’elle l’aimât! Rien ne lui donnait cette conviction. Et pourtant elle évitait, depuis l’après-midi passée avec lui au bois de Vincennes, toute promenade loin de la maison; elle refusait constamment de l’accompagner sur l’épinette quand il exécutait sur la flûte quelque morceau de la musique, alors si à la mode, du célèbre chevalier Gluck; elle s’était aperçue qu’elle tremblait en l’accompagnant, et qu’il passait toujours quelques notes dans les endroits pathétiques.
Constance avait mis, toutefois, de côté cette réserve excessive depuis son entretien secret avec sa mère. Pour peu que Francis eût cherché à la retenir près de lui dans les rares occasions où leurs parents les laissaient seul à seul, elle y aurait maintenant consenti volontiers. Sa position était changée: auparavant, elle ne pouvait que s’exposer à entendre de la bouche d’un jeune homme des paroles dont elle pressentait tacitement et avec une intelligente pudeur la signification; à présent, elle apportait elle-même le prétexte d’une entrevue nécessaire, décisive. Francis l’écouterait, et n’aurait ni le temps ni la volonté de penser à lui, en recevant la confidence que Constance cherchait à lui faire, loin des oreilles indiscrètes des enfants, si terribles à toutes les époques; loin des yeux des domestiques, si vertueux toutes les fois qu’il s’agit de dénoncer. Mais quelque envie qu’ils eussent l’un et l’autre de se rencontrer quelque part dans l’ombre, ils ne parvenaient pas à se trouver dix minutes ensemble; et cependant s’écoulait la dernière semaine qu’ils devaient encore passer à Saint-Mandé avant de rentrer, elle au couvent des Sœurs-Grises de la rue du Temple, lui, avant de partir pour l’école militaire de Bapaume, où décidément il se rendait.
Tout conspirait contre eux. Un jour les gros orages d’automne rendaient impraticable le petit sentier sablonneux tracé entre les deux propriétés. Le lendemain, c’était la visite d’un ami de Paris, qui dévorait les heures où une famille avait l’habitude de se rendre chez l’autre: nouvelle journée perdue! Si, le lendemain, les Cramayenne et les Rétal avaient arrêté de dîner ensemble, le dîner empiétait tant sur la nuit, qu’en se levant de table on allait se coucher. Enfin, la semaine était sur le point de finir sans que le hasard eût favorisé une seule fois ces deux enfants, si tourmentés tous les deux de se dire, l’un le secret de sa peine, l’autre celui de son bonheur.
Il ne leur restait plus pour se voir que la soirée du dimanche au lundi.