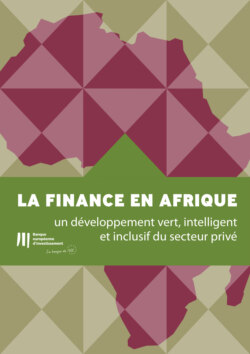Читать книгу La finance au service de l'Afrique - Группа авторов - Страница 8
Résumé analytique
ОглавлениеL’Afrique s’efforcera de financer la relance économique après la crise liée au COVID-19 tout en abordant les défis sous-jacents en matière de développement et les effets croissants des changements climatiques. La crise sanitaire et ses conséquences économiques ont freiné la croissance en Afrique en 2020 et pourraient avoir plongé 30 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté (voir le chapitre 1). Les pays fortement dépendants du tourisme ont été durement touchés et la chute des prix des matières premières a eu des incidences majeures sur les exportateurs de pétrole et de gaz, en particulier au premier semestre de 2020. Une relance inclusive et durable est essentielle pour éviter de nouveaux revers en matière de développement durable, ainsi que pour atténuer le risque d’une déstabilisation accrue et de nouveaux troubles sociaux. Toutefois, la reprise économique devrait être progressive et les besoins de financement sont importants. Une reprise durable et inclusive post-COVID-19 nécessitera 1 000 milliards d’USD supplémentaires par an, en plus des 2 500 milliards d’USD nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), qui manquaient déjà chaque année avant la crise[1]. Les États africains ont intensifié leur soutien aux populations et au secteur privé pendant la pandémie. Toutefois, la chute de la croissance a entraîné un effondrement des recettes budgétaires. L’accroissement de la dette qui en découle, qui a aggravé un endettement déjà élevé dans de nombreux pays, limitera la capacité d’investissement des États africains[2]. Bien que les flux de financements extérieurs privés se redressent après une chute brutale en 2020[3] et que la communauté internationale apporte un allègement de la dette et d’autres aides financières, cela ne suffira pas à couvrir tous les besoins.
Les secteurs financiers africains peuvent jouer un rôle important en faveur d’une reprise durable, intelligente et inclusive en aidant à attirer les investissements étrangers et à affecter les ressources nationales de manière efficace. Le présent rapport examine comment les secteurs financiers africains ont été touchés par la crise du COVID-19 et comment ils ont réagi. Il analyse ensuite leurs capacités à porter la reprise. Cette analyse couvre les principaux acteurs financiers, à savoir les banques (chapitre 1), les institutions de microfinance (chapitre 2) et les fonds de capital-investissement (chapitre 3). Le rapport examine également la façon dont les secteurs financiers gèrent le passage au numérique (chapitre 4), comment ils font face aux défis posés par les changements climatiques et s’ils profitent des possibilités offertes par la finance verte (chapitre 5).
Les secteurs bancaires africains sont la principale source de financement pour les entreprises privées sur le continent, mais les microentreprises et petites et moyennes entreprises (MPME) souffrent toujours d’un important déficit de financement. L’analyse au chapitre 1 s’appuie sur une enquête unique menée début 2021 par la BEI auprès de banques d’Afrique subsaharienne, sur des données issues d’enquêtes sur les entreprises menées par la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ainsi que sur diverses sources de données secondaires. L’activité bancaire dans les pays africains est faible par rapport à la taille de leur économie[4], et les obstacles au financement des MPME sont particulièrement importants. Les banques interrogées ont cité le manque de garanties, d’antécédents de crédit et de projets bancables comme les principales contraintes à l’expansion de leur activité de prêt aux MPME, conformément à d’autres données d’enquête.
Le COVID-19 a rendu cette situation plus difficile et ses effets risquent de durer. Les secteurs bancaires africains sont restés relativement résilients. Une crise de liquidité a été évitée, notamment grâce au fait que la plupart des banques étaient bien capitalisées avant la crise. Le soutien proactif des décideurs politiques a également contribué à maintenir la stabilité et la solidité du secteur financier. Toutefois, les données recueillies dans le cadre des enquêtes sur les entreprises donnent à penser que les entreprises de toute l’Afrique ont été durement touchées par la crise. Lorsque les mesures de soutien prendront fin, la qualité des actifs du secteur bancaire est donc susceptible de diminuer, ce qui réduira la capacité des banques à financer le secteur privé tandis que cellesci chercheront à maintenir et à reconstituer des volants de fonds propres. La plupart des banques interrogées considèrent la détérioration de la qualité des actifs comme l’effet le plus important de la crise sur leurs activités. Nombre d’entre elles se retrouvent à présent avec des volumes importants de prêts non productifs dans leur bilan, ce qui pourrait les inciter à redémarrer leur activité de prêt avec prudence. Une telle situation risque de creuser l’important déficit de financement auquel les entreprises africaines sont confrontées[5], les petites et moyennes entreprises (PME), les start-ups et les entreprises innovantes étant particulièrement concernées.
La microfinance est souvent la seule source officielle de financement pour certains groupes, tels que les pauvres, les femmes et les plus petites entreprises. C’est pourquoi elle joue un rôle essentiel dans la relance économique inclusive. Le chapitre 2 examine la situation actuelle des secteurs de la microfinance en Afrique. Au cours de la dernière décennie, l’Afrique a réalisé des progrès notables dans le développement de l’inclusion financière, principalement grâce à l’expansion des services financiers numériques. Toutefois, d’importantes lacunes subsistent dans l’accès au financement, en particulier parmi les plus pauvres, les femmes et les personnes vivant dans des zones rurales difficiles d’accès. Diverses institutions fournissent des services de microfinance. Il peut s’agir de banques commerciales, d’institutions de microfinance commerciales et réglementées, de prestataires informels ou d’organisations non gouvernementales. Les institutions formelles de microfinance constituent une source de financement importante et ont desservi plus de 6,3 millions de personnes en Afrique en 2018, dont 64 % étaient des femmes et 60 % habitaient en milieu rural[6]. Les organismes africains de microfinance ont réagi à la crise liée au COVID-19 en prenant plusieurs mesures de soutien aux emprunteurs, dont un usage extensif des moratoires, ainsi que des mesures opérationnelles, telles qu’un recours accru aux canaux numériques. Les décideurs politiques leur ont apporté leur appui en adoptant des pratiques accommodantes sur le plan réglementaire et d’autres initiatives, bien qu’ils semblent avoir été moins proactifs que les instances réglementaires d’autres régions. Le secteur de la microfinance en Afrique a évité une crise de liquidités pendant la pandémie grâce à la résilience des institutions de microfinance, à leurs démarches volontaristes et à l’appui des décideurs politiques. Toutefois, la qualité des actifs semble avoir diminué plus fortement que dans d’autres régions et pourrait menacer la solvabilité des petits établissements en particulier (à savoir ceux de deuxième et troisième rang). Les plus grandes institutions de microfinance (celles de premier rang) sont mieux placées pour résister à la crise et semblent développer leur activité de prêt plus rapidement que leurs homologues dans d’autres régions. Inversement, la nécessité de reconstituer les volants de fonds propres pourrait freiner l’activité de prêt, même parmi les institutions plus solides.
Le capital-investissement en Afrique est très limité par rapport à d’autres régions[7], mais il joue un rôle important dans le soutien aux jeunes entreprises innovantes et aux nouvelles industries en fournissant un financement « patient », qui absorbe les risques. Les fonds de capital-investissement et de capital-risque ont donc un rôle majeur à jouer pour appuyer les secteurs des énergies renouvelables et de l’économie numérique, entre autres. Le chapitre 3 fait le point sur la situation des secteurs du capital-investissement en Afrique. À partir des données de la Global Private Capital Association, l’analyse montre que la pandémie a inversé une tendance à la hausse des levées de fonds de capital-investissement ciblant l’Afrique, qui sont tombées à 2,3 milliards d’USD en 2020, soit une baisse de 34 % par rapport à 2019. L’effet sur la valeur des opérations a été moindre : les sociétés de capital-investissement ont investi plus de 3,7 milliards d’USD en Afrique en 2020. Toutefois, la faiblesse prolongée des levées de fonds rendra probablement difficile le maintien de volumes d’investissement élevés à l’avenir. Au-delà du niveau des levées de fonds, les marchés africains sont confrontés à d’autres défis – le faible degré de développement du secteur financier, la rentabilité habituellement basse des investissements non cotés et la valorisation élevée des actions –, qui font qu’il peut être difficile de repérer des opportunités d’investissements rentables sur les marchés privés. Les marchés africains offrent malgré tout des possibilités attrayantes pour les capital-investisseurs, telles que la masse croissante des actifs nationaux sous gestion, la performance relativement élevée des investissements répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ou encore le développement de la classe consommatrice. Ainsi, malgré les défis, les secteurs du capital-investissement ont la possibilité de soutenir une reprise intelligente, verte et inclusive en aidant les jeunes entreprises innovantes à conserver l’accès au financement et en fournissant une source de financement pour les investissements verts et numériques. Les institutions de financement du développement jouent un rôle plus important dans le capital-investissement en Afrique que sur d’autres marchés émergents et en développement, une singularité qui s’est encore accentuée pendant la pandémie, alors que les autres bailleurs de fonds agissaient avec prudence. Ces institutions devraient maintenir un rôle notable en assurant que les financements continuent d’être acheminés vers des entreprises à fort potentiel pendant la reprise, à un moment où l’incertitude demeure élevée.
La transformation numérique des secteurs financiers africains présente un énorme potentiel de stimulation du développement et de la croissance, même si les risques qui y sont associés doivent être gérés de manière appropriée. Comme expliqué au chapitre 4, le passage au numérique, en particulier l’adoption rapide de l’argent mobile, a été un moteur clé de l’inclusion financière en Afrique. La transformation numérique des services financiers africains a été portée par de nouveaux entrants dans les secteurs financiers africains. Toutefois, l’enquête 2021 de la BEI sur le secteur bancaire en Afrique révèle que les secteurs bancaires de l’Afrique subsaharienne élargissent leur offre numérique et que cette évolution a été accélérée par la pandémie. Parmi les banques interrogées, la plupart ont indiqué que la pandémie les avait amenées à accélérer le rythme de la transformation numérique et que ce changement serait permanent. Des possibilités d’élargir encore l’accès au financement via les canaux numériques existent et la gamme des services disponibles se diversifie. Cependant, les cadres réglementaires africains ne tiennent pas encore suffisamment compte de l’augmentation des risques macrofinanciers liés à la transformation numérique. Selon l’analyse du Centre de développement de l’OCDE, prise en compte dans ce chapitre, la mise en place d’un environnement réglementaire favorable au niveau national et le renforcement de la coopération réglementaire régionale peuvent renforcer l’adoption de services financiers numériques et réduire les risques associés. Pour que la transformation numérique apporte les avantages escomptés sur le plan de la croissance inclusive, des investissements importants seront nécessaires. Les solutions et les prestataires de services financiers numériques en Afrique suscitent déjà un vif intérêt de la part des investisseurs, mais le resserrement des conditions de financement dans le sillage de la pandémie de COVID-19 risque de ralentir leur développement. Les investissements dans les infrastructures numériques, l’assistance technique et les formations destinées aux institutions financières, aux régulateurs et aux utilisateurs de services financiers seront également nécessaires pour permettre à la transformation numérique des secteurs financiers de réaliser son plein potentiel de développement.
L’Afrique et ses secteurs financiers sont fortement exposés aux risques liés au dérèglement climatique. Les secteurs financiers doivent jouer un rôle clé dans le financement de l’atténuation des changements climatiques et de l’adaptation à leurs effets. Le chapitre 5 démontre que le verdissement des secteurs financiers africains est essentiel pour mobiliser des capitaux supplémentaires dans la lutte contre les changements climatiques. L’analyse réalisée par l’Overseas Development Institute du Royaume-Uni et la BEI montre que le nombre et le montant des émissions sur le marché africain des obligations vertes augmentent presque chaque année. Toutefois, ce marché n’a pas encore déployé tout son potentiel, car il reste peu développé par rapport aux marchés équivalents dans d’autres régions. Les changements climatiques et la transition énergétique représentent des risques notables pour l’activité des banques africaines. L’enquête 2021 de la BEI sur le secteur bancaire en Afrique révèle que les banques africaines sont de plus en plus conscientes de la nécessité de faire face aux risques que représente le dérèglement climatique et commencent à tirer parti des possibilités qu’offre la finance verte. Par exemple, 54 % des banques interrogées considéraient déjà le climat comme un enjeu stratégique[8], et un peu plus de 40 % d’entre elles avaient du personnel travaillant sur les perspectives liées au climat. D’autres institutions financières, notamment dans la microfinance, les capitaux privés et les assurances, comblent également des lacunes du marché dans le domaine de la finance verte, tandis que les décideurs soutiennent ces développements par des interventions réglementaires, un soutien technique et des financements, avec des initiatives aux niveaux national, régional et international. Toutefois, les secteurs de la finance verte de l’Afrique restent moins développés que ceux d’autres régions, et il est possible de faire davantage pour que les secteurs financiers du continent prennent en compte les risques climatiques et saisissent les possibilités offertes par le financement de l’action pour le climat. Ces efforts sont devenus particulièrement urgents dans le contexte de la reprise économique post-COVID-19. Les organisations internationales peuvent jouer un rôle important en travaillant avec les institutions financières pour financer la transition climatique et en aidant à combler le déficit de connaissances et de capacités afin que des produits financiers durables puissent être proposés.
La BEI a activement soutenu les partenaires africains pendant la pandémie, comme indiqué au chapitre 6. Dans le cadre de l’Équipe Europe, la Banque a intensifié ses efforts pour aider les partenaires africains à faire face à la crise sanitaire et économique liée au COVID-19 et elle continuera à investir en Afrique dans le cadre de la reprise et au-delà. En 2020, la BEI a mis 5 milliards d’EUR à disposition pour de nouveaux investissements publics et privés en Afrique, un engagement annuel record pour la Banque. Ces opérations permettront d’appuyer plus de 12 milliards d’EUR d’investissements dans 28 pays africains, 71 % des fonds bénéficiant à des pays en situation de fragilité et de conflit et à des économies parmi les moins avancées. Le soutien de la BEI a aidé les pays africains à faire face à l’urgence sanitaire et à résister aux conséquences économiques de la crise. À plus long terme, la Banque aidera ces pays à progresser vers la réalisation des objectifs de développement durable. Les projets signés en Afrique en 2020[9] devraient contribuer à la vaccination de 210 millions de personnes contre le coronavirus, à l’alimentation en électricité de 595 400 ménages grâce à de nouvelles installations énergétiques, à l’amélioration de l’approvisionnement en eau de 778 000 personnes ainsi qu’à l’irrigation de 26 500 nouveaux hectares de terres et à la reforestation de 3 076 hectares que les agriculteurs pourront exploiter.
Une grande partie de l’aide de la BEI repose sur des partenariats avec des institutions financières africaines, ce qui lui permet d’atteindre les PME. La BEI octroie des prêts et des fonds propres « patients » pour renforcer la capacité de ces institutions à prêter en faveur d’un redressement durable, en ciblant en particulier les PME et les investissements dans des domaines clés tels que le climat, l’économie numérique, l’innovation et l’entrepreneuriat féminin. Bon nombre de ces prêts sont accordés en monnaie locale, ce qui évite de répercuter le risque de change aux clients de la BEI et les aide à servir les bénéficiaires finals, tels que les PME, dont les recettes sont principalement en monnaie nationale. La Banque soutient divers acteurs, y compris des banques, des institutions de microfinance et des fonds de capital-investissement, afin de répondre à tout l’éventail des besoins en matière de développement durable.
Afin de maximiser l’impact sur le développement, la BEI complète son offre financière par des missions d’assistance technique, des services de conseil et des productions intellectuelles. Ce soutien peut donner aux institutions financières les compétences nécessaires pour faciliter le développement durable, par exemple en atteignant les groupes mal desservis, ou pour devenir plus actives dans des secteurs à fort impact, tels que les énergies renouvelables. Par exemple, en partenariat avec le Fonds monétaire international, la BEI a lancé un cours en ligne sur l’intermédiation et l’inclusion financières, qui aide les fonctionnaires et les intermédiaires financiers à garantir la stabilité des marchés financiers tout en répondant aux besoins des entreprises du secteur privé, en particulier des MPME[10]. La Banque continue également d’investir directement dans des projets de plus grande envergure ayant un fort impact sur le développement durable. À titre d’exemple, le soutien qu’elle apporte à l’Institut Pasteur de Dakar (Sénégal) lui permet d’intensifier la production de vaccins contre le COVID-19, une étape clé dans les efforts déployés à l’échelle mondiale par la BEI pour relever les défis sanitaires et économiques causés par la pandémie et construire un avenir meilleur.
La BEI, en tant que banque de développement de l’Union européenne, réorganise ses activités en dehors de l’UE afin d’améliorer la manière dont elle met en oeuvre ses initiatives de financement du développement. En septembre 2021, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé la proposition relative à la création d’une branche de la BEI consacrée au financement du développement[11]. L’objectif est de renforcer l’engagement de la Banque en matière de développement à l’extérieur de l’Union européenne afin de favoriser l’impact et l’efficacité. Par l’intermédiaire de cette nouvelle branche, la BEI continuera de soutenir les entreprises du secteur privé en Afrique et d’appuyer une reprise intelligente, verte et inclusive, en ciblant plus particulièrement les entreprises et les groupes mal desservis.
Debora Revoltella Directrice, Département Analyses économiques Banque européenne d’investissement
[1] OCDE, 2020. L’OCDE estime que la crise du coronavirus a provoqué un déficit de revenus de 700 milliards d’USD en 2020.
[2] Le déficit budgétaire moyen de l’Afrique subsaharienne est passé de 4,1 % du produit intérieur brut (PIB) en 2019 à 6,9 % en 2020, alors que le ratio de dette rapportée au PIB a augmenté de 6 points de pourcentage en 2020 (Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale).
[3] Les financements extérieurs privés pour les pays en développement ont chuté de 700 milliards d’USD en 2020, sachant que selon les estimations, les envois de fonds des travailleurs émigrés ont baissé de 20 %, les investissements étrangers directs de 35 % et les entrées nettes au titre des investissements de portefeuille de 80 %. OCDE, 2020.
[4] Sur les 42 pays qui se situent dans le quartile inférieur en ce qui concerne la taille du secteur bancaire par rapport au PIB, 28 sont en Afrique (données de la Banque mondiale).
[5] Le déficit de financement des PME a été estimé à 17 % du revenu national en 2017, sur la base des données présentées dans Société financière internationale, 2017.
[6] D’après les données du MIX Market, disponibles à l’adresse : https://datacatalog.worldbank.org/dataset/mix-market.
[7] Au cours des cinq dernières années, l’Afrique a représenté de 3 à 4 % des levées de fonds dans les marchés émergents, soit environ 10 % de l’ensemble des ressources de capital-investissement levées dans le monde (données extraites de la Global Private Capital Association, décrite au chapitre 3 du présent rapport).
[8] Elles peuvent agir dans le cadre d’une stratégie climatique spécifique ou dans le cadre de leur approche globale en matière d’environnement, de société et de gouvernance.
[9] Rapport annuel 2020 sur l’activité de la BEI en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que dans les pays et territoires d’outremer.
[10] Depuis le lancement du cours en 2019, plus de 500 participants se sont inscrits, représentant 33 pays développés et en développement sur cinq continents, de la République dominicaine à la Somalie. Les participants aux cours ont acquis des connaissances plus approfondies des produits et services financiers conçus pour répondre aux besoins des entreprises du secteur privé et des PME, ainsi que des méthodes de gestion des risques employées généralement dans le cadre de prêts aux PME.
[11] https://www.eib.org/fr/press/all/2021-304-eib-strengthens-global-development-focus-and-backs-eur-4-8-billion-new-financing-for-energy-transport-covid-vaccines-and-business-investment.