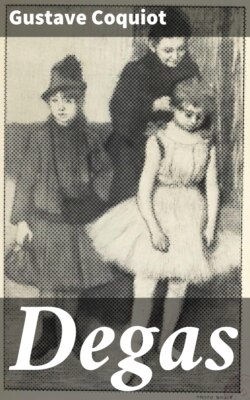Читать книгу Degas - Gustave Coquiot - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES ORIGINES ET LES DÉBUTS D’UN PEINTRE RANGÉ
ОглавлениеTable des matières
Il est incontestable que du jour de sa naissance (19 juin 1834) au jour de sa mort (26 septembre 1917), la vie de Degas n’a été qu’un long moment d’orgueil, d’ordre et de bonne tenue, — toutes estimables vertus qui caractérisent, en province surtout, le parfait notaire.
Dès qu’il se sent vagir, Edgar-Hilaire-Germain Degas (qui deviendra le peintre Degas) se rengorge d’être né à Paris, dans un quartier cossu, rue Saint-Georges, exactement. Son père est noble: il signe de Gas. Il est de plus banquier: directeur-propriétaire d’une succursale dont la maison-mère, depuis longtemps dans la famille, se trouve à Naples (Italie). Mme de Gas est une demoiselle Musson, de famille créole, originaire de la Nouvelle-Orléans. (Province de la Louisiane, Etats-Unis).
Lui, Edgar-Hilaire-Germain, il est enfin l’aîné de cinq enfants: trois fils et deux filles. On va le choyer et veiller plus spécialement sur lui.
On le place d’abord au lycée Louis-le-Grand, où il connaîtra entre autres condisciples les frères Rouart, au nom doré dans l’Art et dans l’Industrie. Ensuite, c’est l’école de droit; l’école funèbre là-haut, devant le morne Panthéon. On comprend que le nouvel étudiant s’en fatigue — et file vers l’école des Beaux-Arts. Hasard? Vocation? C’est ici que Montaigne écrirait encore: «Que sais-je?» L’appel du dessin ou de la couleur n’est pas toujours nettement impérieux.
En tous cas, nous sommes en l’année 1855. Edgar Degas (supprimons déjà la particule qu’il supprimera lui-même quelques années plus tard), Edgar Degas travaille dans l’atelier du peintre Louis Lamothe, aux côtés du peintre Elie Delaunay. Je nomme Elie Delaunay parce que, pendant des années, Degas et Delaunay tireront sous le même joug, les yeux fixés sur l’aiguillon du sieur Lamothe.
Ce dernier, quel pion soumis, d’ailleurs! Sans débat, M. Jean-Dominique Ingres est le maître omnipotent. C’est de son auguste main qu’il faut apprendre à dessiner, à composer, à corriger la nature. C’est en Lui que se nourrissent tous les augustes Principes, que se sont développées toutes les Règles et toutes les intangibles Traditions. Edgar Degas considérera désormais ce Phare avec des yeux toujours éblouis.
S’il est orgueilleux de ses origines, Degas ne sera pas moins orgueilleux d’avoir tout de suite subi un tel maître: M. Ingres. Au moins, il n’aura point, dès les débuts de sa vie, perdu son temps dans des travaux inférieurs.
Ses origines! Quand, quelques années plus tard, il rencontrera Renoir et Cézanne, par exemple, il ne cachera point son mépris pour ces peintres sortis de basse condition. L’un, Renoir, fils d’ouvrier; l’autre, Cézanne, fils d’un ex-chapelier devenu une sorte de banquier-prêteur à la petite semaine; et, encore, Cézanne a-t-il reçu une louable instruction; tandis que Renoir, ce cerveau en jachère, ce mauvais produit d’école communale!... Manet, au contraire, Manet l’étonnera, Manet, ce fils de bourgeois, qui a décidé de «faire de la peinture».
Feu Paul Lafond, l’ancien conservateur du musée de Pau, à qui nous devons sur Degas un livre fortement daté, documenté et délirant, — feu Paul Lafond nous a laissé de Degas ce portrait physique — au temps de la jeunesse et de l’âge mûr:
«Degas, dit-il. Plutôt petit que grand, la tête puissante, l’aspect narquois, le front haut, large, bombé, couronné d’une chevelure châtaine, soyeuse, les yeux vifs, malins, interrogateurs, enfoncés sous une haute arcade sourcillière, en forme d’accent circonflexe, le nez quelque peu retroussé, aux narines ouvertes, la bouche fine, à demi cachée sous une barbe légère, que le rasoir n’a jamais touchée».
Ce portrait, Degas lui-même l’aimera; et il le reproduira souvent, par lui-même et par d’autres dessinateurs et peintres. Cézanne, le haut Cézanne, ne connaîtra point, pareille bonne fortune. Ses camarades peintres ne seront point tentés par sa tête de sanglier mal tenu.
Degas, est, de bonne heure, inquiet, morose; il a le mépris des gens vulgaires; il tient à passer pour un jeune homme de ce monde où l’on se contrôle à toute minute. Il a de l’esprit — et il le laisse fuser. Il cisèle déjà «ses mots» comme des sonnets. Il réprouve de toutes ses forces et de tout son dégoût les peintres qui s’habillent mal et ne parlent point correctement.
Toute sa vie, il va porter — plus ou moins allègrement — la chape du bon ton. Il sera précis, sec, dur; il aura horreur du mouvement, de l’agitation, de la passion qui ne se dose pas. Un notaire, il le faut répéter; mais un notaire dans le public et dans le privé tout autant. Un notaire grincheux, toutefois, fantasque, «lunatique » ; — misanthrope presque tout de suite, dernier état auquel il fut conduit par une sorte de contrainte, que nous indiquerons plus loin.
Et cette contrainte continuera de faire vivre parmi nous Degas comme un curieux homme. D’ailleurs notons, ici, que les artistes peintres ou littérateurs — qui échappent — de temps en temps — à leurs origines, ne sont jamais des indifférents. Edmond de Goncourt, en écrivant Germinie Lacerteux et surtout La fille Elisa, — nous a montré un auteur à manchettes, un auteur raffiné et précieux, ne dédaignant point de renifler les malodorantes jupes des filles. On verra, de même, Degas bien vêtu, humer les sueurs des repasseuses les plus malpropres. Mais ce qui chez de Goncourt put passer pour une «curiosité littéraire», l’examen de la contrainte fixée chez Degas nous donnera une autre explication, peut-être moins estimable.
Ne développons point encore ce que nous voulons réserver pour un autre chapitre; et précisons seulement — fermement — que Degas restera surtout, toute sa vie, fidèle à ses origines. Né jeune homme ordonné, peut-on dire, il en gardera toujours la bonne tenue, l’hypocrisie, et ce qui n’est pas moins utile: le savoir-faire.
En premier lieu, on lui a répété sur tous les tons et de toutes les manières que l’Italie est la «terre classique des arts». Jeune peintre rangé, il conviendra donc qu’il visite, avant toutes choses, les musées italiens; et, par la même occasion, un arrêt à la banque paternelle, à la maison-mère, s’impose. Il est bon également qu’un jeune homme «sente et mesure» les solides appuis dont il disposera plus tard.
DANSEUSE DANS SA LOGE
Voici donc Edgar-Hilaire-Germain Degas parti pour Naples. Il a vingt-deux ans. Nul âge n’est plus propice pour jouir (c’est ici le mot exact) de la formidable «ville pourrissante» de l’Italie, ô Marinetti! A cette époque — année 1856 — aucune armée du Salut, aucune bégueulerie n’avait amoindri la grouillante prostitution de la ville-salope. Les sexes s’y ébattaient en pleine liesse. Flaubert, se contenant, note déjà dans sa correspondance:
«Naples est vraiment un séjour délicieux..... (Fragment de lettre à sa mère, 1851). Les femmes sortent nu-tête en voiture, avec des fleurs dans les cheveux, et elles ont toutes l’air très garces. Il n’y a pas que l’air. A la Chiaia (la Chiaia est une grande promenade de chênes verts au bord de la mer — arbres en berceau et murmure des flots), à la Chiaia les marchandes de violettes vous mettent presque de force leurs bouquets à la boutonnière. Il faut les rudoyer pour qu’elles vous laissent tranquille...»
Autre fragment de lettre (à Louis Bouilhet):
«Naples est charmant par la quantité de femmes qu’il y a. Tout un quartier est garni de putains qui se tiennent sur leur porte, c’est antique et vrai Suburre. Lorsqu’on passe dans la rue, elles retroussent leur robe jusqu’aux aisselles et elles vous montrent leur c.. pour avoir deux ou trois sols. Elles vous poursuivent dans cette posture. C’est encore ce que j’ai vu de plus raide comme prostitution et cynisme... C’est à Naples qu’il faut aller pour se retremper de jeunesse, pour aimer la vie. Le soleil même en est amoureux. Tout est gai et facile. Les chevaux portent des bouquets de plumes de paon aux oreilles...»
«Tout est gai et facile!» Il est vraisemblable cependant de supposer que Edgar-Hilaire-Germain Degas, jeune bourgeois soumis, ne se laissa point harponner par les garces napolitaines, et qu’il se contenta de visiter les musées, les églises (depuis la cathédrale jusqu’à San Paolo Maggiore), de suivre la via Caracciolo et la via Roma, de monter au Pausilippe, de contempler le Vésuve et d’excursionner aux Camadules. Du reste, la magnifique vue que l’on contemple du haut de ce couvent vaut bien la vue d’une brèche féminine. C’est de là que — plus tard — je me suis moi-même enivré des golfes de Naples, de Gaète et de Pouzzoles. Puis c’est l’enchantement de l’ancien lac d’Agnano, les cratères de la Solfatare, de Campiglione, de Cigliano, d’Astroni et de Fossa Lupara; les caps du Pausilippe et de Misène; les îles fortunées de Procida, de Nisida et d’Ischia; les campagnes de Baïes, de Liternum et de Cumes. Et l’on soûle encore ses regards de l’île de Caprée et de la Ponta di Campanella.On découvre Massa, Sorrente et Castellammare, le mont S. Angelo, la pointe fumante du Vésuve; tandis que chante la mer bleue, hérissée de barques polychromes, agitée de mouettes, et peuplée des pezzoni aux nageoires roses, des occhiati, des guaracini, des sarpas et des multicolores violas, tous ces poissons qui sont les vivantes fleurs de la baie merveilleuse.
Et le jeune voyageur voyait encore offerts à ses yeux ces voluptueux environs de Naples: Portici, Herculanum, Torre del Greco, Pompéi, Capri et le golfe de Salerne, Poestum et Amalfi.
Beaux débuts de sa vie — et qui lui firent ensuite aimer Rome, — lui qui n’apportait pas l’amer regard de Flaubert, notant, dans une autre partie de sa correspondance, les remarques ci-après:
«Nous ne sortons pas des Musées. (Fragment d’une lettre à sa mère). Le Vatican et le Capitole nous occupent entièrement, le Vatican surtout, où il y a vraiment des choses assez coquettes. La quantité de chefs-d’œuvre qu’il y a à Rome est quelque chose d’effrayant et d’écrasant...
«La campagne de Rome est ce qu’il y a de plus antique à Rome. Quant à la ville elle-même, malgré la quantité de choses antiques, le cachet antique n’y est plus, il a disparu sous la robe du jésuite. Il faut prendre Rome comme un vaste musée et ne pas lui demander autre chose que du XVIe siècle...»
Autre fragment de lettre (à Louis Bouilhet):
«Mais parlons de Rome, tu t’y attends, bien sûr Eh bien, vieux, je suis fâché de l’avouer, ma première impression a été défavorable. J’ai eu, comme un bourgeois, une désillusion. Je cherchais la Rome de Néron et je n’ai trouvé que celle de Sixte-Quint. L’air prêtre emmiasme d’ennui la ville des Césars. La robe du jésuite a tout recouvert d’une teinte morne et séminariste. J’avais beau me fouetter et chercher, toujours des églises, des églises et des couvents, de longues rues ni assez peuplées ni assez vides, avec de grands murs unis qui les bordent et le christianisme tellement nombreux et envahissant, que l’antique qui subsiste au milieu est écrasé, noyé.
«L’antique subsiste dans la campagne, inculte, vide, maudite comme le désert, avec ses grands morceaux d’aqueduc et ses troupeaux de bœufs à large envergure. Ça c’est vraiment beau et du beau antique rêvé. Quant à Rome elle-même, sous ce rapport, je n’en suis pas encore revenu; j’attends pour la reprendre par là que cette première impression ait un peu disparu. Ce qu’ils ont fait du Colisée, les misérables! Ils ont mis une croix au milieu du cirque et tout autour de l’arène douze chapelles! Mais comme tableaux, comme statues, comme seizième siècle, Rome est le plus splendide musée qu’il y ait au monde. La quantité de chefs-d’œuvre qu’il y a dans cette ville, c’est étourdissant!...
Et c’est cet autre fragment de lettre à Louis Bouilhet:
«Après-demain je pars de Rome, et d’une encore! Je commençais à y bien vivre. On peut s’y faire une atmosphère complètement idéale et vivre, à part, dans les tableaux et les marbres. Quant à l’antique, on est froissé d’abord de ne pas l’y rencontrer, et il est certain qu’il est considérablement étouffé. Comme ils ont gâté Rome! Je comprends bien la haine que Gibbon (historien anglais (1737-1796), auteur de l’Histoire de la décadence et de la chute de l’empire romain) s’est sentie pour le christianisme en voyant dans le Colisée une procession de moines! Il faudrait du temps pour bien se reconstruire dans la tête la Rome antique, encrassée de l’encens de toutes les églises. Il y a des quartiers pourtant, sur les bords du Tibre, de vieux coins pleins de fumier, où l’on respire un peu. Mais les belles rues! Mais les étrangers! Mais la semaine sainte et la via Condotti avec tous ses chapelets, tous ses faux camées, tous ses Saint-Pierre en mosaïque!.....
«Mais la Rome du XVIe siècle, je te le répète, elle est flambante. La quantité de chefs-d’œuvre est une chose aussi surprenante que leur qualité. Quels tableaux! quels tableaux!...»
Or, c’étaient ces tableaux-là que l’élève Degas venait admirer, de toute confiance. L’aiguillon de son professeur Lamothe toujours posé — même de loin — sur son front, il allait admirer éperdument, tout admirer.
Adroit, remuant, même habile à se lier avec des camarades utiles — et «officiels», il connut bientôt, attirés là comme lui, les peintres Léon Bonnat et Gustave Moreau, — le musicien Georges Bizet, les sculpteurs Dubois et Chapu, ces trois derniers pensionnaires de l’indécrottable métairie de l’Académie de France.
Sans perdre de temps, le bon élève court les musées, les églises. Il confronte l’enseignement de son maître Lamothe avec celui des maîtres italiens; il vérifie l’art de dessiner des draperies rigides, des compositions sévères, des figures mortes. Il trouve heureusement d’éloquents exemples dans Mantegna, Ghirlandajo, Fra Angelico, Holbein, etc., etc., dont il copie des fragments de tableaux.
Tout glacé d’académisme, il dessine, il peint, il grave des eaux-fortes; il s’applique à établir des compositions absurdes et vides. A la seconde partie de ce petit livre, quand on étudiera l’œuvre, on en cherchera vainement l’intérêt.
On lui a dit d’être un élève sage, discipliné, de bien copier d’abord les maîtres. Il est cet élève-là, et il ne voit la nature qu’interprétée par eux-mêmes. Sang de seconde, de troisième ou de dixième transfusion qu’il fait passer en lui et qui le figera, le refroidira, quoiqu’il fasse plus tard, pour toute sa vie. Mieux encore, il ne cessera de repéter ces mots de Dominique Ingres: «Il faut apprendre d’après les maîtres et n’aborder la nature qu’après».
Avouons-le, on se laisse guider aisément vers ces augustes béquilles même du second et du troisième ordre. Ce sont de nécessaires appuis pour les vocations débiles. Ils vous conduisent, ces appuis, à travers les hésitations, les craintes, les impuissances inhérentes à toute création; mais il les faut rejeter à temps, pour que l’on ne puisse voir aux aisselles la plus légère trace de frottement et encore moins d’usure.
Après ce premier apprentissage, Degas revient à Paris. Il s’installe d’abord sur la rive gauche de la Seine, rue Madame; puis il se lasse de ce quartier morne, silencieux, où nul appel de la peinture ne s’entend. Sans doute, des peintres «officiels» y foisonnent; mais Degas, tout en prenant part aux Salons officiels, perçoit des bruits, des rumeurs; il entend parler de peintres «révolutionnaires» ; il est averti de maintes tentatives vers un art plus moderne, plus étrange, plus vivant que celui que l’on enseigne académiquement rue Bonaparte. Or, il est trop avisé, trop rusé, trop intelligent pour s’entêter, oreilles et yeux clos, à marcher toujours avec ses premières béquilles. Il observe attentivement la girouette des vents de la peinture. Ingres, c’est bien; mais Manet, c’est peut-être bien également. Prudemment, en ménageant tout, il verra, doucement, ce qu’il doit faire; — et c’est ainsi qu’après avoir de tout l’Académisme subi les formules, il monte au quartier Montmartre, où soufflent et ragent tempêtes et révolutions.
DANSEUSES EN SCÈNE