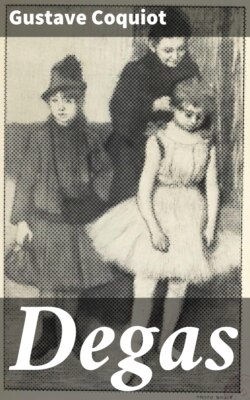Читать книгу Degas - Gustave Coquiot - Страница 6
ОглавлениеII
Table des matières
LE CAFÉ GUERBOIS
Table des matières
En cette année-là — 1865 —, il existait, à l’entrée de l’avenue de Clichy, un café que nous connûmes encore en l’année 1889: c’était le café Guerbois. Il apparaissait comme un bon café, hospitalier et doux, où se réunissaient les artistes, habitant le «village» des Batignolles.
Ce Guerbois offrait le type de ces cafés, anéantis aujourd’hui, où les garçons différaient tellement des insolents louffiats de ce jour; et où l’on ne bousculait point ces clients qui paisiblement s’attardent à boire d’innommables liquides dans des verres malpropres. C’était un café de nuances neutres, patinées et amies.
Les habitués y étaient assidus plus que partout ailleurs. D’autres cafés, dans l’avenue, recueillaient les buveurs de passage, les soiflards qui ne peuvent s’empêcher de lever leur verre à chaque comptoir qui brille. Au Guerbois ne venaient que des gens du quartier, — et surtout «ces messieurs les peintres», — qu’un vieil amateur, M. de Beauchêne, égaré là, — et dont j’ai connu la face en pain de sucre — nomma le premier «ces messieurs de l’école des Batignolles.»
Les plus fidèles — on vit, à bien dire, parmi ces peintres, des critiques d’art et des poètes — furent Manet, Renoir, Claude Monet, Lhermitte Sisley, Desboutin (venu de sa villa de «l’Ombrellino », près de Florence, pour être le plus accompli des bohèmes parisiens), Fantin-Latour, Guillaume Régamey, Legros, Cazin, Camille Pissarro, Zacharie Astruc, sculpteur et poète, Whistler, Stevens, Zola, les critiques Duranty, Théodore Duret, Burty, — et certains autres.
Conduit par Duranty, Degas apparut un jour dans ce milieu. Il se montra poli, de bonne compagnie, surtout très distant. Il rechercha Desboutin et Burty. Mais déjà Manet l’impressionnait; Manet qui, à l’exemple de Courbet, faisait depuis longtemps œuvre de «peintre réaliste» ; aussi, Degas, tiraillé par Ingres et par Manet, se lança à dater de l’année 1866 des dessins de jockeys.
Toutefois, tandis que les uns et les autres, Monet, Renoir, Sisley, etc., se proclamaient, par l’œuvre et par la parole, les tenants de la peinture claire et «moderniste», Degas restait à cheval sur la barricade. Inquiet, irrésolu. Ainsi, un jour, il se décidait à être «moderne» comme Manet; mais, dès le lendemain et se cachant, il dessinait d’après Poussin, Holbein, Clouet ou Bellini.
De même, s’il se montre au Guerbois, il prend presque régulièrement ses repas dans un petit restaurant de la rue de la Rochefoucauld, où s’assoient les peintres officiels Cormon, Humbert, Gérôme et autres Cabanel.
Il reste toujours discret, presque hautain. Ainsi il se tient à l’écart du débraillé, du cynisme qu’apporte au Guerbois le familier Henri Pille. A son corps défendant, il échange quelques mots avec Cézanne, qui apparaît de temps en temps; mais il ne cèle point ses sentiments hostiles à l’égard de Monet et de Renoir. La prétentieuse faconde de Zola, qui se croit le porte-paroles du groupe, l’exaspère — et il lance des mots féroces à Whistler, qui, lorsqu’il est en train, le pique de mots légers.
Malgré tout, une belle œuvre d’ensemble se prépare dans ce café Guerbois. De là, toute la peinture moderne, neuve, vivante, va rayonner; et si Degas n’est pas un des plus actifs promoteurs de ce mouvement, il est certain qu’il en est tout de même un artisan; et nous verrons tout à l’heure qu’il y eut quelque mérite.
Degas a trente et un ans. Il ne se marie pas.
En anticipant — et pour n’y plus revenir —, on le verra rester, en somme, dans ce même quartier — si l’on peut dire! — des Batignolles, et habiter rue Blanche, rue Lepic, rue Notre-Dame de Lorette, rue Fontaine — et rue Ballu, cette charmante rue à petits hôtels, crée sur l’emplacement de l’ancien jardin de Tivoli. Nous nous attarderons plus loin sur ses deux derniers logis: rue de Laval ou Victor-Massé — et boulevard de Clichy.
Degas va facilement au café Guerbois. Tous ces peintres, toutefois, ne composent point entre eux une «charmante réunion de camarades». Par delà le temps — on a une tendance à voir ces parlottes comme un moment de bonne camaraderie entre gens de même profession. Il reste apparent qu’il n’en fût rien; mais ce qu’il faut redire, c’est que ces jeunes peintres etcritiques en commun — et cela fut suffisant pour les réunir — menèrent la lutte contre l’art officiel, c’est-à-dire académique; et tout le mouvement qui partit du café Guerbois, se consolida, dura assez pour qu’il fût par la suite tout à fait efficace et considérable. En particulier pour Degas, il faut noter que, sans le café Guerbois, il ne fût peut-être pas devenu tout à fait le pastelliste des danseuses et des nus au bain. Nous arrivons enfin au chapitre où cela va être exposé explicitement.
FEMME A LA POTICHE
LES DEUX “ VISAGES ” DE DEGAS
Table des matières
Familièrement, comme des Jupiters en robe de chambre, nous logeons volontiers dans le cerveau des gens qui nous agacent, des hannetons ou des araignées qui se livrent, affirmons-nous ensuite, aux pires ébats. Il est presque certain — pour nous qui connûmes Degas bizarre, capricieux, lunatique, — qu’il eût cette araignée trop agitée certains jours; et c’est cette araignée-là qui le persécuta.
Examinez ce cas Degas. Voici un artiste qui, à ses débuts, est très féru des maîtres acceptés par tous —, qui croit à la tradition, à l’Institut. Jeune peintre sérieux et riche, il part tout de suite pour Rome afin d’y recevoir la bonne parole. Il se lie avec tous les pensionnaires de l’Académie de France qu’il peut rencontrer. Il s’astreint à passer des heures longues dans les musées; il ne pense qu’à la parole de M. Ingres: «Dessiner, peindre d’abord d’après les maîtres avant d’aborder la nature». Il fait des portraits rigides, classiques; il se garrotte; il copie des tableaux entiers, n’oubliant pas un point; il commet à son tour des compositions historiques. Il se dit qu’il a raté le prix de Rome; mais, à force de travail, il ne ratera pas l’Institut; et, en fin de compte, bon peintre discipliné, estimé, après avoir été un bon élève, suivant bien les maîtres — son professeur Lamothe et surtout M. Ingres, ce second Raphaël, il finira honnêtement sa carrière, honoré lui aussi et donc pavoisé du ruban de cette Légion qu’on dit d’honneur. Tout cela est dans sa tête — et par toutes ses actions antérieures — bien établi, bien ordonné ; — quand un soir, brusquement, l’araignée qui somnolait en son cerveau se réveille; et, sous les traits de Duranty, le pousse au café Guerbois!
Là, Degas voit de nouveaux peintres. Des jeunes hommes ardents, vivants, qui allument d’incendiaires discours. Il faut brûler la peinture académique, raser l’Institut. Et à Degas, effaré, Duranty explique qu’ils ont raison; qu’on est las des tableaux conventionnels, insipides; qu’il faut rejeter définitivement les Grecs et les Romains, la bataille de Salamine et la défaite de Pompée; qu’il faut reléguer au magasin des accessoires toutes les défroques des anciens peintres; qu’il est nécessaire d’aborder la nature actuelle, notre époque, nos mœurs — et sortir de là un tableau bien neuf, bien réaliste, bien dans la vie, enfin; et, lui, Degas, est-ce qu’il ne veut pas réaliser cela?
Ici, alors, s’ouvre la période des longs débats. Quand on est parti avec tout le lest académique, on ne le jette pas ainsi d’un coup par-dessus bord. Degas demande à réfléchir, à tâtonner. Timidement, il engage quelques croquis, des essais. Dame! c’est peut-être la la gloire nouvelle! Puis, en se cachant encore, il reprend vite ses béquilles; et il soigne tant qu’il peut un portrait bien posé, bien neutre — ou une petite composition qu’il lèche et pourlèche.
Il s’entête. Tous les soirs, il va chez Guerbois; mais, rentré dans son atelier, il adresse à M. Ingres ses oraisons. Il a maintenant deux visages: l’académique et le «moderniste». Il ne sait lequel des deux il doit considérer. Il se demande si ce n’est point par rage qu’il se jette vers les «sujets» de la vie moderne; quand toutes ses traditions, toute son éducation, toutes ses opinions reçues le fixent, au contraire, alors qu’il est de sang-froid, vers tout ce qu’il y a de plus tari dans les musées.
Il reste, de plus, méthodique, ordonné, prudent plus que jamais. S’il aime les discussions au café, où son esprit à l’emporte-pièce taille des blessures et des mots cuisants, il ne se joint pas volontiers à ses camarades pour quelque aventure publique. Qui l’a vu à cette époque — et il reste un ou deux témoins de ce moment-là — se souvient d’un Degas allant vers la vie moderne, comme sournoisement, comme par à coups, comme par soubresauts de «son araignée». Le plus souvent, presque toujours, c’est un homme marchant posément vers quelque dôme vénérable où l’on ne reçoit généralement que les gens frappés d’impuissance.
Le Guerbois, au fond, dut lui apparaître parfois comme une véritable mystification. Allons! qu’existait-il de commun entre lui Degas — et Manet et Renoir et Sisley, par exemple? Entre son dessin tout de contours précis et le dessin flou — si en mouvement de ses camarades? Déjà, il est plus dessinateur que peintre; jamais il ne saisira le sens de ces taches de couleur, de ces hachures remuantes, agitées peut-on dire! Par instants, voici qu’il se dit, qu’il se répète qu’il sera, malgré tout, un institutaire qui a mal tourné. — «Quand Degas était de sang-froid, on ne m’ôtera pas de la tête cette idée qu’il devait regretter amèrement l’Institut et ses honneurs!» m’a dit un jour, de son côté, un critique, qui fut un intermittent ami du pastelliste des Danseuses; — en ajoutant:
«Voyez toute son œuvre après 1870, voyez tous ses jockeys, ses chanteuses, ses nus, comme tout cela est figé, malgré toute sa fureur, malgré toute sa rage!» Oui, l’araignée! l’araignée! pensais-je.....
Et cela me rappelait à moi le temps du Théâtre-Libre, où l’on écrivait d’abord une pièce «pompier», — à laquelle on donnait ensuite un peu d’accent, en la farcissant de mots d’argot.
Pourtant, peu à peu, la vie moderne prit le dessus chez Degas. Mais, au cours de ses voyages en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Espagne, aux Etats-Unis, etc., toujours on le verra hanter malgré tout les musées, en rester «imprégné », — comme ces femmes remariées qui ne peuvent oublier leur premier mari, dont elles restent «imprégnées» elles aussi, disent les physiologistes; — et, en l’année 1897, vous avez bien lu: 1897? n’accourut-il pas au musée de Montauban, pour admirer la collection de peintures et de dessins enfin installée, que Dominique Ingres avait léguée à sa ville natale; — et cela après être allé, lui Degas, contempler Jupiter et Thétys, du même maître, au musée d’Aix-en-Provence; — toute cette œuvre d’Ingres, à propos de laquelle il ne cessait pas de rabâcher — et qu’il connaissait presque par cœur?.....