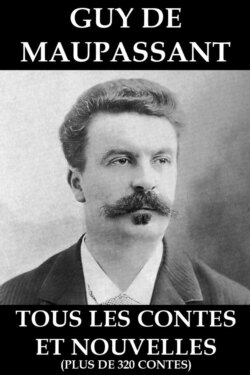Читать книгу Tous les Contes et Nouvelles de Maupassant (plus de 320 Contes) - Guy de Maupassant - Страница 110
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Correspondance
ОглавлениеMadame de X… à Madame de Z…
Étretat, vendredi.
Ma chère tante,
Je viens vers vous tout doucement. Je serai aux Fresnes le 2 septembre, veille de l’ouverture de la chasse que je tiens à ne pas manquer, pour taquiner ces messieurs. Vous êtes trop bonne, ma tante, et vous leur permettez ce jour-là, quand vous êtes seule avec eux, de dîner sans habit et sans s’être rasés en rentrant, sous prétexte de fatigue.
Aussi sont-ils enchantés quand je ne suis pas là. Mais j’y serai, et je passerai la revue, comme un général, à l’heure du dîner; et si j’en trouve un seul un peu négligé, rien qu’un peu, je l’enverrai à la cuisine, avec les bonnes.
Les hommes d’aujourd’hui ont si peu d’égards et de savoir-vivre qu’il faut se montrer toujours sévère. C’est vraiment le règne de la goujaterie. Quand ils se querellent entre eux, ils se provoquent avec des injures de portefaix, et, devant nous, ils se tiennent beaucoup moins bien que nos domestiques. C’est aux bains de mer qu’il faut voir cela. Ils s’y trouvent en bataillons serrés et on peut les juger en masse. Oh! Les êtres grossiers qu’ils sont!
Figurez-vous qu’en chemin de fer, un d’eux, un monsieur qui semblait bien, au premier abord, grâce à son tailleur, a retiré délicatement ses bottes pour les remplacer par des savates. Un autre, un vieux qui doit être un riche parvenu (ce sont les plus mal élevés), assis en face de moi, a posé délicatement ses deux pieds sur la banquette, à mon côté. C’est admis.
Dans les villes d’eaux, c’est un déchaînement de grossièreté. Je dois ajouter une chose: ma révolte tient peut-être à ce que je ne suis point habituée à fréquenter communément les gens qu’on coudoie ici, car leur genre me choquerait moins si je l’observais plus souvent.
Dans le bureau de l’hôtel, je fus presque renversée par un jeune homme qui prenait sa clef pardessus ma tête. Un autre me heurta si fort, sans dire «pardon», ni se découvrir, en sortant d’un bal au Casino, que j’en eus mal dans la poitrine. Voilà comme ils sont tous. Regardons-les aborder les femmes sur la terrasse, c’est à peine s’ils saluent. Ils portent simplement la main à leur couvre-chef. Du reste, comme ils sont tous chauves, cela vaut mieux.
Mais il est une chose qui m’exaspère et me choque pardessus tout, c’est la liberté qu’ils prennent de parler en public, sans aucune espèce de précaution, des aventures les plus révoltantes. Quand deux hommes sont ensemble, ils se racontent, avec les mots les plus crus et les réflexions les plus abominables, des histoires vraiment horribles, sans s’inquiéter le moins du monde si quelque oreille de femme est à portée de leur voix. Hier, sur la plage, je fus contrainte de changer de place pour ne pas être plus longtemps la confidente involontaire d’une anecdote graveleuse, dite en termes si violents que je me sentais humiliée autant qu’indignée d’avoir pu entendre cela. Le plus élémentaire savoir-vivre ne devrait-il pas leur apprendre à parler bas de ces choses en notre voisinage?
Étretat est, en outre, le pays des cancans et, partant, la patrie des commères. De cinq à sept heures on les voit errer en quête de médisances qu’elles transportent de groupe en groupe. Comme vous me le disiez, ma chère tante, le potin est un signe de race des petites gens et des petits esprits. Il est aussi la consolation des femmes qui ne sont plus aimées ni courtisées. Il me suffit de regarder celles qu’on désigne comme les plus cancanières pour être persuadée que vous ne vous trompez pas.
L’autre jour j’assistai à une soirée musicale au Casino, donnée par une remarquable artiste, Mme Masson, qui chante vraiment à ravir. J’eus l’occasion d’applaudir encore l’admirable Coquelin, ainsi que deux charmants pensionnaires du Vaudeville, M… et Meillet. Je pus, en cette circonstance, voir tous les baigneurs réunis cette année sur cette plage. Il n’en est pas beaucoup de marque.
Le lendemain, j’allai déjeuner à Yport. J’aperçus un homme barbu qui sortait d’une grande maison en forme de citadelle. C’était le peintre Jean-Paul Laurens. Il ne lui suffit pas, paraît-il, d’emmurer ses personnages, il tient à s’emmurer lui-même.
Puis je me trouvai assise sur le galet à côté d’un homme encore jeune, d’aspect doux et fin, d’allure calme, qui lisait des vers. Mais il les lisait avec une telle attention, une telle passion, dirai-je, qu’il ne leva pas une seule fois les yeux sur moi. Je fus un peu choquée; et je demandai au maître baigneur, sans paraître y prendre garde, le nom de ce monsieur. En moi je riais un peu de ce liseur de rimes; il me semblait attardé, pour un homme. C’est là, pensai-je, un naïf. Eh bien, ma tante, à présent, je raffole de mon inconnu. Figure-toi qu’il s’appelle Sully Prudhomme. Je retournai m’asseoir auprès de lui pour le considérer tout à mon aise. Sa figure a surtout un grand caractère de tranquillité et de finesse. Quelqu’un étant venu le trouver, j’entendis sa voix qui est douce, presque timide. Celui-là, certes, ne doit pas crier de grossièretés en public, ni heurter des femmes sans s’excuser. Il doit être un délicat, mais un délicat presque maladif, un vibrant. Je tâcherai, cet hiver, qu’il me soit présenté.
Je ne sais plus rien, ma chère tante, et je vous quitte en hâte, l’heure de la poste me pressant. Je baise vos mains et vos joues.
Votre nièce dévouée,
Berthe de X…
P. S. – Je dois cependant ajouter, pour la justification de la politesse française, que nos compatriotes sont en voyage des modèles de savoir-vivre en comparaison des abominables Anglais qui semblent avoir été élevés par des valets d’écurie, tant ils prennent soin de ne se gêner en rien et de toujours gêner leurs voisins.
Madame de Z… à Madame de X…
Les Fresnes, samedi.
Ma chère petite, tu me dis beaucoup de choses pleines de raison, ce qui n’empêche que tu as tort. Je fus, comme toi, très indignée autrefois de l’impolitesse des hommes que j’estimais me manquer sans cesse; mais en vieillissant et en songeant à tout, et en perdant ma coquetterie, et en observant sans y mêler du mien, je me suis aperçue de ceci: que si les hommes ne sont pas toujours polis, les femmes, par contre, sont toujours d’une inqualifiable grossièreté.
Nous nous croyons tout permis, ma chérie, et nous estimons en même temps que tout nous est dû, et nous commettons à coeur joie des actes dépourvus de ce savoir-vivre élémentaire dont tu parles avec passion.
Je trouve maintenant, au contraire, que les hommes ont pour nous beaucoup d’égards, relativement à nos allures envers eux. Du reste, mignonne, les hommes doivent être, et sont, ce que nous les faisons. Dans une société où les femmes seraient toutes de vraies grandes dames, tous les hommes deviendraient des gentilshommes.
Voyons, observe et réfléchis.
Vois deux femmes qui se rencontrent dans la rue; quelle attitude! Quels regards de dénigrement, quel mépris dans le coup d’oeil! Quel coup de tête de haut en bas pour toiser et condamner! Et si le trottoir est étroit, crois-tu que l’une cédera le pas, demandera pardon? Jamais! Quand deux hommes se heurtent en une ruelle insuffisante, tous deux saluent et s’effacent en même temps; tandis que, nous autres, nous nous précipitons ventre à ventre, nez à nez, en nous dévisageant avec insolence.
Vois deux femmes se connaissant qui se rencontrent dans un escalier devant la porte d’une amie que l’une vient de voir et que l’autre va visiter. Elles se mettent à causer en obstruant toute la largeur du passage. Si quelqu’un monte derrière elles, homme ou femme, crois-tu qu’elles se dérangeront d’un demi-pied? Jamais! Jamais!
J’attendis, l’hiver dernier, vingt-deux minutes, montre en main, à la porte d’un salon. Et derrière moi deux messieurs attendaient aussi sans paraître prêts à devenir enragés, comme moi. C’est qu’ils étaient habitués depuis longtemps à nos inconscientes insolences.
L’autre jour, avant de quitter Paris, j’allai dîner, avec ton mari justement, dans un restaurant des Champs-Élysées pour prendre le frais. Toutes les tables étaient occupées. Le garçon nous pria d’attendre.
J’aperçus alors une vieille dame de noble tournure qui venait de payer sa carte et qui semblait prête à partir. Elle me vit, me toisa et ne bougea point. Pendant plus d’un quart d’heure elle resta là, immobile, mettant ses gants, parcourant du regard toutes les tables, considérant avec quiétude ceux qui attendaient comme moi. Or, deux jeunes gens qui achevaient leur repas m’ayant vue à leur tour, appelèrent en hâte le garçon pour régler leur note et m’offrirent leur place tout de suite, s’obstinant même à attendre debout leur monnaie. Et songe, ma belle, que je ne suis plus jolie, comme toi, mais vieille et blanche.
C’est à nous, vois-tu, qu’il faudrait enseigner la politesse; et la besogne serait si rude qu’Hercule n’y suffirait pas.
Tu me parles d’Étretat et des gens qui potinent sur cette gentille plage. C’est un pays fini, perdu pour moi, mais dans lequel je me suis autrefois bien amusée.
Nous étions là quelques-uns seulement, des gens du monde, du vrai monde, et des artistes, fraternisant. On ne cancanait pas, alors.
Or, comme nous n’avions point l’insipide Casino où l’on pose, où l’on chuchote, où l’on danse bêtement, où l’on s’ennuie à profusion, nous cherchions de quelle manière passer gaiement nos soirées. Or, devine ce qu’imagina l’un de nos maris? Ce fut d’aller danser, chaque nuit, dans une des fermes des environs.
On partait en bande avec un orgue de Barbarie dont jouait d’ordinaire le peintre Le Poittevin, coiffé d’un bonnet de coton. Deux hommes portaient des lanternes. Nous suivions en procession, riant et bavardant comme des folles.
On réveillait le fermier, les servantes, les valets. On se faisait même faire de la soupe à l’oignon (horreur!) et l’on dansait sous les pommiers, au son de la boîte à musique. Les coqs réveillés chantaient dans la profondeur des bâtiments; les chevaux s’agitaient sur la litière des écuries. Le vent frais de la campagne nous caressait les joues, plein d’odeurs d’herbes et de moissons coupées.
Que c’est loin! Que c’est loin! Voilà trente ans de cela!
Je ne veux pas, ma chérie, que tu viennes pour l’ouverture de la chasse. Pourquoi gâter la joie de nos amis, en leur imposant des toilettes mondaines en ce jour de plaisir campagnard et violent? C’est ainsi qu’on gâte les hommes, petite.
Je t’embrasse.
Ta vieille tante,
Geneviève de Z…
30 août 1882