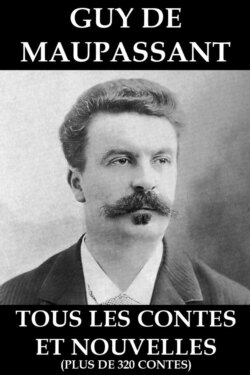Читать книгу Tous les Contes et Nouvelles de Maupassant (plus de 320 Contes) - Guy de Maupassant - Страница 116
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Yveline Samoris
ОглавлениеLa comtesse Samoris.
— Cette dame en noir, là-bas?
— Elle-même, elle porte le deuil de sa fille qu’elle a tuée.
— Allons donc! Que me contez-vous là?
— Une histoire toute simple, sans crime et sans violences.
— Alors quoi?
— Presque rien. Beaucoup de courtisanes étaient nées pour être des honnêtes femmes, dit-on; et beaucoup de femmes dites honnêtes pour être courtisanes, n’est-ce pas? Or, Mme Samoris, née courtisane, avait une fille née honnête femme, voilà tout.
— Je comprends mal.
— Je m’explique:
La comtesse Samoris est une de ces étrangères à clinquant comme il en pleut des centaines sur Paris, chaque année. Comtesse hongroise ou valaque, ou je ne sais quoi, elle apparut un hiver dans un appartement des Champs-Élysées, ce quartier des aventuriers, et ouvrit ses salons au premier venant, et au premier venu.
J’y allai. Pourquoi? Direz-vous. Je n’en sais trop rien. J’y allai comme nous y allons tous, parce qu’on y joue, parce que les femmes sont faciles et les hommes malhonnêtes. Vous connaissez ce monde de flibustiers à décorations variées, tous nobles, tous titrés, tous inconnus aux ambassades, à l’exception des espions.
Tous parlent de l’honneur à propos de bottes, citent leurs ancêtres, racontent leur vie, hâbleurs, menteurs, filous, dangereux comme leurs cartes, trompeurs comme leurs noms, l’aristocratie du bagne enfin.
J’adore ces gens-là. Ils sont intéressants à pénétrer, intéressants à connaître, amusants à entendre, souvent spirituels, jamais banals comme des fonctionnaires publics. Leurs femmes sont toujours jolies, avec une petite saveur de coquinerie étrangère, avec le mystère de leur existence passée peut-être à moitié dans une maison de correction. Elles ont en général des yeux superbes et des cheveux invraisemblables. Je les adore aussi.
Mme Samoris est le type de ces aventurières, élégante, mûre et belle encore, charmeuse et féline; on la sent vicieuse jusque dans les moelles. On s’amusait beaucoup chez elle, on y jouait, on y dansait, on y soupait… enfin on y faisait tout ce qui constitue les plaisirs de la vie mondaine.
Et elle avait une fille, grande, magnifique, toujours joyeuse, toujours prête pour les fêtes, toujours riant à pleine bouche et dansant à corps perdu. Une vraie fille d’aventurière. Mais une innocente, une ignorante, une naïve, qui ne voyait rien, ne savait rien, ne comprenait rien, ne devinait rien de tout ce qui se passait dans la maison paternelle.
«Comment le savez-vous?»
Comment je le sais? C’est plus drôle que tout. On sonne un matin chez moi, et mon valet de chambre vint me prévenir que M. Joseph Bonenthal demande à me parler. Je dis aussitôt: «Qui est ce monsieur?»
Mon serviteur répondit:
«Je ne sais pas trop, Monsieur, c’est peut-être un domestique.»
C’était un domestique, en effet, qui voulait entrer chez moi.
«D’où sortez-vous?
— De chez Mme La comtesse Samoris.
— Ah! Mais ma maison ne ressemble en rien à la sienne.
— Je le sais bien, Monsieur, et voilà pourquoi je voudrais entrer chez Monsieur; j’en ai assez de ces gens-là; on y passe, mais on n’y reste pas.»
J’avais justement besoin d’un homme, je pris celui-là.
Un mois après, Mlle Yveline Samoris mourait mystérieusement, et voici tous les détails de cette mort que je tiens de Joseph qui les tenait de son amie la femme de chambre de la comtesse.
Le soir d’un bal, deux nouveaux arrivés causaient derrière une porte. Mlle Yveline, qui venait de danser, s’appuya contre cette porte pour avoir un peu d’air. Ils ne la virent pas s’approcher; elle les entendit. Ils disaient:
«Mais quel est le père de la jeune personne?
— Un Russe, paraît-il, le comte Rouvaloff. Il ne voit plus la mère.
— Et le prince régnant aujourd’hui?
— Ce prince anglais debout contre la fenêtre; Mme Samoris l’adore. Mais ses adorations ne durent jamais plus d’un mois à six semaines. Du reste, vous voyez que le personnel d’amis est nombreux; tous sont appelés… et presque tous sont élus. Cela coûte un peu cher; mais… bast!
— Où a-t-elle pris ce nom de Samoris?
— Du seul homme peut-être qu’elle ait aimé, un banquier israélite de Berlin qui s’appelait Samuel Morris.
— Bon. Je vous remercie. Maintenant que je suis renseigné, j’y vois clair. Et j’irai droit.»
Quelle tempête éclata dans cette cervelle de jeune fille douée de tous les instincts d’une honnête femme? Quel désespoir bouleversa cette âme simple? Quelles tortures étreignirent cette joie incessante, ce rire charmant, cet exultant bonheur de vivre? Quel combat se livra dans ce coeur si jeune, jusqu’à l’heure où le dernier invité fut parti? Voilà ce que Joseph ne pouvait me dire. Mais le soir même, Yveline entra brusquement dans la chambre de sa mère, qui allait se mettre au lit, fit sortir la suivante qui resta derrière la porte, et debout, pâle, les yeux agrandis, elle prononça:
«Maman, voici ce que j’ai entendu tantôt dans le salon.»
Et elle raconta mot pour mot le propos que je vous ai dit.
La comtesse, stupéfaite, ne savait d’abord que répondre. Puis elle nia tout avec énergie, inventa une histoire, jura, prit Dieu à témoin.
La jeune fille se retira éperdue, mais non convaincue. Et elle épia.
Je me rappelle parfaitement le changement étrange qu’elle avait subi. Elle était toujours grave et triste; et plantait sur nous ses grands yeux fixes comme pour lire au fond de nos âmes. Nous ne savions qu’en penser, et on prétendait qu’elle cherchait un mari, soit définitif, soit passager.
Un soir, elle n’eut plus de doute: elle surprit sa mère. Alors froidement, comme un homme d’affaires qui pose les conditions d’un traité, elle dit:
«Voici, maman, ce que j’ai résolu. Nous nous retirerons toutes les deux dans une petite ville ou bien à la campagne; nous y vivrons sans bruit, comme nous pourrons. Tes bijoux seuls sont une fortune. Si tu trouves à te marier avec quelque honnête homme, tant mieux; encore plus tant mieux si je trouve aussi. Si tu ne consens pas à cela, je me tuerai.»
Cette fois la comtesse envoya coucher sa fille et lui défendit de jamais recommencer cette leçon, malséante en sa bouche.
Yveline répondit:
«Je te donne un mois pour réfléchir. Si dans un mois nous n’avons pas changé d’existence, je me tuerai, puisqu’il ne reste aucune autre issue honorable à ma vie.»
Et elle s’en alla.
Au bout d’un mois, on dansait et on soupait toujours dans l’hôtel Samoris.
Yveline alors prétendit qu’elle avait mal aux dents et fit acheter chez un pharmacien voisin quelques gouttes de chloroforme. Le lendemain elle recommença; elle dut elle-même, chaque fois qu’elle sortait, recueillir des doses insignifiantes du narcotique. Elle en emplit une bouteille.
On la trouva, un matin, dans son lit, déjà froide, avec un masque de coton sur la figure.
Son cercueil fut couvert de fleurs, l’église tendue de blanc. Il y eut foule à la cérémonie funèbre.
Eh bien! Vrai, si j’avais su, – mais on ne sait jamais, – j’aurais peut-être épousé cette fille-là. Elle était rudement jolie.
«Et la mère, qu’est-elle devenue?
— Oh! Elle a beaucoup pleuré. Elle recommence depuis huit jours seulement à recevoir ses intimes.
— Et qu’a-t-on dit pour expliquer cette mort?
— On a parlé d’un poêle perfectionné dont le mécanisme s’était dérangé. Des accidents par ces appareils ayant fait grand bruit jadis, il n’y avait rien d’invraisemblable à cela.»
20 décembre 1882