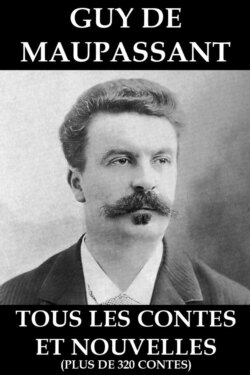Читать книгу Tous les Contes et Nouvelles de Maupassant (plus de 320 Contes) - Guy de Maupassant - Страница 41
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V-Deux hommes célèbres
ОглавлениеM. Patissot avait promis à son ami le canotier qu’il passerait avec lui la journée du dimanche suivant. Une circonstance imprévue dérangea ses projets. Il rencontra un soir, sur le boulevard, un de ses cousins qu’il voyait fort rarement. C’était un journaliste aimable, très lancé dans tous les mondes, et qui proposa son concours à Patissot pour lui montrer bien des choses intéressantes.
— Que faites-vous dimanche, par exemple?
— Je vais à Argenteuil, canoter.
— Allons donc, c’est assommant, votre canotage; c’est ça qui ne change jamais. Tenez, je vous emmène avec moi. Je vous ferai connaître deux hommes illustres et visiter deux maisons d’artistes.
— Mais on m’a ordonné d’aller à la campagne!
— C’est à la campagne que nous irons. Je ferai, en passant, une visite à Meissonier, dans sa propriété de Poissy; puis nous gagnerons à pied Médan, où habite Zola, à qui j’ai mission de demander son prochain roman pour notre journal.
Patissot, délirant de joie, accepta.
Il acheta même une redingote neuve, la sienne étant un peu usée, afin de se présenter convenablement, et il avait une peur horrible de dire des bêtises, soit au peintre, soit à l’homme de lettres, comme tous les gens qui parlent des arts qu’ils n’ont jamais pratiqués.
Il communiqua ses craintes à son cousin, qui se mit à rire, en lui répondant: «Bah! Faites seulement des compliments, rien que des compliments, toujours des compliments; ça fait passer les bêtises quand on en dit. Vous connaissez les tableaux de Meissonier?
— Je crois bien.
— Vous avez lu les Rougon-Macquart?
— D’un bout à l’autre.
— Ça suffit. Nommez un tableau de temps en temps, citez un roman par-ci, par-là, et ajoutez: Superbe!!! Extraordinaire!!! Délicieux d’exécution!!! Étrangement puissant, etc. De cette façon on s’en tire toujours. Je sais bien que ces deux hommes-là sont rudement blasés sur tout; mais, voyez-vous, les louanges, ça fait toujours plaisir à un artiste.»
Le dimanche matin, ils partirent pour Poissy.
A quelques pas de la gare, au bout de la place de l’église, ils trouvèrent la propriété de Meissonier. Après avoir passé sous une porte basse peinte en rouge et que continue un magnifique berceau de vignes, le journaliste s’arrêta et, se tournant vers son compagnon:
— Comment vous figurez-vous Meissonier?
Patissot hésitait. Enfin il se décida: «Un petit homme, très soigné, rasé, d’allure militaire.» – L’autre sourit: «C’est bien. Venez.» Un bâtiment en forme de chalet, fort bizarre, apparaissait à gauche; et, à droite, presque en face, un peu en contrebas, la maison principale. C’était une construction singulière où il y avait de tout, de la forteresse gothique, du manoir, de la villa, de la chaumière, de l’hôtel, de la cathédrale, de la mosquée, de la pyramide, du gâteau de Savoie, de l’oriental et l’occidental. Un style supérieurement compliqué, à rendre fou un architecte classique, quelque chose de fantastique et de joli cependant, inventé par le peintre et exécuté sous ses ordres.
Ils entrèrent; des malles encombraient un petit salon. Un homme parut, vêtu d’une vareuse et petit. Mais ce qui frappait en lui, c’était sa barbe, une barbe de prophète, invraisemblable, un fleuve, un ruissellement, un Niagara de barbe. Il salua le journaliste! «Je vous demande pardon, cher Monsieur; je suis arrivé hier seulement, et tout est encore bouleversé chez moi. Asseyez-vous.» – L’autre refusa, s’excusant: «Mon cher maître, je n’étais venu qu’en passant, vous présenter mes hommages.» Patissot, très troublé, s’inclinait à chaque parole de son ami, comme par un mouvement automatique, et il murmura, en bégayant un peu: «Quelle su-su-perbe propriété!» Le peintre, flatté, sourit et proposa de la visiter.
Il les mena d’abord dans un petit pavillon d’aspect féodal, où se trouvait son ancien atelier, donnant sur une terrasse. Puis ils traversèrent un salon, une salle à manger, un vestibule pleins d’oeuvres d’art merveilleuses, de tapisseries adorables de Beauvais, des Gobelins et des Flandres. Mais le luxe bizarre d’ornementation du dehors devenait, au dedans, un luxe d’escaliers prodigieux. Escalier d’honneur magnifique, escalier dérobé dans une tour, escalier de service dans une autre, escalier partout! Patissot, par hasard, ouvre une porte et recule stupéfait. C’était un temple, cet endroit dont les gens respectables ne prononcent le nom qu’en anglais, un sanctuaire original et charmant, d’un goût exquis, orné comme une pagode, et dont la décoration avait assurément coûté de grands efforts de pensée.
Ils visitèrent ensuite le parc, compliqué, mouvementé, torturé, plein de vieux arbres. Mais le journaliste voulut absolument prendre congé, et, remerciant beaucoup, quitta le maître. Ils rencontrèrent, en sortant, un jardinier; Patissot lui demanda: «Y a-t-il longtemps que M. Meissonier possède cela?» Le bonhomme répondit: «Oh, monsieur, faudrait s’expliquer. Il a bien acheté la terre en 1846, mais la maison!!! Il l’a démolie et reconstruite déjà cinq ou six fois depuis… Je suis sûr qu’il y a deux millions là dedans, Monsieur!»
Et Patissot, en s’en allant, fut pris d’une immense considération pour cet homme, non pas tant à cause de ses grands succès, de sa gloire et de son talent, mais parce qu’il mettait tant d’argent pour une fantaisie, tandis que les bourgeois ordinaires se privent de toute fantaisie pour amasser de l’argent!
Après avoir traversé Poissy, ils prirent, à pied, la route de Médan. Le chemin suit d’abord la Seine, peuplée d’îles charmantes en cet endroit, puis remonte pour traverser le joli village de Villaines, redescend un peu, et pénètre enfin au pays habité par l’auteur des Rougon-Macquart.
Une église ancienne et coquette, flanquée de deux tourelles, se présenta d’abord sur la gauche. Ils firent encore quelques pas, et un paysan qui passait leur indiqua la porte du romancier.
Avant d’entrer, ils examinèrent l’habitation. Une grande construction carrée et neuve, très haute, semblait avoir accouché, comme la montagne de la fable, d’une toute petite maison blanche blottie à son pied. Cette dernière maison, la demeure primitive, a été bâtie par l’ancien propriétaire. La tour fut édifiée par Zola.
Ils sonnèrent. Un chien énorme, croisement de montagnard et de terre-neuve, se mit à hurler si terriblement que Patissot éprouvait un vague désir de retourner sur ses pas. Mais un domestique, accourant, calma Bertrand, ouvrit la porte et reçut la carte du journaliste pour la porter à son maître.
«Pourvu qu’il nous reçoive! Murmurait Patissot; ça m’ennuierait rudement d’être venu jusqu’ici sans le voir.»
Son compagnon souriait:
— Ne craignez rien; j’ai mon idée pour entrer.
Mais le domestique, qui revenait, les pria simplement de le suivre.
Ils pénétrèrent dans la construction neuve, et Patissot, fort ému, soufflait en gravissant un escalier de forme ancienne, qui les conduisit au second étage.
Il cherchait en même temps à se figurer cet homme dont le nom sonore et glorieux résonne en ce moment à tous les coins du monde, au milieu de la haine exaspérée des uns, de l’indignation vraie ou feinte des gens du monde, du mépris envieux de quelques confrères, du respect de toute une foule de lecteurs, et de l’admiration frénétique d’un grand nombre; et il s’attendait à voir apparaître une sorte de géant barbu, d’aspect terrible, avec une voix retentissante, et d’abord peu engageant.
La porte s’ouvrit sur une pièce démesurément grande et haute qu’un vitrage, donnant sur la plaine, éclairait dans toute sa largeur. Des tapisseries anciennes couvraient les murs; à gauche, une cheminée monumentale, flanquée de deux bonshommes de pierre, auraient pu brûler un chêne centenaire en un jour; et une table immense, chargée de livres, de papiers et de journaux, occupait le milieu de cet appartement tellement vaste et grandiose qu’il accaparait l’oeil tout d’abord, et que l’attention ne se portait qu’ensuite vers l’homme, étendu, quand ils entrèrent, sur un divan oriental où vingt personnes auraient dormi.
Il fit quelques pas vers eux, salua, désigna de la main deux sièges et se remit sur son divan, une jambe repliée sous lui. Un livre à son côté gisait, et il maniait de la main droite un couteau à papier en ivoire dont il contemplait le bout de temps en temps, d’un seul oeil, en fermant l’autre avec une obstination de myope.
Pendant que le journaliste expliquait l’intention de sa visite, et que l’écrivain l’écoutait sans répondre encore, en le regardant fixement par moments, Patissot, de plus en plus gêné, considérait cette célébrité.
Âgé de quarante ans à peine, il était de taille moyenne, assez gros et d’aspect bonhomme. Sa tête (très semblable à celles qu’on retrouve dans beaucoup de tableaux italiens du XVIe siècle), sans être belle au sens plastique du mot, présentait un grand caractère de puissance et d’intelligence. Les cheveux courts se redressaient sur le front très développé. Un nez droit s’arrêtait, coupé net, comme par un coup de ciseau, trop brusque, au-dessus de la lèvre supérieure, qu’ombrageait une moustache assez épaisse; et le menton entier était couvert de barbe taillée près de la peau. Le regard noir, souvent ironique, pénétrait; et l’on sentait que là derrière une pensée toujours active travaillait, perçant les gens, interprétant les paroles, analysant les gestes, dénudant le coeur. Cette tête ronde et forte était bien celle de son nom, rapide et court, aux deux syllabes bondissantes dans le retentissement des deux voyelles.
Quand le journaliste eut terminé son boniment, l’écrivain lui répondit qu’il ne voulait point s’engager; qu’il verrait cependant plus tard; que son plan même n’était point encore suffisamment arrêté. Puis il se tut. C’était un congé, et les deux hommes, un peu confus, se levèrent. Mais un désir envahit Patissot: il voulait que ce personnage si connu lui dît un mot, un mot quelconque, qu’il pourrait répéter à ses collègues; et, s’enhardissant, il balbutia: «Oh! Monsieur, si vous saviez combien j’apprécie vos ouvrages!» L’autre s’inclina, mais ne répondit rien. Patissot devenait téméraire, il reprit: «C’est un bien grand honneur pour moi de vous parler aujourd’hui.» L’écrivain salua encore, mais d’un air roide et impatienté. Patissot s’en aperçut, et, perdant la tête, il ajouta en se retirant: «Quelle su-su-superbe propriété!»
Alors le propriétaire s’éveilla dans le coeur indifférent de l’homme de lettres qui, souriant, ouvrit le vitrage pour montrer l’étendue de la perspective. Un horizon démesuré s’élargissait de tous les côtés, c’était Triel, Pisse-Fontaine, Chanteloup, toutes les hauteurs de l’Hautrie, et la Seine, à perte de vue. Les deux visiteurs en extase félicitaient; et la maison leur fut ouverte. Ils virent tout, jusqu’à la cuisine élégante dont les murs et le plafond même, recouverts en faïence à dessins bleus, excitent l’étonnement des paysans.
«Comment avez-vous acheté cette demeure?» demanda le journaliste. Et le romancier raconta que, cherchant une bicoque à louer pour un été il avait trouvé la petite maison, adossée à la nouvelle, qu’on voulait vendre quelques milliers de francs, une bagatelle, presque rien. Il acheta séance tenante.
— Mais tout ce que vous avez ajouté a dû vous coûter cher ensuite?
L’écrivain sourit: «Oui, pas mal!»
Et les deux hommes s’en allèrent.
Le journaliste, tenant le bras de Patissot, philosophait, d’une voix lente: «Tout général a son Waterloo, disait-il; tout Balzac a ses Jardies et tout artiste habitant la campagne a son coeur de propriétaire.»
Ils prirent le train à la station de Villaines, et, dans le wagon, Patissot jetait tout haut les noms de l’illustre peintre et du grand romancier, comme s’ils eussent été ses amis. Il s’efforçait même de laisser croire qu’il avait déjeuné chez l’un et dîné chez l’autre.