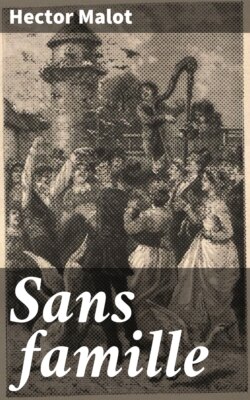Читать книгу Sans famille - Hector Malot - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EN BATEAU
ОглавлениеQuand je rentrai à l’auberge, le cœur gros, les yeux rouges, je trouvai sous la porte de la cour l’aubergiste qui me regarda longuement.
J’allais passer pour rejoindre les chiens, quand il m’arrêta.
«Eh bien, me dit-il, ton maître?
— Il est condamné.
— A combien?
— A deux mois de prison.
— Et à combien d’amende?
— Cent francs.
— Deux mois, cent francs,» répéta-t-il à trois ou quatre reprises.
Je voulus continuer mon chemin; de nouveau il m’arrêta.
«Et qu’est-ce que tu veux faire pendant ces deux mois?
— Je ne sais pas, monsieur.
— Ah! tu ne sais pas. Tu as de l’argent pour vivre et pour nourrir tes bêtes, je pense?
— Non, monsieur.
— Alors tu comptes sur moi pour vous loger?
— Oh! non, monsieur, je ne compte sur personne.»
Rien n’était plus vrai, je ne comptais sur personne.
«Eh bien! mon garçon, continua l’aubergiste, tu as raison, ton maître me doit déjà trop d’argent, je ne peux pas te faire crédit pendant deux mois sans savoir si au bout du compte je serai payé ; il faut t’en aller d’ici.
— M’en aller! mais où voulez-vous que j’aille, monsieur?
— Ça, ce n’est pas mon affaire: je ne suis pas ton père, je ne suis pas non plus ton maître. Pourquoi veux-tu que je te garde?»
Je restai un moment abasourdi. Que dire? Cet homme avait raison. Pourquoi m’aurait-il gardé chez lui? Je ne lui étais rien qu’un embarras et une charge.
«Allons, mon garçon, prends tes chiens et ton singe, puis file; tu me laisseras, bien entendu, le sac de ton maître. Quand il sortira de prison il viendra le chercher, et alors nous réglerons notre compte.»
Ce mot me suggéra une idée, et je crus avoir trouvé le moyen de rester dans cette auberge.
«Puisque vous êtes certain de faire régler votre compte à ce moment, gardez-moi jusque-là, et vous ajouterez ma dépense à celle de mon maître.
— Vraiment, mon garçon? Ton maître pourra bien me payer quelques journées, mais deux mois, c’est une autre affaire.
— Je mangerai aussi peu que vous voudrez.
— Et tes bêtes? Non, vois-tu, il faut t’en aller! Tu trouveras bien à travailler et à gagner ta vie dans les villages.
— Mais, monsieur, où voulez-vous que mon maître me trouve en sortant de prison? C’est ici qu’il viendra me chercher.
— Tu n’auras qu’à revenir ce jour-là ; d’ici là, va faire une promenade de deux mois dans les environs, dans les villes d’eaux. A Bagnères, à Cauterets, à Luz, il y a de l’argent à gagner.
— Et si mon maître m’écrit?
— Je te garderai sa lettre.
— Mais, si je ne lui réponds pas?
— Ah! tu m’ennuies à la fin. Je t’ai dit de t’en aller; il faut sortir d’ici, et plus vite que ça! Je te donne cinq minutes pour partir; si je te retrouve quand je vais revenir dans la cour, tu auras affaire à moi.»
Je sentis bien que toute insistance était inutile. Comme le disait l’aubergiste, «il fallait sortir d’ici.»
J’entrai à l’écurie, et, après avoir détaché les chiens et Joli Cœur, après avoir bouclé mon sac et passé sur mon épaule la bretelle de ma harpe, je sortis de l’auberge.
L’aubergiste était sur sa porte pour me surveiller.
«S’il vient une lettre, me cria-t-il, je te la conserverai!»
J’avais hâte de sortir de la ville, car mes chiens n’étaient pas muselés. Que répondre, si je rencontrais un agent de police? Que je n’avais pas d’argent pour leur acheter des muselières? C’était la vérité, car, tout compte fait, je n’avais que onze sous dans ma poche, et ce n’était pas suffisant pour une pareille acquisition. Ne m’arrêterait-il pas à mon tour? Mon maître en prison, moi aussi, que deviendraient les chiens et Joli-Cœur? J’étais devenu directeur de troupe, chef de famille, moi, l’enfant sans famille, et je sentais ma responsabilité.
Tout en marchant rapidement, les chiens levaient la tête vers moi et me regardaient d’un air qui n’avait pas besoin de paroles pour être compris: ils avaient faim.
Joli-Cœur, que je portais juché sur mon sac, me tirait de temps en temps l’oreille pour m’obliger à tourner la tête vers lui; alors il se brossait le ventre par un geste qui n’était pas moins expressif que le regard des chiens.
Moi aussi j’aurais bien, comme eux, parlé de ma faim, car je n’avais pas déjeuné plus qu’eux tous; mais à quoi bon?
Mes onze sous ne pouvaient pas nous donner à déjeuner et à dîner; nous devions tous nous contenter d’un seul repas, qui, fait au milieu de la journée, nous tiendrait lieu des deux.
L’auberge où nous avions logé et d’où nous venions d’être cnassés se trouvant dans le faubourg Saint-Michel sur la route de Montpellier, c’était naturellement cette route que j’avais suivie.
Dans ma hâte de fuir une ville où je pouvais rencontrer des agents de police, je n’avais pas le temps de me demander où les routes conduisaient; ce que je désirais, c’était qu’elles m’éloignassent de Toulouse, le reste m’importait peu. Je n’avais pas intérêt à aller dans un pays plutôt que dans un autre; partout on nous demanderait de l’argent pour manger et pour nous loger. Encore la question du logement était-elle de beaucoup la moins importante; nous étions dans la saison chaude, et nous pouvions coucher à la belle étoile à l’abri d’un buisson ou d’un mur.
Mais manger?
Je crois bien que nous marchâmes près de deux heures sans que j’osasse m’arrêter, et cependant les chiens me faisaient des yeux de plus en plus suppliants, tandis que Joli-Cœur me tirait l’oreille et se brossait le ventre de plus en plus fort.
Enfin je me crus assez loin de Toulouse pour n’avoir rien à craindre, ou tout au moins pour dire que je musèlerais mes chiens le lendemain, si on me demandait de le faire, et j’entrai dans la première boutique de boulanger que je trouvai.
Je demandai qu’on me servît une livre et demie de pain.
«Vous prendrez bien un pain de deux livres, me dit la boulangère; avec votre ménagerie ce n’est pas trop; il faut bien les nourrir, ces pauvres êtes!»
Sans doute ce n’était pas trop pour ma ménagerie qu’un pain de deux livres, car, sans compter Joli-Cœur, qui ne mangeait pas de gros morceaux, cela ne nous donnait qu’une demi-livre pour chacun de nous, mais c’était trop pour ma bourse.
Le pain était alors à cinq sous la livre, et, si j’en prenais deux livres, elles me coûteraient dix sous, de sorte que sur mes onze sous il ne m’en resterait qu’un seul.
Or, je ne trouvais pas prudent de me laisser entraîner à une aussi grande prodigalité avant d’avoir mon lendemain assuré. En n’achetant qu’une livre et demie de pain qui me coûtait sept sous et trois centimes, il me restait pour le lendemain trois sous et deux centimes, c’est-à-dire assez pour ne pas mourir de faim et attendre une occasion de gagner quelque argent.
J’eus vite fait ce calcul et je dis à la boulangère, d’un air que je tâchai de rendre assuré, que j’avais bien assez d’une livre et demie de pain et que je la priais de ne pas m’en couper davantage.
«C’est bon, c’est bon,» répondit-elle.
Et, autour d’un beau pain de six livres que nous aurions bien certainement mangé tout entier, elle me coupa la quantité que je demandais et la mit dans la balance, à laquelle elle donna un petit coup.
«C’est un peu fort, dit-elle, cela sera pour les deux centimes.»
Et elle fit tomber mes huit sous dans son tiroir.
J’ai vu des gens repousser les centimes qu’on leur rendait, disant qu’ils n’en sauraient que faire; moi, je n’aurais pas repoussé ceux qui m’étaient dus; cependant je n’osai pas les réclamer et sortis sans rien dire, avec mon pain étroitement serré sous mon bras.
Les chiens, joyeux, sautaient autour de moi, et Joli-Cœur me tirait les cheveux en poussant ces petits cris.
Nous n’allâmes pas bien loin.
Au premier arbre qui se trouva sur la route, je posai ma harpe contre son tronc et m’allongeai sur l’herbe; les chiens s’assirent en face de moi, Capi au milieu, Dolce d’un côté, Zerbino de l’autre; quant à Joli-Cœur, qui n’était pas fatigué, il resta debout pour être tout prêt à voler les morceaux qui lui conviendraient.
C’était une affaire délicate que le découpage de ma miche; j’en fis cinq parts aussi égales que possible, et, pour qu’il n’y eût pas de pain gaspillé, je les distribuai en petites tranches; chacun avait son morceau à son tour, comme si nous avions mangé à la gamelle.
Joli-Cœur, qui avait besoin de moins de nourriture que nous, se trouva le mieux partagé, et il n’eut plus faim alors que nous étions encore affamés. Sur sa part je pris trois morceaux que je serrai dans mon sac pour les donner aux chiens plus tard; puis, comme il en restait encore quatre, nous en eûmes chacun un; ce fut à la fois notre plat de supplément et notre dessert.
Bien que ce festin n’eût rien de ceux qui provoquent aux discours, le moment me parut venu d’adresser quelques paroles à mes camarades. Je me considerais naturellement comme leur chef, mais je ne me croyais pas assez au-dessus d’eux pour être dispensé de leur faire part des circonstances graves dans lesquelles nous nous trouvions.
Capi avait sans doute deviné mon intention, car il tenait collés sur les miens ses grands yeux intelligents et affectueux.
«Oui, mon ami Capi, dis-je, oui, mes amis Dolce, Zerbino et Joli-Cœur, oui, mes chers camarades, j’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer: notre maître est éloigné de nous pour deux mois.
— Ouah! cria Capi.
— Cela est bien triste pour lui d’abord, et aussi pour nous. C’était lui qui nous faisait vivre, et en son absence nous allons nous trouver dans une terrible situation. Nous n’avons pas d’argent.»
Sur ce mot, qu’il connaissait parfaitement, Capi se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à marcher en rond comme s’il faisait la quête dans les «rangs de l’honorable société.»
«Tu veux que nous donnions des représentations, continuai-je, c’est assurément un bon conseil, mais ferons-nous recette? Tout est là. Si nous ne réussissons pas, je vous préviens que nous n’avons que trois sous pour toute fortune. Il faudra donc se serrer le ventre. Les choses étant ainsi, j’ose espérer que vous comprendrez la gravité des circonstances, et qu’au lieu de me jouer de mauvais tours vous mettrez votre intelligence au service de la société. Je vous demande de l’obéissance, de la sobriété et du courage. Serrons nos rangs, et comptez sur moi comme je compte sur vous-mêmes. »
Je n’ose pas affirmer que mes camarades comprirent toutes les beautés de mon discours improvisé, mais certainement ils en sentirent les idées générales. Ils savaient par l’absence de notre maître qu’il se passait quelque chose de grave, et ils attendaient de moi une explication. S’ils ne comprirent pas tout ce que je leur dis, ils furent au moins satisfaits de mon procédé à leur égard, et ils me prouvèrent leur contentement par leur attention.
Quand je dis leur attention, je parle des chiens seulement, car, pour Joli-Cœur, il lui était impossible de tenir son esprit longtemps fixé sur un même sujet. Pendant la première partie de mon discours, il m’avait écouté avec les marques du plus vif intérêt; mais, au bout d’une vingtaine de mots, il s’était élancé sur l’arbre qui nous couvrait de son feuillage, et il s’amusait maintenant à se balancer en sautant de branche en branche. Si Capi m’avait fait une pareille injure, j’en aurais certes été blessé, mais de Joli-Cœur rien ne m’étonnait. Ce n’était qu’un étourdi, une cervelle creuse; et puis, après tout, il était bien naturel qu’il eût envie de s’amuser un peu.
J’avoue que j’en aurais fait volontiers autant et que comme lui je me serais balancé avec plaisir; mais l’importance et la dignité de mes fonctions ne me permettaient plus de semblables distractions.
Après quelques instants de repos, je donnai le signal du départ; il nous fallait gagner notre coucher, en tout cas notre déjeuner du lendemain, si, comme cela était probable, nous faisions l’économie de coucher en plein air.
Au bout d’une heure de marche à peu près, nous arrivâmes en vue d’un village qui me parut propre à la réalisation de mon dessein.
De loin il s’annonçait comme assez misérable, et la recette ne pouvait être par conséquent que bien chétive, mais il n’y avait pas là de quoi me décourager; je n’étais pas exigeant sur le chiffre de la recette, et je me disais que, plus le village était petit, moins nous avions de chance de rencontrer des agents de police.
Je fis donc la toilette de mes comédiens, et, en aussi bel ordre que possible, nous entrâmes dans ce village; malheureusement le fifre de Vitalis nous manquait et aussi sa prestance qui, comme celle d’un tambour-major, attirait toujours les regards. Je n’avais pas comme lui l’avantage d’une grande taille et d’une tête expressive; bien petite au contraire était ma taille, bien mince, et sur mon visage devait se montrer plus d’inquiétude que d’assurance.
Tout en marchant je regardais à droite et à gauche pour voir l’effet que nous produisions; il était médiocre, on levait la tête, puis on la rabaissait, personne ne nous suivait.
Arrivés sur une petite place au milieu de laquelle se trouvait une fontaine ombragée par des platanes, je pris ma harpe et commençai à jouer une valse. La musique était gaie, mes doigts étaient légers, mais mon cœur était chagrin, et il me semblait que je portais sur mes épaules un poids bien lourd.
Je dis à Zerbino et à Dolce de valser; ils m’obéirent aussitôt et se mirent à tourner en mesure.
Mais personne ne se dérangea pour venir nous regarder, et cependant sur le seuil des portes je voyais des femmes qui tricotaient ou qui causaient.
Je continuai de jouer; Zerbino et Dolce continuèrent de valser.
Peut-être quelqu’un se déciderait-il à s’approcher de nous; s’il venait une personne, il en viendrait une seconde, puis dix, puis vingt autres.
Mais j’avais beau jouer, Zerbino et Dolce avaient beau tourner, les gens restaient chez eux; ils ne regardaient même plus de notre côté.
C’était à désespérer.
Cependant je ne désespérais pas et jouais avec plus de force, faisant sonner les cordes de ma harpe à les casser.
Tout à coup un petit enfant, si petit qu’il s’essayait, je crois bien, à ses premiers pas, quitta le seuil de sa maison et se dirigea vers nous.
Sa mère allait le suivre sans doute, puis, après la mère, arriverait une amie, nous aurions notre public, et nous aurions ensuite une recette.
Je jouai moins fort pour ne pas effrayer l’enfant et pour l’attirer plutôt.
Les mains dressées, se balançant sur ses hanches, il s’avança doucement.
Il venait, il arrivait; encore quelques pas, et il était près de nous.
La mère leva la tête, surprise sans doute et inquiète de ne pas le sentir près d’elle.
Elle l’aperçut aussitôt. Mais alors, au lieu de courir après lui comme je l’avais espéré, elle se contenta de l’appeler, et l’enfant docile retourna près d’elle.
Peut-être ces gens n’aimaient-ils pas la danse. Après tout, c’était possible.
Je commandai à Zerbino et à Dolce de se coucher et me mis à chanter ma canzonetta; et jamais bien certainement je ne m’y appliquai avec plus de zèle:
Fenesta vascia e patrona crudele,
Quanta sospire m’aje fatto jettare.
J’entamais la deuxième strophe quand je vis un homme vêtu d’une veste et coiffé d’un feutre se diriger vers nous.
Enfin!
Je chantai avec plus d’entraînement.
«Holà ! cria-t-il, que fais-tu ici, mauvais garnement?»
Je m’interrompis, stupéfié par cette interpellation, et restai à le regarder venir vers moi, bouche ouverte
«Eh bien, répondras-tu? dit-il.
— Vous voyez, monsieur, je chante.
— As-tu une permission pour chanter sur la place de notre commune?
— Non, monsieur.
— Alors va-t en, si tu ne veux pas que je te fasse un procès.
— Mais, monsieur.
— Appelle-moi monsieur le garde champêtre, et tourne les talons, mauvais mendiant!»
Un garde champêtre! Je savais par l’exemple de mon maître ce qu’il en coûtait de vouloir se révolter contre les sergents de ville et les gardes champêtres.
Je ne me fis pas répéter cet ordre deux fois; je tournai sur mes talons comme il m’avait ordonné, et rapidement je repris le chemin par lequel j’étais venu.
Mendiant! cela n’était pas juste cependant. Je n’avais pas mendié : j’avais chanté, j’avais dansé, ce qui était ma manière de travailler; quel mal avais-je fait?
En cinq minutes je sortis de cette commune peu hospitalière, mais bien gardée.
Mes chiens me suivaient la tête basse et la mine attristée, comprenant assurément qu’il venait de nous arriver une mauvaise aventure.
Capi, de temps en temps, me dépassait et, se tournant vers moi, il me regardait curieusement avec ses yeux intelligents. Tout autre à sa place m’eût interrogé ; mais Capi était un chien trop bien élevé, trop bien discipliné pour se permettre une question indiscrète; il se contentait seulement de manifester sa curiosité, et je voyais ses mâchoires trembler, agitées par l’effort qu’il faisait pour retenir ses aboiements.
Lorsque nous fûmes assez éloignés pour n’avoir plus à craindre la brutale arrivée du garde champêtre, je fis un signe de la main, et immédiatement les trois chiens formèrent le cercle autour de moi, Capi au milieu, immobile, les yeux sur les miens.
Le moment était venu de leur donner l’explication qu’ils attendaient.
«Comme nous n’avons pas de permission pour jouer, dis-je, on nous renvoie.
— Et alors? demanda Capi d’un coup de tête.
— Alors nous allons coucher à la belle étoile, n’importe où, sans souper.»
Au mot souper, il y eut un grognement général.
Je montrai mes trois sous.
«Vous savez que c’est tout ce qui nous reste; si nous dépensons nos trois sous ce soir, nous n’aurons rien pour déjeuner demain; or, comme nous avons mangé aujourd’hui, je trouve qu’il est sage de penser au lendemain.»
Et je remis mes trois sous dans ma poche.
Capi et Dolce baissèrent la tête avec résignation; mais Zerbino, qui n’avait pas toujours bon caractère et qui de plus était gourmand, continua de gronder.
Après l’avoir regardé sévèrement sans pouvoir le faire taire, je me tournai vers Capi:
«Explique à Zerbino, lui dis-je, ce qu’il paraît ne pas vouloir comprendre; il faut nous priver d’un second repas aujourd’hui, si nous voulons en faire un seul demain.»
Aussitôt Capi donna un coup de patte à son camarade, et une discussion parut s’engager entre eux.
Qu’on ne trouve pas le mot «discussion» impropre parce qu’il est appliqué à deux bêtes. Il est bien certain, en effet, que les bêtes ont un langage particulier à chaque espèce. Si vous avez habité une maison aux corniches ou aux fenêtres de laquelle les hirondelles suspendent leurs nids, vous êtes assurément convaincu que ces oiseaux ne sifflent pas simplement un petit air de musique, alors qu’au jour naissant elles jacassent si vivement entre elles; ce sont de vrais discours qu’elles tiennent, des affaires sérieuses qu’elles agitent, ou des paroles de tendresse qu’elles échangent. Et les fourmis d’une même tribu, lorsqu’elles se rencontrent dans un sentier et se frottent antennes contre antennes, que croyez-vous qu’elles fassent, si vous n’admettez pas qu’elles se communiquent ce qui les intéresse? Quant aux chiens, non seulement ils savent parler, mais encore ils savent lire: voyez-les le nez en l’air, ou bien la tête basse flairant le sol, sentant les cailloux et les buissons; tout à coup ils s’arrêtent devant une touffe d’herbe ou une muraille et ils restent là un moment; nous ne voyons rien sur cette muraille, tandis que le chien y lit toutes sortes de choses curieuses, écrites dans un caractère mystérieux que nous ne voyons même pas.
Ce que Capi dit à Zerbino, je ne l’entendis pas, car, si les chiens comprennent le langage des hommes, les hommes ne comprennent pas le langage des chiens; je vis seulement que Zerbino refusait d’entendre raison et qu’il insistait pour dépenser immédiatement les trois sous; il fallut que Capi se fâchât, et ce fut seulement quand il eut montré ses crocs que Zerbino, qui n’était pas très brave, se résigna au silence.
La question du souper étant ainsi réglée, il ne restait plus que celle du coucher.
Heureusement le temps était beau, la journée était chaude, et coucher à la belle étoile en cette saison n’était pas bien grave; il fallait s’installer seulement de manière à échapper aux loups, s’il y en avait dans le pays, et ce qui me paraissait beaucoup plus dangereux, aux gardes champêtres, les hommes étant encore plus à craindre pour nous.
Il n’y avait donc qu’à marcher droit devant soi sur la route blanche jusqu’à la rencontre d’un gîte.
Ce que nous fîmes.
La route s’allongea, les kilomètres succédèrent aux kilomètres, et les dernières lueurs roses du soleil couchant avaient disparu du ciel que nous n’avions pas encore trouvé ce gîte.
Il fallait, tant bien que mal, se décider.
Quand je me décidai à nous arrêter pour passer la nuit, nous étions dans un Lois que coupaient çà et là des espaces dénudés au milieu desquels se dressaient des blocs de granit. L’endroit était bien triste, bien désert, mais nous n’avions pas mieux à choisir, et je pensai qu’au milieu de ces blocs de granit nous pourrions trouver un abri contre la fraîcheur de la nuit. Je dis nous, en parlant de Joli-Cœur et de moi, car, pour les chiens, je n’étais pas en peine d’eux; il n’y avait pas à craindre qu’ils gagnassent la fièvre à coucher dehors. Mais, pour moi, je devais être soigneux, car j’avais conscience de ma responsabilité. Que deviendrait ma troupe, si je tombais malade? que deviendrais-je moi-même, si j’avais Joli-Cœur à soigner?
Quittant la route, nous nous engageâmes au milieu des pierres, et bientôt j’aperçus un énorme bloc de granit planté de travers de manière à former une sorte de cavité à sa base et un toit à son sommet. Dans cette cavité les vents avaient amoncelé un lit épais d’aiguilles de pin desséchées. Nous ne pouvions mieux trouver: un matelas pour nous étendre, une toiture pour nous abriter; il ne nous manquait qu’un morceau de pain pour souper; mais il fallait tâcher de ne pas penser à cela; d’ailleurs le proverbe n’a-t-il pas dit: «Qui dort dîne?»
Avant de dormir, j’expliquai à Capi que je comptais sur lui pour nous garder, et la bonne bêle, au lieu devenir avec nous se coucher sur les aiguilles de pin, resta en dehors de notre abri, postée en sentinelle. Je pouvais être tranquille, je savais que personne ne nous approcherait sans que j’en fusse prévenu.
Cependant, bien que rassuré sur ce point, je ne m’endormis pas aussitôt que je me fus étendu sur les aiguilles de pin, Joli-Cœur enveloppé près de moi dans ma veste, Zerbino et Dolce couchés en rond à mes pieds, mon inquiétude étant plus grande encore que ma fatigue.
La journée, cette première journée de voyage, avait été mauvaise; que serait celle du lendemain? J’avais faim, j’avais soif, et il ne me restait que trois sous. J’avais beau les manier machinalement dans ma poche, ils n’augmentaient pas: un, deux, trois, je m’arrêtais toujours à ce chiffre.
Comment nourrir ma troupe, comment me nourrir moi-même, si je ne trouvais pas le lendemain et les jours suivants à donner des représentations? Des muselières, une permission pour chanter, où voulait-on que j’en eusse? Faudrait-il donc tous mourir de faim au coin d’un bois, sous un buisson?
Et, tout en agitant ces tristes questions, je regardais les étoiles qui brillaient au-dessus de ma tête dans le ciel sombre. Il ne faisait pas un souffle de vent. Partout le silence, pas un bruissement de feuilles, pas un cri d’oiseau, pas un roulement de voiture sur la route; aussi loin que ma vue pouvait s’étendre dans les profondeurs bleuâtres, le vide. Comme nous étions seuls, abandonnés!
Je sentis mes yeux s’emplir de larmes, puis tout à coup je me mis à pleurer: pauvre mère Barberin! pauvre Vitalis!
Je m’étais couché sur le ventre, et je pleurais dans mes deux mains sans pouvoir m’arrêter quand je sentis un souffle tiède passer dans mes cheveux; vivement je me retournai, et une grande langue douce et chaude se colla sur mon visage. C’était Capi, qui m’avait entendu pleurer et qui venait me consoler, comme il était déjà venu à mon secours lors de ma première nuit de voyage.
Je le pris par le cou à deux bras et j’embrassai son museau humide; alors il poussa deux ou trois gémissements étouffés, et il me sembla qu’il pleurait avec moi.
Quand je me réveillai, il faisait grand jour, et Capi, assis devant moi, me regardait; les oiseaux sifflaient dans le feuillage; au loin, tout au loin, une cloche sonnait l’Angelus; le soleil, déjà haut dans le ciel, lançait des rayons chauds et réconfortants, aussi bien pour le cœur que pour le corps.
Notre toilette matinale fut bien vite faite, et nous nous mîmes en route, nous dirigeant du côté d’où venaient les tintements de la loche; là était un village, là sans doute était un boulanger; quand on s’est couché sans dîner et sans souper, la faim parle de bonne heure.
Mon parti était pris: je dépenserais mes trois sous, et après nous verrions.
En arrivant dans le village, je n’eus pas besoin de demander où était la boulangerie; notre nez nous guida sûrement vers elle; j’eus l’odorat presque aussi fin que celui de mes chiens pour sentir de loin la bonne odeur du pain chaud.
Trois sous de pain quand il coûte cinq sous la livre ne nous donnèrent à chacun qu’un bien petit morceau, et notre déjeuner fut rapidement terminé.
Le moment était donc venu de voir, c’est-à-dire d’aviser aux moyens de faire une recette dans la journée. Pour cela je me mis à parcourir le village en cherchant la place la plus favorable à une représentation, et aussi en examinant la physionomie des gens pour tâcher de deviner s’ils nous seraient amis ou ennemis.
Mon intention n’était pas de donner immédiatement cette représentation, car l’heure n’était pas convenable, mais d’étudier le pays, de faire choix du meilleur emplacement, et de revenir dans le milieu de la journée, sur cet emplacement, tenter la chance.
J’étais absorbé par cette idée, quand tout à coup j’entendis crier derrière moi; je me retournai vivement et je vis arriver Zerbino poursuivi par une vieille femme. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre ce qui provoquait cette poursuite et ces cris: profitant de ma distraction, Zerbino m’avait abandonné, et il était entré dans une maison où il avait volé un morceau de viande qu’il emportait dans sa gueule.
«Au voleur! criait la vieille femme, arrêtez-le, arrêtez-les tous!»
En entendant ces derniers mots, me sentant coupable, ou tout au moins responsable de la faute de mon chien, je me mis à courir aussi. Que répondre, si la vieille femme me demandait le prix du morceau de viande volé ? Comment le payer? Une fois arrêtés, ne nous garderait-on pas?
Me voyant fuir, Capi et Dolce ne restèrent pas en arrière, et je les sentis sur mes talons, tandis que Joli-Cœur que je portais sur mon épaule m empoignait par le cou pour ne pas tomber.
Il n’y avait guère à craindre qu’on nous attrapât en nous rejoignant, mais on pouvait nous arrêter au passage, et justement il me sembla que telle était l’intention de deux ou trois personnes qui barraient la route. Heureusement une ruelle transversale venait déboucher sur la route avant ce groupe d’adversaires. Je me jetai dedans accompagné des chiens, et, toujours courant à toutes jambes, nous fûmes bientôt en pleine campagne. Je m’arrêtai lorsque la respiration commença à me manquer, c’est-à-dire après avoir fait au moins deux kilomètres. Alors je me retournai, osant regarder en arrière; personne ne nous suivait; Capi et Dolce étaient toujours sur mes talons, Zerbino arrivait tout au loin, s’étant arrêté sans doute pour manger son morceau de viande.
Je l’appelai; mais Zerbino, qui savait qu’il avait mérité une sévère correction, s’arrêta, puis, au lieu de venir à moi, il se sauva.
C’était poussé par la faim que Zerbino avait volé ce morceau de viande. Mais je ne pouvais pas accepter cette raison comme une excuse. Il y avait vol. Il fallait que le coupable fût puni, ou bien c’en était fait de la discipline dans ma troupe; au prochain village, Dolce imiterait son camarade, et Capi lui-même finirait par succomber à la tentation.
Je devais donc administrer une correction publique à Zerbino. Mais pour cela il fallait qu’il voulût bien comparaître devant moi, et ce n’était pas chose facile que de le décider.
J’eus recours à Capi.
«Va me chercher Zerbino.»
Et il partit aussitôt pour accomplir la mission que je lui confiais. Cependant il me sembla qu’il acceptait ce rôle avec moins de zèle que de coutume, et dans le regard qu’il me jeta avant de partir je crus voir qu’il se ferait plus volontiers l’avocat de Zerbino que mon gendarme.
Je n’avais plus qu’à attendre le retour de Capi et de son prisonnier, ce qui pouvait être assez long, car Zerbino, très probablement, ne se laisserait pas ramener tout de suite. Mais il n’y avait rien de bien désagréable pour moi dans cette attente. J’étais assez loin du village pour n’avoir guère à craindre qu’on me poursuivît. Et d’un autre côté, j’étais assez fatigué de ma course pour désirer me reposer un moment. D’ailleurs à quoi bon me presser, puisque je ne savais pas où aller et que je n’avais rien à faire?
Justement l’endroit où je m’étais arrêté était fait à souhait pour l’attente et le repos. Sans savoir où j’allais dans ma course folle, j’étais arrivé sur les bords du canal du Midi, et, après avoir traversé des campagnes poussiéreuses depuis mon départ de Toulouse, je me trouvais dans un pays vert et frais: des eaux, des arbres, de l’herbe, une petite source coulant à travers les fentes d’un rocher tapissé de plantes qui tombaient en cascades fleuries suivant le cours de l’eau; c’était charmant, et j’étais là à merveille pour attendre le retour des chiens.
Une heure s’écoula sans que je les visse revenir ni l’un ni l’autre, et je commençais à m’inquiéter, quand Capi reparut seul, la tête basse.
«Où est Zerbino?»
Capi se coucha dans une attitude craintive; alors, en le regardant, je m’aperçus qu’une de ses oreilles était ensanglantée.
Je n’eus pas besoin d’explication pour comprendre ce qui s’était passé : Zerbino s’était révolté contre la gendarmerie, il avait fait résistance, et Capi, qui peut-être n’obéissait qu’à regret à un ordre qu’il considérait comme bien sévère, s’était laissé battre.
Fallait-il le gronder et le corriger aussi? Je n’en eus pas le courage, je n’étais pas en disposition de peiner les autres, étant déjà bien assez affligé de mon propre chagrin.
L’expédition de Capi n’ayant pas réussi, il ne me restait qu’une ressource, qui était d’attendre que Zerbino voulût bien revenir; je le connaissais, après un premier mouvement de révolte, il se résignerait à subir sa punition, et je le verrais apparaître repentant.
Je m’étendis sous un arbre, tenant Joli-Cœur attaché, de peur qu’il ne lui prît fantaisie de rejoindre Zerbino; Capi et Dolce s’étaient couchés à mes pieds.
Le temps s’écoula, Zerbino ne parut pas; insensiblement le sommeil me prit et je m’endormis.
Quand je m’éveillai le soleil était au-dessus de ma tête, et les heures avaient marché. Mais je n’avais plus besoin du soleil pour me dire qu’il était tard, mon estomac me criait qu’il y avait longtemps que j’avais mangé mon morceau de pain. De leur côté les deux chiens et Joli-Cœur me montraient aussi qu’ils avaient faim, Capi et Dolce avec des mines piteuses, Joli-Cœur avec des grimaces.
Et Zerbino n’apparaissait toujours pas.
Je l’appelai, je le sifflai; mais tout fut inutile, il ne parut pas; ayant bien déjeuné, il digérait tranquillement, blotti sous quelque buisson.
Ma situation devenait critique: si je m’en allais, il pouvait très bien se perdre et ne pas nous rejoindre; si je restais, je ne trouvais pas l’occasion de gagner quelques sous et de manger.
Et précisément le besoin de manger devenait de plus en plus impérieux. Les yeux des chiens s’attachaient sur les miens désespérément, et Joli-Cœur se brossait le ventre en poussant des petits cris de colère.
Le temps s’écoulant et Zerbino ne venant pas, j’envoyai une fois encore Capi à la recherche de son camarade; mais, au bout d’une demi-heure, il revint seul et me fit comprendre qu’il ne l’avait pas trouvé.
Que faire?
Bien que Zerbino fût coupable et nous eût mis tous par sa faute encore dans une terrible situation, je ne pouvais pas avoir l’idée de l’abandonner. Que dirait mon maître, si je ne lui ramenais pas ses trois chiens? Et puis, malgré tout, je l’aimais, ce coquin de Zerbino.
Je résolus donc d’attendre jusqu’au soir; mais il était impossible de rester ainsi dans l’inaction à écouter notre estomac crier la faim, car ses cris étaient d’autant plus douloureux qu’ils étaient seuls à se faire entendre, sans aucune distraction aussi bien que sans relâche.
Il fallait inventer quelque chose qui pût nous occuper tous les quatre et nous distraire.
Si nous pouvions oublier que nous avions faim, nous aurions assurément moins faim pendant ces heures d’oubli.
Mais à quoi nous occuper?
Comme j’examinais cette question, je me souvins que Vitalis m’avait dit qu’à la guerre, quand un régiment était fatigué par une longue marche, on faisait jouer la musique, si bien qu’en entendant des airs gais ou entraînants les soldats oubliaient leurs fatigues.
Si je jouais un air gai, peut-être oublierions-nous tous notre faim; en tout cas, étant occupé à jouer et les chiens à danser avec Joli-Cœur, le temps passerait plus vile pour nous.
Je pris ma harpe, qui était posée contre un arbre, et, tournant le dos au canal, après avoir mis mes comédiens en position, je commençai à jouer un air de danse, puis, après, une valse.
Tout d’abord mes acteurs ne semblaient pas très disposés à la danse; il était évident que le morceau de pain eût bien mieux fait leur affaire; mais peu à peu ils s’animèrent, la musique produisit son effet obligé, nous oubliâmes tous le morceau de pain que nous n’avions pas et nous ne pensâmes plus, moi qu’à jouer, eux qu’à danser.
Tout à coup j’entendis une voix claire, une voix d’enfant crier:
«Bravo!» Celle voix venait de derrière moi. Je me retournai vivement.
Un bateau était arrêté sur le canal, l’avant tourné vers la rive sur laquelle je me trouvais; les deux chevaux qui le remorquaient avaient fait halte sur la rive opposée.
C’était un singulier bateau, et tel que je n’en avais pas encore vu de pareil: il était beaucoup plus court que les péniches qui servent ordinairement à la navigation sur les canaux, et au-dessus de son pont peu élevé au-dessus de l’eau était construite une sorte de galerie vitrée. A l’avant de cette galerie se trouvait une vérandah ombragée par des plantes grimpantes, dont le feuillage, accroché çà et là aux découpures du toit, retombait par places en cascades vertes; sous cette vérandah j’aperçus deux personnes: une dame jeune encore, à l’air noble et mélancolique, qui se tenait debout, et un enfant, un garçon à peu près de mon âge, qui me parut couché.
C’était cet enfant sans doute qui avait crié «bravo.»
Remis de ma surprise, car cette apparition n’avait rien d’effrayant, je soulevai mon chapeau pour remercier celui qui m’avait applaudi.
JE PRIS MA HARPE... (PAGE 110.)
«C’est pour votre plaisir que vous jouez? me demanda la dame, parlant avec un accent étranger.
— C’est pour faire travailler mes comédiens et aussi... pour me distraire.»
L’enfant fit un signe, et la dame se pencha vers lui.
«Voulez-vous jouer encore?» me demanda la dame en relevant la tète.
Si je voulais jouer! Jouer pour un public qui m’arrivait si à propos! Je ne me fis pas prier.
«Voulez-vous une danse ou une comédie? dis-je.
— Oh! une comédie!» s’écria l’enfant.
Mais la dame interrompit pour dire qu’elle préférait une danse.
«La danse, c’est trop court, s’écria l’enfant.
— Après la danse, nous pourrons, si l’honorable société le désire, représenter différents tours, «tels qu’ils se font dans les cirques de Paris.»
C’était une phrase de mon maître, je tachai de la débiter comme lui avec noblesse. En réfléchissant, j’étais bien aise qu’on eût refusé la comédie, car j’aurais été assez embarrassé pour organiser la représentation, d’abord parce que Zerbino me manquait et aussi parce que je n’avais pas les costumes et les accessoires nécessaires.
Je repris donc ma harpe et je commençai à jouer une valse; aussitôt Capi entoura la taille de Dolce avec ses deux pattes, et ils se mirent à tourner en mesure. Puis Joli-Cœur dansa un pas seul. Puis successivement nous passâmes en revue tout notre répertoire. Nous ne sentions pas la fatigue. Quant à mes comédiens, ils avaient assurément compris qu’un dîner serait le payement de leurs peines, et ils ne s’épargnaient pas plus que je ne m’épargnais moi-même.
Tout à coup, au milieu d’un de mes exercices, je vis Zerbino sortir d’un buisson, et, quand ses camarades passèrent près de lui, il se plaça effrontément au milieu d’eux et prit son rôle.
Tout en jouant et en surveillant mes comédiens, je regardais de temps en temps le jeune garçon, et, chose étrange, bien qu’il parût prendre grand plaisir à nos exercices, il ne bougeait pas; il restait couché, allongé, dans une immobilité complète, ne remuant que les deux mains pour nous applaudir.
Était il paralysé ? il semblait qu’il était attaché sur une planche.
Insensiblement le vent avait poussé le bateau contre la berge sur laquelle je me trouvais, et je voyais maintenant l’enfant comme si j’avais été sur le bateau même et près de lui: il était blond de cheveux, son visage était pâle, si pâle qu’on voyait les veines bleues de son front sous sa peau transparente; son expression était la douceur et la tristesse, avec quelque chose de maladif.
«Combien faites vous payer les places à votre théâtre? me demanda la dame.
— On paye selon le plaisir qu’on a éprouvé.
— Alors, maman, il faut payer très cher,» dit l’enfant.
Puis il ajouta quelques paroles dans une langue que je ne comprenais pas.
«Arthur voudrait voir vos acteurs de plus près,» me dit la darne.
Je fis un signe à Capi qui, prenant son élan, sauta dans le bateau.
«Et les autres?» cria Arthur.
Zerbino et Dolce suivirent leur camarade.
«Et le singe!»
Joli-Cœur aurait facilement fait le saut, mais je n’étais jamais sûr de lui; une fois à bord, il pouvait se livrer à des plaisanteries qui n’auraient peut-être pas été du goût de la dame.
«Est-il méchant? demanda-t-elle.
— Non, madame, mais il n’est pas toujours obéissant, et j’ai peur qu’il ne se conduise pas convenablement.
— Eh bien! embarquez avec lui.»
Disant cela, elle fit signe à un homme qui se tenait à l’arrière auprès du gouvernail, et aussitôt cet homme, passant à l’avant, jeta une planche sur la berge.
C’était un pont. Il me permit d’embarquer sans risquer le saut périlleux, et j’entrai dans le bateau gravement, ma harpe sur l’épaule et Joli-Cœur dans ma main.
«Le singe! le singe!» s’écria Arthur.
Je m’approchai de l’enfant, et, tandis qu’il flattait et caressait Joli-Cœur, je pus l’examiner à loisir.
Chose surprenante! il était bien véritablement attaché sur une planche, comme je l’avais cru tout d’abord.
«Vous avez un père, n’est-ce pas, mon enfant? me demanda la dame.
— Oui, mais je suis seul en ce moment.
— Pour longtemps?
— Pour deux mois.
— Deux mois! Oh! mon pauvre petit! comment, seul ainsi pour si longtemps, à votre âge!
— Il le faut bien, madame!
— Votre maître vous oblige sans doute à lui rapporter une somme d’argent au bout de ces deux mois?
— Non, madame; il ne m’oblige à rien. Pourvu que je trouve à vivre avec ma troupe, cela suffit.
— Et vous avez trouvé à vivre jusqu’à ce jour?»
J’hésitai avant de répondre; je n’avais jamais vu une dame qui m’inspirât un sentiment de respect comme celle qui m’interrogeait. Cependant elle me parlait avec tant de bonté, sa voix était si douce, son regard était si affable, si encourageant, que je me décidai à dire la vérité. D’ailleurs, pourquoi me taire?
Je lui racontai donc comment j’avais dû me séparer de Vitalis, condamné à la prison pour m’avoir défendu, et comment, depuis que j’avais quitté Toulouse, je n’avais pas pu gagner un sou.
Pendant que je parlais, Arthur jouait avec les chiens; mais cependant il écoutait et entendait ce que je disais.
«Comme vous devez tous avoir faim!» s’écria-t-il.
A ce mot, qu’ils connaissaient bien, les chiens se mirent à aboyer, et Joli-Cœur se frotta le ventre avec frénésie.
«Oh! maman,» dit Arthur.
La dame comprit cet appel; elle dit quelques mots en langue étrangère à une femme qui montrait sa tête dans une porte entre-bâillée, et presque aussitôt cette femme apporta une petite table servie.
«Asseyez-vous, mon enfant,» me dit la dame.
Je ne me fis pas prier, je posai ma harpe et m’assis vivement devant la table; les chiens se rangèrent aussitôt autour de moi, et Joli-Cœur prit place sur mon genou.
«Vos chiens mangent-ils du pain?» me demanda Arthur.
S’ils mangeaient du pain! Je leur en donnai à chacun un morceau qu’ils dévorèrent.
«Et le singe?» dit Arthur.
Mais il n’y avait pas besoin de s’occuper de Joli-Cœur, car, tandis que je servais les chiens, il s’était emparé d’un morceau de croûte de pâté avec lequel il était en train de s’étouffer sous la table.
A mon tour, je pris une tranche de pain, et, si je ne m’étouffai pas comme Joli-Cœur, je dévorai au moins aussi gloutonnement que lui.
«Pauvre enfant!» disait la dame en emplissant mon verre.
Quanta Arthur, il ne disait rien; mais il nous regardait, les yeux écarquillés, émerveillé assurément de notre appétit, car nous étions aussi voraces les uns que les autres, même Zerbino, qui cependant avait dû se rassasier jusqu’à un certain point avec la viande qu’il avait volée.
«Et où auriez-vous diné ce soir, si nous ne nous étions pas rencontrés? demanda Arthur.
— Je crois bien que nous n’aurions pas dîné.
— Et demain, où dînerez-vous?
— Peut-être demain aurons-nous la chance de faire une bonne rencontre comme aujourd’hui.»
Sans continuer de s’entretenir avec moi, Arthur se tourna vers sa mère, et une longue conversation s’engagea entre eux dans la langue étrangère que j’avais déjà entendue; il paraissait demander une chose qu’elle n’était pas disposée à accorder ou tout au moins contre laquelle elle soulevait des objections.
Tout à coup il tourna de nouveau sa tête vers moi, car son corps ne bougeait pas.
«Voulez-vous rester avec nous?» dit-il.
Je le regardai sans répondre, tant cette question me prit à l’improviste.
«Mon fils vous demande si vous voulez rester avec nous.
— Sur ce bateau!
-- Oui, sur ce bateau; mon fils est malade, les médecins ont ordonné de le tenir attaché sur une planche, ainsi que vous le voyez. Pour qu’il ne s’ennuie pas, je le promène dans ce bateau. Vous demeurerez avec nous. Vos chiens et votre singe donneront des représentations pour Arthur, qui sera leur public. Et vous, si vous le voulez bien, mon enfant, vous nous jouerez de la harpe. Ainsi vous nous rendrez service, et nous de notre côté nous vous serons peut-être utiles. Vous n’aurez point chaque jour à trouver un public, ce qui, pour un enfant de votre âge, n’est pas toujours très facile.»
En bateau! Je n’avais jamais été en bateau, et ç’avait été mon grand désir. J’allais vivre en bateau, sur l’eau, quel bonheur!
Ce fut la première pensée qui frappa mon esprit et l’éblouit. Quel rêve!
Quelques secondes de réflexion me firent sentir tout ce qu’il y avait d’heureux pour moi dans cette proposition, et combien était généreuse celle qui me l’adressait.
Je pris la main de la dame et la baisai.
Elle parut sensible à ce témoignage de reconnaissance, et affectueusement, presque tendrement, elle me passa à plusieurs reprises la main sur le front.
«Pauvre petit!» dit-elle.
Puisqu’on me demandait de jouer de la harpe, il me sembla que je ne devais pas différer de me rendre au désir qu’on me montrait; l’empressement était jusqu’à un certain point une manière de prouver ma bonne volonté en même temps que ma reconnaissance.
Je pris mon instrument et j’allai me placer tout à l’avant du bateau, puis je commençai à jouer.
En même temps la dame approcha de ses lèvres un petit sifflet en argent et elle en tira un son aigu.
Je cessai de jouer aussitôt, me demandant pourquoi elle sifflait ainsi: était-ce pour me dire que je jouais mal ou pour me faire taire?
Arthur, qui voyait tout ce qui se passait autour de lui, devina mon inquiétude.
«Maman a sifflé pour que les chevaux se remettent en marche,» dit-il.
En effet, le bateau, qui s’était éloigné de la berge, commençait à filer sur les eaux tranquilles du canal, entraîné par les chevaux; l’eau clapotait contre la carène, et de chaque côté les arbres fuyaient derrière nous, éclairés par les rayons obliques du soleil couchant
«Voulez-vous jouer?» demanda Arthur.
Et d’un signe de tête, appelant sa mère auprès de lui, il lui prit la main et la garda dans les siennes pendant tout le temps que je jouai les divers morceaux que mon maître m’avait appris.