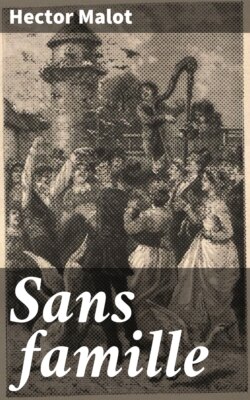Читать книгу Sans famille - Hector Malot - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MON PREMIER AMI
ОглавлениеLa mère d’Arthur était Anglaise, elle se nommait Mme Milligan. Elle était veuve, et je croyais qu’Arthur était son seul enfant; —mais j’appris bientôt qu’elle avait eu un fils aîné, disparu dans des conditions mystérieuses. Jamais on n’avait pu retrouver ses traces. Au moment où cela était arrivé, M. Milligan était mourant, et Mme Milligan, très gravement malade, ne savait rien de ce qui se passait autour d’elle. Quand elle était revenue à la vie, son mari était mort et son fils avait disparu. Les recherches avaient été dirigées par M. James Milligan, son beau-frère. Mais il y avait cela de particulier dans ce choix, que M. James Milligan avait un intérêt opposé à celui de sa belle-sœur. En effet, son frère mort sans enfants, il devenait l’héritier de celui-ci.
Cependant M. James Milligan n’hérita point de son frère, car, sept mois après la mort de son mari, Mme Milligan mit au monde un enfant, qui était le petit Arthur.
Mais cet enfant, chétif et maladif, ne pouvait pas vivre, disaient les médecins; il devait mourir d’un moment à l’autre, et ce jour-là M. James Milligan devenait enfin l’héritier du titre et de la fortune de son frère aîné, car les lois de l’héritagene sont pas les mêmes dans tous les pays, et, en Angleterre, elles permettent, dans certaines circonstances, que ce soit un oncle qui hérite au détriment d’une mère.
Les espérances de M. James Milligan se trouvèrent donc retardées par la naissance de son neveu; elles ne furent pas détruites; il n’avait qu’à attendre.
Il attendit.
Mais les prédictions des médecins ne se réalisèrent point. Arthur resta maladif; il ne mourut pourtant pas, ainsi qu’il avait été décidé ; les soins de sa mère le firent vivre; c’est un miracle qui, Dieu merci! se répète assez souvent.
Vingt fois on le crut perdu, vingt fois il fut sauvé ; successivement, quelquefois même ensemble, il avait eu toutes les maladies qui peuvent s’abattre sur les enfants.
En ces derniers temps s’était déclaré un mal terrible qu’on appelle coxalgie, et dont le siège est dans la hanche. Pour ce mal on avait ordonné les eaux sulfureuses, et Mme Milligan était venue dans les Pyrénées. Mais, après avoir essayé des eaux inutilement, on avait conseillé un autre traitement qui consistait à tenir le malade allongé, sans qu’il pût mettre le pied à terre.
C’est alors que Mme Milligan avait fait construire à Bordeaux le bateau sur lequel je m’étais embarqué.
Elle ne pouvait pas penser à laisser son fils enfermé dans une maison, il y serait mort d’ennui ou de privation d’air; Arthur ne pouvant plus marcher, la maison qu’il habiterait devait marcher pour lui.
On avait transformé un bateau en maison flottante avec chambre, cuisine, salon et vérandah. C’était dans ce salon ou sous cette vérandah, selon les temps, qu’Arthur se tenait du matin au soir, avec sa mère à ses côtés, et les paysages défilaient devant lui, sans qu’il eût d’autre peine que d’ouvrir les yeux.
Ils étaient partis de Bordeaux depuis un mois, et, après avoir remonté la Garonne, ils étaient entrés dans le canal du Midi; par ce canal, ils devaient gagner les étangs et les canaux qui longent la Méditerranée, remonter ensuite le Rhône, puis la Saône, passer de cette rivière dans la Loire jusqu’à Briare, prendre là le canal de ce nom, arriver dans la Seine et suivre le cours de ce fleuve jusqu’à Rouen, où ils s’embarqueraient sur un grand navire pour rentrer en Angleterre.
Le jour de mon arrivée, je fis seulement connaissance de la chambre que je devais occuper dans le bateau qui s’appelait le Cygne. Rien qu’elle fût toute petite, cette chambre, deux mètres de long sur un mètre à peu près de large, c’était la plus charmante cabine, la plus étonnante que puisse rêver une imagination enfantine.
Le mobilier qui la garnissait consistait en une seule commode; mais cette commode ressemblait à la bouteille inépuisable des physiciens qui renferme tant de choses. Au lieu d’être fixe, la tablette supérieure était mobile, et, quand on la relevait, on trouvait sous elle un lit complet, matelas, oreiller, couverture. Bien entendu, il n’était pas très large ce lit; cependant il était assez grand pour qu’on y fût très bien couché. Sous ce lit était un tiroir garni de tous les objets nécessaires à la toilette. Et sous ce tiroir s’en trouvait un autre divisé en plusieurs compartiments, dans lesquels on pouvait ranger le linge et les vêtements. Point de tables, point de sièges, au moins dans la forme habituelle, mais contre la cloison, du côté de la tête du lit, une planchette qui, en s’abaissant, formait table, et du côté des pieds, une autre qui formait chaise.
Un petit hublot percé dans le bordage, et qu’on pouvait fermer avec un verre rond, servait à éclairer et à aérer cette chambre.
Jamais je n’avais rien vu de si joli, ni de si propre; tout était revêtu de boiseries en sapin verni, et sur le plancher était étendue une toile cirée à carreaux noirs et blancs.
Mais ce n’étaient pas seulement les yeux qui étaient charmés.
Quand, après m’être déshabillé, je m’étendis dans le lit, j’éprouvai un sentiment de bien-être tout nouveau pour moi; c’était la première fois que des draps me flattaient la peau, au lieu de me la gratter. Chez mère Barberin, je couchais dans des draps de toile de chanvre raides et rugueux; avec Vitalis, nous couchions bien souvent sans draps sur la paille ou sur le foin, et, quand on nous en donnait, dans les auberges, mieux aurait valu, presque toujours, une bonne litière. Comme ils étaient fins ceux dans lesquels je m’en veloppais! comme ils étaient doux, comme ils sentaient bon! et le matelas, comme il était plus moelleux que les aiguilles de pin sur lesquelles j’avais couché la veille! Le silence de la nuit n’était plus inquiétant, l’ombre n’était plus peuplée, et les étoiles que je regardais par le hublot ne me disaient plus que des paroles d’encouragement et d’espérance.
Si bien couché que je fusse dans ce bon lit, je me levai dès le point du jour, car j’avais l’inquiétude de savoir comment mes comédiens avaient passé la nuit.
Je trouvai tout mon monde à la place où je l’avais installé la veille et dormant comme si ce bateau eût été leur habitation depuis plusieurs mois. A mon approche, les chiens s’éveillèrent et vinrent joyeusement me demander leur caresse du matin. Seul, Joli-Cœur, bien qu’il eût un œil à demi ouvert, ne bougea pas, mais il se mit à ronfler comme un trombone.
Il n’y avait pas besoin d’un grand effort d’esprit pour comprendre ce que cela signifiait: M. Joli-Cœur, qui était la susceptibilité en personne, se fâchait avec une extrême facilité, et, une fois fâché, il boudait longtemps. Dans les circonstances présentes, il était peiné que je ne l’eusse pas emmené dans ma chambre, et il me témoignait son mécontentement par ce sommeil simulé.
Je ne pouvais pas lui expliquer les raisons qui m’avaient obligé, à mon grand regret, à le laisser sur le pont, et, comme je sentais que j’avais, du moins en apparence, des torts envers lui, je le pris dans mes bras, pour lui témoigner mes regrets par quelques caresses.
Tout d’abord il persista dans sa bouderie, mais bientôt, avec sa mobilité d’humeur, il pensa à autre chose, et par sa pantomime il m’expliqua que, si je voulais aller me promener avec lui à terre, il me pardonnerait peut-être.
Le marinier que j’avais vu la veille au gouvernail était déjà levé et il s’occupait à nettoyer le pont; il voulut bien mettre la planche à terre et je pus descendre dans la prairie avec ma troupe.
En jouant avec les chiens et avec Joli-Cœur, en courant, en sautant les fosses, en grimpant aux arbres, le temps passe vite; quand nous revînmes, les chevaux étaient attelés au bateau et attachés à un peuplier sur le chemin de halage: ils n’attendaient qu’un coup de fouet pour partir.
J’embarquai vite; quelques minutes après, l’amarre qui retenait le bateau à la rive fut larguée, le marinier prit place au gouvernail, le haleur enfourcha son cheval, la poulie dans laquelle passait la remorque grinça; nous étions en route.
Quel plaisir que le voyage en bateau! Les chevaux trottaient sur le chemin de halage, et, sans que nous sentissions un mouvement, nous glissions légèrement sur l’eau; les deux rives boisées fuyaient derrière nous, et l’on n’entendait d’autre bruit que celui du remous contre la carène, dont le clapotement se mêlait à la sonnerie des grelots que les chevaux portaient à leur cou.
Nous allions, et, penché sur le bordage, je regardais les peupliers qui, les racines dans l’herbe fraîche, se dressaient fièrement, agitant dans l’air tranquille du matin leurs feuilles toujours émues; leur longue file alignée selon la rive formait un épais rideau vert qui arrêtait les rayons obliques du soleil, et ne laissait venir à nous qu’une douce lumière tamisée par le branchage.
De place en place l’eau se montrait toute noire, comme si elle recouvrait des abîmes insondables; ailleurs, au contraire, elle s’étalait en nappes transparentes qui laissaient voir des cailloux lustrés et des herbes veloutées.
J’étais absorbé dans ma contemplation, lorsque j’entendis prononcer mon nom derrière moi.
Je me retournai vivement: c’était Arthur qu’on apportait sur sa planche; sa mère était près de lui.
«Vous avez bien dormi? me demanda Arthur, mieux que dans les champs?»
Je m’approchai et répondis en cherchant des paroles polies que j’adressai à la mère tout autant qu’à l’enfant.
«Et les chiens?» dit-il.
Je les appelai, ainsi que Joli-Cœur; ils arrivèrent en saluant et Joli-Cœur en faisant des grimaces, comme lorsqu’il prévoyait que nous allions donner une représentation
Mais il ne fut pas question de représentation, ce matin-là.
Mme Milligan avait installé son fils à l’abri des rayons du soleil, et elle s’était placée près de lui.
«Voulez-vous emmener les chiens et le singe? me dit-elle, nous avons à travailler.»
Je fis ce qui m’était demandé, et je m’en allai avec ma troupe, tout à l’avant.
A quel travail ce pauvre petit malade était-il donc propre?
Je vis que sa mère lui faisait répéter une leçon, dont elle suivait le texte dans un livre ouvert.
Etendu sur sa planche, Arthur répétait sans faire un mouvement.
Ou, plus justement, il essayait de répéter, car il hésitait terriblement, et ne disait pas trois mots couramment; encore bien souvent se trompait-il.
Sa mère le reprenait avec douceur, mais en même temps avec fermeté.
«Vous ne savez pas votre fable,» dit-elle.
Cela me parut étrange de l’entendre dire vous à son fils, car je ne savais pas alors que les Anglais ne se servent pas du tutoiement.
«Oh! maman, dit-il d’une voix désolée.
— Vous faites plus de fautes aujourd’hui que vous n’en faisiez hier.
— J’ai tâché d’apprendre.
— Et vous n’avez pas appris.
— Je n’ai pas pu.
— Pourquoi?
— Je ne sais pas.... parce que je n’ai pas pu... Je suis malade.
— Vous n’êtes pas malade de la tête; je ne consentirai jamais à ce que vous n’appreniez rien, et que, sous prétexte de maladie, vous grandissiez dans l’ignorance.»
Elle me paraissait bien sévère, Mme Milligan, et cependant elle parlait sans colère et d’une voix tendre.
«Pourquoi me désolez-vous en n’apprenant pas vos leçons?
— Je ne peux pas, maman, je vous assure que je ne peux pas.»
Et Arthur se prit à pleurer.
Mais Mme Milligan ne se laissa pas ébranler par ses larmes, bien qu’elle parût touchée et même désolée, comme elle avait dit.
«J’aurais voulu vous laisser jouer ce matin avec Rémi et avec les chiens, continua-t-elle, mais vous ne jouerez que quand vous m’aurez répété votre fable sans faute.»
Disant cela, elle donna le livre à Arthur et fit quelques pas, comme pour rentrer dans l’intérieur du bateau, laissant son fils couché sur sa planche.
Il pleurait à sanglots, et de ma place j’entendais sa voix entrecoupée.
Comment Mme Milligan pouvait-elle être sévère avec ce pauvre petit, qu’elle paraissait aimer si tendrement? S’il ne pouvait pas apprendre sa leçon, ce n’était pas sa faute, c’était celle de la maladie sans doute.
Elle allait donc disparaître sans lui dire une bonne parole.
Mais elle ne disparut pas; au lieu d’entrer dans le bateau, elle revint vers son fils.
«Voulez-vous que nous essayions de l’apprendre ensemble? dit-elle
— Oh! oui, maman, ensemble.»
Alors elle s’assit près de lui, et, reprenant le livre, elle commença à lire doucement la fable, qui s’appelait: le Loup et le jeune Mouton; après elle, Arthur répétait les mots et les phrases.
Lorsqu’elle eut lu cette fable trois fois, elle donna le livre à Arthur, en lui disant d’apprendre maintenant tout seul, et elle rentra dans le bateau.
Aussitôt Arthur se mit à lire sa fable, et, de ma place où j’étais resté, je le vis remuer les lèvres.
Il était évident qu’il travaillait et qu’il s’appliquait.
Mais cette application ne dura pas longtemps; bientôt il leva les yeux de dessus son livre, et ses lèvres remuèrent moins vite, puis tout à coup elles s’arrêtèrent complètement.
Il ne lisait plus, et ne répétait plus.
Ses yeux, qui erraient çà et là, rencontrèrent les miens.
De la main je lui fis un signe pour l’engager à revenir à sa leçon.
Il me sourit doucement comme pour me dire qu’il me remerciait de mon avertissement, et ses yeux se fixèrent de nouveau sur son livre.
Mais bientôt ils se relevèrent et allèrent d’une rive à l’autre du canal.
Comme ils ne regardaient pas de mon côté, je me levai, et, ayant ainsi provoqué son attention, je lui montrai son livre.
Il le reprit d’un air confus.
Malheureusement, deux minutes après, un martin-pêcheur, rapide comme une flèche, traversa le canal à l’avant du bateau, laissant derrière lui un rayon bleu.
Arthur souleva la tête pour le suivre.
Puis, quand la vision fut évanouie, il me regarda.
Alors m’adressant la parole:
«Je ne peux pas, dit-il, et cependant je voudrais bien.»
Je m’approchai.
«Cette fable n’est pourtant pas bien difficile, lui dis-je.
— Oh! si, bien difficile, au contraire.
— Elle m’a paru très-facile; et en écoutant votre maman la lire, il me semble que je l’ai retenue.»
Il se mit à sourire d’un air de doute.
«Voulez-vous que je vous la dise?
— Pourquoi, puisque c’est impossible?
— Mais non, ce n’est pas impossible; voulez-vous que j’essaye? prenez le livre.»
Il reprit le livre et je commençai à réciter; il n’eut à me reprendre que trois ou quatre fois.
«Comment, vous la savez! s’écria-t-il.
— Pas très-bien, mais maintenant je crois que je la dirais sans faute.
— Comment avez-vous fait pour l’apprendre?
— J’ai écouté votre maman la lire, mais je l’ai écoutée avec attention, sans regarder ce qui se passait autour de nous.»
Il rougit et détourna les yeux; puis, après un court moment de honte:
«Je comprends comment vous avez écouté, dit-il, et je tâcherai d’écouter comme vous; mais comment avez-vous fait pour retenir tous ces mots qui se brouillent dans ma mémoire?»
Comment j’avais fait? Je ne savais trop, car je n’avais pas réfléchi à cela; cependant je tâchai de lui expliquer ce qu’il me demandait en m’en rendant compte moi-même.
«De quoi s’agit-il dans cette fable? dis-je. D’un mouton. Je commence donc à penser à des moutons. Ensuite je pense à ce qu’ils font: «Des moutons étaient en sûreté dans leur parc.» Je vois les moutons couchés et dormant dans leur parc, puisqu’ils sont en sûreté, et, les ayant vus, je ne les oublie plus.
— Bon, dit-il, je les vois aussi: «Des moutons étaient en sûreté dans leur parc.» J’en vois des blancs et des noirs, je vois des brebis et des agneaux. Je vois même le parc; il est fait de claies.
— Alors vous ne l’oublierez plus?
— Oh! non.
— Ordinairement, qui est-ce qui garde les moutons?
— Des chiens.
— Quand ils n’ont pas besoin de garder les moutons, parce que ceux-ci sont en sûreté, que font les chiens?
— Ils n’ont rien à faire.
— Alors ils peuvent dormir; nous disons donc: «Les chiens dormaient.»
— C’est cela, c’est bien facile.
— N’est-ce pas que c’est très facile? Maintenant, pensons à autre chose. Avec les chiens, qui est-ce qui garde les moutons?
— Un berger.
— Si les moutons sont en sûreté, le berger n’a rien à faire; à quoi peut-il employer son temps?
— A jouer de la flûte.
— Le voyez-vous?
— Oui.
— Où est-il?
— A l’ombre d’un grand ormeau.
— Il est seul?
— Non, il est avec d’autres bergers voisins.
— Alors, si vous voyez les moutons, le parc, les chiens et le berger, est-ce que vous ne pouvez pas répéter sans faute le commencement de votre fable?
— Il me semble
— Essayez.»
En m’entendant parler ainsi et lui expliquer comment il pouvait être facile d’apprendre une leçon qui tout d’abord paraissait difficile, Arthur me regarda avec émotion et avec crainte, comme s’il n’était pas convaincu de la vérité de ce que je lui disais; cependant, après quelques secondes d’hésitation, il se décida.
«Des moutons étaient en sûreté dans leur parc, les chiens dormaient, et le berger, à l’ombre d’un grand ormeau, jouait de la fiûte avec d’autres bergers voisins.»
Alors frappant ses mains l’une contre l’autre:
«Mais je sais! s’écria-t-il, je n’ai pas fait de faute.
— Voulez-vous apprendre le reste de la fable de la même manière?
— Oui, avec vous je suis sûr que je vais l’apprendre. Ah! comme maman sera contente!»
Et il se mit à apprendre le reste de la fable, comme il avait appris sa première phrase.
En moins d’un quart d’heure il la sut parfaitement, et il était en train de la répéter sans faute lorsque sa mère survint derrière nous.
Tout d’abord elle se fâcha de nous voir réunis, car elle crut que nous n’étions ensemble que pour jouer; mais Arthur ne lui laissa pas dire deux paroles.
«Je la sais, s’écria-t-il, et c’est lui qui me l’a apprise.»
Mme Milligan me regardait toute surprise, et elle allait sûrement m’interroger, quand Arthur se mit, sans qu’elle le lui demandât, à répéter le Loup et le jeune Mouton. Il le fit d’un air de triomphe et de joie, sans hésitation et sans faute.
Pendant ce temps, je regardais Mme Milligan. Je vis son beau visage s’éclairer d’un sourire, puis il me sembla que ses yeux se mouillèrent; mais, comme à ce moment elle se pencha sur son fils pour l’embrasser tendrement en l’entourant de ses deux bras, je ne sais pas si elle pleurait.
«Les mots, disait Arthur, c’est bête, ça ne signifie rien, mais les choses, on les voit, et Rémi m’a fait voir le berger avec sa flûte; quand je levais les yeux en apprenant, je ne pensais plus à ce qui m’entourait, je voyais la flûte du berger et j’entendais l’air qu’il jouait. Voulez-vous que je vous chante l’air, maman?»
Et il chanta en anglais une chanson mélancolique.
Cette fois Mme Milligan pleurait pour tout de bon, et quand elle se releva, je vis ses larmes sur les joues de son enfant. Alors elle s’approcha de moi et, me prenant la main, elle me la serra si doucement que je me sentis tout ému:
«Vous êtes un bon garçon,» me dit-elle.
Si j’ai raconté tout au long ce petit incident, c’est pour faire comprendre le changement qui, à partir de ce jour-là, se fit dans ma position. La veille on m’avait pris comme montreur de bêtes pour amuser, moi, mes chiens et mon singe, un enfant malade; mais cette leçon me sépara des chiens et du singe, je devins un camarade, presque un ami.
Il faut dire aussi, tout de suite, ce que je ne sus que plus tard, c’est que Mme Milligan était désolée de voir que son fils n’apprenait rien, ou, plus justement, ne pouvait rien apprendre. Bien qu’il fût malade, elle voulait qu’il travaillât, et précisément parce que cette maladie devait être longue, elle voulait, dès maintenant, donner à son esprit des habitudes qui lui permissent de réparer le temps perdu, le jour où la guérison serait venue.
Jusque-là, elle avait fort mal réussi. Si Arthur n’était point rétif au travail, il l’était absolument à l’attention et à l’application. Il prenait sans résistance le livre qu’on lui mettait aux mains, il ouvrait même assez volontiers ses mains pour le recevoir, mais son esprit, il ne l’ouvrait pas, et c’était mécaniquement, comme une machine, qu’il répétait tant bien que mal, et plutôt mal que bien, les mots qu’on lui faisait entrer de force dans la tête.
De là un vif chagrin chez sa mère, qui désespérait de lui.
De là aussi une vive satisfaction lorsqu’elle lui entendit répéter une fable apprise avec moi en une demi-heure, qu’elle-même n’avait pas pu, en plusieurs jours, lui mettre dans la mémoire.
Quand je pense maintenant aux jours passés sur ce bateau, auprès de Mme Milligan et d’Arthur, je trouve que ce sont les meilleurs de mon enfance.
Arthur s’était pris pour moi d’une ardente amitié, et, de mon côté, je me laissais aller sans réfléchir et sous l’influence de la sympathie à le regarder comme un frère: pas une querelle entre nous; chez lui pas la moindre marque de la supériorité que lui donnait sa position, et chez moi pas le plus léger embarras; je n’avais même pas conscience que je pouvais être embarrassé.
Cela tenait sans doute à mon âge et à mon ignorance des choses de la vie; mais assurément cela tenait beaucoup encore à la délicatesse et à la bonté de Mme Milligan, qui bien souvent me parlait comme si j’avais été son enfant.
Et puis ce voyage en bateau était pour moi un émerveillement; pas une heure d’ennui ou de fatigue; du matin au soir, toutes nos heures remplies.
Depuis la construction des chemins de fer, on ne visite plus, on ne connaît même plus le canal du Midi, et cependant c’est une des curiosités de la France.
De Villefranche de Lauraguais nous avions été à Avignonnet, et d’Avignonnet aux pierres de Naurouse où s’élève le monument érigé à la gloire de Riquet, le constructeur du canal, à l’endroit même où se trouve la ligne de faîte entre les rivières qui vont se jeter dans l’Océan et celles qui descendent à la Méditerranée.
Puis nous avions traversé Castelnaudary, la ville des moulins, Carcassonne, la cité du moyen âge, et par l’écluse de Fouserannes, si curieuse avec ses huit sas accolés, nous étions descendus à Béziers.
Quand le pays était intéressant, nous ne faisions que quelques lieues dans la journée; quand au contraire il était monotone, nous allions plus vite.
C’était la route elle-même qui décidait notre marche et notre départ. Aucune des préoccupations ordinaires aux voyageurs ne nous gênait; nous n’avions pas à faire de longues étapes pour gagner une auberge où nous serions certains de trouver à dîner et à coucher.
A heure fixe, nos repas étaient servis sous la vérandah; et, tout en mangeant, nous suivions tranquillement le spectacle mouvant des deux rives.
Quand le soleil s’abaissait, nous nous arrêtions où l’ombre nous surprenait, et nous restions là jusqu’à ce que la lumière reparût.
Toujours chez nous, dans notre maison, nous ne connaissions point les heures désœuvrées du soir, si longues et si tristes bien souvent pour le voyageur.
Ces heures du soir, tout au contraire, étaient pour nous souvent trop courtes, et le moment du coucher nous surprenait alors que nous ne pensions guère à dormir.
Le bateau arrêté, s’il faisait frais, on s’enfermait dans le salon, et, après avoir allumé un feu doux, pour chasser l’humidité ou le brouillard, qui étaient mauvais pour le malade, on apportait les lampes; on installait Arthur devant la table; je m’asseyais près de lui, et Mme Milligan nous montrait des livres d’images ou des vues photographiques. De même que le bateau qui nous portait avait été construit pour cette navigation spéciale, de même les livres et les vues avaient été choisis pour ce voyage. Quand nos yeux commençaient à se fatiguer, elle ouvrait un de ces livres et nous lisait les passages qui devaient nous intéresser et que nous pouvions comprendre; ou bien, fermant livres et albums, elle nous racontait les légendes, les faits historiques se rapportant aux pays que nous venions de traverser. Elle parlait les yeux attachés sur ceux de son fils, et c’était chose touchante de voir la peine qu’elle se donnait pour n’exprimer que des idées, pour n’employer que des mots qui pussent être facilement compris.
Pour moi, quand les soirées étaient belles, j’avais aussi un rôle actif; alors je prenais ma harpe et, descendant à terre, j’allais à une certaine distance me placer derrière un arbre qui me cachait dans son ombre, et là je chantais toutes les chansons, je jouais tous les airs que je savais. Pour Arthur, c’était un grand plaisir que d’entendre ainsi de la musique dans le calme de la nuit, sans voir celui qui la faisait; souvent il me criait: «Encore!» et je recommençais l’air que je venais de jouer.
C’était, la une vie douce et heureuse pour un enfant qui, comme moi, n’avait quitté la chaumière de mère Barberin que pour suivre sur les grandes routes le signor Vitalis.
Quelle différence entre le plat de pommes de terre au sel de ma pauvre nourrice et les bonnes tartes aux fruits, les gelées, les crèmes, les pâtisseries de la cuisinière de Mme Milligan!
Quel contraste entre les longues marches à pied, dans la boue, sous la pluie, par un soleil de feu, derrière mon maître, et cette promenade en bateau!
Mais, pour être juste envers moi-même, je dois dire que j’étais encore plus sensible au bonheur moral que je trouvais dans cette vie nouvelle qu’aux jouissances matérielles qu’elle me donnait.
Oui, elles étaient bien bonnes, les pâtisseries de Mme Milligan; oui, il était agréable de ne plus souffrir de la faim, du chaud ou du froid; mais combien plus que tout cela étaient bons et agréables pour mon cœur les sentiments qui l’emplissaient!
Deux fois j’avais vu se briser ou se dénouer les liens qui m’attachaient à ceux que j’aimais: la première, lorsque j’avais été arraché d’auprès de mère Barberin; la seconde, lorsque j’avais été séparé de Vitalis; et ainsi deux fois je m’étais trouvé seul au monde, sans appui, sans soutien, n’ayant d’autres amis que mes bêtes.
Et voilà que, dans mon isolement et dans ma détresse, j’avais trouvé quelqu’un qui m’avait témoigné de la tendresse, et que j’avais pu aimer: une femme, une belle dame, douce, affable et tendre, un enfant de mon âge qui me traitait comme si j’avais été son frère.
Quelle joie, quel bonheur pour un cœur qui, comme le mien, avait tant besoin d’aimer!
Combien de fois, en regardant Arthur couché sur sa planche, pâle et dolent, je me prenais à envier son bonheur, moi, plein de santé et de force!
Ce n’était pas le bien-être qui l’entourait que j’enviais, ce n’étaient pas ses livres, ses jouets luxueux, ce n’était pas son bateau, c’était l’amour que sa mère lui témoignait.
Comme il devait être heureux d’être ainsi aimé, d’être ainsi embrassé dix fois, vingt fois par jour, et de pouvoir lui-même embrasser de tout son cœur cette belle dame, sa mère, dont j’osais à peine toucher la main lorsqu’elle me la tendait!
Et alors je me disais tristement que, moi, je n’aurais jamais une mère qui m’embrasserait et que j’embraserais. Peut-être un jour je reverrais mère Barberin, et ce me serait une grande joie, mais enfin je ne pourrais plus maintenant lui dire comme autrefois:
«Maman,» puisqu’elle n’était pas ma mère.
Seul, je serais toujours seul!
Aussi cette pensée me faisait-elle goûter avec plus d’intensité la joie que j’éprouvais à me sentir traiter tendrement par Mme Milligan et Arthur.
Je ne devais pas me montrer trop exigeant pour ma part de bonheur en ce monde, et, puisque je n’aurais jamais ni mère, ni frère, ni famille, je devais me trouver heureux d’avoir des amis.
Je devais être heureux et en réalité je l’étais pleinement.
Cependant, si douces que me parussent ces nouvelles habitudes, il me fallut bientôt les interrompre pour revenir aux anciennes.