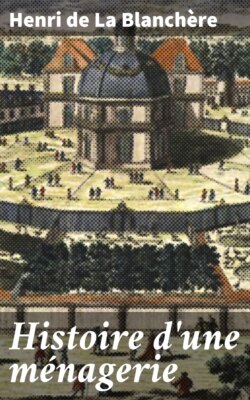Читать книгу Histoire d'une ménagerie - Henri de La Blanchère - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DUR-A-CUIRE
Оглавление— Mes enfants...
— Ah! mais non! glapit le singe.
— Taisez-vous, fit l’ours.
— Paix là ! cria le cacatoès.
— Mes enfants, reprit le lion en posant sa grosse tête sur ses pattes étendues devant lui, taisez-vous d’abord, si vous voulez que je parle, et laissez-moi vous dire que je pourrais, pour donner plus d’intérêt à mon récit, me faire prier longtemps, ainsi que cela se pratique quelquefois; mais ma loyauté bien connue ignore ces moyens mesquins de captiver une attention à laquelle j’ai droit... Contre le droit pas de résistance! Or donc, écoutez-moi sans bouger. Chers compagnons d’infortune, j’ai ouï dire que mes ancêtres ont toujours habité sur la limite du grand désert africain qu’on appelle le Sahara. Je ne vous dépeindrai point les splendeurs de ma patrie, ni la tendresse de ma mère en mon jeune âge. Tous, nous avons passé par là, et je ne me refuse pas à croire que les mères des simples citoyens aiment autant leurs enfants que les mères des rois chérissent l’espoir de leur race.
Tout au plus vous décrirai-je mon berceau. Figurez-vous un amas de roches géantes et crevassées, enguirlandées et couronnées de broussailles tellement épaisses, que le soleil était impuissant à les traverser. Le lion seul s’en trouvait capable! Par suite de l’admirable position que mon honorée mère avait su choisir, notre demeure était à portée en même temps de la nature sauvage et des bienfaits de la civilisation.
Quand mes yeux se tournaient vers le midi je voyais le désert vaste, immense, s’étendant à mes pieds comme une mer sans limite, avec ses vagues de sable roulant devant le simoun. Au loin ondulaient les palmiers de quelques fraîches oasis, îlots de verdure semés sur ce sol calciné, tandis qu’aux alentours passaient, avec précaution, des troupes de gazelles, quelques girafes, des autruches et, de temps en temps, passaient de longues caravanes ondulant comme d’interminables serpents noirs au soleil. J’avais sous les yeux le désert, notre royaume à nous, lions. Là, nous commandons et nous régnons sans partage, car l’homme, notre ennemi et quelquefois notre maître, ne saurait vivre sur le sol aride, brûlé, infertile, où, même quand il se réunit en grand nombre, il ne peut passer qu’en courant.
Si je regardais vers le nord, au contraire, devant moi s’étendaient les terres habitées par l’homme. Je dominais des plaines et des collines verdoyantes où les tribus arabes campaient et laissaient paître leurs troupeaux.
Puisqu’il faut vous parler net, mes chers compagnons, je n’ai nul souvenir des premiers temps de ma vie; mais tout me fait croire qu’ils furent heureux. J’avais une sœur jumelle et nous demeurions constamment sous l’œil vigilant de notre mère, qui passait une partie de la journée à nous lécher avec amour. Vous me permettrez, mes amis, d’attribuer à ces soins constants la beauté de mon manteau; tout le monde l’admire.
— Vantard! dit tout bas le tigre en jetant un regard sur ses flancs fauves rayés de noir... Peuh!... Encore si tu parlais du mien!
— Le premier incident dont j’aie conservé la mémoire n’est point vulgaire et montre bien la vaillance du sang dont nous sommes issus. Mon noble père, désireux de partager les soins et les fatigues de la reine notre mère, avait, depuis notre tendre enfance, abandonné ses courses lointaines et s’était fait le pourvoyeur attentif de la famille. Infatigable, il partait chaque jour pour la chasse, seul, armé de son courage...
— Et de ses dents! sifflota Simius en gambadant.
— Chaque soir il rapportait une pièce choisie: antilope, mouton ou bœuf, qu’il déposait gravement aux pieds de ma mère pour notre souper commun.
Un jour cependant, obligé de nous quitter quelque temps afin de pousser une reconnaissance au fond du pays ennemi, mon père fut absent beaucoup plus que d’habitude, de sorte que la reine ma mère dut se déranger et pourvoir elle-même à notre subsistance commune, car nous mangions déjà la chair. La noble créature nous abandonnait donc chaque soir pendant quelques heures, confiante en l’obscurité et en l’isolement de son logis.
Une nuit, elle tardait à revenir; ma sœur et moi commencions à sentir les atteintes de la faim. Tout à coup un léger bruit s’élève au milieu des broussailles qui masquaient notre demeure.
— Mère, c’est vous? m’écriai-je en me levant joyeusement pour courir au-devant d’elle. Mais à peine eus-je fait quelques pas que je m’arrêtai pétrifié...
Ce n’était pas ma mère; c’était un animal presque aussi grand qu’elle, à la robe fauve couverte de taches noires, aux yeux brillants comme les nôtres, mais se glissant comme un serpent entre les lianes et me montrant des dents effroyables... Seigneurs, je l’ai appris, nous nous trouvions, ma sœur et moi, jeunes, isolés et sans armes, au pouvoir d’une panthère, notre plus mortel ennemi.
Sans comprendre la lâcheté qu’elle commettait en attaquant des innocents sans défense...
— Ah! joli! charmant! hurla Simius en se tordant au bout de sa corde.
— Paix là-haut! cria Gros-Pierre.
— Taisez-vous donc, gronda Martin l’ours, ou je monte...
— Montez, ô mon ami, répondit Simius; les chemins sont ouverts!
— Je reprends, continua le lion; sans défense...
— Hallo! papa la Moustache, et les agneaux que votre père apportait, où étaient leurs dents et leurs griffes?
— Ce n’est pas la même chose, pauvre ignorant. Les agneaux sont faits pour être mangés et les lions...
— Pour les manger!... Hallo! Tout est bien.
— Je condescends à ne pas vous répondre et à continuer. Le monstre me saisit par le cou; je sentis son étreinte mortelle et fermai les yeux, poussant un miaulement plaintif... 0 bonheur! un rugissement épouvantable répond à quelques pas, puis un autre plus près encore. C’est mon père qui revient au logis.
A la vue de notre défenseur, la panthère me laisse tomber de sa gueule et s’aplatit sur le sol, les yeux inquiets, fixés sur mon père qui se dressait devant elle comme le symbole du Châtiment. Toute fuite était impossible: il fallait combattre!... Je me relevai et me glissai aussi loin du danger que mes meurtrissures me le permettaient.
Après quelques secondes d’attente, les adversaires bondirent en même temps, et le choc fut si violent qu’ils roulèrent tous deux parmi les broussailles; mais alors commença le duel le plus terrible qu’on ait jamais vu. Étroitement enlacés l’un à l’autre, mon noble père et la panthère ne formaient qu’un groupe informe qui se tordait et roulait comme un tourbillon... Des rugissements formidables, semblables à des roulements de tonnerre, ébranlaient la montagne et nous glaçaient d’épouvante. Retirés au fond de notre gîte, nous attendions, tremblants comme la feuille, la fin de cette lutte gigantesque. Mais la panthère pouvait-elle résister au lion, au roi des animaux? Deux minutes plus tard, mon père se relevait vainqueur, mais couvert de blessures nombreuses... La panthère gisait à ses pieds, étranglée, la tête écrasée et le ventre tout grand ouvert par les griffes terribles de son ennemi.
Ma mère, qui avait entendu de loin le tumulte du combat, arrivait au grand galop et vint féliciter mon noble père de sa victoire en l’aidant à lécher ses plaies; puis, pour que la vengeance fût complète, nous mangeâmes en commun le corps de l’ennemi qui avait manqué me faire subir le même sort.
— Touchante réciprocité !... soupira Simius.
— Déjà toutes nos dents étaient poussées et nous accomplissions de longues marches à travers les gorges des montagnes.
— Mes enfants, nous dit un jour ma mère, vous voilà grands; il est temps de songer à votre éducation. A partir de cette nuit, vous m’accompagnerez à la chasse et votre père vous instruira.
Vous comprenez notre joie! Nous allions donc apprendre quel coup de dent étrangle le bœuf, quel coup de griffe arrête le cheval au galop!
Combien la journée nous parut longue!
A la nuit noire, le corps léger, le cœur content, nous partions guidés par mon noble père, qui se dirigeait au nord vers un campement d’Arabes, à quatre ou cinq lieues de notre demeure. Cet espace fut rapidement franchi. Vers minuit nous arrivions en vue des barrières élevées qui entouraient le douar.
— Écoutez-moi, mes enfants, dit à voix basse le lion; à cette heure, les gens et les troupeaux dorment en toute confiance; donc rien à craindre de ce côté ; mais les chiens veillent... Ils vont nous sentir tout à l’heure, et je vois déjà, à une certaine agitation dans l’enclos, qu’ils ont connaissance de notre présence. Hâtons-nous donc avant qu’ils puissent donner l’alarme; non pas que je craigne leurs maîtres; mais ma leçon serait incomplète pour vous.
— Comment faire? m’écriai-je.
— Je vais prendre les devants et me porter près de la barrière pour attirer l’attention des chiens. Pendant que ceux-ci perdront leur temps à aboyer après moi, vous franchirez la clôture du côté opposé, sous la conduite de votre mère, et vous ferez ce qu’elle vous montrera... Prudence et décision! allez!
Ce qui était dit fut fait. Pendant que mon père attirait les chiens d’un côté, nous arrivions de l’autre au pied de la barrière, qui pouvait bien avoir deux mètres et demi de hauteur.
— Attention, nous dit ma mère d’une voix douce; voici un premier obstacle qu’il faut franchir. Ce n’est pas difficile. Regardez!... On se ramasse sur soi-même... bien! on roidit ses jarrets, très bien!... puis, comme des ressorts brusquement détendus, ils vous lanceront de l’autre côté. Une fois dans la place, chacun de vous se jettera sur un animal à sa portée, lui posera une patte sur le dos, l’autre sur la tête, en appuyant de manière à bien dégager le cou... Vous saisissez alors la gorge dans votre gueule et vous étranglez la proie d’un coup de dent!... C’est fait! Nous sortirons alors de la même manière que nous sommes entrés. Il n’est pas défendu à celui qui s’en sentira capable de rapporter la proie qu’il aura tuée. Cependant, si vous n’êtes pas encore assez forts, ne vous entêtez pas. Je saurai bien, moi, rapporter de quoi souper... En avant et du courage!
Joignant l’exemple à la théorie, ma mère franchit la barrière d’un seul bond comme en sejouant. Ma sœur la suivit sans balancer. Mais quand vint mon tour, l’émotion inséparable d’un premier début paralysant une partie de mes moyens, je heurtai du pied le haut de la clôture et retombai lourdement sur le sol.
Au moment où je me relevais, étourdi plus encore par la honte que par la commotion de la chute, je sentis la patte de ma mère s’appesantir sur ma joue, en même temps que sa voix murmurait: «Maladroit!» Le regard qui accompagna celle exclamation me fit comprendre que, si elle en avait eu le loisir, ma mère m’aurait administré une de ces corrections qui gravent les conseils dans l’esprit et sur la peau. Mais le temps pressait; les troupeaux, effrayés de notre présence, commençaient à se débander; il fallait agir.
Ma mère, songeant au souper prochain, s’élança sur un gros bœuf et l’étrangla d’un coup de dent Ma sœur choisit, je crois, un mouton sur lequel elle bondit; mais elle sauta trop loin, passa pardessus la bête, et celle-ci échappa... Quant à moi, furieux de ma première maladresse, je résolus de faire un coup de maître. M’aplatissant le mieux possible, sur le sol, je calculai ma distance, et au moment où un jeune veau passait en fuyant, je tombai sur lui comme la foudre et l’étranglai d’un seul coup!
MA MÈRE FRANCHIT LA BARRIÈRE D’UN SEUL COUP.
— En retraite!... dit alors ma mère, les Arabes approchent le fusil au poing; vous n’êtes pas encore assez forts pour résister 1 Sautez les premiers!
Ma sœur passa; j’en fis autant, mais en tenant toujours mon veau entre les dents, et fus assez heureux pour franchir l’obstacle sans lâcher ma ’proie.
— C’est bien, petit! me dit ma mère. Tu rapportes notre souper à tous! Je suis contente de toi!
Mon père nous rejoignit et nous soupâmes tous avec bon appétit. Après quoi, le cœur content et la conscience nette, je m’endormis du sommeil du juste qui a bien employé son temps.
Le lendemain nous recommençâmes, et de même les jours suivants, tantôt dans les douars des environs, tantôt au désert, où mes parents nous apprirent à nous embusquer près des sources et à bondir, à l’improviste, sur les gazelles qui venaient y boire. Temps heureux de ma jeunesse, qu’êtes-vous devenus?
Depuis quelques semaines chacun de nous chassait de son côté, afin de nous mieux dissimuler aux regards de l’homme; mais nous nous retrouvions toujours au logis. Un jour que mon père rôdait dans les montagnes voisines, il entendit tout à coup, non loin de lui, des voix. C’étaient, comme je l’ai su depuis, des soldats français servant d’éclaireurs à une cinquantaine d’hommes envoyés par là pour rétablir l’ordre dans une tribu arabe qui menaçait de se soulever.
— Corne de gazelle! se dit mon père; mes enfants ont chassé et mangé à peu près toutes les espèces de gibier qu’on rencontre dans ce pays... Si je leur faisais goûter de l’homme? Essayons!
Tout en causant, les soldats se rapprochaient et mon père entendait déjà distinctement les paroles qu’ils prononçaient.
— Eh bien! fusilier Coquil...liard, disait l’un d’eux en émaillant ses paroles des cuirs les plus chers aux gens de guerre, quoi que vous dites du payllis?
— Je n’en dis rien, chargent, nonobstant qu’il est-z-un peu abandonné-z-au rapport des routes, comme dit le capitaine.
— Il est de fait que ça ne peut pas subsidiairement se comparer-z-aux chemins vicinaux de la Champagne. Mais, quoi que vous voulez, fusilier Coquilliard, on est chez les sauvages, ou on n’y est pas...
— Faites excuse, chargent Beautreillis, que je vous disais que je ne disais rien, mais que je pensais tout de même à quelque chose... Tel que vous me voyez, je réfléchis, comme dit le capitaine.
— Pas possible! et à quoi donc que vous réfléchissez, fusilier Coquilliard?
— Chargent, je pense que si ces pierrailles et ces ronces qui nous font vis-à-vis ne sont pas très commodes pour voyager-z-à pied, elles sont-z-excellentes pour servir de cachettes aux Arabes... qui ne nous veulent pas du bien, comme dit le capitaine.
— Que vous n’avez pas substantivement raison, fusilier Coquilliard; comme dit le sieur Dumanet, l’Arabe, il n’attaque jamais le troupier français! Rien qu’en voyant l’ombre de son pompon-z-il tourne le dos... Fusilier Coquilliard, est-ce que vous aureriez peur?... subsidiairement et conséquemment...
— Peur, chargent! La peur est un sentiment-z-inconnu au soldat français natif de la Champagne... comme dit le capitaine... Oh! la, la, la!... Saint Crépin, mon patron, au secours!
Tout en causant ainsi, les deux soldats étaient demeurés un peu en arrière; et c’était la présence imprévue de mon père, sortant de sa cachette, qui avait arraché ces exclamations au brave Coquilliard.
Abasourdis par la rencontre d’un lion en cet endroit, les deux soldats firent machinalement le salut militaire, comme des conscrits devant un supérieur. Mon noble père les regarda fixement pendant quelques secondes; puis, Coquilliard lui paraissant le plus gras, il s’élança sur lui, le terrassa, mais sans le tuer, car il tenait à nous apporter un homme vivant; puis, le saisissant par la cuisse et le rejetant sur son épaule, il revint à grands pas vers nous...
Le premier moment de stupeur passé, Beautreillis reprit un peu de sang-froid. Il mit un genou à terre, épaula son fusil et, au risque de tuer son ami Coquilliard, il fit feu... Heureusement la balle n’atteignit mon père que dans l’arrière-train, lui faisant une blessure sans gravité, mais qui gênait beaucoup ses mouvements.
Cependant Coquilliard, la cuisse à moitié broyée par les canines de mon père, s’était évanoui de douleur: d’autant mieux que mon père, blessé, serrait plus fort... Mais le grand air, le mouvement, les chocs qu’il recevait contre les arbres et les pierres le rappelèrent à lui-même et lui permirent de se rendre compte de sa position...
Ah! l’affreux piou-piou champenois!
Il faut le dire à sa louange, il était brave!
Au lieu de se résigner, il chercha dans sa cervelle le moyen d’échapper à mon noble père. 11 se souvint qu’il portait une paire de pistolets chargés à sa ceinture; il en saisit un, et, après des efforts inouïs, il parvint à l’appuyer contre l’oreille de mon père, et paff!... Puis il s’évanouit de nouveau.
Hélas! mes chers amis, cette fois mon père était mortellement blessé ; la balle lui avait traversé la tête! Le héros fit encore deux ou trois pas et tomba sans lâcher son ennemi...
Tout cela se passait non loin de nous. En deux bonds, nous fûmes auprès du roi du désert — ma mère, ma sœur et moi.
— Enfants, eut-il la force de nous dire en nous voyant, je le sens, je vais mourir...
Et il nous raconta ce qui venait de lui arriver.
— Vengeance!... m’écriai-je en me précipitant vers Coquilliard.
—Arrête, enfant! dit mon père. Garde-toi d’agir avec précipitation. Laisse cet affreux soldat revenir à la vie; il ne peut vous échapper, et votre vengeance sera plus complète et plus douce... Maintenant, adieu, mes enfants!... Souvenez-vous des leçons de votre père, ne dérogez pas à vos ancêtres, et puisse le ciel vous protéger!... Adieu!...
Une dernière convulsion roidit ses membres: il était mort.
Ma mère, ma sœur et moi nous nous assîmes en cercle autour de l’affreux Coquilliard toujours étendu le nez contre terre, épiant le moment où il reprendrait ses sens pour le déchirer à notre aise.
Il y avait bien dix minutes que nous étions dans cette position, lorsque tout à coup nous entendîmes un certain cliquetis parmi les rochers qui nous entouraient.
Ma mère se leva d’un bond, aspirant l’air, et monta sur un rocher pour reconnaître la cause de ces bruits inquiétants.
— Mes enfants, dit-elle, voilà l’ennemi; apprêtez-vous à combattre!
C’était en effet la patrouille française qui, rappelée par Beautreillis, avait suivi la piste de mon père et revenait vers nous pour venger la mort du Coquilliard endiablé.
— Écoutez mes instructions, nous dit rapidement ma mère. Bien des fois déjà, j’ai été attaquée par des troupes d’Arabes plus nombreuses que celle-ci, et toujours je m’en suis tirée. Ne vous laissez donc pas effrayer par le nombre, et souvenez-vous qu’un homme seul bien armé et déterminé est plus terrible pour nous que vingt individus indisciplinés et capables de perdre la tête... Rasons-nous sur le sol, prêts à bondir, et aussitôt que vous verrez ces soldats épauler leurs armes, élancez-vous; pas un n’osera vous faire face!... Montrez que vous deviendrez un jour les rois du désert!!...
Ces paroles nous électrisèrent, et nous nous rasâmes sur la terre tout frémissants d’impatience...
Hélas! mes chers amis, nous devions apprendre à nos dépens que les Français ne sont pas des Arabes, et que, s’il est facile d’échapper à ceux-ci, les premiers ont une bien meilleure tactique.
La troupe, par une manœuvre habile du capitaine, nous avait cernés et attendait, l’arme au pied. les ordres des deux officiers qui la commandaient.
— Camarades! s’écria l’un d’eux après s’être consulté quelques instants avec son collègue, il ne sera pas dit que des Français se seront mis cinquante pour combattre trois ennemis, ces ennemis fussent-ils des lions!... Aussi, M. Lambert et moi allons les attaquer seuls... Soldats! restez fermes à vos postes et n’arrivez qu’à notre ordre!...
A ces mots, les deux officiers sortirent des rangs, le fusil à l’épaule. Ils étaient suivis des sergents Dumanet et Beautreillis, portant chacun un fusil de rechange.
— Monsieur Lambert, dit l’officier qui avait déjà parlé, vous tirez mieux que moi; chargez-vous de la mère.
Le capitaine Lambert répondit par un signe de tête, puis les deux officiers, coude à coude, marchèrent... graves, impassibles, l’œil grand ouvert sur le fusil, le doigt sur la détente. On sentait des hommes qui n’ont pas peur.
Arrivés à dix pas du groupe que nous formions, il y eut comme un éclair d’hésitation de part et d’autre... Nous nous élançâmes, comme un seul lion, pour les écraser; mais une double détonation fit retentir les échos de la montagne...
LES DEUX OFFICIERS SORTIRENT DES RANGS LE FUSIL A L’ÉPAULE ET FIRENT FEU.
Ma sœur retomba sur moi, roide morte...
Quant à ma mère, la balle du capitaine lui était entrée dans l’œil... Elle bondit néanmoins; mais, à mi-chemin, une seconde balle, l’atteignant au défaut de l’épaule, lui traversa le cœur et la laissa sans vie sur le sol...
Je n’avais pas été touché !...
Comprenant qu’avec des adversaires semblables la lutte était impossible, et qu’une seconde de retard pouvait me perdre, je pris la fuite, bousculant un soldat qui voulait s’opposer à mon élan. Malheureusement, pour prix du coup de griffe que je lui adressai au passage, il me rendit un coup de baïonnette au beau milieu du ventre...
Je passai néanmoins et, cinq minutes plus tard, j’étais sauvé, seul survivant au massacre de ma famille.
A partir de ce moment, le malheur sembla s’attacher à mes pas. Poursuivi par les Français, traqué comme un loup mourant de faim parce que les douars arabes faisaient très bonne garde et que ma blessure m’empêchait de poursuivre les animaux sauvages, je finis par tomber dans un piège.
Un jour que la faim me tiraillait plus que d’habitude, j’oubliai toute prudence et m’élançai sur une chèvre trouvée en mon chemin... Hélas! cette chèvre était un leurre!... A peine l’eus-je touchée, que je tombai dans une fosse perfide.
Malheur! trois fois malheur!
On me prit, on me musela, on me guérit, et on m’envoya en France, où je fus acheté par l’Hercule de la Réole...
Voilà, mes chers amis, comment, pour avoir voulu goûter de la chair française, trois nobles lions trouvèrent la mort et un quatrième perdit sa liberté ! Puisse mon malheur servir d’exemple à tous nos parents du désert. Si les Français en laissent échapper quelques-uns!