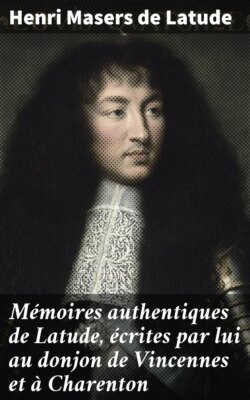Читать книгу Mémoires authentiques de Latude, écrites par lui au donjon de Vincennes et à Charenton - Henri Masers de Latude - Страница 4
II
ОглавлениеDans les Mémoires publiés sous son inspiration à l'époque de la Révolution, Danry a raconté cette première évasion du donjon de Vincennes d'une manière aussi spirituelle que fantaisiste. Il échappa à ses geôliers le plus simplement du monde. Etant descendu au jardin, à l'heure de sa promenade, il y trouva un épagneul noir qui faisait des bonds. Il arriva que le chien se dressa contre la porte d'entrée et la poussa de ses pattes. La porte était ouverte. Danry sortit et courut devant lui, «jusqu'à ce qu'il fût tombé par terre de fatigue, du côté de Saint-Denis, vers les quatre après midi.»
Il resta dans cette situation jusqu'à neuf heures du soir. Puis il prit le chemin de Paris et passa la nuit sur le bord de l'aqueduc du côté de la porte Saint-Denis. Au point du jour il entra dans la ville.
Nous savons quelle importance la cour attachait à la détention du prisonnier: elle espérait encore qu'il se déciderait à parler de ce grave complot dont il possédait le secret. D'Argenson écrit immédiatement à Berryer: «Rien n'est plus important ni plus pressé que d'user de toutes les voies imaginables pour tâcher de rattraper le prisonnier.» Et toute la police se met sur pied: le signalement du fugitif est imprimé à grand nombre d'exemplaires. L'inspecteur Rulhière l'envoie à toutes les maréchaussées.
Danry se logea chez Cocardon, au Soleil d'or; mais il n'osa demeurer plus de deux jours dans la même auberge. Il pensa que son camarade lui viendrait en aide; mais Binguet ne se soucie plus de la Bastille. C'est une jolie fille, Anne Benoist, que Danry avait connue au temps où il logeait chez Charmeleux, qui se dévoue à lui toute entière. Elle sait qu'elle risque d'être mise en prison, et, déjà des inconnus de mauvaise mine sont venus demander au Soleil d'or qui elle était. Qu'importe! elle trouve assistance chez des compagnes; les jeunes filles portent les lettres, se mettent en quête d'un gîte sûr. En attendant, Danry va passer la nuit sous les aqueducs; dès le lendemain il va s'enfermer dans le logement que ces demoiselles lui ont choisi, il y demeure deux jours sans sortir: Annette lui vient tenir compagnie. Mais le jeune homme n'a plus d'argent, comment paiera-t-il son écot? «Que faire, que devenir? dirait-il plus tard; j'étais sûr d'être découvert si je me montais, si je fuyais je courais également des risques.» Il écrit au docteur Quesnay, qui lui témoigna tant de bontés à Vincennes, mais la police a vent de cette correspondance, et Saint-Marc vient saisir le fugitif dans l'auberge où il est caché. Le malheureux est ramené à la Bastille. Annette est arrêtée chez Cocardon au moment où elle demandait les lettres venues pour Danry; elle est enfermée à la Bastille aussi. Les porte-clés et les sentinelles de Vincennes, de service le jour de l'évasion, sont jetés au cachot.
En se sauvant de Vincennes, Danry avait doublé la gravité de sa faute. Les règlements voulaient qu'il fût descendu au cachot, réservé aux prisonniers insubordonnés. «M. Berryer vint encore adoucir mes maux, au dehors il demandait pour moi justice ou clémence, dans ma prison il cherchait à calmer ma douleur, elle me paraissait moins vive quand il m'assurait qu'il la partageait.» Le lieutenant de police ordonna que le prisonnier fût nourri aussi bien que par le passé, qu'on lui laissât ses livres, du papier, ses bibelots, et les deux heures de promenade dont il jouissait à Vincennes. En retour de ces bontés, le garçon chirurgien envoya au magistrat «un remède contre les accès de goutte». Il demandait en même temps qu'on lui permît d'élever des petits oiseaux dont le gazouillis et l'animation le distrairaient. La demande fut accordée; Mais au lieu de prendre sa peine en patience, Danry s'irritait de jour en jour, il se laissait aller à sa nature violente, faisait du vacarme, criait, se démenait, à faire croire qu'il devenait fou. Sur les livres de la bibliothèque de la Bastille, qui passaient de chambre en chambre, il écrivait des poésies injurieuses contre la marquise de Pompadour. Il prolongeait ainsi son séjour dans le cachot. Peu à peu ses lettres changeaient de ton. «C'est un peu fort qu'on me laisse quatorze mois en prison et une année entière qui finit aujourd'hui dans un cachot où je suis encore.»
Cependant Berryer le remit dans une bonne chambre vers la fin de l'année 1751. En même temps, il lui donna, aux frais du roi, un domestique pour le servir. Quant à Annette Benoit, elle avait été mise en liberté après quinze jours de détention. Le domestique de Danry tomba malade; comme on voulait pas que le prisonnier manquât de société, on lui donna un compagnon de chambre. C'était un nommé Antoine Allègre, détenu depuis le 29 mai 1750. Les circonstances qui avaient déterminé son incarcération avaient été à peu près les mêmes que celles qui avaient fait enfermer Danry. Allègre était maître de pension à Marseille lorsqu'il apprit que les ennemis de la marquise de Pompadour cherchaient à la faire périr. Il imagina un complot où il mêla Maurepas, l'archevêque d'Albi et l'évêque de Lodève, envoya la dénonciation de ce complot à Versailles, et, pour y donner de la vraisemblance, adressa au valet de la favorite une lettre d'une écriture contrefaite, qui commençait par ces mots: «Foy de gentilhomme, il y a 100.000 écus pour vous si vous empoisonnez votre maîtresse...» Il espérait obtenir par ce moyen un bon emploi ou la réussite d'un projet qu'il avait fait sur le commerce.
Intelligents l'un et l'autre, instruits et entreprenants, Danry et Allègre étaient faits pour s'entendre, d'autant mieux que le maître de pension, très supérieur à son camarade, le dirigeait. Les années que Danry passa en compagnie d'Allègre exercèrent sur toute sa vie une influence si grande, que le lieutenant de police Lenoir pourrait dire un jour: «Danry est le tome II d'Allègre». Les lettres de ce dernier qui nous sont conservées en grand nombre, témoignent de l'originalité et de la vivacité de son esprit: le style en est fin et rapide, du français le plus pur, les idées exprimées ont de la distinction et sont parfois singulières sans être extravagantes. Il travaillait sans cesse et fut, tout d'abord, ennuyé d'avoir un compagnon. «Donnez-moi, je vous prie, une chambre en particulier, écrit-il à Berryer, même sans feu; j'aime à être seul, je me suffis à moi-même, parce que je sais m'occuper et semer pour l'avenir.» C'était une nature mystique, mais de ce mysticisme froid et amer que nous trouvons quelquefois chez les hommes de science, les mathématiciens en particulier. Car Allègre étudiait principalement les mathématiques, la mécanique, la science des ingénieurs. Le lieutenant de police lui fit acheter des ouvrages traitant des fortifications, de l'architecture civile, de la mécanique, des travaux hydrauliques. Le prisonnier les consultait pour rédiger des mémoires sur les questions les plus diverses, qu'il envoyait au lieutenant de police dans l'espoir qu'ils lui procureraient sa liberté. Ces mémoires, que nous possédons, montrent encore l'étendue de son intelligence et de son instruction. Danry l'imita dans la suite, en cela comme en tout le reste, mais grossièrement. Allègre était également très habile de ses doigts, dont il faisait, disent les officiers du château, tout ce qu'il voulait.
PUITS PLACÉ DANS LA DERNIÈRE COUR DE LA BASTILLE, APPELÉ DE CE FAIT: LA COUR DU PUITS, L'UNE DES HUIT TOURS DE LA BASTILLE EN RECEVAIT ÉGALEMENT SON NOM. (Croquis de l'architecte Palloy) (Bibl. nat., ms. nouv. acq. fran. 3.241)
Allègre était un homme dangereux: les porte-clés en avaient peur. Quelque temps après son entrée à la Bastille il tomba malade; un garde fut placé près de lui; les deux hommes firent mauvais ménage. Allègre envoyait à la lieutenance de police plaintes sur plaintes. On fit une enquête qui ne fut pas défavorable au garde-malade, et celui-ci fut laissé auprès du prisonnier; lorsqu'un matin, le 8 septembre 1751, les officiers de la Bastille entendirent dans la tour du Puits des cris et du bruit. Ils montèrent en hâte et trouvèrent Allègre occupé à percer d'un couteau son compagnon, qu'il tenait à la gorge, renversé dans son sang, le ventre ouvert. Si Allègre n'avait été à la Bastille, le Parlement l'aurait fait rouer en place de Grève; la Bastille le sauva; mais il ne pouvait plus espérer que sa liberté fût prochaine.
Quant à Danry, il lassa à son tour la patience de ses gardiens. Le major Chevalier, qui était la bonté même, écrivit au lieutenant de police: «Il ne vaut pas mieux qu'Allègre, mais il est cependant, quoique plus turbulent et colère, beaucoup moins à craindre, en tout genre que lui.» Le médecin de la Bastille, le docteur Boyer, membre de l'Académie, écrit également: «J'ai lieu de me méfier du personnage». Le caractère de Danry s'aigrissait. Il injuriait ses porte-clés. Un matin, on est obligé de lui enlever un couteau et des instruments tranchants qu'il a dérobés. Il se sert du papier qu'on lui donne pour se mettre en relation avec d'autres détenus et des personnes du dehors. Le papier est supprimé: Danry écrit avec son sang sur des mouchoirs; le lieutenant de police lui fait défendre de lui écrire avec du sang: Danry écrit sur des tablettes de mie de pain qu'il fait presser furtivement entre deux assiettes.
L'usage du papier lui fut rendu, ce qui ne l'empêche pas d'écrire à Berryer: «Monseigneur, je vous écris avec de mon sang sur du linge, parce que messieurs les officiers me refusent d'encre et du papier; voilà plus de six fois que je demande à leur parler inutilement. Qu'est-ce donc, Monseigneur, avez-vous résolu? Ne me poussez pas à bout. Au moins ne me forcez pas à être mon bourreau moi-même. Envoyez-moi une sentinelle pour me casser la tête, c'est bien la moindre grâce que vous puissiez m'accorder.» Berryer, surpris de cette missive, fait des observations au major, qui lui répond: «Je n'ai pas refusé de papier à Danry».
Ainsi le prisonnier faisait croire de plus en plus qu'il n'était qu'un fou. Le 13 octobre 1753, il écrivait au docteur Quesnay pour lui dire qu'il lui voulait grand bien, mais qu'étant trop pauvre pour lui rien donner, il lui faisait cadeau de son corps, qui allait périr, dont il pourrait faire un squellette. Au papier de la lettre, Danry avait cousu un petit carré de drap et il ajoutait: «Dieu a donné aux habits des martyrs la vertu de guérir toutes de maladies. Voilà cinquante-sept mois qu'on me fait souffrir le martyr. Ainsi il est sans doute qu'aujourd'hui le drap de mon habit fera des miracles: en voilà un morceau.» Cette lettre revint à la lieutenance de police au mois de décembre, et nous y trouvons une apostille de la main de Berryer: «Lettre bonne à garder, elle fait connaître l'esprit du personnage». Or nous savons de quelle façon on traitait encore les fous au XVIIIe siècle.
Mais subitement, au grand étonnement des officiers du château, nos deux amis améliorent leur caractère et leur conduite. On n'entendait plus de bruit dans leur chambre, et quand on leur venait parler ils répondaient poliment. En revanche, ils étaient d'allure plus bizarre encore que par le passé. Allègre se promenait dans sa chambre, à moitié nu, pour ménager ses hardes, disait-il, et adressait lettres sur lettres à son frère et au lieutenant de police pour qu'on lui envoyât des nippes, des chemises surtout et des mouchoirs. Danry de même. «Ce prisonnier, mande Chevalier au lieutenant de police, demande du linge; je ne vous écrirai pas, parce qu'il a sept chemises très bonnes, dont quatre neuves; cet article le met aux champs.» Mais pourquoi refuser à un prisonnier de lui passer ses fantaisies? Et le commissaire de la Bastille fit confectionner deux douzaines de chemises de prix—chacune re vint à vingt livres, plus de quarante francs de notre monnaie, et des mouchoirs de la batiste la plus fine.
LETTRE DE LATUDE AU DOCTEUR QUESNAY, ÉCRITE A LA BASTILLE LE 18 OCTOBRE 1753 Il lui envoie un morceau de son habit qui fera sans doute des miracles étant donné que le propriétaire en est un martyr (Bibl. nat., Archives de la Bastille, nº 11.692)
ÉCHELLE DE CORDE FABRIQUÉE A LA BASTILLE PAR LATUDE ET ALLÈGRE, ET A L'AIDE DE LAQUELLE ILS SE SAUVÈRENT DANS LA NUIT DU 25 AU 26 FÉVRIER 1756 (Musée Carnavalet)
Si la lingère du château avait fait attention, elle aurait remarqué que les serviettes et les draps qui entraient dans la chambre des deux compagnons, en sortaient raccourcis dans tous les sens. Nos amis s'étaient mis en rapport avec leurs voisins de prison, qui demeuraient en-dessous et au-dessus d'eux, mendiant des ficelles et du fil, donnant du tabac en échange. Ils étaient parvenus à desceller les barres de fer qui empêchaient de grimper dans la cheminée; la nuit, ils montaient jusque sur les plates-formes, d'où ils conversaient par les cheminées, avec les prisonniers des autres tours. L'un de ces malheureux se croyait prophète de Dieu: il entendit la nuit ce bruit de voix qui tombait sur le foyer éteint; il révéla le prodige aux officiers qui le regardèrent comme plus fou encore qu'auparavant. Sur la terrasse, Allègre et Danry trouvèrent les outils que des maçons et des herbiers employés au château y laissaient le soir. Ils se procurèrent ainsi un maillet, une tarière, deux espèces de moufles et des morceaux de fer pris aux affûts des canons. Ils cachaient le tout dans le tambour existant entre le plancher de leur chambre et le plafond de la chambre inférieure.
Allègre et Danry se sauvèrent de la Bastille dans la nuit du 25 au 26 février 1756. Ils grimpèrent par la cheminée jusque sur la plate-forme des tours et descendirent par la fameuse échelle de corde attachée à l'affût d'un canon. Une muraille séparait le fossé de la Bastille de celui de l'Arsenal. Ils parvinrent, à l'aide d'une barre de fer, à en détacher une grosse pierre, et s'échappèrent par la haie ainsi pratiquée. L'échelle de corde était une œuvre de longue patience et de grande habileté. Plus tard, Allègre deviendrait fou, alors Danry tirerait à lui tout le mérite de cette entreprise que son ami avait conçue et dirigée.
Au moment de partir, Allègre avait écrit sur un chiffon de papier, pour les officiers de la Bastille, la note suivante, qui marque bien son caractère:
«Nous n'avons causé aucun dommage aux meubles de M. le gouverneur, nous ne nous sommes servis que de quelques lambeaux de couvertures qui ne pouvaient être d'aucune utilité, les autres sont dans leur entier. S'il manque quelques serviettes, on les trouvera au-delà de l'eau, dans le grand fossé, où nous les emportons pour essuyer nos pieds: «Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam!»
«Scilo cor nostrum et cognosce semitos nostras.»
«Ce n'est pas sur nous, Seigneur, ce n'est pas sur nous, mais sur ton nom, qu'il faut répandre la gloire; regarde notre cœur et connais les voies où nous marchons.»
Nos deux compagnons s'étaient pourvus d'un portemanteau, et ils s'empressèrent de changer de vêtements dès qu'ils eurent franchi l'enceinte du château. Un metteur en œuvre, Fraissinet, que Danry connaissait, s'intéressa à eux et les conduisit chez le tailleur Rouit, qui les logea quelque temps. Rouit prêta même à Danry 48 livres que celui-ci s'engagea à renvoyer dès son arrivée à Bruxelles. Un mois passé, nos deux amis étaient au-delà des frontières.