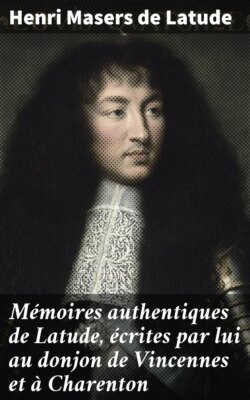Читать книгу Mémoires authentiques de Latude, écrites par lui au donjon de Vincennes et à Charenton - Henri Masers de Latude - Страница 7
IV
ОглавлениеLorsque Latude fut en liberté, il se trouva sans ressource, comme lors sa première évasion. «Je m'étais échappé avec des pantoufles à mes pieds et pas un sou dans ma poche; j'étais dénué de tout.» Ses jeunes amies, les demoiselles Lebrun, lui donnèrent asile.
Il retrouva chez elles une partie de ses papiers, plans et projets, mémoires et dissertations, dont il envoya «un panier» au maréchal de Noailles; il le priait de lui continuer l'honneur de sa protection et lui faisait part de «quatre grandes découvertes qu'il venait de faire: la première, la véritable cause du flux et du reflux de l'Océan; la deuxième, la cause des montagnes, sans lesquelles le globe de la terre serait immobilisé et en peu de temps vitrifié; la troisième, la cause qui fait tourner sans cesse le même globe; la quatrième, la cause de la salure des eaux de toutes les mers». Il écrivit également au duc de Choiseul, ministre de la guerre, afin d'obtenir la récompense de son projet militaire; il écrivit à Sartine pour lui faire des propositions de paix: en retour de 10.000 écus, avancés sur les 150.000 livres qui lui étaient dues, il oublierait le passé: «J'étais, dit-il, résolu de jouer le tout pour le tout». En réponse, il reçut une lettre qui lui désignait une maison où il trouverait 1.200 livres obtenues pour lui par le docteur Quesnay. Il se rendit à l'adresse indiquée, où il fut saisi.
Il fut aussitôt ramené à Vincennes. Danry avoue qu'il allait être mis en liberté au moment où il s'évada: c'était une nouvelle détention à recommencer. Nous ne raconterons pas ici le détail de l'existence qu'il va mener. On en trouvera le récit dans les mémoires imprimés ci-après. Matériellement, il continue d'être bien traité, mais son esprit tourne à la folie, ses colères deviennent de plus en plus violentes, en arrivent au paroxysme de la fureur. Voici quelques extraits des lettres et mémoires envoyés à Sartine: «Par tous les diables, cela est un peu fort de café! Il est vrai, monsieur, qu'à ne vous vanter que médiocrement, on pourrait défier les plus scélérats diables de tout l'enfer de vous donner des leçons de cruauté.» Il écrit une autre fois; «Notre crime à nous tous est d'être instruits de vos friponneries: il faut que nous périssions! quelle joie pour vous si l'on venait vous apprendre que nous nous sommes étranglés dans nos cachots!» Danry rappelle au lieutenant de police les supplices d'Enguerrand de Marigni, et il ajoute: «Sachez qu'on en a rompu plus de mille au milieu de la place de grève de Paris qui n'avaient pas commis la centième partie de vos crimes».—«Il ne se trouverait pas une seule personne d'étonnée en te voyant écorcher tout vif, tanner ta peau et jeter ton corps à la voirie pour être dévoré par les chiens.»—«Mais monsieur se rit de tout, monsieur ne craint ni Dieu, ni le roi, ni le diable, monsieur avale les crimes comme du petit-lait!»
Latude écrivait dans sa prison des mémoires qu'il remplissait de calomnies sur les ministres et la Cour. Ces mémoires étaient composés sur le ton le plus dramatique, avec un accent de sincérité inimitable. On savait que le prisonnier trouvait mille moyens de les faire passer à l'extérieur, et on craignait qu'ils ne se répandissent dans la foule où les esprits—nous sommes en 1775—commençaient à être excités. Latude venait d'être descendu au cachot à la suite d'une nouvelle algarade à ses geôliers. «Le 19 de ce mois de mars 1775, le lieutenant de roi entra, accompagné du major et de trois porte-clés, il me dit:—J'ai obtenu qu'on vous fît sortir du cachot, mais à la condition que vous me remettiez vos papiers.
«—Que je vous remette mes papiers! Sachez, monsieur, que j'aimerais mieux crever dans ce cachot que de faire une pareille lâcheté!
«—Votre malle est là-haut, dans votre chambre, il ne dépend que de moi d'en faire sauter les cachets que vous y avez mis et de prendre vos papiers.
«Je répliquai:—Monsieur, il y a des formalités de justice auxquelles vous devez vous conformer, et il ne vous est point permis de faire de pareilles violences.
«Il sort cinq ou six pas hors du cachot, et, comme je ne le rappelais pas, il rentre en me disant:—Remettez-les-moi tant seulement pour dix jours pour les examiner, et je vous donne ma parole d'honneur qu'au bout de ce temps je vous les ferai rapporter dans votre chambre.
«Je lui répliquai:—Je ne vous les livrerai pas tant seulement pour deux heures.
«—Hé bien! me dit-il, puisque vous ne voulez point me les confier, vous n'avez qu'à rester ici.»
Latude raconte dans ces Mémoires, avec grande indignation, l'histoire d'une flûte qu'il s'était faite, dont il jouait, c'était sa seule distraction durant les longues heures de solitude; ses geôliers eurent la barbarie de lui enlever. Le gouverneur du donjon, par compassion, offrit de la lui rendre. «Mais ce ne sera qu'à la condition que vous n'en jouerez point la nuit, et rien que le jour.» A cet article, écrit Latude dans ses Rêveries, je ne pus éviter de le tourner en ridicule, en lui disant: «Mais y pensez-vous, monsieur? il suffit que ça me soit défendu pour m'en donner envie[1].»
Aussi à Vincennes, comme à Paris en vint-on à considérer Danry comme un fou. Parmi les livres qu'on lui donnait pour le distraire, il s'en trouva quelques-uns traitant de sorcellerie. Il les lut et relut, et vit plus dès lors, dans sa vie, que la perpétuelle intervention des démons évoqués par la magicienne Pompadour et son frère le magicien, marquis de Marigny.
Sartine revint voir le prisonnier le 8 novembre 1772. Danry le pria de lui envoyer un exempt, pour prendre copie d'un mémoire qu'il avait composé pour sa justification; de lui envoyer également un avocat pour l'aider de ses conseils, et un médecin, pour examiner l'état de sa santé.
L'exempt arriva le 24. Le 29, il écrivit au lieutenant de police: «J'ai l'honneur de vous rendre compte qu'en conséquence de vos ordres je me suis rendu au château de Vincennes, le 24 courant, pour entendre ce que Danry prétend intéresser le ministre, et il n'est pas possible d'entendre chose qui l'intéresse si peu. Il a débuté par me dire qu'il fallait, pour que j'écrive tout ce qu'il avait à me dire, que je reste trois semaines avec lui. Il doit me faire l'histoire de cent quatre-vingts ensorcellements et me faire copier cette histoire, d'après lui, dans un tas de papiers qu'il a tirés d'un sac, dont le caractère est indéchiffrable.»
Nous savons par Danry comment se passa la visite de l'avocat. Celui-ci entra dans la chambre du prisonnier sur le midi.
Danry lui présente les deux mémoires qu'il a rédigés et lui en explique le contenu. «Sur-le-champ, il me coupa court, en me disant: «Monsieur, je ne crois point du tout aux ensorcellements.»
«Je ne perdis point courage, et je lui dis: «Monsieur, il ne m'est point possible de vous faire voir le corps du démon, mais je suis très certain de vous convaincre, par le contenu de ce mémoire, que feu la marquise de Pompadour était une magicienne, et que le marquis de Marigny, son frère, est encore aujourd'hui même en commerce avec les démons.»
A peine l'avocat eut-il lu quelques pages, qu'il s'arrêta tout court, posa le cahier sur la table et me dit, comme s'il s'était éveillé d'un profond sommeil: «N'est-ce pas que vous voudriez sortir de prison?» Je repris: «Cela n'est point douteux.—Et comptez-vous rester dans Paris ou retourner chez vous?—«Quand je serai libre, je retournerai chez moi.—Mais avez-vous de quoi?» A ce mot, je le pris par la main et je lui dis: «Monsieur l'avocat, je vous prie de ne pas vous fâcher des paroles que je vais vous dire.—Parlez, me dit-il, dites tout ce qu'il vous plaira, je ne me fâcherai point.—Hé bien, c'est que je me suis aperçu très distinctement que le démon s'est déjà emparé de vous.»
La même année, Malesherbes fit sa célèbre inspection des prisons. «Ce ministre vertueux vint me voir dans le commencement du mois d'août 1775, il m'écouta avec le plus vif intérêt.» L'historien qui a le mieux connu tout ce qui se rapporte à la Bastille, François Ravaisson, a cru que Malesherbes laissa le malheureux en prison par égard pour son collègue Maurepas. «On aurait dit que le premier acte de Maurepas, en reprenant le ministère, avait été de faire sortir son ancien complice.» Une lettre de Malesherbes au gouverneur de Vincennes détruit cette supposition: «Je m'occupe, monsieur, de l'examen des pièces qui concernent vos différents prisonniers. Danry, Thorin et Maréchal sont tout à fait fols suivant les notes qu'on m'a données, et les deux premiers en ont donné des marques indubitables en ma présence.»
Danry fut, en conséquence, transféré à Charenton le 27 septembre 1774, «pour cause de dérangement de tête, en vertu d'un ordre du Roy du 23 dudit mois, contresigné de Lamoignon (Malesherbes). Le Roy paiera sa pension.» Au moment d'entrer dans sa nouvelle demeure, Latude prit la précaution de changer de nom une troisième fois et signa sur les registres «Danger».
En passant du donjon de Vincennes dans la maison de Charenton, Danry ne jugea pas inutile de s'élever encore en dignité. Aussi le voyons-nous s'intituler dorénavant «ingénieur, géographe, pensionnaire du roi à Charenton.» Sa situation s'améliora sensiblement. Il parle des bontés qu'avaient pour lui les Pères de la Charité. Il avait des compagnons dont la société lui plaisait. Des salles où l'on jouait au billard, au trictrac, aux cartes, étaient mises à la disposition des pensionnaires. Il prenait ses repas et se promenait en compagnie. Il revit Allègre, son ancien confrère de captivité, qu'il retrouva dans les catacombes parmi les forcenés: on l'avait fait sortir, en 1763, de la Bastille où il cassait et brisait tout. A présent Allègre se croyait Dieu. Quant à Danry, il était si bien entré dans son rôle de gentilhomme, qu'à voir son air de noblesse et d'aisance, à entendre sa conversation pleine de souvenirs de famille et de jeunesse, nul ne pouvait douter qu'il n'eût été, en effet, ce brillant officier du génie, tombé, dans la fleur de l'âge, victime des intrigues de la favorite. Il fréquentait la partie aristocratique de la société de Charenton, et se lia intimement avec un de ses compagnons, le chevalier de Moyria, fils d'un lieutenant-colonel, chevalier de saint Louis.
Cependant le Parlement, qui envoyait chaque année une commission faire l'inspection de la maison de Charenton, commission devant laquelle Danry comparut à deux reprises différentes, ne jugea pas qu'il dût être mis en liberté. Mais, un beau jour du mois de septembre 1776, le Père prieur, qui s'intéressait tout particulièrement au sort de son pensionnaire, le rencontrant dans le jardin, lui dit brusquement: «Nous attendons la visite de M. le lieutenant de police, préparez un discours court et bon». Le lieutenant de police, Lenoir, vit Danry, l'écouta attentivement, et comme le Père prieur ne donnait que de bons témoignages, le magistrat promit la liberté. «Alors le Père Prudence, directeur, qui était derrière moi, me tira par le bras pour me faire sortir, par crainte que, par quelque parole indiscrète, je ne gâtasse le bien qui avait été résolu.» C'est un trait charmant tout à l'honneur du Père Prudence.
Mais, réflexion faite, il parut dangereux de rejeter ainsi, du jour au lendemain, dans la société un homme qui ne saurait comment y vivre, n'ayant ni parents ni fortune, n'ayant plus les moyens de gagner sa vie, et dont on n'avait d'ailleurs que trop de raisons de se défier. Le Noir fit demander si le prisonnier trouverait, une fois en liberté, de quoi assurer son existence, s'il avait quelque bien, s'il pouvait donner les noms de quelques personnes prêtes à répondre de lui.
Comment, s'il avait quelque bien! comment, s'il trouverait des personnes prêtes à répondre de lui! Lui, Maser de Latude! Mais toute sa famille, quand la marquise de Pompadour le fit embastiller, occupait une situation brillante! Mais sa mère, dont il avait eu la douleur d'apprendre la mort, il avait laissé une maison et des biens-fonds considérables! Latude prit la plume et, sans hésiter, écrivit à M. Caillet, notaire royal à Montagnac:
J.-CH. P. LE NOIR, LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE (Bibl. de l'Arsenal)
«Mon cher ami, je parierais dix contre un que tu me crois mort, vois comme tu t'es trompé!... Il ne dépend que de toi qu'avant ce carnaval passé nous mangions un bon levraut ensemble.»
Et il parle à son ami le notaire de la fortune laissée par sa mère, de toute sa famille qui ne peut manquer de s'intéresser à lui. Latude ne fut peut-être pas très étonné de ne pas recevoir de réponse à cette épître, mais elle devait passer sous les yeux du lieutenant de police.
Le nouvel ami de Latude, le chevalier de Moyria, était en liberté depuis quelque temps déjà. Le prisonnier s'empressa de lui envoyer la copie de sa lettre au notaire.
«La réponse se faisait attendre, M. Caillet était mort sans doute. Que devenir? ces vingt-huit années de captivité avaient compromis sa fortune, lui avaient fait perdre ses amis; comment retrouver les débris de sa famille dispersée? Heureusement qu'il lui restait une amitié, une amitié jeune encore, mais déjà forte, en laquelle il mettait sa confiance.
«Chevalier, il ne dépendrait que de vous de me délivrer, en engageant votre bonne maman à écrire à M. Le Noir. «Le chevalier de Moyria répondit aimablement, Danry écrivit une nouvelle lettre plus pressante et fit si bien que, non seulement la mère du chevalier, mais encore un vieil ami de la famille de Moyria, Mercier de Saint-Vigor, chef d'escadre, contrôleur général de la maison de la reine, intervinrent, firent des démarches à Versailles. «Le 5 du moi de juin 1777, le roi Louis XVI me rendit ma liberté, j'ai l'ordre de sa main dans ma poche!»