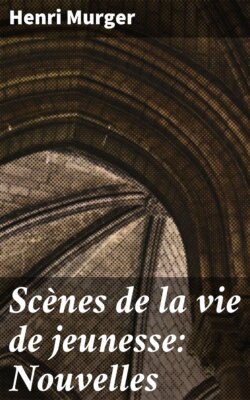Читать книгу Scènes de la vie de jeunesse: Nouvelles - Henri Murger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
Pendant qu'Ulric de Rouvres se rend au rendez-vous que lui avait assigné Tristan, nous donnerons aux lecteurs quelques explications sur les événements qui avaient déterminé son suicide, si singulièrement avorté.
Entré de bonne heure dans la vie, car il avait été mis en possession de sa fortune avant d'avoir atteint sa majorité, Ulric, ébloui d'abord par le soleil levant de sa vingtième année, et étourdi par le bruit que faisait ce monde où il était appelé à vivre, hésita un moment; et, comme un voyageur qui, mettant pour la première fois le pied sur un sol inconnu, craint de s'y égarer, il demanda un guide.
Il s'en présenta cinquante pour un; car, ainsi qu'aux barrières des villes qui renferment des curiosités, on trouve aux portes du monde une foule de cicérones qui viennent bruyamment vous offrir leurs services.
Ulric, ivre de liberté, voulut tout voir et tout savoir; nature ardente, curieuse et impatiente, il aurait désiré pouvoir, dans une seule coupe et d'un seul coup, boire toutes les jouissances et tous les plaisirs.
Il vit et il apprit rapidement; et, à vingt-quatre ans l'expérience lui avait signé son diplôme d'homme.
L'esprit plein d'une science amère, le cœur changé en un cercueil qui renfermait les cendres de sa jeunesse, et l'âme encore tourmentée par d'insatiables désirs, il quitta ce monde où, quatre années auparavant, il était entré l'œil souriant et le front levé, en lui jetant la malédiction désolée des fils d'Obermann et de René; et sinistre et lamentable, il s'en retourna grossir le nombre de ceux qui épanchent sur toutes choses leurs doutes amers ou leurs audacieuses négations.
La brutale disparition d'Ulric fut accueillie dans la société par une banale accusation de misanthropie; et au bout de huit jours, on n'en parlait plus.
De toutes ses anciennes connaissances d'autrefois, Tristan fut le seul avec qui Ulric conserva quelques relations. Un jour il vint le voir, et lui tint des discours qui ne laissèrent point de doute à Tristan sur les idées de suicide qui germaient déjà dans son esprit.
—À vingt-quatre ans, c'est bien tôt, répondit Tristan; en tout cas vous me permettrez de ne pas vous accompagner.
—Ah! c'est donc vrai ce qu'on m'avait dit sur vous? Vous êtes atteint du mal du siècle, vous aurez trop lu Faust et les esprits chagrins qui sont venus à sa suite. C'est plutôt l'influence de ces gens-là que tout le reste qui vous amène au bord de ce moyen extrême. Vous vous croyez mort, vous n'êtes qu'engourdi, mon cher! Quand on a trop couru on est fatigué, cela est naturel. Vous êtes dans une époque de repos; mais, demain ou après, vous jetterez par la fenêtre votre résolution funeste et vos pistolets anglais, ou vous en ferez cadeau à un pauvre diable de poète incompris, qui n'aura pour se guérir des misères de ce monde que le moyen extrême de s'en aller dans l'autre.
J'ai été comme vous; plus d'une fois j'ai mis la clef dans la serrure de cette porte qui donne sur l'inconnu; mais je suis revenu sur mes pas, et j'espère que vous ferez comme moi. Vous me répondrez que vous n'avez plus ni cœur ni âme, et qu'il vous est impossible de croire à rien. D'abord, on a toujours un cœur; et pourvu qu'il accomplisse sa fonction de balancier, on n'a pas besoin de lui en demander davantage. Quant à ce qui est de l'âme, c'est un mot pour l'explication duquel on a écrit dans toutes les langues un million de volumes, ce qui fait qu'on est moins fixé que jamais sur son existence et sa signification. L'âme est une rime à flamme, voilà ce qu'il y a de plus évident jusqu'ici.
Pour ce qui touche les croyances, il en est de tellement naturelles qu'on ne peut jamais les perdre; on ne peut nier ce qu'on voit, ce qu'on touche et ce qu'on entend. À défaut de sentiments, on a toujours des sensations; et c'est n'être point mort que de posséder de bons yeux pour voir le soleil, des oreilles pour entendre la musique, et des mains pour les passer amoureusement dans la chevelure parfumée d'une femme, qui, à défaut de ces vertus idéales que réclament les jeunes gens de l'école romantique allemande, a au moins les qualités positives et plastiques de sa beauté. Vous avez fini votre temps de poésie et perdu les ailes qui vous emportaient dans les olympes de l'imagination; mais il vous reste des pieds pour marcher encore un bon bout de temps dans une prose substantielle et nourrissante; et ce qui vous reste à faire est le meilleur du chemin.
Mais en voyant que ces railleries, qui lui étaient familières, à lui poète du matérialisme et apôtre du scepticisme, semblaient provoquer Ulric au lieu de le calmer, Tristan quitta subitement le ton qu'il avait pris d'abord, et le sermonna avec une éloquence onctueuse, persuasive et presque paternelle, qui eut, du moins un instant, pour résultat de le faire renoncer à son dessein de suicide.
Cependant, à compter de ce jour, Ulric ne revint plus voir Tristan, qui, malgré tous les soins qu'il prit pour le découvrir, fut longtemps sans savoir ce qu'il était devenu.
Un jour Tristan faisait, en compagnie de quelques amis, une partie de cheval dans une campagne des environs de Paris. Ce fut là que le hasard lui fit rencontrer Ulric, après six mois de disparition. Ulric n'était pas seul; il donnait le bras à une jeune fille de dix-huit à vingt ans, ayant le costume des ouvrières. Ulric aussi, Ulric, qui jadis avait donné dans le monde l'initiative de l'élégance; Ulric, qui avait été pendant un temps le thermomètre des variations de la mode et dont les innovations, si audacieuses qu'elles fussent, étaient toujours acceptées; qui, s'il lui avait pris un jour l'idée de mettre des gants rouges, en aurait fait porter à tout le Jockey Club, Ulric était vêtu d'habits coupés sur les modèles trouvés sans doute dans les Herculanums de mauvais goût. Il était méconnaissable. Cependant Tristan le reconnut au premier regard et allait s'approcher de lui pour lui parler, quand Ulric lui fit signe de ne pas l'aborder.
—Quel est ce mystère? murmura Tristan en s'éloignant.
En voici l'explication:
Dans les naïfs récits des romanciers et des poètes du moyen âge, on rencontre beaucoup d'aventures de princes et de chevaliers mélancoliques qui, fuyant les cours et les châteaux, se mettent un jour à courir le pays, cachant leur naissance et leur fortune, et, déguisés en pauvres trouvères, s'en vont, la guitare en main, chanter l'amour, et, parmi toutes les femmes, en cherchent une qui les aime pour eux-mêmes. Ils donnent un soupir pour un sourire, et s'arrêtent aussi volontiers sous l'humble fenêtre des vassales que sous le balcon armorié des châtelaines.
Enfant de ce siècle, Ulric de Rouvres, qui comptait peut-être des aïeux parmi ces héros, demi-poètes, demi-paladins, dont sont peuplées les vieilles légendes, semblait vouloir continuer la tradition de ces temps barbares au milieu des mœurs civilisées de notre époque.
Voici ce qu'Ulric avait fait pour rompre complètement avec un monde où pendant quatre années les délicatesses trop exagérées de sa nature avaient été constamment froissées.
Après avoir réalisé toute sa fortune en rentes sur l'État, il en déposa l'inscription entre les mains d'un notaire qui fut chargé d'utiliser les intérêts comme il l'entendrait. Son mobilier, qui était le dernier mot du luxe et de l'élégance modernes, ses équipages et ses chevaux, dont quelques-uns étaient cités dans l'aristocratie hippique, furent vendus aux enchères, et les sommes que produisirent ces ventes diverses déposées chez le notaire qui avait la gestion de sa fortune. Ulric garda deux cents francs seulement.
Huit jours après, les personnes qui vinrent le demander à son logement de la Chaussée d'Antin apprirent qu'il était parti sans laisser d'adresse.
Sous le nom de Marc Gilbert, Ulric avait été se loger dans une des plus sombres rues du quartier Saint-Marceau. La maison où il habitait était une espèce de caserne populaire où du matin au soir retentissait le bruit de trois cents métiers.
Habitué au confortable recherché au milieu duquel il avait toujours vécu, Ulric passa sans transition de l'extrême opulence au dénuement extrême. Sa chambre était un de ces taudis humides et obscurs dans lesquels le soleil n'ose pas aventurer un rayon, comme s'il craignait de rester prisonnier dans ces cachots aériens. Le mobilier qui garnissait cette chambre était celui du plus pauvre artisan.
Ce fut là qu'Ulric vint se réfugier, ce fut là qu'il essaya de se retremper dans une autre existence. En voyant ses voisins, les ouvriers, partir le matin pour l'atelier la chanson aux lèvres, en les voyant rentrer le soir ployés en deux par la fatigue du labeur, mais ayant sur le visage encore trempé de sueur ce reflet de contentement pacifique qu'imprime l'accomplissement d'un devoir, Ulric s'était dit:
—Ceci est le vrai peuple, le peuple honnête, qui travaille et pétrit de sa main laborieuse le pain qu'il mange le soir. C'est là, ou jamais, que je trouverai l'homme avec ses bons instincts. C'est là, ou jamais, que je pourrai guérir cette invincible tristesse qui m'a suivi dans cette mansarde, où j'ai retrouvé le spectre du dégoût assis au pied de mon lit.
Son plan était tout tracé, et il le mit sur-le-champ à exécution. Huit jours après, Ulric, sous le nom de Marc Gilbert, avait revêtu le sarreau plébéien, et entrait comme apprenti dans un grand atelier du voisinage. Au bout de six mois, il savait assez son métier pour être employé comme ouvrier. À dessein il avait choisi dans l'industrie une des professions les plus fatigantes et exigeant plutôt la force que l'intelligence. Il s'était fait mécanique vivante, outil de chair et d'os. Et, en voyant ses doigts glorieusement mutilés par les saintes cicatrices du travail, c'est à peine s'il se reconnaissait lui-même dans le robuste Marc Gilbert, lui, l'élégant Ulric de Rouvres, dont la main aristocratique aurait jadis pu mettre, sans le rompre, le gant de la princesse Borghèse.
Cependant, malgré le rude labeur quotidien auquel il s'était voué, au milieu même de son atelier, et si bruyantes qu'elles fussent, les clameurs qui l'environnaient ne pouvaient assourdir le chœur de voix désolées qui parlaient incessamment à son esprit.
Lorsqu'il rentrait le soir dans sa chambre, après une laborieuse journée, Ulric ne pouvait même pas trouver ce lourd sommeil qui habite les grabats des prolétaires. L'insomnie s'asseyait à son chevet; et, quoi qu'il fît pour l'en détourner, son esprit descendait au fond d'une rêverie dont l'abîme se creusait chaque jour plus profondément, et d'où il ressortait toujours avec une amertume de plus et une espérance de moins.
Ulric avait au cœur cette lèpre mortelle qui est l'amour du bien et du bon, la haine du faux et de l'injuste; mais une étrange fatalité, qui semblait marcher dans ses pas, avait toujours donné un démenti à ses instincts et raillé la poésie de ses aspirations. Tout ce qu'il avait touché lui avait laissé quelque fange aux mains, tout ce qu'il avait connu lui avait gravé un mépris ou un dégoût dans l'esprit, et, comme ces soldats qui comptent chaque combat par une blessure, chacun de ses amours se comptait par une trahison.
Aussi, pendant ses heures de solitude, et quand il déroulait devant sa pensée le panorama de sa vie passée, ne pouvait-il s'empêcher de pousser des plaintes sinistres.
On est majeur à tout âge pour les passions; mais le plus grand malheur qui puisse arriver à un homme est sans contredit une majorité précoce. Celui qui vit trop jeune vit généralement trop vite; et les privilégiés sont ceux-là qui, pareils aux écoliers, peuvent prendre le long chemin et n'arriver que le plus tard possible au but où la raison enseigne la science de la vie. Mais chacun porte en soi son destin. Il est des êtres chez qui les facultés se développent avant l'heure, et qui, se hâtant d'aller demander à la réalité ses logiques démentis, toujours pleins de désenchantements, se déchirent aux épines de la vérité, à l'âge où l'on commence à peine à respirer l'enivrant parfum des mensonges.
Lorsqu'on rencontre quelques-uns de ces malheureux mutilés par l'expérience, il faut les accueillir avec une pitié secourable; on ne peut interdire la plainte aux blessés, et l'ironie et le blasphème d'un sceptique de vingt ans ne sont bien souvent que le râle de sa dernière illusion.
Le motif qui avait amené Ulric à quitter le monde pour venir se réfugier dans la vie des prolétaires était moins une excentricité romanesque qu'une tentative très sérieusement méditée, et sans doute inspirée par une espèce de philosophie mystique particulière aux esprits tourmentés par les fièvres de l'inconnu.
Spectateur épouvanté et victime souffrante de la corruption et de la fausseté qui règnent dans les relations du monde; trompé à chaque pas qu'il y faisait, comme ce voyageur qui, en traversant une contrée maudite, sentait se transformer sous sa dent, en cendre infecte ou en fiel amer, les fruits magnifiques qui avaient tenté son regard et excité son envie, Ulric voyait, dans cette corruption et cette fausseté même, un fait providentiel.
—Il est juste, pensait-il, que ceux qui, en arrivant dans la vie, y sont accueillis par le sourire doré de la fortune et trouvent dans leurs langes, brodés par la main des fées protectrices, les talismans enchantés qui leur assurent d'avance toutes les jouissances et toutes les félicités qu'on peut échanger contre l'or; il est peut-être juste que ces privilégiés, fatalement condamnés au plaisir, soient déshérités du bonheur, la seule chose qui ne s'achète pas et ne soit point héréditaire.
«Leur destin leur a dit en naissant: Toi, tu vivras parmi les puissants, dans cette moitié du monde qui fait l'éternelle envie de l'autre moitié. Tu auras la fortune et le rang. Enfant, tous tes caprices seront des lois; jeune homme, tous les plaisirs feront cortège à ta jeunesse, et chacune de tes fantaisies viendra s'épanouir en fleur au premier appel de ton désir; homme, toutes les routes seront ouvertes à ton ambition. Tu seras enfin ce qu'on appelle un heureux du monde. Mais ton bonheur n'aura que des apparences, et chacune de tes joies sera doublée d'une déception; car tu vas vivre dans une société où la corruption est presque une nécessité d'existence, et la perfidie une arme de défense personnelle qu'on doit toujours avoir à la main comme un soldat son épée.»
C'est ainsi qu'Ulric avait raisonné intérieurement, et cette singulière philosophie l'avait conduit à rêver cette singulière espérance.
«En revanche, ajoutait-il, ceux-là qui naissent abandonnés de la fortune, les malheureux qui n'ont d'autre protection qu'eux-mêmes et traversent la vie attelés à la glèbe du travail, ceux-là du moins, au milieu de la dure existence que leur impose leur destin, doivent conserver les bons instincts dont ils sont doués nativement. La bonne foi, la reconnaissance, toutes les nobles qualités humaines doivent croître dans les sillons qu'arrose la sueur du travail. L'ouvrier doit pratiquer avec la rudesse de ses mœurs la fraternité; ne possédant rien, il ne connaît point les haines que déterminent les rivalités d'intérêt; ses sympathies et ses amitiés sont spontanées et sincères, et comme celles du monde, n'ont pas seulement la durée d'une paire de gants ou d'un bouquet de bal. Ses amours ignorent les honteux alliages dont sont composés les amours du monde, amours faits d'ambition, d'orgueil, de haine même quelquefois, mais jamais d'amour. L'ignorance du peuple est une sauvegarde contre le mal, car le mal est un résultat du savoir. On fait le bien avec le cœur seulement; le mal exige la collaboration de l'esprit et de la raison.»
Mais cette suprême espérance, à laquelle Ulric s'était obstinément attaché, ne survécut pas à sa tentative. Après avoir pendant six mois vécu au milieu des hommes de labeur, l'étude et le contact des mœurs de ce monde nouveau pour lui laissa Ulric encore plus désolé; et son expérience l'amena à cette conclusion absolue que le bien et le bon n'existaient pas, ou n'existaient qu'à l'état d'instincts dont l'application et le développement n'étaient pas possibles.
Dans les classes élevées de la société, parmi le monde des cravates blanches et des habits noirs, il avait rencontré toute la hideuse famille des vices humains, mais ils étaient du moins correctement vêtus, parlaient le beau langage promulgué par décrets académiques, et n'agissaient point une seule fois sans consulter le code des convenances. Il avait souvent, dans un salon, serré avec joie la main droite d'un homme qui le trahissait de la main gauche, mais cette main était irréprochablement gantée. Souvent il avait cru au sourire de ces trahisons vivantes qu'on appelle des femmes; il s'était laissé émouvoir par les solo de sensibilité qu'elles exécutent en public après les avoir longuement étudiés, comme on fait d'une sonate de piano ou d'un air d'opéra, et il avait été dupe; mais, du moins, ces femmes qui le trompaient étaient vêtues de soie et de velours; les perles et les diamants, arrachés au mystérieux écrin de la nature, luttaient de feux et d'éclairs avec les flammes de leurs regards et resplendissaient sur leur front comme une constellation d'étoiles terrestres. Ces femmes étaient les reines du monde; elles portaient des noms qui avaient eu déjà l'apothéose de l'histoire, et quand elles traversaient un bal, laissant derrière elles un sillage de parfums et de grâces, tous les hommes faisaient sur leur passage une haie d'admirations génuflexes.
—Ulric ne tarda pas à se convaincre que les mœurs de l'atelier ne valaient pas mieux que celles du salon.
En venant pour la première fois à son travail, l'apparence chétive de sa personne, la pâleur distinguée de son visage, la blancheur de ses mains, jusque-là restées oisives, lui valurent, de la part de ses nouveaux compagnons, un accueil plein d'ironie et d'insultes. Résigné d'abord aux humbles fonctions d'apprenti, Ulric subit patiemment sans y répondre toutes les oppressions et toutes les injures dont on l'accablait à cause de sa faiblesse apparente, à cause de sa façon de parler, qui n'avait rien de commun avec le vocabulaire du cabaret. Plus tard, lorsque la pratique de son état eut développé sa force, quand la rouille du travail eut rendu ses mains calleuses et bruni son visage empreint d'un cachet de mâle virilité, ceux qui, en d'autres temps, avaient abusé de leur force pour l'opprimer, changèrent subitement de langage et de manières avec lui dès qu'ils s'aperçurent que son bras frêle soulevait les plus lourds fardeaux aussi facilement que le souffle d'orage enlève une plume du sol.
Au bout d'un an de séjour dans l'atelier, Ulric, dont l'intelligence avait été remarquée par ses chefs, fut nommé contremaître. Cette nomination excita parmi tous ses compagnons un concert de récriminations honteuses et jalouses, et le jour où Ulric se présenta pour la première fois à l'atelier avec son nouveau titre, la conspiration éclata d'une façon assez menaçante pour nécessiter l'intervention des chefs.
—Qu'y a-t-il? demanda l'un d'eux en s'avançant au milieu des ouvriers en révolte.
—Il y a, dit un des ouvriers, que nous ne voulons pas de monsieur pour contremaître, et il désignait Ulric.
—Pourquoi n'en voulez-vous pas? dit le patron.
—Parce que c'est humiliant pour nous d'être commandés par quelqu'un qui, il y a un an, était encore notre apprenti.
—Eh bien, répondit le maître, qu'est-ce que cela prouve?
—Ça prouve, continua l'ouvrier, qui commençait à balbutier, ça prouve que nous sommes tous égaux et qu'on ne doit pas faire d'injustice. Il y a des gens qui travaillent depuis dix ans dans la maison, et ça les vexe de voir entrer un étranger comme ça tout de go dans la première bonne place qui se trouve vacante.
—Oui, c'est injuste! murmurèrent tous les ouvriers, comme pour encourager l'orateur qui discutait leurs intérêts.
—À bas Marc Gilbert! s'écrièrent quelques voix, à bas le monsieur!
—D'ailleurs, continua l'ouvrier qui avait déjà parlé, pourquoi avez-vous renvoyé Pierre? C'était un brave homme... qui faisait vivre sa femme et ses enfants avec sa place.
—Silence! dit le maître d'une voix impérative, et qu'on n'ajoute plus un mot. Je n'ai pas de compte à vous rendre, et je fais ce que je veux. Si Pierre a perdu sa place, il est d'autant plus coupable de s'être exposé à la perdre qu'il a une femme et des enfants. Pierre était un paresseux qui encourageait la paresse; c'était un brave homme pour vous, un bon enfant, et vous le regrettez parce qu'il vous comptait des heures de travail que vous passiez au cabaret. Pour moi, Pierre était un voleur....
Un murmure, aussitôt comprimé par un geste du maître, s'éleva parmi les ouvriers.
—J'ai dit un voleur, et je le répète, et tous ceux qui reçoivent de l'argent qu'ils n'ont pas gagné sont de malhonnêtes gens. Pierre a abusé de ma confiance; pourtant j'ai été patient, j'ai eu égard à sa position de père de famille.
Mais plus j'étais indulgent, et plus il s'est montré incorrigible. À mon tour, j'eusse été coupable envers mes associés en conservant chez moi un homme qui compromettait leurs intérêts. L'honnêteté est dans le devoir; j'ai fait le mien, donc j'ai été juste en renvoyant Pierre, et juste encore en le remplaçant par un homme honnête, laborieux, intelligent. Est-ce ma faute si, parmi tous les ouvriers qui travaillent ici depuis dix ans, je n'en ai pas trouvé un réunissant les qualités et les capacités nécessaires pour remplir l'emploi vacant? Est-ce ma faute si c'est justement l'apprenti à qui tout l'atelier commandait il y a un an qui se trouve être le seul aujourd'hui digne de commander à tout l'atelier? Vous parliez d'égalité tout à l'heure; eh bien, non, vous tous qui parlez, vous n'êtes pas les égaux de Marc Gilbert. Vous n'êtes pas égaux les uns aux autres, puisqu'il y en a parmi vous dont le salaire est différent, et ceux-là qui vous prêchent cette égalité sont des fous; et vous savez bien vous-mêmes, quand vous venez recevoir votre paye, que celui qui travaille le plus et le mieux doit être payé davantage que ceux dont le travail et l'habileté sont moindres.
Ainsi donc, à compter d'aujourd'hui, Marc Gilbert est votre contremaître. C'est un autre moi-même, et j'entends qu'on le respecte et qu'on lui obéisse comme à moi-même. Et maintenant, ceux qui ne sont pas contents peuvent s'en aller.
Pendant ce discours, tous les ouvriers étaient silencieusement retournés à leur travail.
—Cet homme est juste, pensa Ulric en regardant son patron.
—Monsieur Marc Gilbert, lui dit celui-ci, il y a un an vous êtes entré dans la maison en qualité d'apprenti; aujourd'hui, après moi, vous allez y occuper la première place. Ce n'est pas une faveur que je vous accorde, comme je le disais tout à l'heure, c'est une justice. J'espère que vous êtes content, et qu'en une année vous aurez fait du chemin. Seulement, comme vous êtes un peu jeune, et que vous n'auriez pas peut-être toute l'expérience nécessaire, nous ne vous donnerons d'abord que les deux tiers des appointements que nous donnions à votre prédécesseur. Néanmoins la part est encore belle, avouez-le.
Ulric resta profondément étonné par cette contradiction.
—Singulière justice, murmura-t-il quand il fut seul. On remplace un homme paresseux, sans intelligence et sans probité, par un homme qu'on sait être intelligent, probe et dévoué, et sans tenir compte du bénéfice que sa gestion loyale procurera à la maison, on paye l'honnête homme moins cher qu'on ne payait le voleur!
Au bout de huit jours, les nouvelles fonctions et l'autorité dont elles investissaient Ulric lui avaient attiré déjà une foule de courtisans, et ceux-là qui se montraient les plus humbles et les plus empressés autour de lui étaient les mêmes qui jadis s'étaient montrés les plus durs et les moins indulgents à son égard, les mêmes qui s'étaient le plus ouvertement déclarés hostiles à sa nomination. Il expérimenta alors sur le vif ces nobles qualités qui, disait-il autrefois, devaient croître dans les sillons arrosés par les sueurs du travail, et son cœur s'emplit d'un nouveau dégoût en voyant ces hommes qui, devant être pourtant liés par une commune solidarité, essayaient de se nuire les uns aux autres en venant dénoncer les infractions qui se commettaient dans l'atelier, espérant sans doute qu'Ulric leur payerait, en tolérant les leurs, la dénonciation des fautes commises par ceux de leurs compagnons dont ils se faisaient les espions.
—Ô fraternité! murmurait Ulric, fantôme chimérique, mot sonore qu'on fait retentir comme un tocsin pour ameuter les révoltes. On peut facilement t'inscrire sur les étendards et sur le fronton des monuments; mais les siècles futurs ajoutés aux siècles passés auront bien de la peine à te graver dans le cœur de l'homme.
Ainsi donc, dans les classes inférieures de la société, dans le monde des blouses, Ulric avait retrouvé la même corruption, le même esprit de mensonge, la même fureur d'oppression du fort contre le faible. Là, comme ailleurs, tous les vices régnaient sous la présidence de l'égoïsme, maître souverain; tous les nobles instincts étaient crucifiés sur les croix de l'intérêt; là aussi, toute vertu avait son Judas et son Pilate. Là aussi, comme ailleurs et plus qu'ailleurs, Ulric put se convaincre par sa propre expérience que l'ingratitude, celle qui de toutes les plantes humaines a le moins besoin de culture, croissait en plein cœur.
En haut, il avait trouvé le mal hypocrite, rusé, mais intelligent et presque séducteur.
En bas, il le trouva de même, mais cynique, brutal, et presque repoussant.
Un soir Ulric était seul dans sa chambre; plongé dans une misanthropie qui devenait chaque jour plus aiguë, la tête posée entre ses mains, ses yeux erraient machinalement sur un livre ouvert qui se trouvait sur une table: c'était l'Émile de Rousseau, et un signe marginal semblait annoter ce passage:
«Il faut être heureux! c'est la fin de tout être sensible; c'est le premier désir que nous imprima la nature et le seul qui ne nous quitte jamais. Mais où est le bonheur? Chacun le cherche et nul ne le trouve; on use sa vie à le poursuivre et on meurt sans l'avoir atteint.»
Pour la millième fois au moins Ulric faisait en réflexion le tour de cette phrase, dont la conclusion est si désespérée, lorsque des cris perçants qui retentissaient au dehors vinrent brusquement l'arracher à sa rêverie.
Ulric courut à sa fenêtre.
Des cris: au secours! Au secours! continuaient plus pressés et plus inquiets. Ils paraissaient sortir d'une croisée faisant face au corps de logis habité par Ulric, qui reconnut la voix d'une femme.
Il descendit en toute hâte l'escalier, et en quelques secondes il était arrivé sur le palier de l'étage supérieur, où les cris avaient atteint le diapason de l'épouvante.
—Qu'y a-t-il donc? demanda Ulric à quelques voisins assemblés sur le carré.
—Ah! dit une commère avec un accent de fausse pitié, c'est la mère Durand qui vient de trépasser, et c'est sa petite qui crie. Que c'est un enfer dans la maison depuis quinze jours, que la vieille tousse son âme par petits morceaux du matin au soir; qu'on ne peut pas fermer l'œil; que c'est bien malheureux pour de pauvres gens qui ont si besoin de repos; que la vieille n'a pas voulu aller à l'hôpital, qu'elle était trop fière; qu'elle a mieux aimé voir sa pauvre enfant s'abîmer le tempérament à la veiller; qu'elle lui disait encore des sottises par-dessus le marché; qu'enfin nous en voilà débarrassée, et que nous allons pouvoir dormir.
Ce speach avait été prononcé d'un seul trait par une horrible femme, dont la figure ignoble et la voix enrouée étaient ravagées par l'ivrognerie.
Ulric entra dans la chambre, où les sanglots avaient succédé aux cris. C'était un taudis sinistre, désolé, obscur, humide, et dont l'atmosphère étreignait la gorge. Dans un coin, sur un grabat mal caché par de misérables loques servant de rideaux, était étendue la morte, cadavre jaune et long, dont les membres roidis paraissaient encore lutter contre les attaques de l'agonie, et dont la bouche horriblement ouverte semblait vomir des blasphèmes posthumes.
Au pied du lit, tenant dans ses mains une des mains de la trépassée, une jeune fille en désordre était accroupie dans l'abrutissement de la douleur et du désespoir. Une femme du voisinage essayait de lui donner de banales consolations. À l'entrée d'Ulric la jeune fille avait à peine levé la tête, et était aussitôt retombée dans son insensibilité.
—Madame, dit Ulric à la voisine, vous devriez emmener cette jeune fille de cette chambre, ce spectacle la tue.
—C'est ce que je lui disais, mon cher monsieur, mais elle ne m'entend pas.
—Il faudrait pourtant prendre auprès d'elle quelques informations, dit Ulric, pour savoir le nom de ses parents, de ses amis, afin de les avertir.
—Ah! la pauvre fille! je la crois bien abandonnée, répondit la voisine en essayant de faire revenir l'orpheline au sentiment de la réalité.
Enfin elle rouvrit les yeux, qu'elle baissa aussitôt en apercevant un étranger, et murmura quelques paroles confuses. Puis les sanglots la reprirent, et elle tomba de nouveau à genoux au pied du lit.
—Allons, ma petite, dit la voisine, ne vous désolez donc pas comme ça! à quoi que ça sert? Nous sommes tous mortels, d'ailleurs; et puis, après tout, c'est un bien pour un mal. Elle n'était pas bonne, la défunte; méchante, hargneuse et dépensière; on ne pouvait pas la souffrir dans la maison, d'abord: demandez un peu aux voisins, vous verrez ce qu'ils vous diront.
—Madame!... dit Ulric en jetant à la voisine un regard sévère.
—Eh! c'est la vérité du bon Dieu, ce que je dis là, reprit-elle. Vous ne vous figurez pas, mon cher monsieur, quelle méchante créature c'était que la mère Durand, et combien elle a fait souffrir la pauvre Rosette, qui est bien un véritable ange de patience; qu'elle la battait comme plâtre, et lui prenait tout l'argent qu'elle gagnait pour aller boire toute seule des liqueurs qui l'ont conduite insensiblement au tombeau; que le médecin l'avait bien dit, là! Aussi, moi je dis que ça ne vaut pas la peine de tant se chagriner, et que c'est un bon débarras, comme dit cet autre....
—Silence! madame! s'écria Ulric indigné de pareils propos. Dans un tel moment, devant ce lit, c'est odieux.
Et comme la voisine continuait, Ulric, ne pouvant davantage contenir sa colère, la prit par le bras et la mit dehors.
Peu à peu Rosette sortit de son abattement, et lorsque, revenue presque entièrement à elle, elle aperçut un jeune homme dans cette chambre où elle se croyait seule, elle ne put retenir un cri d'étonnement.
—Pardonnez-moi, mademoiselle, dit Ulric très doucement, si j'ai pris la liberté d'entrer chez vous....
—Je... ne... vous connais pas... je ne sais, monsieur... répondit la jeune fille en balbutiant.
—Tout à l'heure, reprit Ulric, j'ai entendu appeler au secours, et je suis monté; voilà comment vous me trouvez ici. Veuillez m'excuser si j'ai pris la liberté de rester; dans les circonstances douloureuses où vous vous trouvez, et vous voyant seule, j'ai cru devoir rester pour me mettre à votre disposition....
—Merci, monsieur, dit Rosette. Je....
—La mort de votre mère nécessite des démarches à faire; il y a une foule de détails dont vous ne pouvez vous occuper vous-même. Il faut prévenir vos parents, vos amis, pour qu'ils viennent vous assister.... Toutes ces courses, je les ferai. Ce sont là de légers services qui se proposent et qui s'acceptent entre voisins, car je suis le vôtre; je m'appelle Marc Gilbert; je suis ouvrier et je travaille dans la fabrique de M. Vincent....
—Je n'ai ni parents ni amis; je n'avais que ma mère. Ah! Mon Dieu! Comment faire? Qu'est-ce que je vais devenir? s'écria Rosette en pleurant.
Ce cri, qui révélait un abandon et une misère si profonds, émut Ulric.
—S'il en est ainsi, mademoiselle, dit-il à Rosette, par amour même pour votre mère, vous devriez accepter mes propositions, et me laisser le soin de veiller aux tristes devoirs qu'il reste à accomplir.
Après une longue hésitation, Rosette se laissa convaincre et accepta les offres de service que lui faisait Ulric.
Le lendemain un modeste corbillard emmenait à l'église le corps de la mère Durand, et de là au cimetière, où Ulric avait acquis une fosse particulière pour que l'orpheline pût y agenouiller son souvenir filial.
Deux jours après l'enterrement de sa mère, Rosette vint chez Ulric pour le remercier de ce qu'il avait fait pour elle. Elle exprima sa reconnaissance avec une franchise et une sincérité telles qu'Ulric resta encore plus ému après cette seconde entrevue qu'il ne l'avait été lors de sa première rencontre avec la jeune fille.
Quelque temps après, comme il rentrait chez lui le soir, son portier lui remit une lettre. Ulric, inquiet de savoir qui pouvait lui écrire, courut d'abord à la signature: il y trouva celle de Rosette. La lettre contenait ces mots:
«Monsieur Marc, «Excusez-moi si je prends la liberté de vous écrire; c'est que j'ai de mauvaises nouvelles à vous apprendre, et je ne puis pas aller chez vous pour vous les dire. Il y a des méchantes gens dans la maison, et on dit de vilaines choses sur nous deux à cause du service que vous m'avez rendu. J'ai beaucoup de chagrin, et je voudrais vous voir un moment. Ce soir, en revenant de mon ouvrage, je passerai par la grande allée du jardin des plantes. «Votre servante bien reconnaissante, «Rosette Durand.»
Ulric courut au rendez-vous que lui donnait l'orpheline. Elle venait seulement d'arriver. Sans parler, elle prit le bras d'Ulric, et le jeune homme s'aperçut que son cœur battait avec violence. Son visage était pâle, fatigué, et laissait voir des traces d'une rosée de larmes. Il la conduisit dans une allée peu fréquentée, et la fit asseoir auprès de lui sur un banc désert.
—Qu'est-il arrivé, Rosette? demanda Ulric.
—Ne l'avez-vous pas deviné en lisant ma lettre? répondit la jeune fille en baissant les yeux. Oh! c'est horrible, ce qu'on a dit! ajouta-t-elle précipitamment, et une rougeur d'indignation empourpra son visage.
—Et bien, dit Ulric, qu'a-t-on pu dire? que j'étais votre amant, n'est-ce pas?
—Si on n'avait dit que cela, je ne souffrirais pas tant, continua Rosette,—car ce serait seulement ma vertu qu'on attaquerait;—mais c'est plus horrible. On a dit que nous avions joué tous les deux une comédie, le jour même où ma mère est morte. Ce service que vous m'avez si généreusement rendu sans me connaître, on a dit que c'était une spéculation, un marché... conclu et payé... devant le corps de ma mère....
—C'est odieux! On a dit cela? fit Ulric.
—Et depuis quelques jours tout le monde le répète dans la maison, dit Rosette.
—Eh bien, ma pauvre enfant, que voulez-vous y faire? Ce que vous m'apprenez ne m'étonne pas. Je comprends que vous vous soyez indignée de cette monstrueuse calomnie; mais, à vrai dire, j'eusse été surpris davantage si elle n'avait pas été faite. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre qu'on fasse le bien seulement pour le bien; nous avons affaire à ces gens-là, et quoi que nous disions, quoi que nous fassions, l'honnêteté de nos relations sera toujours criminelle à leurs yeux.
En ce moment une ombre passa rapidement devant le banc sur lequel ils étaient assis, et une voix leur jeta ces mots en passant: Bonsoir, les amoureux!
Rosette tressaillit et se serra auprès d'Ulric.
Tous deux venaient de reconnaître la voix d'une de leurs voisines.